Paris Break de Pauline SLF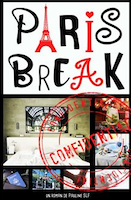
Liens d'achat :
Amazon FnacÇa faisait une éternité que je n’avais pas pris le train. Je devais me rendre à une formation à Paris, pendant trois jours. D’habitude, je n’allais jamais à ce genre de chose. Au fil des années, j’étais devenue adepte des programmes en ligne, du « e-learning » ou « non-présentiel », comme on dit. C’était beaucoup plus simple, par rapport aux enfants. S’absenter trois jours pleins de la maison, à cheval sur un week-end, quand on a des enfants en bas âges et un mari qui aurait bien du mal à se pointer à la crèche ou à la garderie avant l’heure de fermeture, ça m’avait toujours semblé être une situation… à éviter. Alors, qu’est-ce qui avait changé ? Tout d’abord, les enfants ont grandi. Plus besoin d’aller les chercher, ils rentrent seuls. Plus besoin de les aider à faire leurs devoirs, ils gèrent. Plus besoin de les emmener à leurs activités, ils y vont à vélo. Plus besoin d’organiser des après-midis de jeux avec les parents des copains-copines, maintenant nos « bouts de choux » s’envoient des textos pour fixer leurs lieux et heures de rendez-vous eux-mêmes. En fait, à présent, ils avaient juste besoin qu’on leur prépare à manger midi et soir. Et ça, mon mari gérait comme un roi. Donc, l’idée de disparaître pendant trois jours n’avait plus du tout l’air d’un projet égoïste et culpabilisant, d’une sorte d’abandon du domicile familial, laissant mon conjoint seul aux manettes d’un vaisseau infernal que nous avions l’habitude de conduire à deux, dans un partage parfait des différentes tâches… même si, franchement, je ne me serais pas gênée pour le faire si j’en avais ressenti le besoin. En fait, après quinze ans de vie commune, je crois que c’était tout simplement la première fois que j’en ressentais le besoin. Une fois en quinze ans, ce n’est pas si mal, quand on y pense. C’est bien la preuve que je suis heureuse, même si je n’en ai pas toujours conscience. Du moins, à ce moment-là, je n’en avais pas réellement conscience.
Donc voilà, les enfants avaient bien grandi et n’avaient plus autant besoin de moi en tant que co-responsable logistique du foyer. Mais ce n’était pas tout. Oh non. L’autonomie croissante des enfants n’était que le petit plus qui m’avait confortée dans cette démarche de formation. À vrai dire, leur père et moi traversions une période difficile, depuis près de deux ans. Un grand classique dans tous les couples qui durent, je sais. Mais nous peinions à surmonter nos problèmes. On n’arrivait même plus à trouver le courage de faire des efforts. J’en avais eu la preuve pendant nos vacances d’été. Comme tous les ans, nous étions partis trois semaines en vadrouille avec les enfants. Nous aimions alterner les visites culturelles, les activités sportives et les moments de farniente, tout en découvrant de nouveaux pays, de nouvelles régions. Comme tous les ans, nous étions revenus ravis de nos vacances. Mais sur le chemin du retour, alors que nos trois pré-ados dormaient à l’arrière, j’avais fait un constat assez sinistre. Nous roulions depuis des heures, en conduisant chacun notre tour. Et nous ne nous étions pas adressé la parole depuis notre départ, le matin-même. J’avais alors réalisé que durant ces trois semaines de vacances, à chaque fois que nous nous étions retrouvés seuls, nous n’avions jamais décroché un mot. Ni lui, ni moi. En présence des enfants, nous devions très certainement avoir l’air d’un couple normal, car nous nous efforcions de ne rien laisser paraître. On était des parents au top. On jouait notre rôle à merveille. La machine était bien rodée. Mais le soir venu, dans notre lit, on bouquinait en silence, ou pianotait sur nos téléphones, jusqu’à ce que chacun éteigne sa lampe de chevet, de façon plus ou moins décalée dans le temps. On avait même perdu l’habitude de se dire simplement « bonne nuit » dès que l’autre éteignait sa lampe. Bref. Pas un mot pendant trois semaines. Pas un contact. Pas une caresse. Je ne me souvenais pas vraiment de notre dernier gros câlin. Je me rendais compte qu’on ne s’embrassait même plus. Pas même un petit bisou machinal le matin. Rien. Et ça ne me manquait pas.
Une fois rentrés chez nous, dans notre duplex avignonnais, j’avais profité des quelques jours qui nous restaient avant de reprendre le boulot pour faire un bilan de la situation, de mon point de vue à moi. J’étais assise dans la salle à manger, occupée à commander les courses sur l’application de notre supermarché de quartier, accompagnée d’une chaleureuse tasse de thé vert. J’observais mon mari pendant qu’il cuisinait, son bassin collé à l’îlot central, sa tête penchée vers sa cagette de légumes frais, son regard figé sur la planche à découper, totalement absorbé par cette aubergine qu’il taillait en fines lamelles. Je l’observais, en silence, pendant de longues minutes. Je ne ressentais pas d’envie, pas de désir, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais je ne ressentais pas de choses négatives pour autant. En fait, je ne ressentais plus rien. Je n’avais pas envie de lui parler, pas envie de l’embrasser, pas envie d’être avec lui. Mais je n’éprouvais pas non plus l’envie irrésistible de lui hurler dessus, le couvrir de reproches, lui envoyer ses lamelles d’aubergine à la figure et lui demander de partir. Sa présence ne suscitait plus rien chez moi, mais elle ne m’indisposait pas pour autant. J’avais donc bien du mal à savoir ce que je voulais, ou ce qui serait le mieux pour nous deux. J’étais complètement paumée. Et le pire, c’était qu’à force de ne plus se parler, à part pour des banalités, je n’arrivais même plus à me motiver pour me lancer avec lui dans une conversation pourtant bien nécessaire. Visiblement, lui non plus. C’est ce qu’on appelle un cercle vicieux, non ? Et pourtant, j’étais là. La veille de notre reprise du travail, alors que nos enfants avaient encore quelques jours de vacances avant la rentrée scolaire, j’avais pris l’initiative de jeter un œil à mes mails professionnels, histoire de ne pas y passer deux heures le lendemain matin et de trier d’ores et déjà le « urgent » du « peut attendre ». Parmi la centaine de mails à traiter, j’étais alors tombée sur une proposition de formation à Paris, dont la première session de l’année avait lieu quelques jours plus tard. Mon premier réflexe fut de supprimer le message, sans même l’avoir lu. Après avoir fait le tour des mails, je traînai quelques instants sur mon réseau social préféré. J’étais abonnée à un compte qui publiait des proverbes et citations tous les jours. En faisant défiler la page d’accueil du bout de mon index, je tombai sur la dernière publication de ce compte. C’était une phrase en anglais dont la traduction littérale voulait dire « J’ai juste besoin de m’éloigner pour me souvenir pourquoi je reste. ». Et là, en une fraction de seconde, un feu d’artifice éclata dans ma petite tête. Partir, n’était-ce effectivement pas la meilleure façon de comprendre pourquoi on reste ? J’avais immédiatement pensé au mail que j’avais supprimé. Celui sur la proposition de formation en présentiel. Trois jours à Paris, toute seule, dans un contexte professionnel, n’était-ce pas exactement ce qu’il me fallait ? N’était-ce pas une façon toute simple de faire le point ? De savoir si mon mari, avec qui je vivais depuis près de quinze ans, allait me manquer ? Et réciproquement, mon absence serait-elle pour lui la confirmation que ma présence ne comptait plus du tout, et qu’il était temps de s’interroger sérieusement sur l’avenir de notre couple ? Ou serait-ce au contraire le déclic dont il avait besoin pour se rendre compte que non, il n’envisageait pas une seule seconde de vivre sans moi ? J’avais immédiatement récupéré le mail dans la corbeille et l’avais ouvert pour le lire avec attention. Dans ma profession, nous avions une obligation de formation annuelle, les logiciels sur lesquels nous travaillions étant en constante évolution. Les trois jours de stage à Paris concernaient l’apprentissage d’une nouvelle fonction sur un logiciel que j’utilisais très peu. Dans un autre contexte, je ne me serais jamais inscrite. Mais là, j’avais juste besoin d’un prétexte. Un prétexte bien crédible pour m’accorder trois jours de réflexion en solitaire, loin du foyer familial et de mes enfants qui, soyons honnêtes, étaient sans le vouloir une merveilleuse diversion permettant à leurs parents d’éviter de se retrouver face à leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Trois jours rien qu’à moi, pour faire le point, pour me poser les bonnes questions, tout en satisfaisant ma conscience professionnelle et mon obligation de formation annuelle. En plus, je serais revenue quatre jours avant la rentrée scolaire, ce qui me laisserait le temps de m’occuper des derniers petits préparatifs, s’il en restait. C’était décidé. J’allais le faire.
Le lendemain matin, avant-dernier lundi du mois d’août, dès mon arrivée au boulot, j’avais envoyé un mail à mon chef pour lui demander de m’inscrire à cette formation. Très surpris, il s’était pointé illico dans mon bureau, me demandant si j’étais certaine de vouloir partir trois jours alors que je revenais tout juste de vacances, tout ça pour suivre une formation qui ne présentait pas un immense intérêt pour ma carrière. Eh bien oui, c’était ce que je voulais. Le long soupir qu’il avait poussé me laissait entendre que j’étais en train de passer pour une cinglée, doublée d’une enquiquineuse. Bah tant pis. J’avais su me montrer à peu près convaincante, et avais conclu les négociations par ce qui s’avérait être un énorme mensonge, à savoir que j’avais toujours rêvé de faire cette formation car je souhaitais vraiment développer mes compétences en matière d’animation vidéo. Mon chef m’avait lancé un regard étrange. En même temps, tout était étrange dans ce que je venais de dire. Depuis dix ans que je bossais pour cette boîte, il me connaissait bien. Et là, rien ne me ressemblait. Mais il n’avait aucune raison valable de me refuser cette formation. Alors il avait accepté, après m’avoir gentiment rappelé que dès mon retour, on attendait mes propositions d’illustrations pour les affiches du festival de jazz du printemps prochain. Victoire. Dans l’heure suivante, j’avais reçu la confirmation de l’organisme chargé du stage, ainsi qu’un mail de la secrétaire de direction me donnant les références de réservation pour mes billets de train et mes deux nuits d’hôtel, le tout aux frais de la boîte. Impeccable.
Le soir-même, j’avais profité du dîner pour annoncer officiellement mon projet. Entre deux débats opposant mes filles à mon fils à propos des dernières séries télé disponibles sur notre service de vidéos à la demande favori, j’avais pris mon courage à deux mains et m’étais lancée. Voilà. C’était une grande première, mais Maman allait partir jeudi matin de très bonne heure, et reviendrait samedi soir. Pourquoi donc ? Parce que Maman avait l’opportunité de suivre une formation très intéressante qui serait du meilleur effet sur son C.V si un jour elle décidait d’évoluer professionnellement, ou si elle voulait carrément changer de boîte. Où partait Maman ? À Paris, pendant trois jours. Comment partait Maman ? En train. Où allait dormir Maman ? Dans un petit hôtel. Comme je me l’étais imaginé, mes trois pré-ados s’étaient contentés d’un « ok » et avaient immédiatement repris leur conversation télévisuelle. Mon mari, lui, m’avait regardée droit dans les yeux de façon franche et intense, pour la première fois depuis deux ans. Il m’avait interrogée sur le programme de la formation, et j’avais avancé exactement les mêmes arguments qu’avec mon chef. Après quelques échanges sur les conséquences logistiques de mon absence et le passage en revue des petites choses qu’il aurait à manager seul pour la première fois depuis la naissance de nos aînées, il avait imité ses enfants en concluant la conversation d’un « ok » qui suintait l’indifférence. En réalité, il n’était pas si indifférent. Au moment du coucher, quand nous nous étions retrouvés seuls dans notre chambre, au lieu du traditionnel silence, il m’avait posé quelques questions anodines sur mon séjour parisien de dernière minute. Et j’en avais assez vite conclu qu’il croyait moyennement à mon histoire de formation qui sortait de nulle part. Mine de rien, il était la personne qui me connaissait le mieux au monde. Vu l’état de notre couple, il s’était peut-être imaginé que j’allais rejoindre un amant, ou une amie à qui je confirais mon mal-être et qui me pousserait à demander le divorce. J’aurais pu le laisser cogiter, le laisser dans le flou, s’imaginer des trucs, en espérant que ça le pousse lui aussi à faire le point. Mais non. Je détestais qu’on me soupçonne, et lui avais donc montré les preuves que toute cette histoire était vraie : la confirmation d’inscription venant de l’organisme de formation, mes billets de train aller-retour et ma réservation d’hôtel. N’ayant plus aucune raison de me questionner, il s’était alors tourné dos à moi et avait éteint sa lampe de chevet, sans me souhaiter bonne nuit. J’avais attendu quelques secondes, me disant que c’était peut-être l’occasion de discuter avec franchise. J’avais hésité à lui dire clairement que je partais à Paris pour faire le point sur nous, histoire de provoquer chez lui une sorte d’électrochoc, une quelconque réaction. Alors qu’il me tournait le dos et cherchait le sommeil, je lui avais lancé un très pacifique « Peut-être que ça serait bien qu’on parle, non ? » auquel il m’avait vaguement répondu « Bah tu veux qu’on parle de quoi à cette heure-ci ? », preuve qu’il ne ressentait ni ne voyait la nécessité d’avoir une conversation de couple face à la dégradation progressive et inéluctable de nos rapports. À croire que ça ne l’inquiétait pas, ne le perturbait pas, ne le rendait pas malheureux. À ce moment-là, j’avais eu la certitude que cette escapade de trois jours nous ferait le plus grand bien. Mais trois jours, était-ce vraiment suffisant pour prendre tout le recul dont nous avions besoin ? Pas sûr.
Le mercredi soir, après le dîner, j’étais montée dans ma chambre pour préparer mes bagages, pendant que mes enfants et mon mari jouaient ensemble à un jeu vidéo auquel je perdais tout le temps. J’emportais tout d’abord le bagage à main professionnel contenant mon ordinateur portable équipé de tous mes logiciels de boulot, et ma tablette graphique dernier cri. Dans la petite valise à roulette assortie sur laquelle le bagage à main se fixait de manière très astucieuse, j’avais mis trois tenues estivales qui me permettraient d’avoir le choix et de m’adapter à la météo qui s’annonçait encore très chaude, mais qui pouvait très bien changer en cours de route. Ça me permettrait aussi de m’adapter à la température de la salle de formation, car rien ne stipulait que celle-ci serait climatisée. J’avais pris du classique, décontracté et léger. Une paire de sandales de rechange, des sous-vêtements, ma trousse de toilette, de quoi m’attacher les cheveux, ma petite trousse à maquillage, et un bouquin que j’avais commencé pendant les vacances et que je peinais à finir. Pendant que je bouclais ma valise, mon mari entra dans la chambre pour prendre son chargeur de portable dans sa table de chevet. Je levai les yeux vers lui, pour voir si j’arrivais à capter son regard. Encore une fois, je pensais que peut-être, le fait de me voir préparer mes bagages provoquerait quelque chose chez lui. Une réaction, une émotion… quelque chose. Mais rien. Toujours rien. J’avais envie de lui dire un truc du genre « Tu as vu ? Tu as vu ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de préparer ma valise ! Je suis en train de me barrer ! Tu le vois, ça ? Tu le vois

». Mais bien évidemment, rien ne sortit de ma bouche. Il avait quitté la pièce sans un mot, sans un regard. À ce moment-là, je n’avais plus eu qu’une seule envie : mettre mon pyjama, me coucher, et m’endormir le plus vite possible pour que le matin arrive. J’étais allée embrasser mes enfants avant de filer sous la couette, leur rappelant que je comptais sur eux pour bien se comporter pendant mon absence, histoire qu’à mon retour je ne retrouve pas un mari épuisé qui me supplierait de ne plus jamais le laisser trois jours seuls avec nos pré-ados. J’avais même poussé le vice jusqu’à leur dire que mon absence était une merveilleuse occasion pour eux de passer des moments privilégiés avec leur père et qu’il fallait en profiter. En réalité, mon mari était déjà un père formidable qui prenait le temps d’avoir des petits moments de complicité avec chacun de nos enfants, et ce depuis leur naissance. Donc, ma remarque était carrément déplacée et superflue. Mais tant pis. Sur le coup, ça m’avait donné l’impression de dire quelque chose de bien. Je m’étais couchée seule, fatiguée de ma journée de travail mais surexcitée à l’idée de partir seule à Paris, avec la musique du jeu vidéo sur lequel ma petite famille continuait de s’éclater à l’étage du dessous, en guise de berceuse. Voilà. Allez, bonne nuit tout le monde.
Nous étions donc jeudi matin. Je m’étais levée à 6H15, avais fait le moins de bruit possible en me préparant, et quittai l’appartement en ayant une drôle de sensation. Quelque chose d’assez inexplicable. Nous vivions à vingt minutes à pied de la gare d’Avignon-TGV. Pendant que je marchais dans les rues désertes, et que ma valise à roulettes semblait faire le même bruit qu’un avion au décollage tant la ville était silencieuse, j’essayais d’identifier cette sensation. C’était comme si, au fond de moi, quelque chose me disait qu’un mécanisme s’était déclenché, et que rien ne pourrait l’arrêter. Comme si ces trois jours loin de mon foyer allaient me transformer, et que je reviendrais samedi soir en n’étant plus vraiment la même personne. Je pensai à mon couple, à mon mari, à notre histoire qui avait pourtant si bien commencé. On s’était rencontrés à l’anniversaire d’une de mes copines de promo. À l’époque, j’étais en troisième année d’études, et lui en plein master 2 de biochimie et biologie moléculaire. Il était ami avec le frère de cette fameuse copine. Lorsque l’on me l’avait présenté, ce soir-là, je l’avais trouvé sympa, et mignon, mais sans plus. J’étais venue avant tout pour m’amuser et danser avec mes copines, pas pour me faire draguer. Mais j’avais quand même discuté avec lui, et nous avions échangé nos numéros de portable, sans grande conviction. On s’était revus une semaine plus tard, autour d’un verre en terrasse, avec le prétexte de devoir rejoindre ma copine et son frère pour voir un film au ciné. On avait discuté de tout un tas de choses. Mais ce qui nous avait rapprochés, au point de ne pas voir l’heure passer et de louper la séance, c’était de découvrir que nous avions pour point commun de sortir chacun d’une relation sérieuse qui s’était mal terminée. Comme moi, il avait vécu avec quelqu’un pendant plusieurs mois avant de retourner en colocation. Comme moi, il était à l’origine de la rupture. Comme moi, il avait énormément souffert de mettre fin à une relation qui avait duré plusieurs années et gérait mal le poids de la culpabilité. Comme moi, il venait de faire une croix sur un avenir amoureux qu’il pensait tout écrit, et devait à présent accepter l’idée que le chemin serait différent. Comme moi, il avait tellement aimé cette personne qu’il avait peur de ne plus jamais tomber amoureux avec la même intensité. On avait les mêmes craintes, les mêmes doutes. On se comprenait, lui et moi. Et quelque chose de fort était né de ça. On avait commencé à sortir ensemble, et on était très vite tombés amoureux. C’était grisant de constater que contrairement à ce qu’on s’était imaginé, nous vivions une histoire encore plus forte, encore plus belle, encore plus intense que n’importe quelle autre relation d’avant. Très vite, il m’avait proposé de vivre avec lui. Et notre cohabitation était une totale réussite. Tout me convenait. Moi qui ne croyait pas au concept d’âmes-sœurs, je devais avouer que ça y ressemblait beaucoup. On s’était mariés quelques mois après la fin de mes études. Un petit mariage civil tout simple, à notre image, entourés de nos amis et de la famille proche. On voulait des enfants rapidement. On ne voulait pas attendre. Au contraire. On voulait commencer par ça, et profiter de la vie après, avec eux. Je l’ignorais au moment de dire oui, mais je m’étais mariée enceinte de trois semaines. Les années qui suivirent furent parfaites. Vraiment parfaites. Nous avions chacun un boulot stable et épanouissant, nous vivions dans un superbe appartement, les enfants se portaient bien, nous avions des amis formidables que l’on voyait régulièrement, nous partions en vacances plusieurs fois par an. La grande force de notre couple, c’était notre compatibilité. On s’entendait à merveille, et avions tellement de points communs. Les sujets de discorde étaient rares, même très rares. On ne se disputait quasiment jamais. Et pourtant, on s’était éloignés, progressivement, au point de cordialement s’ignorer depuis deux ans. Qu’est-ce qui s’était passé ? La routine ? Les enfants ? Peut-être. Pourtant, je l’aimais, notre routine. J’aimais notre vie de famille, notre quotidien. Je n’imaginais pas ma vie autrement. Oui, les enfants sont chronophages. Mais j’avais toujours eu l’impression qu’au contraire, nos enfants nous avaient encore rapprochés davantage. Avec eux, nous étions bien plus qu’un couple d’adultes amoureux. Nous étions une paire de parents. Un duo de choc capable de faire face à n’importe quelle situation. C’était comme ça que je nous voyais. Etions-nous moins beaux, moins désirables qu’avant ? Sans doute. Mais je nous estimais encore jeunes et séduisants. En tout cas, moi, quand je me regardais dans le miroir, je ne me faisais pas horreur du tout. Je n’avais plus vingt ans, certes. Mais j’estimais être encore jolie. Et lui aussi, je le trouvais beau. Peut-être même encore plus beau que quinze ans plus tôt, car son visage gagnait en caractère. Etais-je devenue inintéressante ? Ennuyeuse ? Aucune idée. J’avais la prétention de penser que non. Et en même temps, étais-je vraiment la mieux placée pour répondre à cette question ? Peut-être que, sans m’en rendre compte, j’étais devenue fade, et terne. Je cogitais tellement que je ne vis pas le trajet passer. Nous y étions. Les horloges de la gare indiquaient 7H15, et je me trouvais sur le quai avec ma valise à roulettes à attendre le T.G.V qui me mènerait de la cité des papes à la capitale en deux heures et trente minutes. Il n’y avait pas grand monde autour de moi. Normal, à cette heure-ci, fin août, quand pas mal de gens sont encore en vacances, ou encore dans leur lit. On voyait déjà que ça allait être une belle journée. Le soleil était de la partie. Tout était si calme, si désert. À tel point que le jingle de la S.N.C.F et la voix dans le micro nous demandant de nous éloigner de la bordure du quai me firent sursauter. L’arrivée du train étant imminente, je jetai un œil à mes billets et découvris avec satisfaction que j’allais voyager en première classe. Sympa, le chef. En même temps, étant une experte du télétravail et des formations à distance, on ne pouvait pas dire que je lui avais coûté cher en transports et en hôtel depuis mon embauche. J’étais toute contente. Je n’avais pas pris le train depuis des années, alors que j’adorais ça. Et je ressentais encore quelque chose d’indescriptible. Mais pas comme la sensation que j’avais pendant que je marchais vers la gare. Là, en voyant le train qui arrivait au loin, c’était plutôt quelque chose qui me donnait l’impression qu’en fait, j’aurais dû m’autoriser ce genre d’escapade depuis bien longtemps. J’étais seule, avec ma valise, sur un quai de gare, comme quand j’étais étudiante. Un bond de presque vingt ans en arrière. C’était plus fort que moi, je ne pouvais pas m’empêcher d’être heureuse, comme jamais depuis de nombreux mois. Le train arriva. Apparemment, tout le monde se rendait à Paris, car personne n’en descendit. Une fois à bord, je fus surprise de voir qu’il n’était pas aussi vide que le quai. Les gens n’étaient donc pas tous en vacances ou au fond de leur lit. Toutes ces personnes s’étaient même levées bien plus tôt que moi, les pauvres. Depuis l’entrée du wagon, je constatai que toutes les places individuelles étaient occupées. J’étais donc forcément dans un carré de quatre personnes, à moins que quelqu’un ait piqué ma place. Je jetai encore une fois un œil à mon billet pour me remémorer mon numéro de siège, et avançai à l’intérieur du wagon. Une fois devant ma place, je m’apprêtai à prendre ma sacoche contenant mon ordinateur et ma tablette pour pouvoir travailler le temps du trajet. Mais finalement, non. Je n’avais pas envie de travailler, j’aurais mes soirées en solo à l’hôtel pour pondre ces fameuses illustrations de jazz. J’avais envie d’écouter de la musique. Je posai donc ma valise et ma sacoche quelques mètres plus loin dans un espace à bagages, ne gardai que mon sac à main et allai m’asseoir. Dans le carré de quatre places où j’étais censée m’installer, une seule était occupée. Il s’agissait d’un homme grisonnant et corpulent, assis côté fenêtre, en train de lire un magazine de sports mécaniques. Normalement, je devais m’asseoir en face de lui. Mais nous aurions passé tout le trajet à faire en sorte que nos jambes ne se touchent pas, et ça aurait été très pénible. Les autres places du carré étant inoccupées, je décidai donc de m’installer dans sa diagonale, côté couloir. Quand je fus assise, il leva les yeux vers moi et fit un petit mouvement de tête en guise de salutation, sans prononcer un mot. Je répondis avec un petit « bonjour » tout juste audible pour ne pas perturber le calme qui régnait dans le wagon. Pendant que je prenais mes écouteurs pour les brancher sur mon téléphone, l’homme regarda vite fait la table qui se trouvait entre lui et moi afin de s’assurer que ses affaires n’empiétaient pas sur mon espace. Sa pile de magazines débordait légèrement sur le côté couloir. Alors qu’il s’apprêtait à les déplacer vers lui, je lui fis un signe de la main accompagné d’une petite moue bienveillante pour lui faire comprendre que ses magazines ne me gênaient pas du tout, et qu’il n’était pas nécessaire de les déplacer. Encore une fois, il me fit un signe de la tête en guise de remerciement, sans prononcer un mot, puis replongea dans sa lecture. Je mis les écouteurs dans mes oreilles, lançai ma playlist, et me réjouis à l’idée de passer deux heures et demi dans un siège de première classe, à écouter mes chansons préférées tout en contemplant le paysage. Un moment tout simple, qui avait pourtant quelque chose de magique, tant ça me changeait de mon quotidien. J’adorais cette ambiance, ce wagon tout calme et silencieux, peuplé de personnes qui ne se connaissaient pas et ne se reverrais plus jamais. J’avais toujours été un peu fascinée par tous ces gens que l’on croise un jour dans le train, dans le métro, au restaurant, au cinéma… Toutes ces personnes à côté de qui on passe tout au long de sa vie sans jamais vraiment se rencontrer, avec qui on a comme seul point commun le fait d’avoir été au même endroit, au même moment. Voilà. J’étais confortablement assise, ma musique dans les oreilles, heureuse d’avoir pris l’initiative de passer trois jours seule, loin de la maison, et espérant que cette escapade allait m’apporter au moins un début de réponse à toutes les questions que je me posais.
Puisque je regardais en direction de la fenêtre, mes yeux se posaient machinalement et à de nombreuses reprises sur mon voisin de voyage. Le magazine qu’il lisait était en anglais. Je compris alors que son mutisme à mon égard ne venait pas forcément d’une envie de respecter le silence du wagon, mais tout simplement du fait qu’il ne parlait peut-être pas un mot de français. Il ne prêtait pas du tout attention à moi, plongé dans sa lecture. Du coup, sans pouvoir m’en empêcher, je l’observais. Et la raison était simple : depuis que nos regards s’étaient croisés, j’avais la certitude de l’avoir déjà vu quelque part. Et en même temps, il me semblait étranger. Ou alors, peut-être qu’il me rappelait simplement quelqu’un ? Je lui donnais une cinquantaine d’années. Il avait des cheveux poivre et sel coupés courts, et un teint très mat. Des yeux noirs, un large front, les rides d’un quinquagénaire, et d’épaisses joues qui allaient avec son surpoids. Rasé de près, une dentition d’une blancheur dont j’étais follement jalouse, il avait un regard très doux, mais fatigué. Il respirait la gentillesse. Pourtant, sa corpulence en faisait le genre de gars qu’on imaginait bien faire des ravages dans une mêlée de rugby, ou sur un ring de boxe. Il portait une chemise à manches courtes très classique, à fines rayures verticales. En regardant à côté de moi vers le sol, j’apercevais une paire de baskets noires d’une marque connue et le bas d’un jean bleu. Alors qu’il tournait sa page, il leva brièvement les yeux vers moi, se sentant probablement observé. Nos regards se croisèrent encore, le temps d’un instant, et cela suffit à me conforter dans l’idée qu’il ne m’était pas totalement étranger. Je réalisai qu’il allait peut-être falloir que j’arrête de l’observer, sinon il risquerait de s’imaginer des trucs. C’était pénible. Je me trouvais partagée entre la certitude de croiser cet homme pour la première fois de ma vie, et la sensation de le connaître depuis longtemps. Alors qui était-il ?
Nos regards se croisèrent une nouvelle fois quelques minutes plus tard quand il voulut quitter sa place pour se rendre au wagon-restaurant. Il se déplaça d’abord tout doucement sur le siège situé en face de moi tout en veillant à ne pas me marcher sur les pieds. Par réflexe, je repliai immédiatement mes jambes sous mon siège.
- Merci, marmonna-t-il d’une voix grave.
Je lui souris. Il se leva en s’aidant des montants des sièges, pour être certain de ne pas perdre l’équilibre. Je le vis se déplier douloureusement, ce qui laissait supposer qu’il était assis depuis longtemps et avait dû monter dans le train au tout début du trajet, sur la Côte d’Azur. Alors que mon regard s’était déjà redirigé vers la fenêtre, l’homme, debout à côté de moi, tapota sur mon épaule du bout de son index. J’ôtai un écouteur pour être sûre de l’entendre.
- Pardon. Mon français… difficile, dit-il en grimaçant avec un accent américain très reconnaissable. Je vais… café. Vous voulez ? Café ?
Grâce à mon travail, j’avais un bon niveau d’anglais et pouvais soutenir une conversation sans difficulté. Je lui répondis donc dans sa langue maternelle, ce qui le fit immédiatement sourire.
- Non merci. J’ai déjà ce qu’il me faut, déclarai-je gentiment en lui montrant la gourde de thé qui dépassait de mon sac à main. Mais c’est très gentil de votre part.
- Ok.
Il quitta le wagon. Je remis mon écouteur et réallongeai mes jambes en attendant qu’il revienne. Un quinquagénaire Américain, seul, dans un train reliant Toulon à Paris. Tout en écoutant ma playlist, je continuais de chercher pourquoi j’avais la sensation de le connaître. Mais rien ne me venait à l’esprit. J’avais eu l’occasion de travailler avec des Américains à plusieurs reprises, mais pas avec ce type-là. J’en étais sûre. Ça ne venait pas du boulot. Quelques minutes plus tard, je vis dans le reflet de la porte vitrée du fond du wagon que la porte opposée située derrière moi venait de s’ouvrir et que l’homme regagnait notre carré, son café à la main. Plus loin dans le wagon, je vis alors un couple de trentenaires chuchoter discrètement tout en dévisageant l’Américain. Bon. Je n’étais visiblement pas la seule à cogiter. Ça ne faisait plus aucun doute : ce type était connu. Mais pour quelle raison ? Lorsqu’il arriva à ma hauteur, je repliai mes jambes pour le laisser s’installer, sans lever les yeux vers lui. Quand il fut assis, je vis qu’il tendait quelque chose dans ma direction.
- Tenez, c’est pour accompagner le thé.
Il venait de s’exprimer en anglais, et me tendait un sachet de noix et graines. Par politesse, je retirai une nouvelle fois mes écouteurs et saisis le sachet en le remerciant, alors que j’avais encore mon petit déjeuner sur l’estomac, et donc pas du tout faim.
- Vous avez l’air de bien parler anglais, ajouta-t-il, alors si ça ne vous dérange pas, je crois que je ne vais plus faire d’efforts. Le français, c’est beaucoup trop compliqué.
- Je confirme. Même pour un Français pure-souche, le français est compliqué.
Il ouvrit un sachet de noix et graines identique à celui qu’il m’avait rapporté du wagon-restaurant, et leva son gobelet de café en ma direction, comme pour porter un toast. Je m’empressai donc d’attraper ma gourde de thé pour l’imiter. Nous trinquâmes discrètement. Je me sentis obligée de l’accompagner dans cette petite pause grignotage, et ouvris donc mon sachet après avoir avalé une gorgée de thé. Il mastiqua quelques noix en soupirant, puis déglutit avec un air désespéré. Il faisait presque peine à voir.
- D’habitude je craque pour les cacahuètes au chocolat, mais pour des raisons évidentes, il faut que je m’habitue à calmer mes envies de sucre avec ce genre de choses. Ce n’est pas facile.
- Je suis de tout cœur avec vous, répondis-je entre deux noix. J’ai traîné un surpoids pendant des années, je pensais que je ne m’en sortirais jamais. Et un beau jour, j’ai réussi à franchir le cap d’arrêter le sucre. J’ai perdu mes kilos en quelques mois et je ne les ai jamais repris. Au début c’est difficile. Mais le sucre, c’est une drogue. Et comme toutes les drogues, le sevrage doit se faire en douceur, et avec beaucoup de volonté. Vous devez vous accrocher.
- C’est exactement ce que me dit mon médecin. J’essaye de diminuer ma consommation de sucre, mais je crois que je pars de très loin.
- Il faut commencer par des choses simples et concrètes. Par exemple, moi, le premier truc que j’ai fait, c’est arrêter de manger des desserts le midi et le soir. Je me rassasie avec le plat principal, et je m’arrête là.
- Vraiment ? Pas de dessert ? Non, c’est trop dur. Et c’est trop triste.
- Au début, oui, confirmai-je avec empathie. C’est même carrément horrible. Si vous avez vraiment du mal à vous passer de dessert, l’astuce c’est de vous autoriser un carré de chocolat noir avec le café. C’est d’ailleurs pour ça que dans les restaurants, quand vous commandez un café, on vous le sert presque toujours avec un petit carré de chocolat, ou quelque chose dans le genre. C’est pour vous apporter la petite touche de sucre qui fait du bien au moral. Mais quand on a beaucoup de poids à perdre, arrêter les sucres rapides ajoutés, c’est vraiment la clé. C’est pour votre santé, tout ça. C’est très important, si vous voulez vivre longtemps. Donc voilà, à partir de maintenant, plus de desserts. Juste un café, ou un thé, avec le petit carré de chocolat noir. Et pas de sucre dans le café, évidemment.
- J’ai du mal à croire que vous ayez été en surpoids. Vous avez l’air mince.
- Aujourd’hui, oui. Mais croyez-moi, je n’ai pas toujours été comme ça. Accrochez-vous. C’est dur, mais ça vaut vraiment le coup.
- Ok. Et après le sevrage du sucre, quelle est la prochaine étape ?
- Le sport, évidemment. Mais là c’est pareil, ne vous en faites pas toute une montagne. Les gens s’imaginent que pour garder la ligne, il faut faire des heures et des heures de sport par semaine. C’est faux. Il suffit d’avoir une activité régulière, avec une intensité qui vous correspond. Et encore une fois, tout est une question de motivation. Il y a bien des choses qui doivent vous motiver, non ?
- La tête déconfite de mon médecin devant mes analyses de sang, ou quand je monte sur la balance, ça fait tellement mal à voir que ça pourrait être une très bonne motivation. C’est moi qui suis aux portes de l’obésité, et c’est à lui que ça a l’air de faire le plus de peine.
Au fur et à mesure qu’il me parlait avec sa voix grave si apaisante, j’observais cette bouille carrée toute douce et me sentais plus que jamais convaincue que je me trouvais assise face à une star Américaine. Ou une ancienne star Américaine ? Je crevais d’envie de lui poser la question frontalement, mais si jamais je me trompais, j’aurais l’air ridicule et le reste du voyage me semblerait bien long. En tout cas, il était vraiment adorable. C’était dingue, cette douceur qui émanait d’un tel colosse.
- Sérieusement, continua-t-il, je me demande parfois comment j’ai pu en arriver là. Et en même temps, la réponse est évidente. J’ai arrêté de fumer il y a dix ans et j’ai compensé avec la nourriture. Je mange n’importe comment, j’ai arrêté le sport il y a des années, je suis souvent invité à des soirées où l’alcool coule à flots et j’ai du mal à résister… Mon surpoids me déprime, et quand je suis déprimé, j’ai envie de manger.
- Eh bien c’est un schéma très classique, tout ça. Et le fait d’en être conscient, c’est déjà un excellent point. Donc voilà. Le hasard de la vie a fait que je me suis assise en face de vous aujourd’hui, et que j’ai réussi à me sortir d’une situation dans laquelle vous vous sentez coincé. C’est un signe ! C’est le signe qu’aujourd’hui, ça y est, vous êtes résolu à vous débarrasser de votre surpoids, parce que vous avez rencontré une fille qui l’a fait, et que si elle en a été capable, vous en êtes capable. En montant dans ce train, vous ne saviez pas que votre vie allait changer. Alors voilà, c’est fait. À partir de maintenant, vous êtes le gars qui ne prend plus de dessert, qui ne boit plus d’alcool, et qui fait quelques minutes de sport tous les jours. Tout ça grâce à un voyage en train. La vie est quand même surprenante.
Il se mit à rire. Et j’eus immédiatement un flash. Le flash que j’attendais depuis que je m’étais assise en face de lui.




