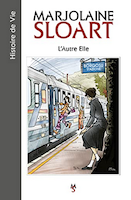Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
61
« Dernier message par Apogon le jeu. 15/09/2022 à 17:33 »
Une vie d'artistes de Alexandre Page Pour l'acheter : Amazon BOD -I- Un jour, un écrivaillon est venu me trouver pour me demander s’il pouvait raconter mon histoire ou, plus exactement, notre histoire. Il avait trente ans et pas l’air de manger à sa faim. Il faut dire que c’était moins un génie incompris qu’un médiocre feuilletoniste. J’aurai l’occasion de détailler plus tard notre rencontre et la raison de mes propos inamicaux à son égard, mais je peux déjà confesser ma faute : je lui ai répondu « oui ». Il m’a alors demandé où il devait commencer son récit et quel avait été l’élément qui avait conduit à nos mésaventures. J’ai longuement réfléchi et je lui ai affirmé que tout cela avait commencé le jour où j’étais entré dans l’atelier de Clémence. C’était un excellent début pour un roman, un début romanesque. À cette époque, je croyais vraiment que c’était la genèse des péripéties, tant bonnes que mauvaises, qui ont suivi. En ce temps, si j’avais pris la plume à la place de cet écrivaillon, sûrement aurais-je choisi ce même point de départ, ou alors ma première rencontre avec Clémence. Oui, cela aurait pu éclaircir mieux encore certaines zones d’ombre. Enfin, à cette époque j’aurais précipitamment fait débuter cette histoire à Clémence, mais ça aurait été une erreur, car son origine remontait en fait à quelques jours plus tôt, les derniers d’une vie dont ils allaient acter le crépuscule. J’ignorais alors qu’ils m’en préparaient une nouvelle, bien meilleure que la période très problématique que je traversais. À dire vrai, sans la prompte arrivée de Clémence, mon histoire aurait pu tenir en une phrase : « Il quitta son appartement, un soir, d’un pas décidé, pour aller se jeter dans les eaux noires de la Seine qui l’engloutirent sitôt dans leurs abîmes opaques. » Il est malheureux de songer que ce genre de récits, dont les auteurs jadis faisaient des drames en cinq actes, composent de nos jours des listes invraisemblables à la rubrique « faits divers » de nos journaux. Je ne regrette pas que mon histoire se soit finalement déroulée autrement, et que je puisse vous la raconter moi-même. En effet, si elle a déjà été racontée par Joseph Guignoux — cet écrivaillon qui depuis est retombé dans l’oubli —, je tenais à en donner ma propre version. Mon intention est de rétablir certains faits, de dire à la postérité ce qui s’est réellement passé et surtout de débuter cette histoire au bon endroit, au bon moment, à l’instant fatidique où croyant que ma vie se dérobait à moi-même, elle entrait en vérité dans sa renaissance. Aussi, ce n’est pas avec Clémence que je vais entamer mon récit, mais avec Gabrielle. Une femme, les histoires débutent souvent avec des femmes quand ce ne sont pas elles qui les terminent, et d’ailleurs, Gabrielle en a terminé une pour en commencer une autre. Il faut dire que Gabrielle était une femme d’exception, une figure mémorable qu’on aimerait aimer sans avoir à la détester, qu’on aimerait détester sans avoir à l’aimer, ce qui était impossible et lui a fait jouer si fréquemment le premier rôle dans la vie de ses amants, même les plus passagers. Gabrielle n’était bien sûr pas son vrai nom, elle l’avait choisi comme un hommage à Gabrielle d’Estrées, une autre rousse et une autre amie des hommes ! Gabrielle était de cette génération de demi-mondaines qui préféraient les noms des favorites royales à toutes les Léda, Cleïa, Gaïa et Ophelia de l’Antiquité qui avaient essaimé au milieu du siècle. Il y avait un côté moins classique, moins pompeux, ou peut-être les jeunes femmes du demi-monde moderne n’étaient-elles plus assez cultivées en lettres latines et grecques pour s’accaparer ce genre d’identités. Il est vrai qu’à la fin des années 1870, le demi-monde avait bien changé. Sans recevoir le niveau d’une éducation bourgeoise, de simples filles des classes laborieuses pouvaient apprendre assez pour devenir ambitieuses à condition d’être très belles, et avec de la volonté, faire leur nid au-dessus du commun. C’était ainsi que s’était « faite » Gabrielle qui avait commencé à quinze ans comme vendeuse dans une boutique de chapeaux avant de creuser son sillon au bras d’hommes judicieusement choisis. Elle avait su mettre à profit son mystérieux charme de rousse, mais elle avait deviné très tôt qu’un bel esprit était nécessaire pour s’élever, et elle avait durement travaillé pour cela. Elle aimait le dire, elle aimait dire qu’elle s’était élevée, quand dans cette classe de femmes il est si facile de choir. Je l’avais rencontrée pour la première fois lorsque j’étais encore un peintre en gloire, un jeune peintre prometteur avec le sou en poche, la notoriété parisienne et l’avenir doré. Elle appartenait à ces trophées que la bonne fortune m’avait fait acquérir à un âge indécent, mais en vérité, et comme j’allais bientôt le constater, ces femmes nous acquiert plus que nous les acquérons. Elle était devenue ma maîtresse, j’étais devenu l’un de ses amants. Nous étions trois chanceux, je ne l’ignorais pas, mais j’espérais bien être parmi tous son amant de cœur. Ces femmes-là ont toujours un amant de cœur, celui auquel elles pardonnent les déboires financiers, les cadeaux trop modestes, à qui, parfois même, elles acceptent de prêter de l’argent. Les artistes sont souvent des amants de cœur, car ils font rêver les femmes, font d’elles leur muse, leur apportent la célébrité, mais le sou va et vient très vite dans leur poche. J’en étais la preuve vivante. J’espérais être cet amant chanceux, mais Gabrielle était issue de la classe laborieuse, elle connaissait la valeur de l’argent et c’était son art de l’économie qui l’avait faite libre. Je ne sais pas si elle avait un amant de cœur, et tout du moins, ce n’était pas moi. Un jour, le jour où commence cette histoire, je me rendis chez elle, à son appartement cossu rue de l’Odéon, dans ce quartier de La Madeleine qui était encore un temple du demi-monde. Nous étions à la fin du mois de novembre et Paris avait rarement été aussi grise que ce jour-là. Le ciel était laiteux et se reflétait dans les pavés mouillés d’une averse de la veille qui promettait de se transformer en neige à la prochaine incartade. Les femmes avaient déjà sorti leurs robes de lourdes étoffes, la bourrette et la neigeuse étaient à la mode, et la chenille « chenillait » sur le bleu marine et les nuances de loutre. Les rues auraient pu être plus tristes encore si la fraîcheur de l’air n’avait donné sous les voilettes de belles couleurs aux joues, et si les vendeurs de marrons chauds n’avaient apporté le sourire aux enfants qui se plaisaient à se brûler les doigts en cherchant la chair dorée des fruits sous l’enveloppe brune. L’ambiance de l’hiver était bien là, et c’était la tristesse de l’automne finissant qui se mêlait à celle, plus joyeuse, de la nouvelle saison qui venait avec un peu d’avance. Arrivé rue de l’Odéon, je descendis devant l’immeuble qui abritait les appartements de Gabrielle. Elle aurait pu avoir mieux avenue de Villiers ou au Trocadéro, avec les horizontales , mais elle était économe et avait gardé cet appartement qui seyait à ce trait de son caractère. Un salut à la concierge qui me connaissait bien, une ascension bondissante et néanmoins un peu inquiète dans l’escalier jusqu’au premier étage, porte de gauche, et me voilà sonnant avec un inconfort qui ne m’était pas habituel. En vérité, c’était la première fois que je me présentais à Gabrielle sans un sou, sans un cadeau, et je n’ignorais pas que cela susciterait chez elle des interrogations que mes talents de « séduiseur » ne suffiraient peut-être pas à dissiper. J’avais d’ailleurs l’attention de m’en expliquer et j’avais prévu à cet effet une défense que j’espérais satisfaisante pour passer la tempête jusqu’à ce que la fortune m’aidât à me refaire. Je sonnai donc, et comme de coutume, ce fut Jeanne qui vint m’ouvrir. Jeanne était la bonne de Gabrielle, une femme lumineuse, au moins autant que sa maîtresse. Elle se devait d’être charmante de frimousse et de conversation, puisqu’elle était censée rendre l’attente des nombreux visiteurs de sa maîtresse moins pénible. Elle savait faire cela très bien, et quoiqu’elle ne fût plus niaise depuis longtemps malgré sa jeunesse, elle prenait encore la garance aux joues qui lui donnait une candeur délicieuse : — Gabrielle est-elle ici et est-elle libre, Mademoiselle Jeanne ? dis-je en insistant sur le « mademoiselle » qui garantissait toujours un sourire de la jeune bonne et un accueil plus chaleureux qu’en ne le disant pas. — Vous êtes bien matinal, Monsieur Philéas, me répondit-elle. Madame s’habille. Venez au salon, je vais la prévenir. Jeanne me conduisit au salon puis m’abandonna au milieu de cette pièce rocaille, sorte de lupanar Louis XV décoré de gravures et de tableaux où les jeunes filles soulevaient leurs jupes sur des escarpolettes, où les billets doux se glissaient dans les corsages et où les couchers des mariés n’avaient rien d’innocent. Puis il y avait une bonbonnière toujours pleine de sucreries. « Pour l’haleine », se plaisait à dire Gabrielle aux hommes qui s’interrogeaient sur cette tentation enfantine ainsi exposée aux visiteurs. J’en avais déjà attendu des heures ici, surveillé par toutes ces nymphes du Grand Siècle. Si elles avaient été vivantes, je les aurais sûrement toutes appelées par leurs petits noms à force de familiarité. Mais ce jour-là, je n’attendis pas très longtemps. Gabrielle me fit cette bonté et parut devant moi dans une toilette nouvelle, une robe verte à passementerie qui, bien entendu, ne se fermait pas au milieu comme les robes de « tout le monde », mais sur le côté, de façon à offrir une ligne gracieuse et originale. C’était bien Gabrielle et son souci du détail mignard qui avait fait d’elle plus qu’une demi-mondaine, un paon adulé des modes parisiennes. Elle me tendit la main, je lui baisai, un peu maladroitement en effleurant sa peau si douce du bout des lèvres. Comme de coutume, elle embaumait l’eau de Cologne Grand Cordon, le « parfum pudique », un surnom qui amusait follement Gabrielle mais qu’elle n’avait connu que bien après en avoir fait sa fragrance fétiche. Les salutations faites, le thé en préparation, les petits biscuits avancés à côté des bonbons par une Jeanne gambadante, et voilà Gabrielle me reprochant de ne pas l’avoir visitée depuis trop longtemps : — Est-ce donc que tu peins une nouvelle grande œuvre ? me demanda-t-elle avec une pointe d’ironie. — Je ne ferai jamais plus grande œuvre que ton portrait ! lui répondis-je subtilement en lui rappelant que l’effigie qui trônait au-dessus de son lit et qui contemplait si fréquemment ses ébats était un de mes cadeaux un jour que je m’étais déjà retrouvé la bourse vide. — Vois-tu, continua-t-elle, c’est bien que tu sois venu. Tu es le premier à découvrir ma nouvelle robe. Qu’en penses-tu ? C’est une Madame Duboys. Ses toilettes d’automne sont les plus originales. Elle est originale, n’est-ce pas ? Elle était originale, assurément, et tant la forme que la couleur convenaient à merveille au teint de Gabrielle et à sa flamboyante chevelure qui la distinguait toujours au milieu du commun. Je lui servis tous les compliments qu’elle attendait, me disant que cela faciliterait ma confession à venir : — Tes mots me vont droit au cœur, répondit-elle, souriant d’un sourire sincère mais qui dissimulait une suite. Elle ne tarda pas à venir, et elle reprit : — Tes mots me vont droit au cœur, mais tu vois, sur ce cœur, j’aimerais un petit ornement. Il me manque une broche, une broche charmante et… justement, j’en ai vu une place Vendôme dans une boutique… Elle est en émeraude, elle irait parfaitement avec cette robe, avec mes cheveux et trouverait belle place sur mon sein. — Allons, la coupai-je, ce sein est parfait, pourquoi veux-tu le parer de joyaux qui ne le valent pas ?! J’espérais me sortir de cette ornière où m’entraînait Gabrielle, mais elle était maline et m’y plongea davantage encore : — Alors, puisqu’elle ne vaut pas mon sein, peut-être pourrais-tu me l’offrir ? Tu comprends que si tu ne me l’offres pas, il te sera plus difficile de t’offrir mon sein. Je me trouvais devant l’abîme : — Eh bien… Ce n’est pas que je ne voudrais pas mais… Les temps sont durs ! On ne reconnaît plus le génie, les grands artistes sont condamnés à la mendicité et… — Ta bourse est donc vide, à nouveau ! Tu as encore préféré le jeu à mes charmes ! me lança Gabrielle sur un ton sentencieux, car elle prenait la chose pour un affront. Je ne pouvais lui cacher la vérité. J’avais englouti mes rares argents dans un club mondain où j’avais mes habitudes ; trop d’habitudes. Je n’avais pas les mêmes vertus économes qu’elle : — Oui, elle est vide, et c’est ce que j’étais venu te dire. Le cadeau du mois dernier, ces lorgnettes de théâtre… — Jumelles ! — Jumelles ! Ces jumelles de théâtre en nacre, elles m’ont coûté fort cher. Je n’ai qu’une main pour peindre, je ne peux pas… — Tu me mentirais en plus et tu me ferais porter le chapeau ! Tu dilapides ton argent aux cartes et dans les paris et c’est la femme que tu accuses ! Goujat que tu es ! Elle n’avait pas tort : — Je pense que le mois prochain, les choses iront mieux. Je peux faire ton portrait si tu veux, comme la dernière fois ? — Eh bien non, Philéas Chasselat, tu as déjà fait mon portrait et c’est d’une émeraude dont j’ai besoin. Puisque tu ne peux pas m’offrir mon émeraude, alors je ne t’offrirai pas mon lit. Si tu me crois trop exigeante, tu n’as qu’à aller voir La Boulotte ou La Bossue, les rues en sont pleines et elles ne te demanderont qu’un sou, s’il te reste encore ça ! — Mais Gabrielle, nous nous connaissons depuis longtemps, je pensais être… je pensais être ton amant de cœur, celui à qui tu pardonnes les moments difficiles. — Je t’ai connu au sommet de ta gloire, je t’ai déjà pardonné trop de fois, et il vient un temps pour une femme où elle doit choisir entre la passion et la raison, et si je choisissais continuellement la passion, je finirais consumée et je te recevrais dans une de ces maisons où s’entassent des créatures hommasses et scrofuleuses. — N’exagères-tu pas, je te demande une grâce d’un mois ? — Et le mois prochain tu m’imploreras à nouveau, et le suivant, car tu ne peins plus que des croûtes et que tu dépenses avec inconséquence ce qu’elles te rapportent ! Vois-tu, je sais ce que c’est d’avoir un bol d’eau chaude pour tout repas, et j’ai mes limites avec les gens inconséquents qui dilapident leurs argents plutôt que de faire plaisir aux gens qu’ils prétendent aimer. Adieu Philéas ! Si cela peut te soulager, tu me manqueras quand même un peu. Mais n’oublie pas, si tu veux me revoir, tâche d’avoir mon émeraude ! Sur ces mots, et alors que Jeanne amenait tout juste le thé, elle lui demanda de me raccompagner sans plus de démonstration. J’espérais au moins qu’elle se retournerait en me voyant partir, mais elle n’en fit rien et ce fut Jeanne qui me souffla quelques mots réconfortants et déposa sur ma joue un baiser en guise de consolation avant de me fermer, pour un temps qui s’annonçait fort long, la porte de Gabrielle. Je restai un peu interdit, encore sous le choc de cette entrevue désastreuse avec Gabrielle. La porte se ferma sur un dernier sourire de la jeune bonne et je me retrouvais là, sur le palier, bien nigaud et de plus en plus conscient d’être un funambule sur son fil à l’approche de la tempête. Ma vie n’était qu’au début de ses aléas tumultueux. -II- Cette rupture malheureuse avec Gabrielle n’était en effet que le prologue de ma déchéance à venir. L’ancien Philéas Chasselat, le jeune artiste plein de promesses, celui qui avait vendu une Bataille de Valmy à l’État pour cinq mille francs et séduit la presse assez pour prendre le surnom de « jeune Meissonier » n’existait plus, et quelqu’un qui aurait vu le nouveau dans son appartement à demi-vide se serait probablement demandé comment, en quelques années, l’homme à qui l’on prédisait déjà la Légion d’honneur et l’Institut comme couronne de gloire avait pu plonger dans une semi-indigence et voir ses lauriers se faner si vite. Fané, le terme convenait parfaitement à ma situation, j’étais une plante vigoureuse prématurément fanée après avoir trop abusé de ses forces ou plutôt pour avoir trop goûté aux fruits de ses efforts. Quand on est jeune, ambitieux, mais sans argent ni relation et que l’on veut se tailler une place dans une société qui nous fait rêver, alors seul le travail acharné peut nous y conduire. Une fois que l’on est rendu, l’effort a été si grand que l’on profite, qu’on use et abuse, et à moins d’avoir la raison de Gabrielle, on se brûle vite et la déchéance guette. La gloire et l’argent m’avaient mené dans tous les clubs mondains de la ville, avaient pendu à mon bras une coûteuse maîtresse en vue et j’avais perdu l’inspiration. C’est le souci du créateur lorsqu’il change. Il crée dans un contexte, avec un sentiment, un esprit particulier, et quand ce contexte évolue et l’homme avec, la machinerie parfaitement huilée de la création se grippe et l’inspiration s’en va. La main est toujours là, mais le génie étouffe et il ne sort du pinceau qu’une bouillie infâme qui n’illusionne pas même son créateur et le désespère, et en le désespérant, lui rend encore plus douloureux l’acte créatif. Il préfère oublier ses déboires dans les bras d’une femme, dans le jeu, dans les mondanités où on le sollicite à tout va, mais il omet qu’il n’est pas de cette haute société qu’il fréquente, qu’il reste un besogneux, un artiste auprès du beau monde fortuné et oisif auquel il n’appartient que par un fil qui peut vite se couper. L’argent se tarit, la gloire s’éloigne, de nouveaux jeunes artistes surgissent avec leurs propres promesses et font oublier les prometteurs d’hier qui n’ont jamais tenu les leurs. Les clubs vous ferment leurs portes, la presse vous oublie, on ne vous fait plus crédit dans les restaurants chics, le prix du billet d’une pièce de théâtre vous donne des sueurs froides et celle qui frissonnait dans vos bras en vous répétant des « je t’aime » enfiévrés vous répudie, car elle préfère le métal froid de l’argent à la douceur de vos lèvres. C’est là le destin de beaucoup d’artistes arrivés, et si aujourd’hui j’admets volontiers m’être sabordé moi-même, avoir cédé avec une aisance déconcertante aux sirènes de l’oisiveté et du confort soudainement acquis, à l’époque, je jugeais être victime de la jalousie des pontifes du Salon, mécontents de voir un jeune créateur leur tailler des croupières ; victime des journalistes médiocres, sans goût, envoyés au Salon de peinture pour donner leur avis lorsque la veille ils le donnaient sur le Salon de l’agriculture ; victime d’une classe d’aristocrates prétentieux qui ne voyaient pas d’un bon œil un intrus parmi eux. Le succès rend aveugle et la déchéance rend paranoïaque. Quand Gabrielle m’a assené son soufflet, je croyais avoir atteint le fond du gouffre. Je l’espérais en supposant que je pourrais redevenir assez inconnu, insignifiant, pour retrouver mon inspiration et remonter à la surface. C’est dans les épreuves et les difficultés que se fondent les grandes œuvres, mais en vérité, je n’aspirais plus à la peinture que l’on exigeait de moi. Je m’étais fait connaître comme peintre militaire, celui des exploits révolutionnaires qui étaient très demandés dans les années 1870 et plaisaient beaucoup à la frange républicaine. Les Suisses de l’Ancien Régime et les gardes de la Convention n’avaient aucun secret pour moi. Maintenant, la mode avait évolué, on voulait des grognards de Napoléon, des hussards à la Murat et des grenadiers de la Vieille Garde, mais sans le sang et sans la poudre ou seulement la poudre de riz. On voulait des soldats, mais pour les mettre dans des salons bourgeois, des soldats dans leurs beaux uniformes flamboyants, si possible un bouquet à la main pour séduire une dame. On voulait des soldats avec pour champ de bataille le Jardin des Tuileries ou celui du Luxembourg. Oh, je ne dis pas qu’au Salon de peinture et sculpture on n’encensait plus les grandes batailles de jadis, mais je n’avais plus la volonté d’y exposer mes œuvres. L’inspiration, l’énergie et l’envie me manquaient pour ça. Alors, depuis ma disgrâce, je me contentais de peindre de petits tableautins militaires pour un marchand, rue de Choiseul, qui, observateur rigoureux de la célèbre règle des marchands de tableaux, « acheter à moindre prix et vendre très cher », ne m’enrichissait guère. À sa décharge, je ne produisais pas beaucoup, car je n’avais aucun entrain à peindre en série ces misérables croûtes ennuyeuses et si mièvres qu’elles auraient paru sucrées dans une chambre de jeune fille. Je les produisais sans entrain et sans génie et je n’étais plus grand-chose. Les lauriers jaunis ne font plus de bonnes sauces, et j’avais encore de la chance d’avoir la confiance d’un marchand assez généreux pour me débarrasser de ces affreux tableautins qu’il plaçait à des clients du monde entier. Je savais que les Américains en raffolaient et lui achetaient à des prix considérables. J’aurais sûrement pu les lui vendre plus cher, mais j’avais trop honte de mes peinturlures. Je peignais mécaniquement ces militaires en goguette au bras d’Incroyables, et en dépit de mes efforts, je n’arrivais à peindre rien d’autre. J’étais un automate, la main allait mais le Génie de la composition, la Muse de l’inspiration, eux, n’étaient plus là et tout ce que j’ambitionnais devenait cendres et s’évanouissait. Ma célébrité fondait, ma bourse se vidait, je redevenais l’homme que j’avais été jadis, mais l’envie d’art, elle, ne revenait pas. Pour être honnête, tout n’était pas encore redevenu comme avant, car je m’accrochais déraisonnablement à mon appartement, boulevard des Capucines. C’était un bel appartement qu’accompagnait un atelier lumineux comme il se doit et que j’avais choisi comme écrin à ma gloire future, comme matrice à la genèse des chefs-d’œuvre de ma maturité. J’aimais cet endroit, j’aimais ces murs même si je n’en étais que locataire, j’aimais le quartier où j’avais mes habitudes, mais si je me retrouvais dans les difficultés financières, ce n’était pas seulement parce que je jouais et perdais trop souvent ni parce que Gabrielle me suçait jusqu’à la moelle, mais à cause de ce Panthéon dans lequel je n’accouchais que de souris. Il me coûtait les yeux de la tête et je n’y accomplissais rien de grand, rien de glorieux, rien qui pût satisfaire à son entretien et au paiement régulier du loyer. Je n’ose dire le prix, mais il était de ceux qu’on ne peut acquitter qu’à la condition d’être en mesure d’offrir une émeraude à son amante quand elle en réclame une. Autant dire que je n’étais plus dans cette disposition, et que cela faisait déjà plusieurs mois que je payais mon loyer en vidant mon appartement de ce qui en constituait le mobilier. J’avais commencé par me débarrasser de mes artefacts d’uniformes, d’armes, de militaria. Je n’avais plus besoin de ça pour peindre mes militaires tant les moindres boutons de chemise étaient ancrés dans mon esprit. Puis j’avais vendu mes copies d’antiques, lesquelles ne m’avaient jamais vraiment servi mais faisaient le sérieux d’un atelier d’artiste. Petit à petit, mon appartement s’était libéré des encombrants, et à présent il ne restait plus que deux chaises sur six autour de la grande table du salon. Ma chambre avait des airs de cellule de chartreux ironiquement lovée parmi les ors et les moulures de l’architecture palatiale. Il ne me restait plus grand-chose, et cependant, il y avait ce bon Anicet qui demeurait à mes côtés et tentait, tant bien que mal, de donner une allure chaleureuse et point trop misérable à ce qui subsistait. Il essayait de me dissimuler ce qu’il avait vendu la veille pour équilibrer les comptes qui ne l’étaient jamais puisque je dépensais beaucoup trop. Je l’avais engagé en même temps que je m’étais installé dans cet appartement et l’enthousiasme d’être au service d’un artiste l’avait porté dans un premier temps. Je l’avais même fait poser avec quelques uniformes, car il avait bien la tête et la carrure d’un militaire, puis à mes côtés, il avait vécu ma disgrâce sans me faire faux bond. Pourtant, il ne touchait plus les appointements de ses débuts, mais en voyant autour de lui, il comprenait que ce n’était pas par avarice de ma part, alors il l’acceptait et espérait sûrement que l’inspiration me visiterait à nouveau, et avec elle, ses gages. Je le croyais, mais ce jour où je revenais dépité de chez Gabrielle, non sans avoir fait quelques détours pour oublier notre triste entrevue, j’avais encore assez de clairvoyance et je connaissais assez bien Anicet pour constater que lui aussi était préoccupé. Il manifesta le désir de m’entretenir d’un sujet important, mais j’étais tout à mes propres tourments, et imaginant qu’il voulait me parler de dettes en souffrance et de la nécessité de vendre quelque chose, je lui demandai de m’en parler plus tard : — Nous verrons cela demain, si tu veux bien. Porte-moi plutôt un cognac s’il nous en reste, je n’ai pas la tête à autre chose qu’à boire et m’endormir si je le peux pour oublier cette maudite journée ! Je lui répondis cela, en substance, et il n’insista pas, me gratifiant d’un simple « Très bien Monsieur » qui ne pouvait pas me laisser deviner la teneur de ce qu’il voulait me confier. Le soir même, j’avais oublié tout ça, d’autant qu’Anicet avait eu l’amabilité de ne pas essayer de me le rappeler en ce jour si pénible pour moi, mais ce n’était que partie remise ainsi que l’on dit.
62
« Dernier message par Apogon le jeu. 01/09/2022 à 17:55 »
Conditionnel de P.M Lorenz Pour vous le procurer : Amazon FnacLe Jeune 1.1 Il tourna sa casquette, sur sa gauche, pour se protéger du soleil. Un soleil insoutenable, comme tous les jours à cette heure, lorsqu’il rentrait chez lui, après le boulot. Les éclats d'argent sur la mer lui interdisaient de regarder à gauche, sous peine d'être ébloui, d'être aveuglé. Entre lui et l’océan, le boulevard Lancastel, une deux fois trois voies longeant le littoral dionysien. Heureusement, pour atténuer ces éclats d’argent. … Il me faut des lunettes solaires... Il se faisait cette remarque tous les jours, au même endroit. Une remarque qu’il oublierait dans quelques minutes, lorsqu’il tournerait à droite dans la rue de la Mer. La rue que les habitants de son quartier appelaient la rue de la Merde. Une fois dans cette rue, il se sentirait surveillé, épié, chassé. Des sensations trop présentes, trop persistantes pour penser à des lunettes solaires. Un bruit d’accélérateur retentit sur sa gauche, à moins de deux mètres de lui, sur la route. Une fumée l’entoura juste après, entra par ses narines. L’odeur était dégueulasse, un mélange d’essence et de suie. Il bloqua sa respiration, instinctivement. Le temps de faire deux pas, de sortir de ce nuage, de retrouver un air moins pollué. Il s’y était fait, à force, s’était habitué à ces odeurs de pot d’échappement. Normal, trois ans qu’il empruntait cet itinéraire, tous les jours. Le boulevard Lancastel était un axe principal de Saint-Denis, était presque toujours encombré, infectait chaque jour un peu plus l'air. Mais cette odeur de pot d’échappement valait mille fois mieux que celles de zamal et de pisse qui empestaient Lapoudrière. ― Tu as été payé ? Il tourna la tête, sur sa gauche, légèrement. Malgré les éclats d’argent. Mily était là, à ses côtés, apparue dont on ne sait où. Comme elle le faisait toujours, depuis un an. Aujourd’hui, elle portait un chemisier blanc, un jean noir. Des vêtements qu’il voyait souvent sur elle. … Peut-être même tous les jours… Mily fixait l’enveloppe. Celle qu’il tenait dans ses mains. Une enveloppe bondée, remplie de billets de cinquante euros. Vingt-cinq billets de cinquante euros. Pas besoin de compter pour le savoir. Il ne manquait jamais un billet dans les enveloppes que lui donnaient Léon. Il sourit. Obligé. On souriait toujours à Mily. ― Avec deux jours d’avance. ― Ça te fait combien, maintenant ? Un rapide calcul mental. Les chiffres qu’il avait dans le tableau de son vieil ordi additionnés à ces mille cinq cents euros. ― Si je ne dépense rien de cette enveloppe, quarante-deux mille trois cents. ― Ben voilà, les quarante mille sont dépassés... Il s’arrêta, un moment. À cause de la réflexion de Mily. Une réflexion insouciante, spontanée, comme Mily en faisait toujours. Son regard se porta sur le ciel, au loin, sur l’horizon urbain. Un ciel bleu, parsemé de quelques nuages blancs, ou presque. … Elle a raison... Il avait atteint les quarante mille euros d’économie, son projet initial. Le but secret qu’il s’était fixé après son embauche à la station, il y avait trois ans. Il venait alors de fêter ses quinze ans, avait emménagé à Lapoudrière depuis quelques semaines seulement. Maman ne travaillait pas encore, l'argent manquait, et le peu que gagnait Maman repartait pour Pépé, immédiatement. Il était venu à la station par hasard, pour une baguette, ou un paquet de cigarette pour Maman. Léon était à la caisse, l’avait regardé de haut en bas, lui avait expliqué qu’il venait de reprendre la gérance, qu’il cherchait de nouvelles têtes pour y travailler. Léon lui avait proposé mille cinq cents euros net par mois. Au black. Mille cinq cents euros qu’il n’aurait pas à déclarer, pas imposables, qui ne supprimeraient pas les futures allocations de Maman. Il avait dit oui à Léon. Tout de suite. Mille cinq cents euros à quinze ans, c’était un bon départ dans la vie. Il s’était tout de suite fixé les quarante mille euros d’économie. Le prix d’un petit studio. Pour lui, pour Maman. Un studio en dehors de Lapoudrière, de ce quartier horrible. Et puis, petit à petit, Maman avait disparu de cet objectif, de sa vision. A peine six mois plus tard. Mily l’y avait remplacée. … Le projet initial… Le projet n’avait plus de sens aujourd’hui. Un rêve de plus englouti à Lapoudrière, par Lapoudrière. Un de plus. ― Je l’avais oublié. Mily se remit en marche. Sans se préoccuper de sa réponse. ― Ne t’arrête pas comme ça, tu vas être en retard. Il regarda sa montre. Une montre digitale verte, au contour en plastique, la moins chère du Mercado. Quatorze heures dix-huit. Mily avait raison. Toujours. Il devait être à l’hôpital à seize heures, devait se remettre en route, suivre Mily. Mais il resta planté là, à la regarder s’éloigner doucement, à admirer sa beauté, à contempler sa présence. ― Qu’est-ce qui t’est arrivé, Mily ? Les mots avaient été jetés dans un souffle. Un souffle de désespoir. Mily continua à avancer, sans faire attention à lui. Encore. Elle ne répondrait pas à cette question, n’y répondait jamais. Une file de voitures passa à côté de lui, à toute vitesse. Leur souffle le poussa en avant, l’obligea à se remettre en route. Il suivit Mily sur quelques dizaines de mètres, la rattrapa après avoir traversé la rue, devant la borne. Celle de la « rue des Aglets ». Mily s'était arrêtée, devant cette borne. Le boulevard Lancastel continuait tout droit, menait au second accès de Lapoudrière, à la rue de la Merde, la rue qu’il empruntait habituellement pour rentrer chez lui. Plus loin, au fil du boulevard Lancastel, d’autres quartiers de Saint-Denis, le Chaudron, Sainte-Clotilde, le Moufia. Des quartiers qu’il enviait, qui valaient mille fois Lapoudrière. Il s’arrêta à moins d’un mètre de Mily, observa la borne « rue des Aglets ». Longtemps. Une borne en pierre, d’un orange délavé, surmontée d’une plaque bleue. Il manquait la lettre « g » au mot Aglets. Ses yeux se levèrent vers cette rue. Une longue ligne droite au milieu des maisons de ville dégueulasses. Mily ne s'était pas arrêtée là par hasard. Elle lui passait un message, lui montrait le chemin à suivre. Son regard resta bloqué sur la rue. Une rue qu’il connaissait bien, presque par cœur. Combien de fois l’avait-il déjà empruntée ? Mille fois ? Peut-être, oui. Mais cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas posé les pieds. …Un an… Plus ou moins… Il tourna la tête vers Mily, brièvement, revint à la rue ensuite, souffla. Sa main gauche monta, se posa sur sa nuque, à la base de son cou. Ses doigts passèrent sur sa cicatrice. Un petit renflement de chair, de peau fripée. Un geste qu’il avait pris l’habitude de réaliser, depuis son enfance, depuis que Maman lui répétait qu’il valait mieux avoir des remords que des regrets. Son index passa sur les contours de sa cicatrice, remonta ensuite, de trois centimètres. … A trois centimètres près... Sa vie tenait dans ces trois centimètres. Maman le lui avait dit. Un accident, lorsqu’il était petit, trop petit pour qu’il s’en rappelle. Trois centimètres plus haut, il aurait été mort, sur le coup. Depuis que Maman le lui avait dit, il avait pris ce geste, ce tic. Il le faisait toujours avant de prendre des décisions importantes, pour se donner l’élan nécessaire, pour se donner du courage, pour avoir plus de remords que de regrets. Oui, aujourd’hui, il emprunterait cette rue, aurait enfin des réponses. Aujourd’hui marquerait la fin du silence, de l’indifférence. Oui, Aujourd’hui... … Allez… Il quitta le boulevard Lancastel, obliqua vers la rue des Aglets. Le bruit des pas de Mily arriva de derrière lui. Elle le suivait. ― Tu vas voir ton grand-père ? Il se retourna. Brusquement. Mily souriait. Un sourire espiègle, un sourire de celle qui savait qu'elle avait dit une connerie. Ce sourire l'obligea à lui pardonner. Ce sourire l’obligeait toujours à lui pardonner. … Qu’il crève… Il pivota à nouveau. Sans rien répondre. Mily connaissait la situation, parfaitement, le taquinait souvent avec ça. La maison de Pépé était là, sur sa droite, de l’autre côté de la rue. La peinture verte du portail s'écaillait, de plus en plus, la courette continuait de se remplir de déchets. Malgré son accident. La maison ressemblait à son occupant, vieille, ridée, sur le point de s’écrouler. Elle était dégueulasse, sentait l’huile de friture rance, puait les cadavres de rongeurs en décomposition. Une maison qui empestait la mort. Maman avait grandi ici, dans cette maison, avait fini par la fuir. Lui y était venu quelques fois. Jamais il n’y retournerait. Il passa la maison du vieux con, s’en éloigna. Ses yeux se posèrent sur d’autres maisons de la rue. Toutes horribles. Certaines plus que d’autres. Mais aussi horribles qu’elles furent, la rue baignait dans une atmosphère particulière. Une atmosphère de presque liberté, de quasi-quiétude. Une atmosphère figée dans le temps. L’un des rares endroits de Lapoudrière où vous pouviez ressentir cette impression. Rien à voir avec le centre du quartier, sur sa gauche, derrière ces immeubles immondes, rien à voir avec là où il habitait. Là-bas, au milieu de ces immeubles, le stress vous effrayait, l’anxiété vous empêchait de respirer. Il connaissait la raison de cette atmosphère particulière ici, dans cette rue, l’avait suffisamment parcourue pour comprendre. La rue des Aglets était la limite ouest de Lapoudrière. Après cette rue, la liberté. Totale, complète. La liberté de côtoyer des gens normaux, la liberté de réussir sa vie sans s’attirer critiques ou jalousies, la liberté d’être heureux sans devoir s’excuser de l’être. ―Tu vas chez moi ? Il se retourna, encore, s’arrêta, obligé. À cause de l'expression figée sur le visage de Mily. Une expression d'effroi. Ou presque. ― Je dois savoir Mily. Mily étira légèrement son cou, jeta un regard vers l’extrémité de la rue, dans son dos à lui. Elle regardait sa maison, il en était sûr. ― Il va te jeter. Il le savait. Pertinemment. On l'avait jeté tant et tant de fois. Mais il ne pouvait plus s’arrêter. Plus maintenant que le courage d’y aller lui était venu, plus maintenant que sa main avait touché sa cicatrice. Il ne pouvait plus supporter de ne pas savoir ce qui était arrivé. ― Je dois savoir… ― Que cela t’apportera-t-il ? On ne peut pas changer le passé. Il le savait. Ça aussi. Depuis l’âge de onze ans. Depuis qu’il avait lu le livre d’Agnès Latin, l’année de son prix Nobel de médecine, l’année où Agnès Latin était devenue son modèle. Son regard se perdit dans celui de Mily. Un instant. Le temps de l’apprécier, de s’imprégner de sa douceur, le temps de le graver dans sa mémoire. … C’est peut-être la dernière fois… ― Je dois savoir, Mily… Après-demain, ça fera un an. Un an passé à poser des questions, à chercher des réponses. Un an à me faire ignorer, à me faire insulter. Mily cassa le regard, les épaules tombantes, les lèvres pincées. Elle avança vers chez elle. Résignée, le pas lourd. Il la suivit. En silence. Cent mètres. Environ. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mily s’arrêta la première, pivota sur sa droite. Il fit le même mouvement. La maison de Mily était en face. Une de ces maisons qui paraissaient moins horribles que les autres. Peinture refaite sur la façade, sur le portail, courette pleine de pots de fleurs entretenues, mais carcasse de voiture rouillée dans un coin du jardin. ― Tu es sûr de toi ? Beaucoup moins qu’il y avait cent mètres. Encore moins qu’il y avait un kilomètre. Mais il le ferait. Pour lui. Et pour Mily. Il hocha la tête, doucement. ― Si tu le fais, je ne viendrai plus te voir. Il souffla. ― Si je ne le fais pas, à quoi cela servirait-il que tu viennes ? Mily ne répondit rien, semblait accepter la fatalité de la situation. Il se tourna vers elle. Si elle ne venait plus, s'ils ne se voyaient plus, il devait le lui dire. Maintenant. ― Mily… Je… Mily leva la main. Pour l’interrompre. Un geste bref, sec. Elle s'y attendait, savait qu'il voulait le lui avouer. ― Il est trop tard, Joshua. Il s'enfonça dans ses prunelles. Elle avait raison. Toujours. Il aurait dû le lui dire trois ans auparavant. Juste après leur quatrième ou cinquième rencontre. Il aurait pu le lui dire aussi après, à leur dixième ou à leur vingtième. Les occasions n'avaient pas manqué. Il y en avait eu, tellement. … Toutes gaspillées... ― Mily… ― Tu aurais dû me le dire avant... Bien avant. Un grincement agressa ses oreilles, l'obligea à en rechercher la source. Un simple regard suffit. Une porte s’ouvrait, de l’autre côté de la rue. Celle de la maison de Mily. Un homme sortit. La cinquantaine, torse nu, ventripotent, vieux short de foot jaune et gris sur les fesses. Monsieur Cousin, le père de Mily. Monsieur Cousin s’immobilisa sur le pas de son entrée, dès qu’il le vit. Son visage changea dans la seconde. Son front se froissa, ses yeux se rapprochèrent, sa bouche rapetissa. La même expression que monsieur Cousin affichait toujours quand il le voyait, depuis un an. Monsieur Cousin ne l’avait jamais aimé. Ça se comprenait. Pour Monsieur Cousin, il n'était qu'un jeune qui tournait autour de sa fille, qu'un jeune du centre de Lapoudrière. Monsieur Cousin ne l’avait jamais aimé, l’aimait encore moins depuis un an. Il resta figé, lui aussi, tétanisé. Monsieur Cousin avait cette carrure imposante qu’on distinguait de loin, avait cet air sévère hérité d’une éducation traditionnelle. Cette éducation traditionnelle se moquait de l'empathie, interdisait de se mettre à la place de l’autre. À ce moment précis, rien ne comptait plus que son sentiment à lui. Monsieur Cousin se retourna, disparut dans sa maison. Précipitamment. Il sentit l’oxygène remplir à nouveau ses poumons, alimenter à nouveau son cœur. ― Je le fais pour toi Mily. Les aboiements de chiens l'entourèrent, les musiques dans les barres d’immeubles derrière lui l'encerclèrent. Et rien d’autre. Il tourna sa tête à gauche. Là où Mily se trouvait. Là où Mily se trouvait encore trois secondes plus tôt. Il n’y avait plus personne. … Elle est partie… Pour de bon, peut-être. Il ne la verrait plus. Cette Mily qui l'accompagnait tous les jours à la sortie du travail, cette Mily avec qui il discutait comme si de rien n’était. Cette Mily qui n’existait que dans sa tête. … Allez… Une profonde respiration. Deux. Trois. Il traversa la rue, s’arrêta au portail de Monsieur Cousin. Il attendit, quelques secondes, immobile, pétrifié. Les réponses se trouvaient juste derrière ce portail, juste à l’intérieur de cette maison, juste à quelques mètres de lui. … Allez… Une profonde respiration. Encore. Pour engranger le courage nécessaire, pour se donner l’élan dont il avait besoin. Ici, pas de sonnette, pas de clochette. Il fallait crier, à la manière des anciens, et espérer qu'on l'entende de l'intérieur. Il ouvrit la bouche, s’apprêta à solliciter Monsieur Cousin. Il ouvrit la bouche, les mots se coincèrent dans sa gorge. Monsieur Cousin sortit au même moment, les yeux tombants, les joues mouillées. Un visage marqué par la tristesse, des mains crispées de colère. Des mains crispées sur le canon d’un fusil. Un canon de fusil levé, droit, fier. Un canon de fusil braqué sur lui. Monsieur Cousin fit deux pas, entre les pots de fleurs, à côté de la carcasse de voiture. ― Casse-toi ! Sa respiration se bloqua, ses muscles se paralysèrent. ― C’est de ta faute, putain !!! Les mots sortaient, tremblants, enveloppés de tristesse. Une tristesse infinie. Une tristesse qui ne trahissait qu’une certitude absolue. ― C’est de ta faute!!! L'adulte 1.1 Le feu. Toujours. Il l'avait réveillé. La sensation arpentait encore chaque recoin de son corps, brûlait sa chair, irritait ses narines. Son crâne lui faisait mal. Atrocement. L'esprit refusait d'obéir, ne se rappelait plus de rien. De rien, sauf du feu. De rien, sauf des cris. Ses yeux s'ouvrirent. Péniblement. Le flou. Tout autour. Il souleva la tête. Difficilement. De la bave avait coulé sur sa joue. Sa main l'essuya. Une bave dégueulasse, pâteuse, gluante. Sa main ne fit que s'en cochonner encore plus le visage. … Saloperie... Ses yeux clignèrent, firent la mise au point. Un peu. Pas suffisamment pour distinguer où il se trouvait. Juste assez pour remarquer le carrelage. Sous son corps. Il reconnaîtrait ces carreaux immondes n'importe où. Il était allongé par terre. Dans son studio. La netteté revint. Totalement. Oui, c'était bien son studio, à Choisy, près de Paris. Et oui, c'était bien de la bave sur le carrelage, partout sur sa joue. Un haut le cœur le traversa. Toute cette bave, cette odeur... … Dégueul... Trop tard. Il vomit, là, le visage à quelques centimètres du sol. Des éclaboussures de dégueulis lui revinrent dans la gueule. Il avait vomi de la bile, l'estomac était vide, rien d’autre à dégueuler. L'acidité lui enflamma le gosier, l'odeur de pourri lui envahit les narines. Vomir était déjà désagréable, vomir du suc gastrique l'était plus encore. Il cracha. Dans son vomi. Pour faire disparaître ce goût acide et âcre de sa bouche. Le goût resta. Évidemment. Les choses les moins bonnes s'incrustaient toujours le plus. Il força sur ses mains, se mit assis. La tête lui tournait. Il se serait bien laissé retomber. S'il n'y avait pas eu ce vomi frais sur le sol. Ses yeux balayèrent son studio. Une bouteille de whisky était allongée par terre, un peu plus loin, près du clic-clac, la moitié de la boisson répandue sur le carrelage, dans une large flaque. Le goût de l'alcool lui revint en bouche, l'odeur au nez. Un haut le cœur. À nouveau. Le spasme le secoua. Il ouvrit la bouche. Encore. Rien ne sortit. Plus assez de bile à déverser. … Ça explique mon état... Il avait dû passer la soirée à boire. Sans doute même. Son estomac n'était pas vide finalement, et ce n'était pas seulement de la bile qu'il avait vomi. Une petite poubelle en acier près de la bouteille de whisky attira son regard. Voilà pourquoi il avait bu. A cause de ce qui se trouvait dedans. Il se leva. Laborieusement. Encore des étourdissements. Un rot le surprit, l'acidité nauséabonde suivit. Une fois de plus. Il fit un pas. Sur sa droite, vers le couloir, vers la salle de bain. Un pas maladroit. Il faillit tomber, se rattrapa au mur. Avoir un petit studio avait du bon. Finalement. Rien n'était trop éloigné pour se rattraper. Surtout avec une gueule de bois. Un pas. Un autre. Les pas les plus difficiles de sa vie. … Plus jamais... L'alcool aidait à oublier. Mais bon dieu que c'était dégueulasse. Dégueulasse à boire. Plus encore à vomir. L'alcool aidait à oublier. À oublier qu'on était un raté, à oublier ces chiffres qui ne collaient pas. Ces putains de chiffres. L'alcool aidait à oublier, oui. Momentanément. Puis on s'en rappelait, terriblement, douloureusement. La salle de bain. Enfin. Il s'accrocha au lavabo, enfouit à moitié sa tête sous le robinet, ouvrit l'eau. Elle coulait, sur son crâne, sur sa nuque, ruisselait sur ses yeux, sur ses joues. Il la sentit sur sa cicatrice, derrière sa tête, en haut du cou. L'eau coulait, à la manière d'un bain de jouvence. Il sentait cette fraîcheur raviver chaque neurone engourdi par l'alcool, faciliter chaque connexion endormie de son cerveau. Il tourna la tête, avala l'eau, rinça cette bouche fétide, nettoya ses yeux pleins de merde. … Du mucus... Du mucus qui aidait à nettoyer les yeux pendant la nuit. Un mucus mélangé à des cellules mortes et une larme. L'homme appelait de la merde un phénomène naturel pour nettoyer les yeux. L'homme était con, guidé par l'ignorance. Depuis la nuit des temps. Et lui était le plus con. Sans doute. Il s'épongea le visage. La serviette sentait le mélange de transpiration et de moisi. Depuis combien de temps s'essuyait-il avec celle-là ? Trop, sans doute. Voilà qui était mieux. Beaucoup mieux. Son foie n'avait pas fini de traiter tout cet alcool ingurgité, prendrait encore plusieurs heures pour le faire. Mais au moins, là, tout de suite, il se sentait mieux. Son poignet se leva. Un réflexe, dicté par le temps. Le temps qui lui manquait, toujours. Il regarda sa montre. Sans bave, sans vomi. Une montre à cinq mille dollars, bracelet cuir, cadran à aiguille incrusté de diamants, mécanisme à quartz. Un vestige d'une autre époque. Les aiguilles indiquaient cinq heures dix-huit. Il était tôt. Le RER C de sept heures pouvait encore être pris. Après s'être douché, s'être préparé, avoir nettoyé ce vomi. Il serait à Paris, dans le Xe, à sept heures trente. Isa serait encore là. … Pour dix minutes seulement… Elle serait là, physiquement. Mais elle ne lui adresserait pas la parole, ne le regarderait même pas. … À quoi bon... ? Mauvaise idée. Encore, toujours. Comme à chaque fois qu'il pensait à Isa. Il revint au salon. La flaque de vomi l'assaillit. De nouveau. En face de lui, le coin cuisine. Un évier, une plaque électrique. Basique. Il attrapa la moitié de cigarette près de la plaque, la mit à sa bouche. Le goût du tabac froid s'incrusta sur son palais, chassa un peu plus celui du vomi. Un regard circulaire à la pièce. Les allumettes étaient sur le clic-clac, à l'autre bout du studio. Il vérifia les extincteurs sous l'évier, comme avant chaque cigarette. Les cinq étaient là. Il n'en revenait toujours pas d'avoir réussi à se mettre à fumer avec ces images tous les soirs, ces cauchemars de feu toutes les nuits. … L'ironie de la vie... La porte du placard se referma. Il fit trois pas, s'assit sur le canapé, prit la boîte d'allumette, la secoua. Encore un réflexe. Un réflexe de fumeur, de stressé. La boite était pleine. Ou presque. Il regarda la petite poubelle en acier juste devant lui. Une pile de papier en débordait. Cent cinquante ou deux cents feuilles. Deux ans et demi de sa vie s'y trouvait. Deux ans et demi d'espoir perdu. Son bras se tendit. Au maximum. Son dos se courba. Jusqu'à lui couper le souffle. Il attrapa la bouteille de whisky par terre, retira la cigarette de sa bouche, la remplaça par le goulot de la bouteille. L'alcool coula dans son gosier. Aussi dégueulasse que la veille. Peut-être plus. … CH3CH2OH... La composition chimique de l'éthanol, l'alcool qu'on buvait tous. Ça, il ne l'avait pas oublié, ne l'oublierait jamais. Il posa la bouteille, craqua une allumette, alluma la demi-cigarette. Il tira une longue bouffée. Une bouffée rassurante. Le docteur Laurent Maillot lui avait dit que ce qui calmait le plus dans la cigarette, c'était cette respiration profonde. Le doc le lui avait dit la première fois qu'il avait essayé d'arrêter. "Pour arrêter de fumer, il suffisait d'enlever la cigarette, de garder cette respiration". … Qu'il vienne essayer lui... Un non fumeur qui explique comment arrêter... La minuscule flamme brûlait toujours le minuscule bois. Il expira, rejeta un nuage de fumée, lança l'allumette. Vers la poubelle. Raté. Il craqua une nouvelle, le feu s’éteignit, craqua encore une autre. Dans la poubelle. Il attendit. Rien. Une nouvelle allumette. Dans la poubelle. Toujours rien. La fumée de la cigarette envahit le studio. Peu à peu. Bouffée après bouffée. À mesure que la cigarette rapetissait. Il avala une nouvelle rasade d'alcool, grimaça. Encore plus dégueulasse. Il se leva, versa le reste de la bouteille dans la poubelle. Sur ces maudites feuilles. Il se rassit. Une nouvelle bouffée. Plus longue, plus profonde, plus rassurante. … Maillot a peut-être raison... Il bloqua sa respiration, retira sa cigarette. Un rouge incandescent consumait le tabac, la nicotine, le goudron, le papier. Il relâcha la fumée, lança la cigarette. Dans la poubelle, lancé réussi. Le feu prit. Instantanément. L'extincteur l'appela. Immédiatement. Machinalement. Il se retint, attendrait le prochain appel. Juste avant que la peur ne se transforme en panique. Les flammes jaillirent. Le papier brûlait, faisait un parfait combustible. Avec ces flammes, plus de deux ans de sa vie, plus de deux ans d'espoir, partaient en fumée. Avait-il eu tort ? Tort de tout changer, du jour au lendemain, tort d'embarquer Isa avec lui ? Il avait été si haut avant, était si bas aujourd'hui. Et il devait tout recommencer. Encore. Tout recommencer, pour Mily. Le vieux 1.1 Le soleil était doux, calme. Un soleil de matin d'hiver. Un soleil qui vous donnait du courage, qui vous procurait un élan nécessaire pour changer le monde. Le soleil éclairait un ciel bleu. Un bleu apaisant, abaissant toutes vos barrières. Du blanc tachetait ce bleu, somnolait, ici et là dans ce ciel. Des nuages. Certains denses, opaques, d'autres fins, égrainés. Tous reposants. Des nuages totalement blancs. Tous. Sauf un. Là-bas, celui de droite, sans forme distincte. Un nuage blanc marquée d'une ombre noire. Une petite ombre. Un avion, immobile. L'ombre n'avançait pas sur ce fond blanc, l'avion ne se déplaçait pas dans ce ciel bleu. La caresse arriva ensuite. Une caresse infinie, une douceur posée sur son visage. Délicatement. Une douceur obligeant à déposer les armes, à cesser de lutter. La douceur d'une brise figée, d'un souffle immobile. Il la ressentait. Cette sensation qu'il ne connaissait pas encore, qu'il pensait ne jamais connaître. Il la ressentait. Enfin. La liberté. Une liberté où rien ne pouvait vous arriver, où rien ne pouvait vous atteindre. La liberté où vous étiez seul à décider. Sans aucune contrainte, sans personne pour vous aiguiller, pour vous diriger. Les musiques s'élevèrent soudain, haut dans le ciel. Du R'n'B, du rap, du zouk. Il apprenait à les connaître. Elles prônaient la vie, plus que tout, donnaient l'impression d'exister, d'avoir une destinée. Elles poussaient à danser, à extérioriser, interdisaient la réflexion, bannissaient l'introspection. Elles enivraient l'esprit, travestissaient la réalité. Des voix se mélangeaient aux musiques. Non, pas des voix, des cris. Des femmes engueulaient des enfants. Des hommes engueulaient des femmes. Des cris enveloppés de frustration, où l'on déversait son incapacité à diriger sa vie sur les autres, sur les plus faibles que soi. Une fumée, à gauche. Une colonne noire essayait d'atteindre le bleu du ciel, de le souiller. Une fumée funeste, éparse. Rien de naturel, on ne trouvait pas ce genre de fumée dans la nature. L'odeur l'accompagna, rapidement. Une odeur de pneus brûlés, de plastiques incinérés. Une odeur de feu, pas loin. Un feu de poubelle, sans doute. Ou un incendie de bâtiment. Tout aussi probable. Surtout ici. Un immeuble lui faisait face, obstruait sa vision. En partie. Un immeuble massif, inerte. Un immeuble pitoyable. Les peintures s'effritaient, par plaques. Les murs se fissuraient. Les fissures se transformaient en entailles. Lapoudrière, toujours la même, ne changerait jamais. Il était là, dans son quartier. À nouveau. Là où tout avait commencé, après tout ce qu'il avait fait. Il était au bon endroit, au bon moment. Pour être heureux. Son cœur se souleva. Tout à coup. Pour la première fois. Un cœur fragile, faible. Un cœur pas encore endurci, qui n'en avait pas eu le temps. Les nuages bougèrent, le vent souffla, la fumée monta. Des visages apparurent. À la fenêtre de l'immeuble, en face de lui. Des visages sans contour compréhensible. Les traits s'affinèrent rapidement, devinrent plus singuliers. Il reconnut un des deux visages. Le seul qu'il connaisse vraiment. Le seul qu'il connaisse par cœur. Maman. Un visage encore juvénile, comme il ne le lui avait jamais connu. Des traits encore souples, arrondis. Un visage qui repoussait la vieillesse, un visage qui n'avait pas peur du temps à venir. Maman était là. Encore, toujours. À la fenêtre, bouche grande ouverte. Son visage était crispé, déformé. Elle poussait un cri, un cri strident. Ce cri lui faisait du bien, le remplissait de bien être. Le bon endroit, le bon moment. À côté d'elle, un homme. Le regard hébété, niais, vide. Vide de tout. De pensées, d'intelligence, de sentiments. Un homme qu'il n'avait jamais vu, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas envie de connaître. Un homme au visage moins jeune, au visage plus tracassé, au visage plus marqué par la vie. Non, au visage plus marqué par sa vie. Le visage de Maman rapetissait, celui de l'homme s'évanouissait. Il s'éloignait, volait. Avec une liberté plus grande encore. Une liberté absolue. Cette liberté où vous étiez maître de vous, maître de votre destin. Celle où vous saviez que plus rien ne pouvait vous arriver, ne pouvait vous toucher. Quoi qu'il advienne. Sa vue se brouilla. Subitement. Il ne distingua plus rien, ne comprit plus les sons qui l'entouraient, les odeurs qui l'enveloppaient. Il ne resta que la voix. Une voix fébrile, usée. Elle venait de partout et de nulle part à la fois, parlait dans une langue étrangère, dans une langue qu'il comprenait malgré tout. « Tu sais ce que tu dois faire ». Maman 1.1 Les articles passaient, les uns après les autres, toujours les mêmes, ou presque. Des articles à bas prix, au niveau du sol dans les rayons. Les bips s’enchaînaient. Comme les "bonjour", les "merci", les "au revoir", les "bonne journée". De huit heures trente à dix-sept heures trente. Quarante heures par semaine. Quarante heures payées trente-cinq, payées au salaire minimum. L'extrême minimum. … Je ne le ferai pas toute ma vie... Non. Jamais. Une vie à faire ce métier ne serait pas une vie. Trois mois seulement et elle en avait déjà marre. L’enthousiasme du début avait disparu, derrière la monotonie de la tâche, obstrué par sa pénibilité. Mais c'était un travail, avec un salaire. Un premier pas pour s'en sortir enfin, pour arrêter de s'apitoyer sur son sort. S’en sortir… Son vœu le plus cher, depuis qu'elle s'était rendue compte de sa vie pauvre, misérable. Elle se le rappelait parfaitement, de ce jour où elle avait ouvert les yeux. Elle se le rappelait très bien. Un samedi, le jour de ses treize ans. Elle avait été invitée par Caroline, chez Caroline, dans sa grande maison. Une maison de riche. Avec une grande chambre et une salle de jeu attenante, un grand jardin et une piscine éblouissante. Elle avait adoré cet anniversaire, ce temps passé avec ses amies, à parler garçons, sexe, à essayer des vêtements, à se maquiller. Elles avaient fini par manger son gâteau d'anniversaire, dans la chambre, en dansant sur Saga Africa du beau Yannick Noah, en chantant Désenchantée de la mystérieuse Mylène Farmer. Son plus bel anniversaire. Assurément. L'anniversaire avait pris fin trop vite à son goût. Vers seize heures trente. Les parents de Caroline l'avaient raccompagnée chez elle, rue des Aglets, Lapoudrière. Dans leur grosse voiture. C'est là qu'elle avait pris sa misère en pleine face, au moment précis où elle était descendue de la voiture. Elle avait posé les yeux sur sa maison. Une vieille maison de ville, collée à d'autres vieilles maisons de ville. Chacune d'entre elles était une honte. Ensemble, bien pire. Toutes avaient un jardin minuscule aux herbes brûlées par le soleil. Dans son jardin à elle, pas beaucoup d'herbes desséchées. Papa n'en laissait pas l'espace, utilisait les deux tiers de la surface pour y faire dormir son bordel. Des ferrailles trouvées dans les dépôts d'ordures sauvages, principalement, ou retrouvées en bord de mer, parfois. « Ça peut toujours servir », qu'il disait à Maman à chaque nouvelle trouvaille. Ça ne servait jamais. Évidemment. Elle avait laissé les parents de Caroline faire demi-tour, s'éloigner. Loin. La voiture faisait tâche dans la rue. Trop belle, trop neuve, pas assez bruyante. Elle avait laissé la voiture tourner à droite sur le boulevard Lancastel. Après seulement, elle était rentrée chez elle, avait poussé le petit portail, avait eu de la vieille peinture caillée plein les mains. Tout lui avait alors paru fade. Sans couleur, sans chaleur. Non, plus que ça. Tout lui avait paru sale. Immonde, presque. Comme les photos d'Afrique que son professeur d'Histoire-Géo passait en longueur de cours. C'est ce jour-là qu'elle avait pris la décision. Celle de refuser cette vie. La vie de ses parents, des habitants de la rue, de tous les habitants de Lapoudrière. C'est ce jour-là qu'elle avait pris la décision de refuser cette vie, par tous les moyens. Elle n'avait jamais été bonne à l'école. Toujours dans les derniers de la classe au primaire, encore moins haut au collège. Elle aurait pu être parmi les meilleures. Elle comprenait les leçons, mais n'avait pas envie d'apprendre, préférait la télé, la radio, les magazines. Et Papa ne l'aidait pas pour l’école. Trop occupé à farfouiller les dépôts sauvages. Maman non plus ne se souciait pas de ça. Trop de ménage, de repas, de télé-novelas. Trop enracinée dans ce mode de vie volé à Mémé. Ce ne serait pas grâce à l'école qu'elle s'en sortirait. Impossible. Elle l'avait compris tout de suite. Cet après-midi-là, chez Caroline, entre robes et maquillages, elle s'était trouvée belle. Très belle. Bien plus belle que ses amies, bien plus belle que n'importe qui au collège. Même cette grande pimbêche de troisième, Alivia. La solution lui avait alors paru évidente. Voilà ce qu'elle avait envie de faire, ce qu'elle ferait. Mannequin, ou top modèle, ou miss. Voilà comment elle s'en sortirait, comment elle aurait une belle vie. Encore mieux que celle de Caroline. Elle l'avait dit à Maman. Le soir même. Maman avait ri. Dans sa gueule. « D'abord l'école » avait-elle répondu après sa crise de rire. Maman n'avait rien compris à ce qu'elle voulait. Pas plus que Papa. Maman s'était chargée de le lui répéter. Mais Papa, ce n'était pas Maman. Il s'était énervé, l'avait traitée de conne, d'idiote. Elle se rappelait de la douleur de ce moment. Encore maintenant. Huit ans après. Ses parents croyaient que la vie se délimitait de la rue Aglet à la rue Michel Roulet, étaient persuadés que la vie s'arrêtait à Lapoudrière. Ils ne voyaient pas plus loin que l'instant présent. Un présent qui n'existait déjà plus lorsqu'ils l’appréhendaient. Elle avait été la seule à y croire. La seule. Elle s'était mise à copier le style des filles qu'elle trouvait belles. Celles qu'on voyait à la télé, celles qu'on trouvait au lycée juste à côté. Sa garde-robe se renouvela. Petit à petit. Vêtement après vêtement. Au fil des bourses scolaires versées pour elle. Adieu les robes à fleurs, les culottes rose bonbon. Bonjour les décolletés, les mini-jupes, les strings. Les têtes s'étaient vite retournées sur elle, à mesure que sa poitrine avait gonflé, à mesure qu'elle la mettait en évidence. Celles des filles jalouses, celles des garçons affamés. Celles des hommes aussi. Elle plaisait, beaucoup, avait atteint son but... Trop. Les garçons l'abordaient. De plus en plus. Des garçons en scooter, des garçons avec leur zamal entre les lèvres, qui n'avaient rien de mieux à faire que de traîner devant le collège toute la journée. Ceux-là, elle ne leur répondait même pas. Il ne fallait pas leur répondre, tout le monde le savait. Quatrième, troisième. Au revoir collège, bonjour lycée. Elle avait choisi un bac pro. La branche des métiers de la mode. Raté, pas une assez bonne moyenne pour y avoir une place. Elle s'était rabattue sur un CAP coiffure. Raté, plus de place non plus. Elle s'était retrouvée dans un CAP espace vert. Un CAP qu'elle n'avait même pas demandé. Elle s'était retrouvée dans une classe de tarés, sans autre ambition que d'en finir avec l'école, pour pouvoir toucher les allocations. Mais elle avait continué, continué à croire en ses rêves. À y croire toute seule. À mal y croire. Jusqu'à finir ici. Sur ce siège qui faisait mal au cul. ― Bonjour. La voix la ramena aux bips, aux articles scannés. Une voix entre aigus et suave, peu commune. Elle attrapa la barre qui séparait les articles des clients, la fit glisser dans les rails à côté du tapis. ― Bonjour. Un bonjour réflexe. Le même qu'elle lançait deux cents fois par jour. Sa tête se leva. Sur le client. Sur l'homme. Un homme souriant, le regard plongé dans les yeux. Un regard qu'elle connaissait, dont elle avait déjà vécu l'issue, plus d'une fois. Un regard dont elle ne se défit pas. Le jeune 1.2 Ses jambes tremblaient, fébriles. Il s'assit, précipitamment, dans le fauteuil blanc à sa gauche. Ses forces le lâchaient, l'adrénaline coulait de moins en moins dans son sang. Il n'aimait pas s'asseoir dans ce fauteuil, n'aimait pas venir ici. Trop blanc, trop propre, trop aseptisé. La lumière tamisée vous faisait angoisser, l'odeur des produits ménagers vous donnait envie de vomir, l'air conditionné vous interdisait de respirer. Non, décidément, il n'aimait pas venir ici. Mais il y était obligé. Encore plus maintenant. … C'est de ma faute... La phrase avait tourné dans sa tête tout au long du trajet. « C'est de ta faute ». Monsieur Cousin l'avait dit avec la voix cassée, les joues mouillées, une tristesse avouée. Monsieur Cousin s'était livré, avait montré ses sentiments. Une mise à nue émotive jamais dévoilée auparavant, interdite par une éducation archaïque. Mily le lui avait assez répété, Monsieur Cousin était un de ses pères qui ne montraient aucune affection, qui ne prononçaient aucun compliment à ceux qu'il aimait. Cette mise à nue émotive garantissait obligatoirement la véracité de ses mots, de ses paroles. « C'est de ta faute ». … Pourquoi... ? ― Qu'est-ce qu'il t'est arrivé ? Il fixa Mily, en face de lui. La vraie Mily. Pas celle imaginée, rêvée. Mily regardait devant elle, droit devant. Ses yeux ne clignaient pas, ne bougeaient pas. Elle ne répondrait pas, ne répondait jamais. Depuis un an. Seuls les bruits lui offrirent une réponse. Les bips réguliers, le ronflement de la pompe aux montées et descentes infinies, le bourdonnement de l'aspirateur à salive. Des appareils agrippés à Mily par des électrodes sur la tête, sur la poitrine, par des seringues dans le bras, dans le ventre, par des tuyaux dans la bouche, dans le nez. La voilà, la vraie Mily. Faussement en vie, artificiellement vivante. Une vie que ces machines retenaient depuis bientôt un an, depuis cette nuit. Cette nuit maudite. *** Les lumières bleues clignotaient, troublaient le noir profond de la nuit. Encore. Il connaissait ces lumières. Tout le monde les connaissait ici. Le ciel de Lapoudrière en était troublé tous les soirs, toutes les nuits. Des scintillements d'ambulances, de véhicules d’urgence, de pompiers. Il remontait la rue de la Merde. Première fois aussi tardivement. D'habitude, il le faisait vers vingt-deux heures trente. Là, il devait être minuit et demi. La faute à Léon, son patron. Il l'avait appelé un peu avant vingt-deux heures, en panique, ne pouvait pas venir tout de suite, devait être remplacé. Il avait accepté, immédiatement. On ne refusait rien à son patron, à celui qui vous donnait mille cinq cents euros tous les mois. Marcher dans cette rue à minuit et demi une fois de temps à autre était une bien petite contrepartie en échange de mille cinq cents euros tous les mois. On parlait fort autour de lui. Un peu partout, au bas des immeubles. Les gars fumaient leur zamal, avalaient quelques gorgées de plus de whisky-coca. Leur ivresse serait bientôt au summum, redescendrait ensuite, jusqu'à disparaître vers trois heures trente, quatre heures du matin, leur signalerait le moment d'aller dormir. Il arriva à l’intersection de la rue de la Merde et de sa rue, tourna à droite. Devant son immeuble, trois gars et deux filles discutaient incompréhensiblement. Il entra dans son bâtiment parfumé à la pisse, monta à son étage aromatisé au zamal, pénétra dans son appartement. Les sanglots l'avertirent. Directement. Maman était assise à table, dans le noir. Elle aurait dû être dans son lit, en train de dormir, pour se réveiller dans quelques heures, à cinq heures. Mais elle était là, à presqu'une heure du matin, en pleurs. … Pépé... Assurément. Seul Pépé pouvait la rendre aussi malheureuse. Seule la mort de Pépé. … Enfin... Le soulagement, l'unique sentiment qu'il ressentit. Il fit un pas. Maman se leva, courut dans ses bras, s'y réfugia. Il la dépassait d'une bonne tête, depuis ses quinze ans. Première fois qu'elle cherchait ainsi du réconfort auprès de lui. Les larmes de Maman mouillèrent son tee-shirt à lui, son corps transmettait au sien les spasmes saccadés de la tristesse infinie. ― Maman... Il n'aimait pas Pépé, le détestait, ne comprenait pas l'amour que lui avait toujours porté Maman. Mais il détestait encore plus voir Maman dans cet état. Maman tenta de reprendre son souffle, comme elle le put, de maîtriser ses spasmes. ― Je suis désolée, Jo. … Quoi... ? Il la repoussa, délicatement, à bout de bras. ― Calme-toi... Pourquoi tu es désolée ? Encore un spasme. ― Marie vient de m'appeler... Marie ? Sa collègue de travail ? La voisine des Cousin ? ― Émilie a eu un accident. Elle est à l’hôpital, dans le coma. … Mily... Il ferma les yeux. Le silence le compressa, le noir le comprima. Il rouvrit les yeux, aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bellepierre. Le jour était sur le point de se lever. Il se trouvait assis, sur un banc en pierre, juste devant l'entrée, sans aucune manière d'expliquer comment il était arrivé ici. Il leva ses mains, pour se frictionner le visage. Son mouvement s'arrêta, quelque chose était inscrit dans sa paume gauche. « 3e ». … Un numéro de chambre ?... Non, d’étage... Il se leva, entra dans le bâtiment à sa droite, suivit les indications des pancartes, longea cinq couloirs, emprunta un ascenseur, arriva au troisième étage. La première porte à gauche était ouverte. Il frappa doucement, à peine, du bout des doigts. ― Entrez. Un « entrez » trop doux pour être celui de Monsieur Cousin. Il suivit la permission. Deux infirmières tapaient sur des ordinateurs portables dans un coin. Le reste de la pièce n'était qu'un long couloir formé par des rideaux bleus tirés. Un homme en blouse blanche attendait un peu plus loin, avec un sourire désolé. ― Vous venez voir mademoiselle Cousin ? Il hocha doucement la tête. L'homme en blouse blanche lui fit signe d'approcher de la main, écarta légèrement le rideau quand il arriva à sa hauteur. Mily était allongé sur un lit, dans ce minuscule box. Des fils allaient et venaient autour d'elle, des machines ronflaient derrière elle. Il s'approcha. Elle avait les yeux ouverts. Ouverts et immobiles. Sans battements de cils, sans mouvements des pupilles. ― Elle s'est réveillée, il y a deux heures environ... Il se tourna vers l'homme, lu son nom et sa fonction sur le badge de sa poitrine. « Docteur Mauve, neurochirurgien ». ― … Sortir du coma rapidement est une bonne nouvelle. Cela réduit le risque de séquelle grave. Il est encore trop tôt pour savoir si ceux-ci seront importants ou non. Plusieurs tests doivent être passés et analysés avant de juger. ― Qu'est-ce... Que lui est-il arrivé ? ― Vous êtes de la famille ? Il balança la tête. ― Son... Un ami. ― Seule la famille peut être mise au courant des causes de son arrivée ici. Je vous conseillerais de vous rapprocher de celle d’Émilie pour en savoir plus. Mais je peux vous dire que le meilleur moyen d'aider Émilie à partir de maintenant, à votre niveau, est de lui parler, beaucoup. Son cerveau doit être stimulé le plus possible… *** Docteur Mauve lui avait parlé encore cinq bonnes minutes. Au moins. Il n'avait plus écouté, trop choqué, trop triste. Il avait regardé Mily, allongée, immobile, momifiée. Mily avait fini par quitter ce box de toile, avait été transférée dans la chambre 308, un étage plus haut. Il y était venu. Tous les jours, ou presque, pendant un an. Parfois en début d'après-midi, avant de commencer sa journée, parfois en fin de journée, après avoir quitté le boulot. Il était venu, s'était arrangé pour ne jamais croiser Monsieur Cousin. Parce que Monsieur Cousin ne l'aimait pas, comme tous les membres de la famille de Mily. … Normal, s'il pense que c'est de ma faute... Pendant un an, les conseils du docteur Mauve étaient restés gravés dans sa mémoire. Son cerveau doit être stimulé le plus possible. Il avait parlé à Mily, lui avait fait entendre sa voix, avait stimulé ce cerveau. Tous les jours, il avait raconté des histoires banales, inintéressantes, sans savoir s'il parlait à un cerveau éveillé ou non. À chaque arrivée, il avait caressé l'espoir inavouable de retrouver Mily parfaitement réveillée. À chaque départ, il s’enfonçait toujours avec une déception sans limite. En une année, rien n'avait changé. Mily était toujours dans ce fauteuil, à regarder droit devant elle, entourée des mêmes bruits effrayants. … Rien n'a changé, rien ne changera… Qu'il soit là ou non. Espérer et croire ne changeait que la perception de la réalité, pas la réalité elle-même. Et la réalité était que Mily était encore dans le coma, sans possibilité de savoir si elle avait une chance de s'en sortir. … A quoi bon venir dans ce cas... ? À rien. La voir dans cet état le faisait souffrir. Encore plus maintenant que Monsieur Cousin lui avait dit que tout était de sa faute. Il fixa Mily, ses yeux sans expression, son visage sans vie. Il se leva. La décision était prise. Définitivement. … Excuse-moi... Il s'approcha d'elle, l'embrassa sur le front. Comme tous les jours, ou presque, depuis un an. Un baiser à la saveur différente des fois précédentes, à la saveur plus forte, plus prononcée qu'un au revoir. À la saveur d'un adieu. … Je suis désolé... Il pourrait le lui dire, qu'elle l'entende ou non, de façon symbolique. Mais il y renonça. À cause du doute de ce qu'il se trouvait derrière ces yeux immobiles. Un esprit mort ? Un cerveau en ébullition, à la limite de la folie ? Si seul le corps ne répondait plus, comment réagirait l'esprit s'il lui disait qu'il ne viendrait plus jamais la voir ? Son esprit s’agiterait, se débattrait, crierait de ne pas la laisser seule avec elle-même. Une agitation sans mouvement, des cris sans bruit. Non, il ne ferait pas ça, ne pouvait le lui dire. Il ouvrit la porte de la chambre. Dehors, les voix d'infirmiers hantaient le couloir. On les entendait toujours, ne le voyait jamais. Ou presque. Il posa un pied dans le couloir. Une porte en face de lui s'ouvrit. Une porte à laquelle il n'avait jamais prêté attention. Une femme sortit, le téléphone collé à l’oreille, l’inquiétude scotchée au visage. ― … Reste où tu es, j’arrive dans dix minutes. La femme ferma la porte, mima un bonjour dans sa direction, fila dans le couloir, vers l’ascenseur. Il attendit, immobile, un pied dans le couloir, le reste du corps dans la chambre. Il hésitait à la quitter, avait encore quelque chose à lui dire, à lui avouer. Pas qu'il ne viendrait plus. Ce qu'il devait lui dire maintenant, il n'avait jamais réussi à le lui avouer avant. Même à la Mily de son esprit. Il se retourna dans l’encadrement de la porte. Mily le fixait. Au niveau du ventre. Difficile de le dire quand on ne vous regardait pas dans les yeux. ― Mily… Un éclair traversa son esprit. Une connexion synaptique à retardement. La plaque fixée sur la porte que la femme en tailleur venait de fermer. Il tourna la tête, regarda dans son dos. La plaque portait l’inscription « secrétaire du docteur Mauve ». ― … je… Cette porte donnait sur le bureau de la secrétaire du docteur qui s’occupait de Mily. Un docteur qui devait constituer un dossier médical pour chaque patient. Il revoyait la femme partir, tracassée, pressée. Il la revoyait ouvrir la porte, sortir de son bureau, la rabattre sur son bâti. Sans vérifier qu'elle était bien fermée. Il vérifia, du regard. La porte était légèrement entrouverte.
63
« Dernier message par Apogon le jeu. 18/08/2022 à 17:52 »
Comment naissent les étoiles de Lola Swann Pour l'acheter : AmazonPetite étoile Petite étoile est née Une nuit de janvier Le visage poupin Les joues roses à croquer Dans ses traits l’on perçoit Une expression d’antan Les beaux yeux, le minois D’une étoile née avant Cette étoile la berce Juste avant de dormir Lui raconte des histoires Fait éclore son rire Petite étoile grandit Sous un ciel ténébreux Son étoile adorée Bientôt bannie des dieux Petite étoile l’efface Pour ne pas avoir mal Peu à peu elle oublie Celle qui l’a tant chérie Peu à peu elle oublie Sa douce voix, son sourire Se remémore seulement Qu’un jour elle est partie Petite étoile ne sait Ou ne veut plus savoir Qu’un cœur pour elle jamais N’avait battu si fort *** Hurler sans bruit La première fois que Lila a écrit, ce n’était pas pour être lue. Elle devait écrire des lignes de lettres en attaché sur son cahier – tout le long la même lettre, et qui changeait chaque jour – pour apprendre à bien les former. Puis elle a écrit son prénom, un L, un I, à nouveau un L puis un A. Rien de plus facile. Ses leçons ensuite. Puis des poèmes pour ses parents. C’est peut-être à ce moment-là que tout a commencé… L’occasion n’était qu’un prétexte. Lorsque Lila avait quelque chose à dire, elle ne le disait pas ; elle l’écrivait. La chose la plus essentielle qu’elle avait à dire ne se disait pas dans sa famille. On ne lui avait jamais dit à elle, personne ne l’avait jamais dit à personne, pas même sa maman à son papa, ou son papa à sa maman. Mais Lila, du haut de ses dix ans, ne savait même pas que c’était tout ce qu’elle avait à dire, au fond. Et peut-être tout ce qu’elle aurait eu besoin d’entendre, aussi. Alors, en vain, elle tournait autour du pot. D’une coquette façon, symbolique et ingénue, elle écrivait que même si elle raffolait des fraises, c’était sa maman qu’elle préférait. Dans ses poèmes pour elle, Lila lui prêtait des qualités qu’elle ne possédait pas, ou qui se faisaient bien rares. Sa maman était évidemment la plus belle et sentait le parfum des fleurs. Sa maman ressemblait à une fée et était d’une gentillesse à couper le souffle. Sa maman était la plus douce créature qui soit, tel un ange qui aurait atterri par mégarde sur la Terre. Comme tous les enfants, Lila l’idéalisait, surtout le jour de la fête des mères. Quand venait celui de la fête des pères, c’est son papa qui devenait un héros : le plus fabuleux de tous les papas du monde. On aurait pu croire qu’elle mentait si l’on avait été témoin de la réalité de son enfance, mais dans le fond de son cœur, la jeune Lila ne mentait pas. Tout ce qu’elle décrivait à propos de ses parents, elle l’avait entraperçu au moins une fois, elle en avait vu des bribes lors d’un jour enchanteur, elle en avait glané un soir magique une miette dorée. Et puis, à partir de cette seule miette, elle avait fabriqué du pain chaud. Un pain cuivré, à la fois tendre et croustillant, dont la mie moelleuse fondait sous le palais. Tous les jours, elle en confectionnait ; tous les jours, des mots d’amour sortaient du four. Inlassablement. À ses amies aussi, Lila écrivait. Des lettres par dizaines, pour les vacances, pour leur anniversaire, Noël, la nouvelle année, Pâques, la fin de l’école, la rentrée… Encore une fois, chaque occasion était un prétexte à choisir son plus beau papier à lettres et à faire éclore des mots dessus à l’aide de son magnifique stylo à plume. Lila s’appliquait jusque dans l’écriture de l’adresse et le collage du timbre ; rien n’était laissé au hasard, pas même la petite fleur rose dessinée sous sa signature ou le croquignolet cœur violet dans le coin droit en bas – symboles, couleurs et emplacements changeant selon l’inspiration de l’instant. Lorsqu’elle avait de beaux autocollants – fleurs, étoiles, oiseaux, papillons… –, la petite fille n’hésitait pas à en agrémenter généreusement ses lettres. Quand tout était fin prêt et envoyé, Lila n’avait plus qu’à attendre. L’enfant se réjouissait, rien que d’imaginer son amie en train de recevoir sa lettre, de l’ouvrir avec délectation et puis de la lire, enfin. Et, dans une impatience mêlée d’ivresse, Lila attendait la réponse. C’étaient des échanges qui duraient de longs et heureux mois, parfois même des années, puis qui, un jour, s’essoufflaient. Les amies d’antan avaient quitté l’école de Lila, voire la ville où elle résidait, depuis longtemps désormais et elles s’étaient enfin acclimatées : la correspondance n’avait plus lieu d’être à un moment donné. Quand leurs nouvelles amies, supposément, leur devenaient aussi précieuses que Lila pour elles l’avait été. Et Lila était oubliée. Mais Lila ne pleurait pas parce que cela se faisait si doucement, si délicatement, qu’on ne s’en rendait presque pas compte. La nouvelle lettre mettait juste un peu plus de temps que la précédente à arriver, elle était peut-être légèrement moins longue ou moins enjouée, quelque chose transparaissait dans les mots choisis, dans les formules convenues ; l’amie et elle étaient devenues des étrangères. Alors naturellement, le lien se défaisait, mais cela ne faisait pas mal. C’était juste une toute petite piqûre dans le cœur, à peine perceptible. Lila conservait malgré tout l’ensemble des lettres reçues par l’amie évanescente, et en relisait de temps à autre quelques-unes avec nostalgie. Puis Lila avait collectionné les amies d’antan et les amies de vacances, et leurs lettres. Au fil du temps, les amies changeaient mais les lettres demeuraient. Lila, elle, ne changeait pas ; si aucun lien avec quiconque jamais n’avait été coupé, elle aurait probablement continué d’entretenir chacune des correspondances. Car chaque amie était unique et chacune occupait une place en son cœur. Un jour – l’enfance était déjà presque finie –, l’ordinateur est arrivé dans le monde, puis à la maison. L’on y allait pour écrire des mails et c’était rigolo. Lila pouvait écrire à sa meilleure amie qui habitait à quelques rues à peine de chez elle et qu’elle avait déjà vue tout le jour au lycée, pour lui dire tout et n’importe quoi, et recevoir en très peu de temps, le soir même assurément, une réponse. Les mails pouvaient être imprimés et l’on gardait la trace de ce message qui n’avait plus rien d’une lettre écrite au stylo à plume avec des petits cœurs partout, mais ressemblait à n’importe quel polycopié de cours, du moins de loin : lettres carrées à l’encre noire sur fond blanc. C’était grisant, un peu comme de jouer à se parler dans un talkie-walkie. Inutile et futile mais quel enchantement que de pouvoir communiquer ainsi. La magie est retombée peu à peu, puis tout à fait, lorsque l’adolescente a découvert le pot-aux-roses : les mails étaient si pratiques qu’on n’utilisait plus que ça. Les lettres venaient de rendre l’âme. Pour autant, Lila ne s’est pas complètement fait avoir. Les mots écrits n’ont jamais entièrement disparu pour elle. Malgré la suprématie des mails, et bientôt des textos, les lettres ont refleuri sous forme de petites cartes mignonnettes dénichées dans les papeteries. Les occasions se faisaient plus rares cependant ; écrire pour écrire – vraiment – n’était plus dans l’air du temps. Mais sa passion s’est transmise d’une étonnante manière au gré des années à celles et ceux qu’elle gâtait de ses mots… Et Lila, elle aussi, s’est mise à recevoir d’adorables cartes pour son anniversaire et pour Noël, des cartes d’amis, d’amoureux, de petits enfants qu’elle gardait… Puis un jour, Lila a voulu écrire. Pour personne en particulier. Juste écrire. Afin de mettre en forme ses pensées, comme elle avait mis en forme petite fille la courbure des lettres calligraphiques sur son cahier d’écolière. C’était un exercice prenant, difficile, essentiel. Cela semblait partir de rien, comme quelque chose né sans racine ; cela semblait n’aller nulle part, tel un brin d’herbe qui pousserait indéfiniment jusqu’à heurter le ciel. La chose n’avait pas vraiment de sens non plus, c’était sibyllin, ondoyant, nébuleux, parce qu’il fallait pour qu’elle appréciât le rendu de ses dires, se relire, se relire, et peaufiner ses mots, en structurer le fil, un par un, virgule après virgule, point après point. Et puis, à un moment donné, quelquefois mais pas toujours, le message prenait forme, il était devenu ce qui se rapprochait le plus de ses pensées. Un peu comme, pour un musicien, le fait de transformer le solfège en des notes de musique. Audibles. Lila était le piano qui métamorphosait le magma de ses pensées en des mots. Intelligibles. Des mots soyeux tels des arpèges ondulant pianissimo, et des mots graves, percutants, tels des accords fusant fortissimo. Néanmoins, la musique a cela de plus que les mots qu’elle ne délimite pas de contours. Or, les mots renferment intrinsèquement la pensée, puisqu’ils la composent. C’est tout le problème avec l’écriture, toute la difficulté, toute la subtilité. Bien qu’elle aimât la mélodie des mots, Lila était pleinement consciente des limites du langage. Celui-ci, dès lors qu’il était acquis, semblait retirer quelque chose à l’humain. Peut-être bien que sans la parole, les hommes auraient été télépathes, songeait-elle de loin en loin. Il existait sûrement à l’origine un langage infiniment plus riche que celui offert par les mots. Peut-être bien que les bébés pleurent parce qu’ils s’expriment en pensées, en vain, à des adultes qui ne les écoutent pas. Puisque personne ne les entend ni ne peut les comprendre ces pensées-là, non faites de mots. Peut-être bien que c’est la raison pour laquelle on ne peut se remémorer un événement vécu dans la prime enfance ; le système de pensées que nous possédions alors allant bientôt être annihilé par l’apprentissage du langage, effaçant les souvenirs d’avant la parole. C’était le principal souci de Lila lorsqu’elle écrivait, elle devait se limiter aux mots. Or les mots ne suffisaient pas. Il manquait quelque chose. Mais quoi ? Comment raconter la pluie lorsque celle-ci est si fine et le temps si clément qu’elle est comme une caresse sur la peau ? Comment raconter l’orage, grondant si fort que l’on a peur et qui pourtant nous apaise, comme s’il exprimait toute la colère tue en nous ? Certes, en l’expliquant ainsi, la chose peut être appréhendée. Mais les mots pluie ou orage renferment intrinsèquement des conceptions – gris, froid, tristesse… – qui pouvaient aller à l’encontre de ce qu’était parfois la pluie ou l’orage pour Lila. Les mots orientent de façon immanente vers une idée, un sentiment. Aussi Lila devait-elle tout décortiquer, retirer le sens premier ou au contraire le mettre en exergue afin de transcrire fidèlement ses pensées. Non, vraiment, si elle avait appris le solfège enfant, elle était certaine que le piano l’aurait rendue mille fois plus libre de s’exprimer que ne le faisaient les mots. Mais Lila n’avait que les mots. Les mots écrits. Alors Lila écrivait. Encore et encore. Dans ses écrits, le cœur de Lila était complètement à nu, bien qu’elle ne parlât pas tout à fait d’elle-même, ni tout à fait de quelqu’un d’autre. Sa plume était une âme qui s’adressait au monde. Une âme qui avait un vécu, et, certes, ce vécu pouvait transparaître en filigrane çà et là. Mais ses mots allaient au-delà de ce qui a pu être vécu ou imaginé, ils fouillaient le champ des possibles, ils sublimaient un ciel gris, faisaient d’un orage un arc-en-ciel, transformaient un cauchemar en rêve, une peur en cauchemar, un rêve en réalité, un drame en poème, un poème en déclaration d’amour. Seule persistait l’essence. L’essence de son cœur. Les mots de Lila étaient l’huile essentielle de son âme.
64
« Dernier message par Apogon le mar. 09/08/2022 à 13:07 »
65
« Dernier message par marie08 le mar. 09/08/2022 à 09:50 »
Pour avoir lu presque tous les romans de Anne-Marie Bougret, (un seul manque à ma liste) dont le prequel de ce thriller : L’invitation, que j’ai adoré, j’étais certaine de ne pas être déçue. C’est donc avec un grand plaisir que j’ai retrouvé la plume fluide et dynamique de cette auteure. Avec ce thriller, Anne-Marie nous entraîne dans un road-trip haletant à travers les USA. Le couple Stephen et leur fille Stessie mènent une vie sans histoire, jusqu’au jour où Stephen, le mari est assassiné. Dès lors, Vanessa, sa femme, et sa petite fille sont entraînées dans une course poursuite jalonnée de cadavres. Intrigues, complots et meurtres sont au programme de ce roman dont les rebondissements sont aussi nombreux que surprenants. Arrivera-t-elle à se sauver avec sa fille ? Vous ne le saurez qu’en lisant cet excellent roman que je vous recommande vivement. Merci Anne-Marie pour m’avoir fait haleter. Et bravo pour ce roman. https://www.amazon.fr/Dossier-explosif-Mme-Anne-Marie-Bougret/dp/B0B4HRSXH6/ref=sr_1_1?crid=25GBTGX1UCKDY&keywords=un+dossier+explosif&qid=1660031260&sprefix=un+dossier%2Caps%2C959&sr=8-1
66
« Dernier message par marie08 le mar. 09/08/2022 à 09:44 »
Avec ce roman, je découvre la plume de Mélodie Miller. Une plume fluide, tendre et franche. L’histoire se situe entre la romance et le feel-good, avec une palette de personnages haut en couleurs. Et tous sont attachants, chacun à sa manière. Nous faisons connaissance avec Manon, une jeune femme de 28 ans, célibataire, dont la meilleure amie se nomme Claire. Elle traîne derrière elle un passé familial douloureux qu’elle nous dévoilera au fil des pages. Obligée de partir à Ibiza pour son travail, elle va devoir cohabiter avec trois personnes, Arturo, le fils du patron, Mattéo, un latin lover dans toute sa splendeur, et Jeanne, une graphiste. Trois êtres totalement différent les uns des autres, dont nous apprendrons peu à peu leurs secrets. L’auteure nous fait également voyager entre la superbe villa et les différents lieux d’Ibiza. C’est un véritable dépaysement. En un mot, si vous voulez oublier votre quotidien et prendre un bol d’air et de soleil, libérez la licorne qui est en vous et partez avec elle pour Ibiza. C’est vraiment un roman que je recommande. Merci Mélodie Miller pour m’avoir fait passer un merveilleux moment. https://www.amazon.fr/nest-jamais-trop-lib%C3%A9rer-licornes/dp/B0B2TY7H8T/ref=sr_1_1?crid=14EFPIWU49HNF&keywords=il+n%27est+jamais+trop+tard+pour+lib%C3%A9rer+les+licornes&qid=1660031053&sprefix=il+n%27est+jamais+%2Caps%2C878&sr=8-1
67
« Dernier message par Antalmos le lun. 08/08/2022 à 20:24 »
John Stephen, architecte new-yorkais, mène une vie sans histoires avec sa femme, Vanessa, et leur fille Stessie, jusqu'au jour où il découvre que son associé, Brandon, lui cache des choses. Est-ce pour cette raison que John est retrouvé peu après mort, assassiné ? Comprenant que sa vie aussi est menacée, Vanessa se lance avec sa fille dans une course poursuite, à travers les États-Unis, sur une route jalonnée de cadavres et de rencontres. Mais à qui peut-elle vraiment faire confiance ?
Un dossier explosif, dont le titre à lui tout seul annonce déjà la couleur, fait partie de ces romans que j'ai dévorés très vite, tant par la qualité d'écriture, fluide et maîtrisée de l'autrice, que par la densité d'événements et de rebondissements qui se succèdent et qui donnent envie de tourner les pages au plus vite pour connaître la suite. Car Anne-Marie Bougret a fait le choix d'aller droit à l'essentiel, sans lourdeurs. Les événements s'enchaînent à une telle vitesse qu'il devient dés lors difficile de lâcher le livre.
En résumé, je recommande ce roman avec lequel j'ai passé un très bon moment de lecture et qui réunit tous les ingrédients du genre avec son lot de trahisons, magouilles, meurtres et d'actions, et qui m'a donné très envie de découvrir le prequel de ce livre : L'invitation.
68
Résumé :
Meghan Grayford, une jeune journaliste passionnée par l'exploration de lieux abandonnés, a localisé un vieux manoir dans la forêt de Brocéliande : ses occupants semblent avoir fui précipitamment…
En se faufilant dans cette bâtisse isolée, Meghan ignore encore que son histoire n'est pas peuplée de magie et de fées, mais d'horreur et de sang…
La nuit, quand tout est calme, le Manoir Brocélia se réveille…
La nuit, quand tout est calme, les atrocités de son passé reprennent vie…
La curiosité est un vilain défaut… Meghan aurait mieux fait de s'en souvenir…
Un thriller aussi terrifiant que captivant, dans la lignée des investigations paranormales d'Alan Lambin. Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance, et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième fort énigmatique. Jeune journaliste travaillant pour Insolite, journal spécialisé dans les phénomènes paranormaux, Meghan Grayford doit écrire à tout prix un article accrocheur pour contenter son patron pointilleux et souvent intransigeant ; elle décide alors de se mettre en quête d'un scoop destiné à le satisfaire. Se souvenant d’un vieux manoir situé dans la forêt de Brocéliande qu’elle avait visité il y a quelques temps en grande passionnée d’Urbex (l'exploration de lieux abandonnés ), Meghan décide sur un coup de tête de jeter son dévolu sur cette étrange bâtisse. Accompagnés de cette pétillante journaliste au tempérament curieux et plutôt casse-cou, nous allons pénétrer dans ces lieux forts mystérieux et mener l’enquête à ses côtés. Ces quelques lignes posées, le ton est donné ; les questions affolent notre esprit cartésien. Vu le côté inquiétant, est-il vraiment souhaitable d’entrer dans cette demeure, d’y glisser un orteil intrusif, de déranger ses nombreux occupants pour déterrer leurs histoires ? C’est mal connaître Meghan. Toujours en quête de sensationnel, se targuant d’être une habituée de ces environnements peu communs, elle ne va pas réfléchir bien longtemps, et va balayer le danger d’un revers de main. Mais une fois sur place, comme pour confirmer nos ressentis, les choses ne se passent pas comme prévu. Très vite, Meghan s'aperçoit que les derniers résidants de la bâtisse semblent l'avoir quittée de manière précipitée. Pourquoi ? Que s’est-il passé ? Quelles sont les raisons qui les ont poussés à partir ? Quels secrets peuvent bien cacher ces anciens habitants ? Le roman à peine entamé, nous voici entraînés, plongés, absorbés au cœur d’une histoire perturbante et glaçante, où vont se mêler vieilles légendes et activités paranormales. En effet, Brocélia semble dissimuler en son cœur des meurtres, suicides et autres joyeusetés. Des manifestations inquiétantes vont se succéder ; de surprenantes apparitions vont se produire, mais la journaliste malgré le danger omniprésent, va vouloir persister dans son entreprise. Aidée d'Alan Lambin, un spécialiste des phénomènes étranges rencontré dans certains opus précédents, elle n’aura de cesse de découvrir le passé mystérieux de ce manoir, quitte à se mettre en danger, à prendre de multiples risques, autant pour elle que pour ses amis Pour autant, Meghan est loin de se douter de toutes les atrocités qu'elle va rencontrer. Ne dit-on pas que la curiosité est un vilain défaut ? La jeune femme va malheureusement l'apprendre à ses dépens… Toutefois, malgré une intrigue rondement menée et une histoire captivante, quelques écueils ont gêné la fluidité de ma lecture. En effet, j’ai été par moments déroutée par le comportement de notre personnage principal, qui, là où le plus raisonnable des mortels aurait temporisé, voire déguerpi vu la multitude d’éléments surnaturels qui se succèdent, Meghan, elle, n’a pas pris la poudre d’escampette, s’est au contraire obstinée dans ses investigations, rendant son comportement parfois inconcevable, ou plus simplement tiré par les cheveux. De plus, j’ai eu la curieuse sensation que l’épilogue était incroyablement long si on le compare au rythme soutenu insufflé durant le reste du récit. Même ressenti concernant la dernière partie pourtant essentielle afin de clôturer définitivement l'enquête ; elle arrive un peu tard, engendrant une impression de lenteur, et gâchant malencontreusement l’homogénéité du roman. Chose d’autant plus dommageable que la plume de l’auteur est agréable, tantôt visuelle et précise, tantôt nerveuse, et addictive ; les pages se tournent à toute allure. Tout comme notre protagoniste, malgré la peur qui s'instille au fil de la lecture, révélant nos frayeurs les plus primaires, nous voulons savoir, comprendre quelles souffrances intérieures animent cette bâtisse. Et donc, que cache Brocélia et ses habitants? Je ne vous en dirai pas plus, à vous d’être curieux, et de venir comme moi pousser la porte de cette demeure ^^ Vous l’aurez compris, malgré les quelques bémols sus-cités, j’ai particulièrement apprécié cette histoire pleine de rebondissements inattendus. Une seule envie maintenant : après la découverte de ce super auteur, se plonger dans ses autres ouvrages dès que possible  Alors, si vous aimez les maisons hantées, le surnaturel et les sensations fortes où l'horreur côtoie le fantastique, ce roman est fait pour vous ; dépaysement et frissons garantis  Ma note : Ma note :      
Pour vous le procurer : Éditions Taurnada Amazon Réseaux sociaux : Twitter Facebook
69
« Dernier message par Apogon le jeu. 04/08/2022 à 17:42 »
L'Autre Elle de Marjolaine Sloart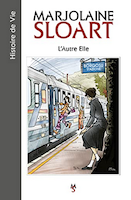 Pour l'acheter : AmazonChapitre 1 Il y a certains amours dans la vie qui bouleversent la tête, les sens, l’esprit et le cœur ; il y en a parmi tous un seul qui ne trouble pas, qui pénètre, et celui-là ne meurt qu’avec l’être dans lequel il a pris racine.Alfred de Musset La journée s’annonçait belle, Clara s’était levée, comme d’habitude, aux aurores. Le café fumant trônait sur la gazinière. Le pain frais sur la table, tout semblait prêt pour que ses trois hommes puissent prendre le petit-déjeuner. Son mari n’allait pas tarder. Avant de quitter la maison, elle irait réveiller ses deux garçons, Mattéo et Gianni. Elle devait se dépêcher, les clients de l’épicerie avaient leur habitude et elle aimait quand tout était rangé avant leur venue. Elle ordonnait la nourriture et toutes les viennoiseries dans les rayons ainsi que les produits laitiers, les légumes seraient livrés à une heure plus avancée. Tout ce qui attendait derrière la devanture de son magasin nécessitait d’être mis en place pour 7 h. Son premier fidèle client s’appelait Alberto, c’était l’employé communal de Borgosu, un village de 1500 habitants se situant à l’intérieur des terres, en Sicile, c’était un vieux garçon, gentil et serviable. Tous les matins, il passait en coup de vent acheter une baguette, ensuite arrivait Mme Di Lila, mariée, sans enfant, elle raffolait des croissants fourrés aux amandes, tout comme son mari. Puis entrait Mlle Sofia, la secrétaire du notaire au coin de la rue, elle n’était pas fiancée, toujours en quête de son âme sœur, elle commandait trois pains au chocolat, trois croissants et une madeleine. Les clients détenaient leurs habitudes et elle, les siennes. Elle s’y était accoutumée depuis plus de vingt ans qu’elle tenait son épicerie. Elle incarnait une personne discrète, de bonne écoute, les paroles étaient entendues, mais ne ressortaient pas de son magasin. Clara était appréciée pour cette qualité inestimable. Tous les jours se déroulait le même rituel, tout nécessitait la perfection afin de ne pas endurer les remontrances de son époux. Il faut reconnaître qu’il n’était pas commode. Claudio demeurait rustre et autoritaire avec elle. Elle le subissait depuis de nombreuses années. Lorsqu’elle l’avait rencontré il y a une vingtaine d’années, il semblait charmant et prévenant, pourtant à peine lui avait-il mis la bague au doigt que les problèmes débutèrent. Cela se passait dans les années soixante-dix, ils habitaient dans la campagne à une demi-heure de Catane, à cette époque-là, les femmes étaient soumises et les hommes commandaient, cela paraissait normal. Au fil du temps, le caractère bien trempé de son mari l’avait muselée. Elle finit par en avoir peur et elle le craignit. Devant les gens, il semblait gentil, mais une fois le dos tourné, il devenait despote. Il ne lui restait plus de famille, ses parents, à leur mort, lui avaient légué la seule épicerie du bourg qu’elle reprit sans se poser de questions. Cela représentait son refuge et elle y passait la plupart de son temps. Souvent, Clara fuyait la maison prétextant quelques affaires à régler, des comptes à faire, des étagères à organiser. Son mari la laissait s’y rendre, pour autant qu’il n’en subisse aucune conséquence. Il n’avait jamais brandi la main sur elle, mais ses paroles aiguisées lui léguaient de béantes blessures, devenues des cicatrices. Petit à petit, son travail de dévalorisation avait fait son chemin et elle se sentait de plus en plus comme une moins que rien. Deux garçons naquirent de cette union, Mattéo, dix-neuf ans et Gianni, seize. Élevés par leur grand-mère paternelle tandis que Clara s’occupait de son commerce. Ceci expliquait pourquoi ils ne la considéraient pas plus que cela, surtout Mattéo son aîné. Avec Gianni, elle semblait plus proche, peut-être parce qu’il lui ressemblait. À la maison, Mattéo avait à peu près la même attitude que son père. En y regardant de plus près, elle était la bonne à tout faire et elle acceptait la situation sans broncher bien que cela ne la rendait pas heureuse. Dans ce village rural où il fallait travailler dur pour s’en sortir, les états d’âme n’avaient que peu de place. Seul le travail comptait, rapporter de l’argent chez soi pour montrer aux autres que l’on savait faire mieux qu’eux. Cette mentalité était bien ancrée et Clara poursuivait sa vie sans trop de réflexions, tout cela lui semblait normal. Dans son ignorance, elle supposait que c’était partout ainsi. Ses journées étaient interminables, entre l’épicerie qui l’accaparait du matin au soir, les repas, le ménage et les lessives, elle n’avait jamais une seconde pour elle. Elle travaillait d’arrache-pied et le dimanche après-midi elle soufflait, seul moment pendant lequel son mari et ses garçons s’absentaient pour aller au village d’à côté voir des matchs de football pendant la saison chaude ou traîner au bar de Borgosu en hiver. Elle profitait durant ces quelques heures de répit pour rencontrer quelques amies et manger une glace ou boire un café. Les rares sorties de Borgosu se résumaient à quelques concerts donnés à gauche à droite dans la région. Son époux était membre de la fanfare locale et une à deux fois par année, ils partaient en excursion afin qu’il se produise avec son groupe musical. Ses enfants suivaient les traces de leur père au même degré que bien des jeunes des villages aux alentours. Mattéo jouait du trombone tandis que Gianni sonnait de la trompette comme son papa et était de surcroît très doué. Mis à part ces quelques sorties éphémères, ils ne quittaient jamais leur région, les vacances, c’était pour les autres, ainsi, l’épicerie restait ouverte presque toute l’année sauf les jours fériés, ce qui revenait à dire que Clara ne fermait celle-ci qu’une dizaine de jours par an. Les veilles de fête, elle engageait toujours une aide, pour satisfaire rapidement tous les clients, il fallait être efficace. En principe, elle placardait un encart sur sa vitrine et elle n’avait jamais de problème à trouver une personne dévouée pour l’épauler. Le travail était répétitif, son employée passait la majeure partie de ses journées à servir les antipastis, deux cents grammes de jambon cuit par ci, trois cents grammes de jambon de parme par-là, de la salade russe, des poivrons farcis, etc., c’était une occupation qui laissait peu de temps à la conversation. Il fallait contenter tout le monde et il n’était pas rare qu’une queue s’installe sur le trottoir. Pendant ce temps, les discussions allaient bon train. Ces moments festifs, les gens les appréciaient. Afin de ne froisser personne, elle donnait la possibilité à chacun de venir œuvrer avec elle, mais en définitive elle engageait toujours la même personne, une femme d’une cinquantaine d’années, elle l’avait formée et depuis elle maîtrisait la machine à trancheuse, ce qui était important durant ces périodes de forte affluence. Malheureusement, Simona ne pourrait être là cette année. Tombée d’un escabeau alors qu’elle tentait de décrocher un rideau, elle s’était cassé le bras. Bien entendu, Clara connaissait tous les habitants et quand une tête nouvelle se présentait, elle aimait savoir d’où elle arrivait. C’était le mois de mars et elle venait de coller une affiche pour engager un extra en prévision des fêtes de Pâques. Il ne s’était pas passé une demi-journée lorsqu’elle entendit le grelot de la porte tandis qu’elle était installée derrière son comptoir. Elle leva le nez du catalogue qu’elle consultait et elle se trouva en face d’une personne étrangère. La femme qu’elle dévisageait devait avoir une trentaine d’années. Habillée d’un pantalon ocre avec des pattes d’éléphant, elle portait un chemisier jaune sur lequel des motifs de fleurs blanches étaient peints, ses cheveux coiffés en chignon, un foulard les égayait. Sur son long cou pendait un collier avec des perles en bois. Un agréable parfum l’entourait. Clara la trouva sublime. — Bonjour, je peux vous aider ? — J’ai vu votre pancarte, vous cherchez une vendeuse ? — Oui c’est bien cela. Elle lui tendit la main. — Je m’appelle Antonietta Mazzari, mais c’est Nietta pour les intimes, j’ai 31 ans, je suis la nièce du professeur Angelo. J’arrive de Milan. Je suis là pour quelques mois afin de m’occuper de mon vieil oncle, vous n’êtes certainement pas sans savoir que depuis son AVC, il a besoin de soutien. — Oui, j’en ai eu ouï-dire par sa voisine. D’emblée, Nietta lui plut, elle l’estima totalement décalée par rapport aux gens d’ici. Son modernisme étant frappant, Nietta l’époustoufla ! Malgré elle, elle ne pouvait que se comparer aux autres, elle portait une longue jupe plissée, un chemisier blanc, ses cheveux relevés en chignon lui donnaient un air austère et ses sandales n’avaient rien de sexy. Ce n’était pas ainsi qu’elle pouvait se mettre en valeur, elle devait bien le reconnaître. — J’ai déjà travaillé comme vendeuse dans un gros magasin au rayon alimentaire à Milan, je pourrais vous être d’une grande utilité si vous m’engagez. — Vous tombez alors à pic, Simona, qui normalement me fournit un coup de main durant les fêtes, s’est cassé le bras, j’ai donc besoin d’une personne qui maîtrise la trancheuse, pourriez-vous faire un essai ? — Oui, volontiers, quand voulez-vous que je commence ? — Demain, si cela va pour vous ? — Parfait, à quelle heure, dois-je être présente ? — Dix heures, je vous expliquerai ce que j’attends de vous et nous ferons le point en fin de journée. — Bien, à demain. Nietta s’était montrée d’emblée efficace, elle avait tout de suite constaté qu’elle maîtrisait parfaitement ce travail, son expérience allait lui être utile. C’était une bénédiction que de l’avoir au magasin. Les clients l’appréciaient, elle apportait de la fraîcheur et de l’originalité ce qui ne déplaisait pas à certains, en particulier à la gent masculine. Lorsque Clara rentra à la maison, son mari Claudio n’hésita pas à critiquer son choix. Sa chère mère étant passée dans la journée acheter des antipastis, elle n’avait pas manqué de s’épancher auprès de lui. Quelle vipère celle-là, pensa-t-elle ! — C’est qui cette nouvelle vendeuse ? — Elle s’appelle Nietta, c’est la nièce du professeur Angelo. — Et elle sort d’où ? — Elle arrive de Milan. — Ah ! Ceci explique cela. — Que veux-tu dire ? — Ben sa manière de s’habiller et son côté aguicheur. — Tant qu’elle effectue son travail et que les clients en sont contents, je ne vois pas le problème. — Certes, tu ne penses jamais à rien. Comme d’habitude, aucun esprit d’analyse et l’on observe le résultat ! Ça y est, ça allait recommencer. Elle n’avait aucune envie de partir dans ce genre de discussion, elle y mit fin, en prétextant qu’elle devait se rendre à la buanderie étendre du linge. Clara supportait de moins en moins cette manière de la dénigrer. Elle était certaine que sa belle-mère y était pour quelque chose. Elle ne pouvait s’empêcher de la critiquer. C’était toujours pareil, chaque fois qu’elle prenait une initiative, elle avait droit à des réflexions blessantes, ce n’était pas qu’elle s’y habituait, mais elle faisait avec. Nietta paraissait pourtant ravissante et pimpante, tout l’opposé de cette femme amère. Néanmoins son fils buvait ses paroles et ne voulait en aucun cas la contrarier, tout ce que sa mère disait était des propos d’une « Madone » et pour avoir la paix, Clara adoptait le parti de se taire afin de ne pas envenimer les rapports tendus entre elle et son mari. Alors, elle restait silencieuse la plupart du temps, elle subissait son existence. Étant sous le joug de son époux, son esprit d’analyse concernant bien des aspects de sa vie s’amenuisait de plus en plus. Il en était de même quand l’heure d’aller se coucher arrivait. Il utilisait son corps sans se préoccuper de ses envies, l’acte fort heureusement, ne durait pas. Il accomplissait sa petite affaire, se retournait et s’endormait en deux minutes la laissant à la limite des larmes. Elle se levait et elle faisait un détour par la salle de bains avant de se faire un lait chaud. Clara avait de la peine à comprendre que certaines filles parlaient de l’amour comme étant le Graal. Dans son épicerie, elle vendait des périodiques. Aux heures creuses, elle les dévorait. À ce qu’elle lisait, elle vivait dans une époque où les femmes revendiquaient des droits, elles étaient en pleine libération sexuelle. Clara réalisait que, dans son village, ils résidaient encore à des années-lumière de ce qui se déroulait dans les grandes agglomérations. Tout ce qu’elle apprenait lui semblait tellement lointain de ce qu’elle expérimentait avec son mari qu’elle peinait à croire ce qui se disait dans les magazines, elle pensait que les journalistes inventaient des histoires pour les vendre… Chapitre 2 Plusieurs mois s’écoulèrent depuis qu’elle avait engagé Nietta, son énergie, sa jeunesse et sa vision du monde l’avaient tout bonnement rendue indispensable. Afin de l’aider à s’intégrer, Clara la présenta à quelques amies du village. Toutes la trouvaient tellement exotique. Elle avait une dizaine d’années de moins que Clara, pourtant quand elle l’entendait parler de sa vie à Milan, elle donnait l’impression d’avoir mille ans. Un dimanche, alors que toutes ses copines se réunissaient pour manger une glace, Eleonora, la femme du boucher la questionna. — Nietta, comment cela se fait-il que tu ne sois pas encore mariée ? Si tu penses que je suis indiscrète, tu n’es pas obligée de me répondre. — Eh bien, j’ai eu un fiancé, Marco, mais je n’étais pas convaincue. Je l’ai rencontré sur les bancs de l’école et nous sommes restés ensemble pendant dix ans et puis je me suis lassée. Il était adorable, mais j’avais envie d’autre chose. Personne n’a compris mon choix, mais sincèrement, j’attendais autre chose de la vie. Nietta, une fois lancée, semblait difficile à arrêter. — Voyez-vous, je l’aimais comme un frère, il n’y avait plus de grand frisson quand j’étais avec lui, plus de papillons dans le ventre, tout était devenu d’une platitude… Je m’en suis rendu compte lorsque j’ai rencontré Luca. Lorsqu’elle énonça son nom, tout son être s’illumina. — Raconte, où l’as-tu connu ? — Au travail. Il était responsable des achats. Au début, je n’y ai pas prêté attention, mais lui m’a tout de suite remarquée. Chaque fois qu’il passait dans mon rayon, il me faisait un compliment. À certains moments, sur ma façon de m’habiller, d’autres fois, sur ma coiffure, mon maquillage, etc. Il avait toujours une parole gentille. De temps en temps, il m’apportait un cadeau, une rose, un chocolat. Il tissait sa toile comme une araignée et mes collègues ont bien tenté de m’avertir, pourtant je n’ai rien vu venir. — Et alors, que s’est-il passé ? Sandra s’impatienta tandis qu’elle pourléchait sa glace. — Je me suis laissé séduire. Il m’a invitée à boire un café et j’ai fini par accepter et là il m’a servi son baratin. Un expert en la matière. J’ai bu ses paroles. Je le trouvais tellement différent de Marco. C’est sûr, il savait y faire. Ce n’est que plus tard que j’ai réalisé qu’il utilisait sa technique bien rodée auprès de toutes les femmes qui l’intéressait. Leur curiosité était à son comble. — Et… — Et, il est advenu ce qui devait arriver. J’ai quitté Marco pour Luca. Notre relation a duré cinq mois. J’étais sur un petit nuage, de l’aube au crépuscule. Luca m’a appris à aimer, il m’a enseigné « l’Amour », il m’a fait découvrir toutes les zones érogènes de mon corps. Avec lui, le sexe ressemblait à un feu d’artifice et je ne m’en privais pas. Et puis, il y a eu une autre femme, une nouvelle employée qui travaillait au rayon des chaussures… Et comme nous n’étions pas sur le même étage, je n’ai rien vu ni su. C’est seulement quand il a souhaité rompre que je suis redescendue sur terre. Son doux visage s’assombrit, des larmes au coin de ses yeux leur firent réaliser qu’elle avait toujours cette histoire sur le cœur. Cela ne dura que l’espace d’un instant éphémère et elle sourit en se tamponnant les paupières. — Je ne regrette rien, juste un peu Luca, mais je vous rassure, on guérit vite lorsqu’on est trahie, ceci chassant cela. Sur le moment, j’étais anéantie tant la douleur était vive, le fait de travailler au même endroit et l’idée de le croiser au bras de l’autre greluche m’insupportaient. Elle soupira. — Je n’avais pas d’alternative. Rester digne et prendre sur moi étaient tout ce que j’avais à faire. Je me disais que tôt ou tard, la fille en question expérimenterait un chaos identique et bien que cela ne me réjouissait guère, je ressentais un peu de réconfort en imaginant cela et puis, j’avais des amies très convaincantes pour m’aider à démolir pièce après pièce ce que représentait Luca à mes yeux. Soit j’alimentais mon chagrin soit je le fuyais et j’ai décidé que pour ma propre survie, le mieux était de l’occulter. Je me suis mise en quête d’un nouveau loisir, une collègue cherchait une partenaire pour un garçon de son cours de Salsa, elle m’a proposé d’essayer et heureusement, j’y ai pris tout de suite goût. Clara l’interrogea. — De quoi s’agit-il ? — La salsa, signifie littéralement « Sauce » en espagnol, elle recoupe plus l’idée d’une danse apportant de la saveur, de la joie et de la force à la vie. Honnêtement, cela m’a libéré l’esprit. Mon partenaire était un excellent cavalier et j’ai appris les pas de salsa grâce à lui. Cela a été un bon début afin de m’éloigner des sentiments que j’éprouvais pour Luca. J’ai commencé par me rendre une fois par semaine au studio et puis deux et pour finir j’y allais même le week-end. Nietta prit Clara par la main et lui montra quelques mouvements de danse en la faisant virevolter dans la pièce. Toutes les femmes présentes se mirent à rire de bon cœur. — Mes chères amies, il se fait tard, il est presque 18 h, je dois partir. Nous continuerons cette discussion, n’est-ce pas Nietta ? — Mais bien entendu. Clara embrassa ses amies et se dépêcha de rentrer. Borgosu était une petite bourgade, y demeurait un peu plus de deux mille personnes. Dans sa rue principale, le quidam trouvait tous les commerces nécessaires pour y subsister. Une boulangerie tenue par Pépé, un commerce d’électricité, une bijouterie, une boucherie, un poissonnier : lui, venait exclusivement les fins de semaine pour vendre sa pêche, un cordonnier, une papeterie, un magasin de journaux qui faisait office de librairie, une banque, une pharmacie, une droguerie, un fleuriste, une mercerie avec quelques habits à la mode du coin (donc pas d’actualité), une boutique de vêtements pour hommes, une quincaillerie, un glacier, un bar, un restaurant et au bout de l’allée, l’épicerie de Clara. Il y avait de quoi satisfaire tout le monde. Dans les rues adjacentes, on trouvait un mécanicien, la Poste, un carreleur, un lavoir. Les habitants disposaient quasiment de tout sous la main et ils n’avaient pas besoin de se rendre en ville. On pouvait aussi dénicher un médecin qui comme le curé était au courant de bien des choses inavouables. Résider dans une si petite communauté comportait des avantages, les gens se sentaient moins isolés, d’une certaine manière, chacun se montrait concerné par le malheur des autres. Tout le monde connaissait tout le monde et le dimanche la population se retrouvait la plupart du temps à l’église. Il restait plutôt difficile de vivre caché ou d’avoir des secrets, car tout se répandait et les nouvelles, bonnes comme mauvaises, étaient révélées à la vitesse du vent. Clara habitait à la sortie du village, elle mettait une dizaine de minutes pour rentrer chez elle depuis son épicerie. Elle avait l’habitude de marcher et de faire le trajet plusieurs fois par semaine. À midi, la plupart du temps, elle se rendait chez sa belle-mère qui concoctait le déjeuner pour toute sa famille. Cela l’arrangeait bien, car elle était libérée d’une corvée supplémentaire et cela faisait l’affaire de son mari qui trouvait que sa maman préparait mieux à manger qu’elle. Sa belle-mère habitait proche du magasin, c’était également pour cela qu’elle passait tous les jours chercher des vivres. Clara était obligée de lui faire la conversation à chaque fois, bien que cela ne l’enchantait guère. Claudio, quant à lui, disposait de sa menuiserie en dessous de leur maison. Il prenait, par conséquent, sa Fiat 500 et chargeait Mattéo qui travaillait avec lui, pour se rendre chez sa mère. Gianni arrivait un peu plus tard par le bus scolaire, sa grand-mère lui gardait toujours son repas au chaud. Clara remontait tranquillement la rue et elle ne manquait pas de saluer les personnes qu’elle rencontrait. Elle devait faire attention où elle posait ses pieds, car lorsqu’il pleuvait, c’était souvent de manière diluvienne. Le trottoir en pâtissait et quelques trous de-ci de-là rendaient celui-ci dangereux. Elle s’irrita, il faudra qu’elle en parle au maire pour voir s’il ne pouvait pas au moins boucher ces cavités. Elle se demandait pourquoi la Municipalité ne faisait rien, qu’attendait-elle, qu’une personne se torde la cheville ? Elle en était là de ses réflexions tandis qu’elle arrivait enfin chez elle.
70
« Dernier message par Apogon le jeu. 21/07/2022 à 18:09 »
Des colts et du Beethoven de Elsa Errack Pour l'acheter : Amazon FnacDes Colts et du Beethoven
(Et il paraît que la musique adoucit les mœurs…)PARTIE I LA TRAQUE I Un fracas terrible le réveilla en sursaut. Il était déjà trop tard. Un homme venait de défoncer la porte, malgré le lit qu’il avait eu la précaution de mettre en travers la veille pour la protéger. Comment ? D’un coup de carabine ? Il n’eut pas le temps d’avoir de réponse. C’est à peine s’il put distinguer un chapeau gris crasseux avançant vers lui qu’il ressentait déjà une terrible douleur, l’autre lui vidait consciencieusement le barillet de son Colt 44 en pleine poitrine. Il lui semblait que cela durait, durait. Et pas moyen de saisir son arme, et cela le tourmentait terriblement : comment se faisait-il que lui, si rapide, si précis, n’ait rien pu faire ? Il s’en voulait à un tel point que l’idée de la mort, sa propre mort pourtant si proche, ne le hantait même pas et cela aussi l’étonnait et il était surpris également qu’il puisse réfléchir à tout cela. Quand il ouvrit les yeux après avoir réussi à sommeiller quelques heures entrecoupées de nombreux réveils et peuplées de cauchemars comme celui qui venait de le réveiller, une faible lueur pénétrait dans la chambre miteuse par l’unique fenêtre aux vitres sales. La main gauche déjà sur son Colt, il jeta un bref regard sur la porte : elle était heureusement intacte. Presque chaque nuit ce même cauchemar revenait depuis bientôt trois mois maintenant, Victor étant constamment sur ses gardes, de jour comme de nuit, traqué, les nerfs à vif, toujours à la merci de la balle qui mettrait fin à ses jours. Il se leva du vieux fauteuil bancal où il avait passé la nuit puis se dirigea avec précaution vers la fenêtre. Il jeta un coup d’œil prudent sur la rue poussiéreuse. Un jour glauque pointait peu à peu. La tempête qui sévissait la veille s’était calmée, il ne soufflait plus qu’un vent encore assez furieux. La rue était déserte. Il entreprit une toilette sommaire - ce qui le contraria car habituellement il prenait un bain quotidien quand il était en ville- versant dans une cuvette à la propreté douteuse le peu d’eau qu’il y avait dans le broc ébréché, le tout étant posé sur une table si frêle qu’elle donnait l’impression de vouloir s’effondrer à tout moment sous ce poids pourtant ridicule. Il prit toutefois le temps de se raser parfaitement, utilisant pour cela son propre miroir et son savon à barbe, étant donné que la chambre n’offrait pas ce genre de confort. Avec son lit rempli de punaises que Victor avait dédaigné autant par dégoût que par la nécessité d’être toujours sur le qui-vive, la pièce présentait un spectacle désolant. Le plancher était noir de crasse tout comme les murs et le fauteuil où il avait passé la nuit devait dater de l’époque de Thomas Jefferson. « Et dire que Domir est mort ! » La terrible nouvelle qu’il avait apprise un mois plus tôt et qui l’avait effondré lui revint douloureusement à l’esprit. « C’était stupide de ma part mais, il me semblait que jamais cela n’arriverait. » Puis il peigna soigneusement son abondante chevelure brune, se disant machinalement qu’il ferait bien de se rendre chez le barbier pour une bonne coupe. Il s’habilla le plus élégamment possible malgré une chemise blanche des plus froissées, n’ayant pas été repassée depuis longtemps. C’est là qu’un des boutons de son gilet lui resta dans les doigts… Ce qui n’aurait dû être qu’un détail des plus futiles au vu de sa situation provoqua un trouble chez lui. Comment, lui, toujours vêtu de façon impeccable, devoir porter un gilet auquel il manquait un bouton ? Et après ? Ce seraient des manches élimées ? Une cravate qui s’effiloche ? Des chaussures trouées ? Lui apparut aussitôt l’image de ce pauvre hère, qu’il avait croisé dans la rue la veille au soir juste avant d’arriver dans cette misérable auberge des abords de Wichita, à qui il manquait la moitié des dents et qui exhibait ses haillons tout en réclamant quelques cents. Ce n’est pas qu’il ait vécu auparavant dans le luxe - la parenthèse dorée de Denver mis à part- mais il n’avait jamais manqué de rien étant enfant et ce jusqu’à l’âge de dix-sept ans et depuis peu encore, il connaissait une grande aisance. Il s’aperçut aussi que sa boite à pâte dentifrice Sheffield était quasiment vide et tout en la laissant sur la table, il se dit, sarcastique, que vu ce qui l’attendait, cela ferait toujours quelques onces de moins à transporter. Dans la salle de l’auberge qui offrait un décor tout à fait en accord avec la chambre et où régnait une lourde odeur de graillon, officiait un gros homme chauve à la mine réjouie. Quand Victor entra, quatre jeunes hommes, dont aucun ne devait avoir plus de dix-huit ans, des cowboys à la tenue fruste, en sortaient justement. L’aubergiste voyant le visage de Victor aux traits tirés par la fatigue, lui demanda, sur un ton ironique, s’il avait passé une bonne nuit. Celui-ci ne daigna pas répondre et s’assit devant l’une des tables branlantes et poisseuses. Bien que le vent se soit calmé depuis la veille, on avait toujours l’impression qu’il allait emporter le bâtiment de bois vacillant, l’air poussiéreux s’infiltrant à travers les planches disjointes. Victor réussit à obtenir un œuf frit et un café épouvantable. Il n’osait presque pas toucher au morceau de gâteau rassis que l’aubergiste avait apporté en assurant jovialement que sa femme l’avait fait seulement la veille. Victor fut surpris de découvrir qu’il avait cependant bon goût. Et soudain, subrepticement, lui revinrent en mémoire Denver, le Brown Palace Hotel, Octavie, douces images ressurgies d’un temps qui lui semblait déjà lointain -alors que tout cela datait seulement de quatre ans. Il fut étonné que de tels souvenirs émergent de son esprit car il ne repensait pas souvent à cette époque. Mais ce n’était vraiment pas le moment de se remémorer cela. Il s’empressa de chasser ces pensées, il lui fallait concentrer toute son attention sur ce qu’il avait à faire. Il alla seller son cheval, son adorée Terpsichore, une jument anglo-arabe de douze ans à la robe alezane. Il lui dit quelques mots en français -il n’y avait presque plus qu’avec ses chevaux qu’il parlait le français ces derniers mois : « Tu vas être un peu plus chargée que d’habitude mais enfin, cela ne fera pas un poids très lourd » puis il alla flatter une dernière fois l’encolure de Boniface, son ancien cheval de bât. Il était obligé de le laisser, et cela pour diverses raisons. Tout d’abord, parce que lorsqu’il était arrivé la veille au soir, il avait joué de malchance : l’aubergiste l’avait reconnu immédiatement et il avait bien fallu négocier pour ne pas être livré au shérif. Victor n’ayant plus assez d’argent, le cheval avait servi de monnaie d’échange. Boniface n’était plus de la première jeunesse mais il était encore solide et bien entretenu. Ensuite, il fallait bien avouer que Victor n’avait plus grand-chose à lui faire porter depuis cette épouvantable histoire qui lui était arrivée un mois auparavant à l’hôtel (un hôtel digne de ce nom car à l’époque il pouvait encore se le payer) de North Platte. Enfin, il devrait, encore plus que d’habitude, faire montre de rapidité, et si Terpsichore volait au-dessus du sol, ce n’était pas le cas de ce pauvre vieux Boniface qui allait le ralentir au risque de lui faire perdre la liberté et donc la vie car la corde l’attendait en cas d’arrestation. Il sortit dans la rue qui commençait lentement à s’animer. C’était une belle matinée de septembre, hormis le vent qui soufflait encore assez fort. Terpsichore montrait des signes de nervosité, ressentant l’inquiétude de son maître. Victor traversa la ville de Wichita, cette ancienne « cowtown » qui comptait désormais plus de dix mille habitants, au quotidien plus calme qu’à l’époque où elle était une tête de ligne pour le transport du bétail au début des années 1870. En ces temps-là des hordes de cowboys l’investissaient régulièrement lorsqu’ils conduisaient les troupeaux de vaches jusqu’à la gare. Après un rude voyage de plus de deux mois, l’arrivée en ville donnait lieu à une explosion de joie par trop bruyante et exubérante au goût des honnêtes citoyens désirant mener une vie tranquille. C’est ainsi que s’était forgée la mauvaise réputation de Wichita et encore plus celle de Delano, la ville de l’autre côté de l’Arkansas où se trouvaient quantité de saloons, tripots et maisons closes qui étaient pris d’assaut par tous les marchands de bétail, conducteurs de troupeaux et cowboys. Victor emprunta les rues les moins fréquentées, le chapeau baissé sur les yeux, prenant une allure calme et dégagée mais étant dans la crainte permanente d’être reconnu. Il arriva dans le quartier résidentiel de College Hill où vivaient les habitants les plus fortunés de la ville. Il s’avança jusqu’aux abords d’une immense villa construite sur une éminence artificielle, une réplique d’un des palais vénitiens de Palladio, la villa Foscari, dont les somptueuses colonnes ioniques de pierre blanche de Pucisca dominaient un grand bassin où évoluaient des cygnes noirs. Un magnifique jardin entourait la maison, agrémenté de statues représentant divers personnages de la mythologie grecque, il y avait même un Cerbère dans un coin, tellement criant de vérité qu’il semblait que, de ses trois gueules allaient sortir de furieux aboiements et qui, invariablement, faisait sursauter les invités qui le découvraient subitement au détour d’une allée. Victor s’arrêta à une centaine de yards de la villa et descendit de cheval. Il attacha Terpsichore à l’une des branches à moitié cassée, qui pendait au sol, d’un énorme chêne et se plaça en embuscade derrière l’arbre. Il vérifia ensuite à nouveau minutieusement son arme -il avait pris un de ses Schofield- puis il tenta de s’immobiliser, le revolver dans la main gauche, prêt à faire feu. Alors qu’il était toujours si sûr de lui et maître de ses nerfs, cette fois il ne parvenait pas à évacuer une forte tension qui avait envahi tout son corps. Il n’avait pas eu le temps de bien inspecter les lieux, de se préparer et il n’aimait pas ça. Il n’était jamais allé auparavant dans ce quartier de Wichita et c’est seulement la veille, avant de s’installer dans cette pauvre auberge qu’il était passé pour observer la maison, mais très rapidement et il faisait déjà nuit. C’est donc presque contre son gré qu’il finit par sortir une flasque de whisky d’un de ses sacs de selle et qu’il en but quelques gorgées bien qu’il se fût donné pour règle de ne jamais boire une goutte d’alcool avant de se mettre au « travail ». Radomir le lui avait dit cent fois : « Le whisky et le tir, ça ne fait pas bon ménage, parce que, à part troubler la vue et faire trembler la main… » Victor se disait qu’il lui fallait à tout prix réussir, réussir à éliminer le commanditaire de ces tueurs lancés les uns après les autres à ses trousses. Il avait supprimé le premier à Grand Island au Nebraska, le second sur la route de Kearney et lorsqu’il avait découvert qu’un troisième l’avait pris en chasse, il avait compris qu’il ne le laisserait jamais en paix où qu’il se trouve. Après le désastreux épisode de North Platte, il était parvenu à se débarrasser du troisième tueur, mais il savait trop bien qu’il en avait à nouveau deux autres à ses basques -il espérait d’ailleurs qu’ils ne surgiraient pas à l’instant. Pour avoir une chance de s’en sortir vivant, Victor savait qu’il devait d’abord en finir avec l’homme qui s’acharnait après lui et qui ne cesserait de lui envoyer ses mercenaires qu’une fois mort. « Et dire que je n’en serai pas là, que tout cela ne serait pas arrivé si je n’avais pas eu la faiblesse, la bêtise... La bêtise ? L’idiotie oui -et là Victor ne trouvait jamais de mot assez fort pour se blâmer- d’accepter ce contrat proposé par ce crétin d’Albert Cooler, ce traître, cet imbécile, cette chiffe molle, ce pleurnicheur… » Victor s’arrêta là, mais il n’avait pas pu s’empêcher, encore une fois, de se reprocher amèrement de s’être laissé embarquer dans cette stupide affaire qui avait complètement bouleversé le cours de sa vie et l’avait mis en constant péril de mort. S’invectivant, s’injuriant même, il ne cessait de se demander ce qu’il lui était passé par la tête, ce soir de mai dernier. « Et tout ça pour 545 misérables dollars ! » Lui qui ne se déplaçait jamais pour moins de cinq mille ! Il finit par se ressaisir, se répétant à nouveau qu’il ne pouvait pas savoir que cela tournerait aussi mal, puis desserra les mâchoires, ferma les yeux et expira lentement pour se forcer à retrouver le calme. Dix heures dix. Exactement. Dans un élégant cabriolet à quatre roues mené par un vieux cocher noir vêtu d’une livrée écarlate, Blake Hole sortait de la villa pour se rendre à sa quotidienne séance de spiritisme. Victor arma le chien de son revolver. Mais pour comprendre pourquoi Victor Brennan s’apprête à tuer Blake Hole en cette matinée de septembre 1876, il nous faut revenir quatre ans en arrière, lorsque John Cooler, modeste ingénieur de Chicago venu s’installer à Wichita travaillait d’arrache-pied afin de créer sa Cooler Refrigerator Company. II - P’pa, tu viens manger, il est presque 22h… En plus Margarita nous a fait sa tarte à la rhubarbe… - Viens, viens voir ! ça y est, j’y suis, regarde un peu, je vais t’expliquer le fonctionnement. C’est bien parce qu’il aimait à ce point son père et éprouvait pour lui une grande admiration, sachant aussi combien ses recherches étaient fondamentales à ses yeux qu’Albert se pencha sur les plans qui jonchaient la table de travail plutôt que d’aller déguster une part du délicieux gâteau dont l’odeur suave agaçait encore plus son appétit. L’adolescent tenta de se concentrer afin d’essayer de comprendre les explications. - Tu vois, en fait c’est tout bête, mais… personne encore n’y avait pensé. Voilà : là, en haut des wagons, il y aura les caissons contenant la glace, ainsi l’air refroidi s’écoulera vers le bas. Il n’y aura plus qu’à bien emballer la viande, et … le tour est joué ! Elle pourra être transportée sans dommage pendant plusieurs jours. Et maintenant que je le tiens, mon wagon frigorifique, il va falloir monter cette affaire… Tu vas voir, dans quelques mois, des wagons de la Cooler Refrigerator Company sillonneront les Etats-Unis d’Ouest en Est ! De Wichita à Chicago et peut-être même jusqu’à New York ! Et nous gagnerons des millions ! - Ah ! C’est formidable p’pa ! Je l’ai toujours dit, tu as des idées géniales ! Et maintenant, tu viens manger ? John Cooler en avait passé un temps pour le mettre au point, ce wagon frigorifique ! Cela faisait des mois et des mois qu’il y travaillait. Mais attention, c’était un wagon réfrigérant fiable, performant, pas une de ces glacières sur roues -les premières tentatives avaient eu lieu vers 1851- qu’on ne pouvait utiliser qu’en hiver et dans lesquelles la viande en contact avec la glace s’abimait, prenant un mauvais goût et se décolorant, ni ces wagons où les carcasses étaient suspendues au-dessus d’un mélange de sel et de glace que l’on avait rapidement cessé d’utiliser car ils provoquaient des déraillements tant leur charge oscillait dans les virages. La mise au point de ce wagon frigorifique n’était toutefois qu’un élément de la vaste entreprise que John Cooler se promettait de mettre en œuvre. Depuis quatre ans, John ne vivait plus que pour cela, c’était devenu une obsession : aussitôt éveillé il se mettait à y réfléchir, n’hésitant pas à retourner à sa table de travail en pleine nuit, multipliant calculs, plans, schémas, prévoyant le montant des capitaux à investir (c’était là où le bât blessait le plus) et également les bénéfices qu’il escomptait prodigieux. Son exaltation lui faisait perdre le sommeil et il en oubliait également parfois de manger. Néanmoins, jamais il ne cessa de s’occuper de son fils, Albert, pour qui il avait une tendre affection. Il l’associa à tous les stades de la réalisation de son grand projet. L’idée de John Cooler était simple mais elle pouvait rapporter gros si elle aboutissait : il s’agissait de contrôler toute la filière de la viande, de l’achat de bétail à son abattage et à sa transformation sur place, à l’Ouest, jusqu’au transport et à la livraison de viande au détail dans les villes de la côte Est. De la vache sur pied au steak fraîchement livré ! Car jusque-là, les vaches, les fameuses « longhorns », parcouraient un épuisant trajet, parfois de plus de mille cinq cents miles, en troupeaux de deux à trois milles têtes, des ranchs du Texas où elles étaient élevées aux cowtowns du Kansas et c’est ensuite entassées dans des wagons à bestiaux, pendant plusieurs jours (sans eau ni nourriture le plus souvent) qu’elles étaient acheminées dans les villes de l’Est où se trouvaient abattoirs et usines de transformation de la viande. Il n’était guère étonnant que dans ces conditions nombre de bêtes meurent en route et que les autres arrivent dans un état pitoyable, amaigries ou malades et qu’ainsi la viande ne soit pas de la meilleure qualité. Le système inventé par John Cooler permettrait donc un bien meilleur rendement avec la disparition de tous les intermédiaires. Tout le monde y serait gagnant, de l’éleveur qui gagnerait plus, au consommateur qui paierait moins. Mais pour que cela fonctionne, il fallait pouvoir transporter la viande sur des milliers de miles, pendant des jours sans que celle-ci s’abime, donc il était indispensable de disposer d’un wagon réfrigérant qui garantisse vraiment sa qualité et sa fraîcheur. - Ah si ta mère était encore avec nous, elle serait bien épatée de voir que j’ai réussi, elle qui pensait toujours que je n’arriverais à rien… Avec Gladys, son épouse, John n’avait pas eu de chance. Le mariage avait tourné court. Gladys avait quitté son mari pour partir avec le meilleur ami de celui-ci- c’est d’un commun certes, mais c’est toujours affreusement vexant et navrant- et était allée s’installer avec lui en Californie. Elle avait cependant attendu d’accoucher car elle ne désirait pas s’embarrasser de l’enfant qu’elle attendait et c’est bien volontiers qu’elle l’avait laissé à son mari. Elle envoyait toutefois une lettre chaque année pour les vœux. Albert n’avait donc jamais connu sa mère. Son père et lui avaient quitté Chicago pour s’installer à Wichita en 1872 au moment même où le chemin de fer arrivait. L’Atchinson Topeka and Santa Fe Railroad permit alors de relier la ville à la côte Est en faisant également d’elle une « tête de ligne » pour le bétail1. Si sa femme avait encore vécu avec lui, elle n’aurait pas manqué de s’écrier que son mari était fou, que tout cela les mènerait directement à la ruine et elle aurait enjoint John de retourner aussitôt à Chicago dans son petit bureau d’ingénieur où il travaillait pour Mr Baker. Mais John était plein d’allant et avait une foi inébranlable en son projet. Aussitôt le brevet de son wagon frigorifique déposé, il se lança dans l’aventure, qui promettait d’être risquée et pleine d’obstacles à surmonter, l’absence quasi-totale de fonds n’en étant pas le moindre. Il réussit à convaincre quelques personnes qui n’avaient pas froid aux yeux de s’associer à lui pour donner naissance à la Cooler Refrigerator Company et se lança corps et âme dans la réalisation de son entreprise y consacrant tout son temps et toute son énergie. Cela lui demanda un travail acharné, il se démena pour tenter de convaincre quelques éleveurs de lui vendre leurs bêtes, fit de nombreux allers-retours au Texas, mais un seul d’entre eux accepta. Il persuada ensuite son vieil ami George Walter de lui fabriquer dix wagons frigorifiques dans son usine de Chicago. Il réussit, avec ses trois associés qui étaient tout aussi désargentés que lui, à réunir les capitaux en multipliant les prêts, s’endettant jusqu’au cou. Et enfin, après avoir fait construire un abattoir à Wichita et s’être associé à un détaillant de Boston qui revendrait ses produits, il parvint à obtenir de l’Atchinson Topeka and Santa Fe Railroad de faire rouler ses wagons réfrigérés, ce qui fut des plus difficiles, la compagnie de chemin de fer craignant de perdre ses juteux bénéfices liés au transport de bétail sur pied. Pendant tous ces longs mois de lutte, le père et le fils furent inséparables. John emmenait Albert partout, dans les ranchs au Texas, à Chicago dans l’usine de George Walter, dans les nombreuses banques qu’il avait sollicitées... Albert, même s’il n’en saisissait pas tous les enjeux, s’était enthousiasmé pour cette affaire et surtout il ne pensait pas un seul instant que son père pût échouer. Et c’est ainsi que La Cooler Refrigerator Company vit le jour, au début de l’année 1874, le six janvier, jour de l’anniversaire d’Albert qui venait d’avoir dix-huit ans. Le premier convoi de wagons frigorifiques emplis de carcasses de viande partit de Wichita le 15 février 1874 et arriva sans encombre à Boston une semaine après. Les premiers profits furent engloutis dans 1 L’aboutissement du sentier sur lequel étaient conduites les longhorns du Texas au Kansas se déplaçant au fur et à mesure de l’avancée de la construction des chemins de fer. les remboursements des emprunts mais tout avait l’air de se passer admirablement bien. C’était sans compter l’éternelle histoire du pot de terre contre le pot de fer. Et le pot de fer en l’occurrence fut le puissant Julius Hole. Celui-ci, associé à son frère Blake, était à la tête d’un véritable empire financier dont le commerce de la viande n’était qu’une affaire parmi bien d’autres. Les richissimes frères s’étaient partagé le pays, Julius œuvrait à l’Ouest, Blake régnait sur l’Est. Julius prenait part à tout ce qui concernait le développement de l’Ouest : lignes de chemins de fer, ventes de terres aux colons, exploitation de mines et donc aussi commerce du bétail. Julius, qui n’était pas marié, se plaisait à changer souvent de lieu de résidence, suivant l’avancée des lignes de chemin de fer, mais en 1871, il eut un coup de foudre pour Wichita (sans doute pas pour le site qui n’a rien de rare.) Il se fit bâtir une demeure magnifique sur le modèle d’une villa du Palladio car il était un grand admirateur de la civilisation italienne de la Renaissance. Le vieux père Hole, resté à Boston, n’avait jamais compris pourquoi Julius s’était entiché de ce coin perdu à la réputation épouvantable. Pour lui, ces régions de l’Ouest ne faisaient pas partie du monde civilisé et Wichita n’était synonyme que de violence, débauche et crimes. Julius Hole avait suivi avec grand intérêt le projet de John Cooler, il avait missionné une équipe qui était chargée d’espionner tous ses faits et gestes et qui les lui communiquait au fur et à mesure de l’avancée de l’opération. Pour rien au monde il n’y aurait mis un cent, car il voulait d’abord s’assurer que tout cela pourrait fonctionner et ensuite il était hors de question pour lui d’être l’associé d’un petit ingénieur de rien du tout et de participer à une entreprise d’une taille méprisable. S’il obtenait la preuve que le système était efficace, Julius Hole n’aurait plus qu’à récupérer l’idée de John Cooler. Ce qui ne lui fut pas très difficile, car il avait l’habitude des affaires et donc des coups retors. Il envoya ses sbires chez George Walter qui se laissa convaincre sans trop de peine de fabriquer des wagons frigorifiques pour Hole étant donné qu’on lui laissait entrevoir de substantiels bénéfices. George Walter se persuada lui-même, pour balayer ses scrupules, qu’après tout, cela ne se faisait pas contre John, que c’était le progrès, qu’il fallait vivre avec son temps et puis, malgré le brevet, tout un chacun pouvait bien, en observant un peu comment fonctionnait le système de réfrigération, fabriquer ces wagons, alors pourquoi refuser une offre aussi intéressante ? Il accepta donc et, pour son plus grand malheur, commit la grave erreur d’accepter de travailler avec les gens à la solde de Julius. Ils s’empressèrent de voler les plans et les wagons furent construits dans une des usines des Hole, à Boston. John Cooler, fort de son brevet, tenta bien une action en justice mais à part y perdre beaucoup d’argent, il n’arriva à rien, les Hole ayant à leur disposition une armée de brillants avocats ainsi que de sérieuses relations dans les milieux politiques. La Hole Refrigerator Line vit ainsi rapidement le jour et très vite ce furent près de cinq cents wagons réfrigérés qui circulèrent à travers le pays, non seulement sur la ligne de l’Atchinson Topeka and Santa Fe Railroad mais aussi sur d’autres lignes du pays. Des contrats furent passés avec de nombreux éleveurs et les Hole avaient déjà à leur disposition tout un réseau de grossistes et de détaillants pour revendre la viande sur la Côte Est. Ils proposèrent des prix alléchants pour tout le monde et la Hole Refrigerator Line devint ainsi incontournable sur le marché de la viande bovine de l’époque. Quant à John Cooler, un malheur n’arrivant jamais seul, l’unique éleveur qui le fournissait mourut subitement et ses fils qui avaient repris le ranch firent affaire avec Julius Hole. Bref, en quelques mois seulement, la Cooler Refrigerator Company fut coulée, John fut ruiné, tout comme ses associés, et il se trouva dans l’incapacité de payer ses très lourdes dettes et de verser la paye de ses employés. Ce fut Julius Hole qui lui racheta ses quelques wagons frigorifiques… Avant de mettre fin à ses jours, John Cooler avait longuement hésité, non pas à exécuter son sinistre projet, car pour cela sa décision était irrévocable, mais à laisser une lettre à son fils bien aimé. Le matin même de sa mort, quelques heures avant de se jeter sous le dix heures quarante qui partait pour Chicago et qui comportait d’ailleurs plusieurs wagons de la Hole Refrigerator Line, John s’enferma dans son bureau. Il commença par quelques phrases solennelles, puis pris d’une grande lassitude, il finit par déchirer et brûler son brouillon. Il espérait qu’Albert surmonterait ces moments pénibles et irait vivre en Californie avec sa mère. Il jeta alors quelques mots sur une feuille qu’il introduisit dans une enveloppe adressée à sa femme qui vivait à San Francisco. Albert fut totalement effondré par le décès de son père. Quand il l’apprit, une demi-heure seulement après le drame, il pensa ne jamais pouvoir y survivre. Pendant plus d’une semaine, plongé dans une affliction extrême, c’est à peine s’il put s’alimenter (ce qui était signe chez lui d’un profond désespoir), il ne quitta pas la chambre et beaucoup craignirent qu’il ne se laissât mourir. Puis peu à peu, malgré son immense détresse, il se remit à faire machinalement les gestes du quotidien et revint tout doucement à la vie. Dans le même temps naissait dans son esprit l’obsession qui allait le hanter pendant de longs mois: faire disparaître de cette terre Julius Hole qu’il tenait pour seul responsable de la mort de son père. Il s’en fit la promesse et c’est ce qui lui permit de trouver la force de continuer à vivre. Quant à Gladys, lorsqu’elle reçut la lettre de John avec seulement cette phrase : « Tu avais raison » elle s’interrogea longuement, se demandant de quoi il pouvait bien parler. Puis elle fut prévenue du décès de son ex-mari. Elle en éprouva du chagrin car elle avait toujours gardé une certaine affection pour John, même si très rapidement après leur mariage elle l’avait trouvé trop sérieux, trop sage, trop triste enfin bref, trop terne et qu’elle était très vite tombée amoureuse de Jim qui était tout l’inverse de John. Elle fut par contre étonnée elle-même de s’inquiéter du sort d’Albert, dont elle ne s’était pourtant jamais préoccupée pendant toutes ces années. Elle demanda à son frère et à sa belle-sœur, installés à Wichita depuis peu de veiller sur son fils, ce qu’ils firent avec bienveillance, même s’ils avaient toujours pensé que John était un fou exalté et que son fils prenait le même chemin que lui. Ils proposèrent à leur neveu de l’héberger mais celui-ci refusa, préférant rester seul dans la demeure paternelle, qu’il réussit à garder grâce à une hypothèque. III - Mais Bon Dieu, ça fait deux ans que tu me répètes la même chanson ! Arrête ! Soit tu le fais vraiment soit tu cesses d’en parler ! s’écria Frank excédé. - Je le ferai, je te dis, je le ferai, je le ferai ! Tiens, regarde, j’ai acheté ça hier. Et Albert souleva sa veste pour montrer un Colt 1849 Pocket glissé sous sa ceinture. - Tu es fou d’avoir apporté ça ici. Tu sais ce que tu risques ? Albert Cooler referma sa veste et haussa ostensiblement les épaules. Il avait déjà beaucoup bu mais il commanda un autre whisky. Il savait bien qu’au « White horse », le saloon où Frank et lui se trouvaient, comme dans tous les autres lieux de distraction de Delano, cette banlieue autrefois très agitée de Wichita, le port d’une arme était interdit et qu’on se devait de la laisser à l’entrée sous peine de se faire sonner les cloches par le shérif. - C’est pas parce que Paul Honor te connaît depuis des années et qu’il serait indulgent avec toi que ça ne te vaudrait pas une nuit en taule, un truc comme ça ! Pour toute réponse, Albert se mit à pleurer, abondamment. Son vieil ami Frank, qui devait se rendre à sa partie de poker -il était devenu joueur professionnel- s’impatienta mais il ne voulait pas laisser Albert seul dans cet état. C’était son ami d’enfance et son seul véritable ami d’ailleurs. Il assista une fois encore à la même scène, à laquelle il assistait plusieurs fois par semaine depuis plus de deux ans, depuis ce jour de 1874 où le père d’Albert avait mis fin à ses jours : Albert se lamentait sur son sort, sur celui de son père John Cooler, ruiné par Julius Hole, puis se mettait à traiter le patron de la Hole Refrigerator Line de tous les noms, pour au final promettre de le tuer de ses propres mains. Mais ce soir, ce qui était nouveau, c’est qu’Albert était armé et cela inquiétait Frank qui se demandait quel usage il pourrait faire de cette arme car à défaut de tuer Julius Hole il était possible qu’il tente de la retourner contre lui. Soudain Albert s’effondra sur la table -Frank eut juste le temps de reculer le verre de whisky à moitié plein pour éviter qu’il ne le renverse- et c’est à peine si Frank l’entendit murmurer : « Je le ferai, je le ferai… Il va crever ce salaud de Julius. » Ses propos se faisaient de plus en plus confus. Puis après un court silence, s’étant un peu redressé, il pleurnicha, dans un soupir de désespoir et levant douloureusement les yeux sur Frank : « J’sais pas me servir de ce truc, tu te rends compte, Nom de Dieu, j’sais pas, j’y arriverai jamais ! » Et il retomba sur la table. Frank avait vraiment de la peine pour lui. Il avait bien conseillé à de nombreuses reprises à Albert de vendre la vieille maison de son père, de liquider l’abattoir qui fonctionnait au ralenti -il n’en sortait plus que quelques carcasses de viande par mois qui lui assurait un maigre revenu- de partir s’installer dans une autre ville, pourquoi pas en Californie aller rejoindre sa mère, en tout cas de refaire sa vie, ou plutôt de la faire car il avait seulement vingt ans, mais Albert s’acharnait, voulait à tout prix venger son père, et en même temps, était incapable d’agir. A ce moment-là, Peter Drabek, un grand blond à l’air dégingandé, entra dans le saloon et fit signe à Frank. « Qu’est-ce que tu fiches, on t’a attendu, mais comme tu ne venais pas, je leur ai dit de trouver d’autres partenaires. Comme ce n’est pas ton habitude, j’étais inquiet, qu’est-ce qui se passe ? » Et il jeta un regard sur Albert, qu’il avait croisé une ou deux fois, il connaissait vaguement son histoire. Albert se releva un peu, avec difficulté, fit un bref signe de tête pour saluer le nouveau venu, puis aussitôt, repartit dans ses borborygmes. Frank se mit en devoir de résumer l’affaire pour Peter. Il se trouvait que Peter était du genre à s’occuper des affaires des autres et à aimer trouver une solution pour chaque problème. - Ah, je vois, fit Peter, je pense que j’ai ce qu’il vous faut. - Ce qu’il faut à Albert, pas à moi, attention, je n’ai rien à voir avec ça, moi, précisa Frank d’un ton irrité. Et puis, qu’est-ce que ça veut dire « ce qu’il faut ? » - Eh bien, vous ne voyez pas… Si on veut tuer quelqu’un… - Chut, moins fort ! lui intima Franck, les sourcils froncés par l’agacement. - Ouais, bon, continua Peter à voix basse, je disais que si on veut… mais qu’on est pas en mesure de le faire soi-même… Eh bien, faut trouver un gars qui le fera à votre place… C’est un type sûr, je le connais bien, quand on était gosses, on habitait le même quartier à Omaha, au Nebraska. C’est mon père qui lui donnait ses cours de piano, il est très doué d’ailleurs, un vrai virtuose. - Quoi ! Un pianiste ? Mais qu’est-ce que tu veux qu’on foute d’un pianiste ? C’est pas vrai, t’es encore plus bourré que ce pauvre Albert ! tempêta Frank qui commençait en à avoir assez de cette discussion sans queue ni tête. - Mais non, il est pas pianiste, il a changé d’instrument, si tu vois ce que je veux dire, et c’est un véritable as de la gâchette. Frank secoua la tête, il désapprouvait totalement la proposition, mais Albert, qui avait fini par comprendre, tiré peu à peu de sa torpeur alcoolique par les propos de Peter, s’exclama : - Un tueur, c’est ça, c’est un tueur ? - C’est ça, gueule-le encore plus fort pendant que tu y es ! En plus, avec ce que tu as sur toi, c’est vraiment le moment de te faire remarquer, gronda Frank. - Mais oui, Nom de Dieu, j’y avais pas pensé, c’est ça qu’il me faut, et se tournant vers Peter, trouve-le moi tout de suite, je veux que Julius soit descendu dès demain. - Pas si vite, je pense savoir où le trouver, mais il me faudra quelques jours. Et puis il va falloir du fric, parce que Vic, il ne fait pas dans les œuvres de bienfaisance. Par contre, tu peux être sûr que ce sera du travail bien fait. - Ouais, pour le fric, ça ira, j’en trouverai, va le chercher, il est où, en ville ? - T’as quasiment plus un cent et tu es prêt à… Frank bouillait. Tiens, je préfère partir, mais avant, comme tu es mon ami, je tiens quand même à te dire que tu te conduis comme un imbécile et encore une fois, je te conseille de tout vendre et de partir d’ici. Je sais que tu ne m’écouteras pas mais au moins j’aurais la conscience tranquille car je t’aurais prévenu. Frank quitta vivement la table et sortit du saloon. Peter reprit alors, en chuchotant. - Donne-moi trois jours, je te trouve Vic et je te le ramène. On peut se retrouver chez toi, jeudi soir, vers onze heures, c’est OK ? - C’est bon, je vous attendrai. Jeudi, onze heures. - T’habites où ? - Douglas Avenue, n°16. Le jour dit, à onze heures précises, Peter, accompagné d’un homme grand et mince très élégamment vêtu, jaquette et chapeau noirs, gilet vert jade à discrets motifs floraux et cravate de soie de couleur taupe, se trouvait devant le 16, Douglas Avenue. Il frappa à la porte mais personne ne venait. La maison avait l’air inhabité, il n’y avait aucune lumière aux fenêtres. Il était visible qu’elle tombait peu à peu en décrépitude. Ils attendirent un instant, puis ils aperçurent Albert surgir au coin de la maison et leur faire signe de le suivre. Les cheveux en bataille, la tenue négligée, il avait l’air encore plus désorienté que l’autre fois au saloon. Il les fit entrer par la porte de l’office dont il était le seul à faire usage désormais puisque les domestiques engagés par John Cooler autrefois avaient tous été renvoyés, même Margarita, la cuisinière mexicaine qu’Albert aimait tant, autant pour la douceur de son caractère que celle de ses gâteaux. Albert ne passait plus que par-là, ayant délaissée l’entrée principale. Il s’était replié sur deux pièces seulement: la cuisine et sa chambre, laissant le reste de la demeure vivre sa lente déchéance sans lui. Ils ne virent pas grand-chose de la cuisine car elle était plongée en grande partie dans l’obscurité, seule la lampe à pétrole posée sur la table émettait une faible lumière. Les présentations furent rapides et on en vint tout de suite aux termes du contrat. Ils s’assirent autour d’une table qui était, étonnamment dans cette demeure à l’abandon, d’une propreté irréprochable. Albert sortit fébrilement une vieille bouteille de rhum dont l’étiquette avait disparu et trois verres dont l’un était un peu ébréché. « Je suis désolé, je n’ai que ça », bredouilla-t-il. Sa nervosité était palpable. Albert commença à remplir les verres. A peine le sien fut-il empli à moitié que Victor fit un geste pour arrêter la main d’Albert. Quant à Peter, il but aussitôt le sien et tout en déclarant que le rhum était fameux fit signe qu’il en accepterait bien un deuxième. - Je ne suis pas fortuné, comme vous pouvez le voir, dit Albert en s’adressant à Victor avec un sourire forcé, tout en faisant un geste de la main pour désigner la pièce, mais je peux vous payer… je vous propose… 545 $ et 50 cents. Victor resta impassible, but une gorgée de rhum, reposa son verre, et enfin d’un ton glacial annonça : - Ce n’est pas mon habitude de travailler pour un salaire de conducteur de troupeau. - N’exagères pas, Vic, je t’ai expliqué la situation, et puis, 545 $, c’est quand même pas mal, plaida Peter. C’est pas le salaire d’un conducteur de bétail, ah ça non ! Eh, ça fait plus de trois mois de salaire du shérif de Delano, ajouta-t-il en riant pour tenter de détendre l’atmosphère. Cependant la remarque n’arracha aucun sourire à Victor ni à Albert qui commençait à paniquer. - C’est tout ce que j’ai. C’est vraiment tout ce que j’ai pu réunir. Je peux… je peux aussi… vous donner ça, et il montra l’arme qu’il avait acquise. - Allez, Vic, s’il te plait, je t’ai raconté son histoire, tu comprends bien, surtout toi, avec ce que tu as vécu, ce qui est arrivé à ton père… - S’il vous plait, acceptez, j’en peux plus, si vous le faites pas, j’irai, tant pis, avec ça, et il montrait son revolver, je sais pas m’en servir mais tant pis, j’irai et puis, je sais pas… Il continua, les yeux dans le vague, comme se parlant à lui-même. A travers sa logorrhée, on pouvait discerner « vengeance, pourri de Julius, qu’il aille au diable, j’en mourrai et à de très nombreuses reprises « mon pauvre père », puis la voix se perdit dans un murmure inaudible. Victor et Peter attendirent calmement, sans montrer aucune impatience qu’il ait terminé. - Tu vois, Vic, c’est comme qui dirait pour réparer une injustice. Et puis aussi pour qu’Al ait à nouveau l’âme en paix. De toutes façons, pour toi, c’est rien, tu vas faire ça en deux temps trois mouvements, t’es un as dans ta partie, c’est bien connu, t’es un des meilleurs de tout l’Ouest. » Victor ne laissa paraître aucune émotion sous le flot des « compliments » adressés par Peter Drabek, mais celui-ci savait qu’il avait touché une corde sensible chez lui. En effet Victor était content de lui, fier de ce qu’il était devenu. Depuis l’âge de douze ans, suite aux effroyables instants qu’il avait vécus, il s’était promis de savoir manier une arme de façon à devenir l’un des plus redoutés tireurs de tout l’Ouest et il y était parvenu. Après un apprentissage avec un maître en la matière, il avait fait ses preuves en tant que détective de la fameuse agence Pinkerton puis… alors qu’il n’avait pas encore vingt ans, il était passé du côté de ceux qu’il pourchassait. Cela était advenu un peu par hasard. L’occasion de gagner une somme considérable s’était présentée à lui à un moment où il avait vraiment besoin d’argent et il s’était fait, il est vrai de façon bien inconséquente, tueur professionnel. Pour une seule et unique fois s’était-il promis sur l’instant. Une seule et unique fois… Néanmoins c’était maintenant depuis près de quatre ans qu’il « exerçait » cette activité. Sans que cela trouble apparemment sa conscience, du moins jusqu’à présent… tant l’homme s’accoutume à toutes les situations qui ne tardent pas alors à lui apparaître ordinaires. Au moment où il se trouvait dans la cuisine d’Albert Cooler, il n’avait eu encore aucun problème avec la justice, ayant toujours réussi à exécuter ses contrats sans que son nom soit révélé : aucune affiche ne mettait sa tête à prix, aucun shérif n’était à sa poursuite. La loi implacable selon laquelle, dans son cas, on se retrouve forcément un jour ou l’autre face à plus rapide, plus précis ou alors simplement plus malin que soi ne devait pas être inconnue de Victor, mais, soit jeunesse, soit vanité, il n’y pensait pas trop, ou peut-être, ne voulait pas trop y penser. Après un moment de silence, Victor reprit la parole de la même voix neutre : - Bon, j’accepte, mais il faudra me payer d’avance, car Julius Hole, c’est du gros gibier, dès qu’il sera abattu, ce sera le branle-bas de combat, il faudra que je quitte immédiatement la ville et même le Kansas. IV Pour Julius Hole, l’Ouest avait été un exutoire lui permettant de fuir une famille oppressante. Il avait souffert durant son enfance et sa jeunesse, pris dans les carcans d’une éducation stricte, subissant les dures exigences d’un père calviniste et d’une mère plus austère encore que son mari. Dès l’âge de vingt et un ans il s’était installé à l’Ouest et depuis il menait la vie qu’il avait rêvée. Son père avait voulu l’envoyer à Harvard mais Julius n’y était pas resté longtemps, ce qu’il voulait, c’était suivre son frère Blake, de deux ans son aîné, qui s’était lancé avec succès dans les affaires. Les deux frères s’étaient toujours bien entendu même s’ils n’avaient pas du tout le même caractère, Julius étant exubérant et expansif, alors que Blake était plus sombre et renfermé. Ils s’associèrent et si Blake avait bien réussi dans ses premières entreprises, il fallait avouer que Julius le surpassait de beaucoup, le génie des affaires l’habitait. Tous le disaient : « Il a ça dans le sang, dès que Julius s’occupe d’une affaire, on est sûr que l’or va couler à flot ». On le surnomma rapidement le Midas de l’Ouest. Julius Hole était prudent, n’engageant jamais de capitaux de façon hasardeuse, par exemple, dans les années 1850 il avait spéculé sur des compagnies minières mais uniquement après avoir eu l’assurance que les filons exploités par celles-ci étaient abondants, car trop souvent ces derniers étaient superficiels et menaient à des faillites retentissantes. Il n’hésitait pas aussi à user de procédés malhonnêtes : ainsi, avant la création de la Hole Refrigerator Line, pour augmenter le poids des vaches amaigries par les longs trajets en train, il ordonnait qu’on les assoiffe pendant le voyage puis qu’on les fasse boire tant et plus le jour de la vente. Il avait aussi été à l’origine d’un bureau de publicité mensongère pour que les compagnies de chemin de fer dans lesquelles il avait investi vendent facilement les terres, que le gouvernement fédéral leur avait octroyées, à de naïfs pionniers. Pour attirer ceux-ci, il leur promettait dans de beaux prospectus que la fortune était à portée de main et n’hésitait pas à inventer de brillantes métropoles là où il n’y avait encore que trois cabanes de bois. Et bien sûr, il n’avait aucun scrupule à s’emparer des idées des autres comme il l’avait fait avec John Cooler. Flairant toujours les bons coups, il avait dernièrement jeté son dévolu sur le fil de fer barbelé, qui se vendait seulement 20 dollars les cent livres en 1874 mais 80 dollars en 1876, ayant bien compris que le prix n’allait cesser de croître, les fermiers étant résolus à protéger leurs cultures des ravages causés par les troupeaux itinérants. Julius Hole prétendait être accaparé par ses affaires qui ne lui laissaient pas une minute de libre selon lui, pour systématiquement éviter les réunions familiales qui se tenaient à Boston, la ville natale de son père. A cinquante-deux ans, Julius n’était toujours pas marié et il y avait bien longtemps que l’on avait cessé de lui faire des remarques là-dessus, ses parents s’étant résignés. Sa débauche n’avait fait que croître au fil des années et maintenant dans sa somptueuse maison de Wichita ses maîtresses se succédaient, chacune parvenant à se maintenir, dans le meilleur des cas, cinq à six mois. Il y organisait de titanesques orgies, arrosées des meilleurs vins français. Son vieux père serait mort d’une attaque s’il avait eu connaissance des mœurs dépravées de son fils. Quant à sa mère, elle se doutait que la vie de Julius n’était pas d’une pureté angélique mais faisait mine de ne rien soupçonner et d’ailleurs ce qu’elle imaginait ne pouvait rester que bien en-deçà de la réalité. En outre Julius adorait aller s’encanailler dans les quartiers mal famés de Delano, toutefois toujours accompagné de deux ou trois colosses qui étaient chargés de sa protection. Il y fréquentait tout particulièrement le Red Orchard, un lupanar réputé. La maison était tenue par Mme Gessler, une suissesse pas commode qui ne tolérait aucun désordre. Chez Mme Gessler, c’était la légion romaine, tout était d’une propreté irréprochable et tout son petit monde lui obéissait au doigt et à l’œil, mais sans heurts, c’était une autorité ferme qui s’exerçait en douceur. Les clients étaient toujours très satisfaits et nul ne s’était jamais plaint du Red Orchard. Quand Julius Hole s’y rendait, la patronne lui réservait deux ou trois très jeunes filles, connaissant bien les goûts du fortuné débauché. La vie des plus rangées de son frère Blake : marié à l’âge de vingt-deux ans avec la fille aînée d’une famille de la grande bourgeoisie de Boston dont il avait eu deux enfants et pour laquelle il faisait preuve d’une fidélité irréprochable depuis trente-deux ans, formait donc un éclatant contraste avec la licencieuse existence de Julius. Et pourtant Blake, depuis sa prime jeunesse, n’était pas dénué de bizarreries. Loin de là. Mais il les cultivait en secret. Gavé de lectures ésotériques, il avait par exemple lu et relu le Zohar et les œuvres d’Aboulafia, Blake étant persuadé que les réalités du monde n’en étaient pas et que tout n’était que signes, chiffres, mystères à dévoiler. Il suivait les enseignements de plusieurs maîtres spirituels et lui-même se pensait capable de décrypter le sens caché de l’univers. Il était notamment convaincu de l’existence du royaume souterrain mythique d’Agartha, pensant que le but de l’Humanité était d’y accéder et d’y trouver le bonheur éternel. Et il était sûr que lui, Blake Hole, avait un rôle décisif à jouer dans tout cela, il attendait son moment, qui ne tarderait pas à venir selon lui. Il « savait » que cela arriverait. Il avait financé au moins deux expéditions de pseudo-savants en Inde pour retrouver ce monde idéal qui permettrait d’accéder à des connaissances et à des pouvoirs surnaturels, mais sans résultat. Il était même allé en France pour rencontrer le grand maître spirituel Jean Saint Mont-Ernier, qui avait bien voulu lui accorder une demi-journée d’entretien. Ce maître, doté, selon lui-même, de pouvoirs extraordinaires, délivrait un enseignement uniquement oral car il prétendait que les livres corrompaient la vérité. Jean Saint Mont-Ernier lui avait beaucoup révélé sur Agartha et sur l’au-delà -il assurait être revenu lui-même de chez les morts- ainsi que sur les façons de communiquer avec les âmes des disparus. Blake était d’ailleurs un fervent adepte du spiritisme. Il avait tenté à de nombreuses reprises de convaincre son frère de le suivre dans sa voie, mais toujours en vain. Julius ne manquait pas une occasion de se moquer de Blake, pensant que tout son charabia était à mourir de rire et il avait plus d’une fois menacé, pour s’amuser, d’en avertir leurs parents, surtout quand ils étaient jeunes car désormais il n’avait quasiment plus aucun contact avec eux et de toute façon il se fichait bien de ce qu’ils pouvaient penser de son frère et de lui. La bonne entente qui existait entre Julius et Blake quand ils étaient jeunes avait perduré mais les deux frères ne se voyaient plus : ce n’était qu’échanges de lettres et de télégrammes et de plus en plus uniquement pour les affaires, il n’y avait quasiment plus rien de personnel, seul Blake donnait très sporadiquement des nouvelles de leurs vieux parents. Victor Brennan, qui s’était installé dans le plus bel hôtel de Wichita, avait été mis au courant par Peter Drabek que Julius avait ses habitudes au Red Orchard et qu’il s’y rendait toujours le dernier jeudi du mois. Ce serait donc le 25 mai. Victor avait huit jours pour se préparer. Il parcourut méthodiquement le quartier où se trouvait la maison close, mais aussi le reste de la ville de Delano pour bien repérer les lieux, tout d’abord de jour, puis la nuit. Il avait pris soin de se changer et de mettre de vieux vêtements pour passer inaperçu. Il examina tout très attentivement, observant les allées et venues, mémorisant chaque détail, déterminant l’endroit où se placer pour abattre sa cible et également comment quitter la ville au plus vite sans se faire remarquer. Lorsqu’à deux heures dix du matin, le vendredi 26 mai, Julius Hole sortait du « Red Orchard », il n’eut pas le temps de faire dix pas qu’une balle de Winchester lui explosait la cervelle. Les deux gardes du corps qui l’accompagnaient n’avaient même pas vu d’où le coup venait. V Victor quitta Delano aussitôt, sans que quiconque l’ait aperçu, s’éloignant de la ville rapidement, en parcourant déjà près quinze miles cette nuit-là, bénéficiant de la faible clarté d’un dernier croissant de lune. Il prit la direction de la ville d’Omaha au Nebraska. Il avait un peu plus de trois cents miles à parcourir mais il avait l’habitude de franchir de grandes distances en peu de temps et il comptait mettre deux semaines environ, en chevauchant six à sept heures par jour, ayant pris soin d’emporter suffisamment de vivres. Il disposait en tout de trois chevaux : deux de selle, Régulus, un hongre bai très vif qu’il avait acheté six ans auparavant et sa belle jument anglo-arabe Terpsichore ainsi que d’un cheval de bât. Il était surtout pressé de quitter le Kansas, ce qui fut fait au bout de sept jours, et par la suite, il n’eut pas envie de s’attarder dans cet espace agricole des plus monotones qu’était le Sud-Est du Nebraska. C’était toujours les mêmes plaines, les mêmes prairies dépourvues d’arbres, les mêmes champs de blé ou de maïs, les mêmes troupeaux de vaches. Il avait l’impression de revivre sans cesse la même journée. Bien qu’il préférât en règle générale dormir à l’hôtel, il choisit de bivouaquer jusqu’à ce qu’il arrivât à la ville de Lincoln au Nebraska, d’abord parce que la prudence étant de mise, il préféra éviter les villes tant qu’il était au Kansas, et ensuite, dans ce coin de campagne perdu du Nebraska où on ne pouvait rencontrer que quelques misérables bourgades, si c’était pour se trouver un lit plein de punaises sous lequel couraient rats ou souris dans une auberge minable, il préférait encore dormir à la belle étoile, d’autant que les nuits n’étaient plus trop fraîches et qu’il eut la chance de ne pas subir de vent trop violent. Il fit une halte de quatre jours à Lincoln, retrouvant avec plaisir les commodités de la ville et profitant d’une confortable chambre au Lancaster Hotel. Victor arriva à Omaha le matin du neuf juin, après quinze jours de voyage. Comme toujours, son premier soin fut de s’occuper de ses chevaux. Il les confia au vieux Tom en lui donnant généreusement trente dollars comme d’habitude et comme d’habitude Tom fit mine de refuser, protestant que c’était trop. Victor lui laissa aussi ses armes (sa Winchester et ses deux Colts 45 que Radomir lui avait offerts trois ans plus tôt), ayant une confiance totale en le vieil homme. Avant même que Victor l’ait demandé, Tom proposa d’envoyer le petit Joe porter ses affaires à l’adresse habituelle, Victor le remercia et confia également au garçon un billet dans lequel il annonçait sa venue pour onze heures. Il profita des deux heures qu’il avait devant lui pour flâner dans Omaha. A chaque fois qu’il revenait, il trouvait la ville plus peuplée et animée, et de plus en plus cosmopolite. La « porte d’entrée de l’Ouest », qui comprenait alors plus de vingt-cinq mille habitants, n’était plus la capitale du Nebraska depuis vingt-deux ans, Lincoln lui ayant ravi la place. Victor s’aperçut que les grands bâtiments de brique rouge de trois ou quatre étages s’étaient multipliés, abritant commerces, hôtels ou usines. Il évita la gare de l’Union Pacific, et son quartier d’entrepôts, d’abattoirs et d’usines de conditionnement de la viande et se rendit jusqu’au bord du Missouri, dont les berges étaient agréablement ombragées par des peupliers, des frênes et des ormes et qui lui rappelaient les bons moments qu’il y avait passés dans son enfance. Là encore c’était l’effervescence, avec les va-et-vient permanents des ferries, qui en traversant le fleuve, faisaient le lien entre l’Est et l’Ouest du pays. Il finit sa déambulation par la place du marché qui regorgeait de produits venus des quatre coins du monde. Il y avait foule. Il se mit en quête d’un présent, hésitant entre de l’eau de Cologne Guerlain et des mouchoirs en dentelle d’Alençon. Il acheta ces derniers, demandant à ce qu’on les lui enveloppe dans un papier de soie agrémenté d’une faveur. Il acheta pour lui un flacon d’eau de Cologne « Extra-Vieille de Roger et Gallet » -on lui assura qu’il s’agissait d’une nouvelle qualité de l’eau de Jean-Marie Farina- et une autre nouveauté de la même maison : un savon rond parfumé1. Soudain, il sentit qu’un gamin tentait de lui faire les poches, il lui saisit aussitôt fermement le poignet et pris un air terrible, sans dire un mot. Le gamin était paniqué, se voyant déjà en prison mais Victor le laissa aller non sans lui assurer, pour lui faire peur, qu’il demanderait à Mr. Walter, le shérif, de l’envoyer aux travaux forcés s’il recommençait. Il faisait déjà chaud en cette matinée du début de mois de juin et il s’arrêta pour boire une bière fraîche. Il était près de onze heures, il se dirigea vers Jefferson Square et frappa à la porte d’une coquette maison. Une belle femme brune aux yeux bleus vêtue d’une élégante robe en taffetas parme lui tomba dans les bras. - Bonjour maman. 1 L’auteur s’est permis un léger anachronisme car si l’ « Extra-vieille » existe bien depuis 1875, les savons ronds parfumés, quant à eux, ne sont apparus qu’en 1879. - Je t’attendais, le petit Joe a apporté tes affaires, je les lui ai fait mettre dans ta chambre. Je suis tellement heureuse de te revoir. Tu m’as manqué depuis tous ces longs mois. Elle regarda son fils avec un large sourire, le fit entrer et reçut son cadeau - avec plaisir. - A moi aussi, tu m’as manqué. Mais rapidement, le beau regard bleu de sa mère se fit scrutateur. - Tu aurais pu nouer ta cravate correctement… » Elle esquissa un geste pour tenter de la rajuster mais se retint, puis, regardant le chapeau que Victor tenait à la main : Eh bien ! Il est encore plus poussiéreux que le plumeau de Lida ! Et tes bottes ! Dans quel état sont-elles ! Victor -qui pensait éviter ce genre de remarques en ayant pris soin de brosser ses vêtements le matin-même - tenta de se défendre : - M’man ! J’ai parcouru plus de trois cents miles en moins de … - Oh ! Ne me dis rien ! Je ne veux surtout pas savoir d’où tu viens. Mais enfin tu es de plus en plus négligé. Ce n’est pas étonnant aussi, avec la vie que tu mènes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais… Enfin… Allez, tu vas aller prendre un bain et te vêtir correctement, il y a du linge et des vêtements propres dans ta chambre. Pendant ce temps je préparerai moi-même le déjeuner -j’ai envoyé Lida faire quelques achats- je te ferais un repas digne de ce nom, car tu as dû manger n’importe quoi ces derniers mois. Et là tomba la question que Victor redoutait toujours : « Tu restes combien de temps ? » Et il répondit comme à l’accoutumée de façon évasive, « quelques jours » en pensant que trois, ce serait bien assez. La dernière fois qu’il était venu, c’était à Noël dernier, six mois auparavant ; l’atmosphère s’était alourdie peu à peu et la mère et le fils s’étaient quittés non pas fâchés mais soulagés de se séparer. Précisons tout de suite qu’Eugénie ignorait totalement ce qu’était devenu Victor -celui-ci n’avait heureusement pas eu le mauvais goût de lui signaler son changement de… d’« activité »- elle le croyait toujours simplement un « vulgaire détective » comme elle le disait, profession qu’elle exécrait, la trouvant indigne et avilissante et depuis près de six ans, elle ne cessait d’exhorter son fils à changer de vie. Alors, si elle avait su que désormais il était l’un de ces horribles hors-la-loi qu’il pourchassait autrefois ! Elle en aurait été épouvantée et n’aurait peut-être plus voulu le revoir (quoique, elle l’aimait tellement !) La profession de Victor mise à part, les sujets de discordes ne manquaient pas et Victor savait trop ce qu’il allait devoir entendre: « Et si ton père te voyait ! Et le piano ! Et Laura ! Et quand te marieras-tu ?… » Les reproches de sa mère l’agaçaient et même s’il l’aimait profondément, il ne pouvait pas s’empêcher parfois de répliquer durement. C’est pourquoi il pensait qu’il était préférable de ne pas rester trop longtemps. Eugénie Brennan, la mère de Victor, avait définitivement quitté la France en 1850, après la mort de sa mère car elle ne supportait plus la vie qu’elle menait. Son père, bien que fortuné, devenait de plus en plus avare, et surtout elle voulait oublier sa catastrophique histoire d’amour avec son cousin Hector qui lui avait promis de l’épouser mais qui finalement l’avait abandonnée pour aller faire fortune aux Indes. Elle en avait été très malheureuse, attendant en vain des nouvelles pendant plus de deux ans, puis avait appris qu’il s’était marié avec une Anglaise. Elle avait alors pris sa décision : elle partirait et se bâtirait une nouvelle vie ailleurs. Elle avait quitté sa petite ville natale de Buzançais, emportant ses économies qui étaient substantielles (et dire qu’elle avait failli les donner à son cousin qui voulait se lancer dans le négoce !) et avait pris le bateau au Havre. A peine était-elle arrivée à New-York qu’elle rencontrait un bel Irlandais, Pilib Brennan. Ce fut le coup de foudre, ils se marièrent quelques semaines après et en 1852 naissait Victor. L’accouchement s’était très mal passé et Pilib pensa perdre sa femme. Eugénie survécut mais ne put plus avoir d’autres enfants. Ils s’installèrent à Omaha en 1855, un an après la fondation de la ville. Après la mort de son mari, en 1863, Eugénie refusa de se remarier. Et pourtant ce n’était pas les demandes qui manquaient. Bien qu’approchant de la cinquantaine, elle était restée très belle et beaucoup d’hommes auraient bien voulu l’épouser, mais c’était en vain qu’ils faisaient leur demande. Quand, en juin 1869, elle trouva la lettre de Victor -il n’avait pas même dix-sept ans- lui expliquant qu’il était parti pour l’Ouest (sans plus de précisions) promettant de venger son père et insistant sur le fait qu’il « les retrouverait et les abattrait tous », Eugénie fut horrifiée. Foudroyée par la nouvelle, elle resta hébétée pendant un long moment face aux quelques lignes écrites par son fils. Elle tombait des nues, car elle ne se doutait vraiment de rien, ne voyant encore en Victor qu’un doux enfant calme. Et pourtant… Cela faisait un bout de temps que le doux enfant s’entraînait à manier un Colt avec le cousin de son professeur de piano, Radomir Drabek, un Tchèque fraîchement arrivé à Omaha, excellent violoniste, au passé plus que trouble toutefois. Omaha n’étant qu’une étape pour lui vers l’Ouest où il souhaitait exercer ses talents (sans doute pas seulement ceux de virtuose) il accepta bien volontiers d’accompagner Victor dans ses recherches, ce qui permettrait aussi de parfaire l’apprentissage de son élève. Pendant six mois environ Eugénie n’eut aucune nouvelle de son fils. Plongée dans le désespoir le plus profond, elle le pensait perdu pour toujours. Mais, lorsqu’au début de l’année 1870, dans une deuxième lettre, Victor lui annonçait que finalement il venait de s’engager dans l’agence Pinkerton, passée la stupéfaction, l’indignation la gagna et sa colère enfla démesurément. Elle se mit à tourner en rond dans le salon: « Détective ? Détective chez Pinkerton ? Mais quelle idée, qu’est-ce qu’il lui a pris ? Où est-il allé chercher ça ? Quelle absurdité ! Détective… Chasseur de crapules ! Mais c’est… répugnant ! C’est abject ! Sordide ! Ah, quelle horreur ! Détective, non mais voyez-vous ça ! Ah, le sot ! Ah, petit imbécile ! » Et elle finit par utiliser un vocabulaire de plus en plus grossier, ce dont elle ne se serait jamais cru capable, et cela la fâcha encore plus contre Victor, qui, par son comportement, la forçait à dire des horreurs. Elle avait tellement honte qu’il ait fait ce choix, ce n’était pas là un métier honorable, d’ailleurs un « métier », on ne pouvait pas appeler cela un « métier », mais plutôt une vile tâche qui le ferait sans cesse vivre au contact de la pire canaille. Que cela était dégradant, pour lui comme pour elle ! Et ses amis, ses connaissances, ses voisins qui n’allaient pas tarder à être au courant ! Mais ceux-ci, par respect pour Eugénie, ne lui en parlèrent jamais, sachant à quel point elle avait été blessée et attristée. Heureusement, Victor exerçait sa méprisable besogne loin de là, hors du Nebraska, au Colorado, au Kansas ou le diable savait où ! Alors qu’elle l’avait toujours choyé, qu’il avait reçu une bonne éducation et qu’elle lui avait payé (sur ses économies personnelles toujours) des cours de piano -ayant convaincu ce professeur tchèque, leur voisin à New York, Mr Janecek Drabek, de venir s’installer à Omaha pour lui donner des cours- qu’il avait été un enfant calme, sans histoire, pas bagarreur, que lui était-il soudain arrivé ? Elle n’avait pas compris quelles étaient ses motivations et les explications qu’il avait données pour justifier son choix lui paraissaient étranges, même si, bien sûr, il y avait eu le drame de la mort de son père, tué sous ses propres yeux. Mais pour Eugénie, cela ne pouvait pas expliquer cette décision qu’elle considérait désastreuse et elle n’avait cessé de condamner sa conduite. C’est pourquoi au bonheur que ressentait Eugénie de revoir son fils se mêlaient toujours de la déception, de l’amertume et une certaine colère. Eugénie avait toujours imaginé Victor en grand pianiste (ne sachant pas d’où cela lui venait, personne dans sa famille ni dans celle de son mari n’était musicien et elle n’avait été influencée par aucun exemple autour d’elle.) Son mari avait accepté que Victor apprenne le piano mais il voulait qu’il fasse ensuite quelque chose de plus « sérieux ». S’il n’était pas mort prématurément, Pilib se serait sans doute opposé au rêve de sa femme, car le sien était d’envoyer son fils à l’université, à Chicago, voire à Cambridge ou Harvard. Une voisine irlandaise avait dit à Eugénie que le patronyme « Brennan » venait du mot chagrin et en effet le père et le fils lui avaient causé bien des chagrins, pas de la même nature toutefois. Alors que son mari, qui était la probité incarnée, s’était toujours conduit de façon si digne, si honnête, Victor… Ah, Victor ! Que lui était-il donc passé par la tête ? Même si elle essayait de chasser ses noires pensées, elle était régulièrement tourmentée par la crainte d’apprendre sa mort et quand George Walter, le shérif, passait pour venir la saluer (il avait le béguin pour elle mais n’osait pas faire sa demande, se doutant qu’elle le refuserait comme les autres) l’angoisse l’envahissait toujours car elle imaginait le pire. Elle aurait certes pu sombrer dans la folie après la mort de son mari, se jeter dans le Missouri après le départ de son fils, mais non, elle n’avait rien fait de tout cela. Elle avait prié -elle se rendait chaque semaine à la cathédrale Sainte Philomène- espérant que Dieu accueillerait l’âme de son défunt époux tant aimé au Paradis et guiderait Victor sur un chemin plus sage. Sur le plan matériel, Eugénie vivait dans une aisance certaine, son mari lui avait laissé suffisamment d’argent et surtout, elle avait hérité une véritable fortune de son vieux grigou de père qui était décédé l’année où Victor avait quitté le foyer familial. Si elle avait ouvert une boutique de chapeaux, c’était pour s’occuper et non pour gagner sa vie, boutique qui par ailleurs connaissait un grand succès, toutes les élégantes d’Omaha se précipitaient au « Chapeau de la Parisienne. » Victor retrouvait à chaque fois avec plaisir l’intérieur confortable de la maison de sa mère : tout était impeccable, astiqué, en ordre, même s’il se faisait toujours la même réflexion : « Tout ce rose et ce parme, ç’a un peu un côté bonbonnière, mais enfin, cela convient pour une femme seule… » Après un délicieux déjeuner, Victor se mit au piano avant même que sa mère le lui demande car il savait que cela lui ferait plaisir. Victor se disait avec satisfaction que le premier jour cela commençait toujours bien : après un bon repas, quelques airs au piano. Ça se dégradait après… Eugénie avait acheté avec ses propres économies un piano droit, un Erard, lorsque Victor avait commencé à apprendre à jouer, à cinq ans et demi, et le faisait accorder chaque année, même si Victor ne passait pas plus de deux ou trois fois par an. Elle-même jouait un peu. Il joua d’abord du Mozart car il savait qu’elle aimait beaucoup ce compositeur. A peine eut-il achevé « la Marche turque » que sa mère ne put s’empêcher de s’exclamer: « Tu gâches vraiment ton talent, tu aurais pu être un grand pianiste ! D’ailleurs il n’est pas trop tard… » « Ça commence toujours bien, hum… » pensa Victor, qui préféra ne rien répondre, faisant mine d’être absorbé par l’interprétation de la sonate n° 8 de Mozart. - Tu devrais nous jouer la sonate de Beethoven que Mr Drabek t’avait apprise la dernière année, tu sais celle qu’on appelle l’Appassionata, et puis aussi la Rhapsodie hongroise de Liszt. Ce n’était pas par hasard si Eugénie lui réclamait de tels morceaux (elle demandait conseil pour cela auprès de Mr Drabek), c’était des partitions particulièrement ardues, son seul but étant de vérifier la virtuosité de son fils. Victor le savait bien, déjà à Noël dernier, elle lui avait demandé de jouer la fantaisie impromptue de Chopin et le grand galop romantique de Liszt, là encore des pièces qui nécessitaient une habileté de musicien accompli. Il ne put s’empêcher de répliquer : - Tu as vraiment envie d’entendre ça ou si c’est pour… et là Victor hésita sur les mots - comme il n’utilisait plus le français très souvent, il avait tendance à oublier certaines expressions- … pour me mettre à l’épreuve ? - Mais en plus, tu perds ton français ! Ah ! Il ne manquerait plus que ça que tu perdes ton français ! Il faut que tu l’entretiennes ! Il faudra que tu emportes quelques livres et que tu les lises à voix haute. Vaincu, Victor se contenta finalement de dire, très calmement, que dans ce cas, il devrait y travailler plusieurs heures. Il passa donc toute une partie de l’après-midi et de la soirée à revoir la sonate de Beethoven. Sa mère était aux anges, d’entendre ainsi le piano résonner dans toute la maison, comme « avant ». Victor soudain cessa un moment de jouer. Il se prit à penser qu’il ferait peut-être mieux de faire des fausses notes, de massacrer la partition pour qu’ainsi sa mère ne l’importune plus avec ça. Mais… Non… Il ne pouvait quand même pas faire ça à Beethoven, lui assassiner son Appassionata… Et il reposa les mains sur le clavier. Quand sa mère voyait ainsi son fils, si beau, si élégant, jouant du piano, elle ne pouvait pas l’imaginer en train de… enfin, en train de… Elle ne savait comment dire. D’ailleurs elle ne l’avait jamais vu tenir une arme et ne savait pas vraiment en quoi consistait son métier (enfin, son premier métier, celui de détective.) Mais malgré elle, elle l’imaginait parfois, le voyant vêtu en cowboy, avec des vêtements sales, le visage maculé, rampant par terre, dans un brulant désert, des coups de feu éclatant au loin. Elle ne savait pas pourquoi, mais à chaque fois que lui venait ce genre d’images elle l’imaginait dans le désert. Une réminiscence de Manon Lescaut de l’abbé Prevost peut-être, dont la lecture l’avait fortement impressionnée quand elle était jeune ? Néanmoins, elle ne pouvait se représenter son Vic chéri une arme à la main. Et quelquefois, aussi, surgissait une terrible vision : Victor, allongé sur le dos, immobile -toujours dans un désert- une grosse tâche de sang sur la poitrine ; quand cela lui arrivait, de jour comme de nuit, Eugénie se précipitait sur ses rubans, voiles et autres accessoires et elle se mettait à confectionner un chapeau. Elle se plongeait dans sa création, s’y absorbait et finissait par oublier. En fin d’après-midi, alors que Victor faisait une pause et s’était allongé sur un des canapés tendu d’un beau velours rose pêche, sa mère vint s’assoir auprès de lui. Alors qu’elle lui passait la main dans les cheveux, elle lui dit tendrement, comme à son habitude : « Tu as les cheveux de ton père. » Puis, après un court silence : « Au fait, tu sais que Laura est revenue de New York et qu’elle va se marier à la fin du mois ? » « Ah, elle attaque déjà sur le mariage ! » pensa Victor, qui toutefois ne put s’empêcher de ressentir un pincement au cœur. Il aimait Laura. Néanmoins comme celle-ci n’avait jamais fait montre d’un quelconque sentiment amoureux envers lui, il était résolu à l’oublier –ou du moins à essayer. Ils ne s’étaient même pas revus au dernier Noël. - Oui, tu me l’as déjà dit à plusieurs reprises à Noël dernier, que le mariage était prévu pour ce mois-ci. Et toi maman, pourquoi tu ne te remarierais pas, Mr Frog a encore fait sa demande, c’est le vieux Tom qui me l’a dit ce matin… Mais à peine avait-t-il prononcé ces quelques mots qu’il le regretta, il savait bien pourtant ce que cela allait déclencher… Et en effet l’habituelle litanie de réprobations se mit à cascader, et ce furent à n’en plus finir des : « Oh enfin, quelle idée ! », « Tu n’y penses pas », « Comment ! Tu voudrais que j’oublie ton père », « Moi, me remarier, jamais »… Pour échapper un peu à ce déluge, Victor se leva et se remit au piano, reprenant l’Allegro ma non troppo de l’Appassionata. Le flot finit par cesser et Eugénie revint à son idée première. - Quand je pense que vous vous entendiez si bien, Laura et toi, tu te rappelles ? Vous étiez inséparables, depuis que vous étiez tout petits. Eugénie avait toujours espéré qu’ils se marieraient ensemble. Laura était la fille du juge Wright, la famille était originaire de Richmond et était venue s’installer à Omaha la même année que les Brennan. - Et dire qu’elle va épouser cette grosse larve de Charles Pencil, c’est sûrement par dépit, car je suis sûre qu’elle aurait préféré… - Maman ! Tu me l’as déjà dit ! - Et toi, quand vas-tu te marier, Tu vas avoir vingt-quatre ans en août prochain. - Et bien justement, il n’y a pas d’urgence. - Et d’ailleurs, est-ce que tu reviendras pour ton anniversaire, pour le seize août ? - Je ne sais pas, ça dépendra… - Tu n’aimerais pas avoir ton foyer, une épouse, vivre une vie normale, plutôt que de… de vagabonder ainsi ! - Maman, tu exagères ! - Un jour, on va te mettre en prison ou même on va t’envoyer aux travaux forcés pour vagabondage, et tu travailleras comme un esclave sur une route ! - Maman ! Eugénie était tellement prise par ses pensées qu’elle n’accordait plus aucune attention à la musique. Victor était en train de reprendre depuis le début, depuis l’Allegro assai, il secouait la tête, sentant monter l’agacement. Ah, cette éternelle rengaine, sa mère qui voulait le voir marié... Eugénie s’était tu. Cependant, une question lui brûlait les lèvres, à chaque fois la même, mais jamais elle n’oserait aborder un tel sujet avec son fils. Elle se demandait s’il, ne, … ne fréquentait pas,… quand même, ces … ces lieux -elle n’arrivait pas à formuler même en pensée le mot « maisons closes. » Enfin, les trois jours se passèrent plutôt bien, chacun y mettant du sien. Eugénie se résigna, tentant de réfréner ses reproches, tandis que Victor resta attentionné, se gardant de montrer de l’impatience. VI - Avec un salaud pareil, ça va nous en faire des suspects, hein ? Parce que, le Julius, y avait un tas de gars qui lui en voulaient et qui auraient rêvé de lui faire la peau. Depuis tous les cocus aux dizaines de pauvres types qui ont été plumés en faisant affaire avec lui. C’est qu’il en a berné du monde. Ça risque d’être compliqué, vous croyez pas ? Paul Honor, le shérif de Delano, garda le silence et ne réagit pas mais il avait un air concentré et son adjoint qui le connaissait bien - ils travaillaient ensemble depuis quatre ans - savait qu’il avait été écouté. - Ouais, je vois que vous avez déjà une idée, c’est ça ? - Oh, y a pas à aller chercher bien loin, tu vois ce que je veux dire. Cette histoire de wagon frigorifique… - Vous pensez quand même pas à Albert Cooler ? Alors là, franchement,… Il se mit à ricaner. Y a mieux comme tueur sanguinaire ! Ce pauvre Albert, à part pleurnicher et se saouler la gueule depuis deux ans… - Je ne te dis pas que c’est lui qui a tué Julius Hole, mais… Il sait peut-être quelque chose. J’irai lui rendre une petite visite dès que possible. Paul Honor avait tout de suite été mis au courant du meurtre de Julius Hole. Et il en avait été plus que contrarié. Et pas seulement d’avoir été réveillé à trois heures du matin. Il s’était aussitôt rendu sur les lieux -même si sa femme Nellie lui avait dit que ça pouvait attendre : « Maintenant qu’il est mort, y va plus aller bien loin, tu verras ça demain »- mais le problème, c’était que personne n’avait rien vu apparemment. Bon, le shérif ne désespérait pas car il y a toujours des témoins qui mettent un peu de temps à parler. Et puis, il y avait un autre souci et ce n’était pas le moindre, le frère de Julius Hole, le richissime et puissant Blake Hole, déjà averti du drame, avait envoyé en fin de matinée un télégramme annonçant sa venue et sa ferme intention de retrouver le meurtrier de son frère au plus vite. Paul Honor redoutait la rencontre car Blake devait sans doute être tout aussi arrogant que son frère et il allait sûrement vouloir lui dicter ses exigences. Il allait l’avoir dans les pattes et il avait horreur de ça même s’il était bien décidé à ne pas se laisser faire. Mettant ces préoccupations-là de côté, Paul Honor se concentra sur son enquête. Avec son adjoint, il se rendit à nouveau sur les lieux pour les inspecter avec soin au grand jour et interroger encore les éventuels témoins mais il ne fut pas bien plus avancé. Puis, laissant à son adjoint le soin d’essayer de dresser la liste de tous les potentiels suspects, le shérif se rendit chez Albert Cooler, au 16, Douglas Avenue à Wichita. Paul Honor avait bien connu le père d’Albert et avait conçu pour lui une grande estime. Quand il avait appris la nouvelle de sa mort, il en avait été très affecté. Il le trouvait tellement courageux, avec cette affaire qu’il avait réussi à monter contre vents et marées. Il savait parfaitement que le fils de John était incapable de tuer qui que ce soit mais il voulait savoir s’il n’était tout de même pas mêlé à cette histoire. Entre deux verres de whisky, il avait peut-être trouvé le courage d’engager un tueur. Car si c’était le cas, quitte à prendre quelques libertés avec la loi (cela lui arrivait de temps à autre, oh, mais attention, jamais pour protéger de grands criminels mais plutôt pour tirer du pétrin de pauvres gars qui s’y étaient mis suite à un mauvais concours de circonstances) il chercherait comment l’aider, compte tenu de l’amitié qu’il portait à son père. Cependant si Blake Hole venait à apprendre qu’Albert était à l’origine du meurtre de son frère… Il ne donnait pas cher de la peau du jeune homme. Allez, on verra bien ! se dit Paul Honor, arrêtant là ses réflexions puisqu’il arrivait devant la maison des Cooler. Il connaissait les habitudes d’Albert et ne frappa pas à la porte principale, il contourna la maison. Cependant, elle avait l’air encore plus inhabité que d’habitude et elle l’était en effet. Le shérif interrogea alors une des voisines d’Albert, la vieille Carrie, qui jour et nuit était à sa fenêtre, épiant les faits et gestes de tous ceux qui passaient dans son champ de vision. Elle était tellement efficace dans ce domaine que Paul disait souvent à son collègue de Wichita qu’il devrait la prendre comme adjointe. Et quand elle lui dit que oui, ce matin très tôt, le petit Albert était parti sur sa vieille carne décharnée avec des fontes bien remplies, et qu’une semaine plus tôt, tard le soir, il avait reçu deux hommes, Paul se dit qu’il avait donc peut-être vu juste. Il alla aussitôt chez Frank End, le meilleur ami d’Albert, mais celui-ci lui affirma qu’Albert et lui étaient fâchés et qu’ils ne s’étaient pas vus depuis une semaine à peu près. Paul passa ensuite chez son collègue de Wichita, qui était déjà au courant de la mort de Julius Hole, et lui dit de faire rechercher Albert, mais discrètement, et de l’avertir si on le trouvait. Quand il revint à son bureau de Delano, son adjoint avait déjà noirci neuf pages de noms et entamait la dixième. - Alors, qu’est-ce que ça a donné ? - Je peux encore rien dire mais… - Ah, mais, quand même, quand vous dites ça c’est que vous avez appris quelque chose… - Eh bien, la vieille Carrie m’a dit qu’il s’était barré tout juste ce matin et qu’il a reçu deux types il y a une semaine environ, au milieu de la nuit. - Nom de Dieu ! Vous aviez sacrément bien vu ! Il faut le faire rechercher et l’arrêter ! - Ne nous emballons pas. Y’a l’autre Hole qui va se pointer et je suppose que ça va pas être un marrant. On va l’avoir sur le dos, ça va pas tarder. Albert, je le connais bien, je veux pas faire n’importe quoi et je veux l’interroger moi-même. - Ouais, mais il faut le retrouver. - Hum, pas d’inquiétude, je suis sûr qu’il n’est pas loin. - Et s’il s’était barré chez sa mère ? En Californie, je crois ? - On verra dans ce cas, mais… je ne pense pas. J’ai déjà prévenu Jack, on va le chercher. Dans les environs. Mais aussi bien, il reviendra tout seul. L’adjoint de Paul Honor se fia au flair de son chef, il avait une grande confiance dans le shérif qui depuis des années montrait perspicacité et courage - faisant le coup de feu quand il le fallait- et qui avait déjà mis derrière les barreaux nombre de coupables. En fait Albert n’avait pas du tout prévu de partir. Victor Brennan lui avait demandé de le croiser « par hasard » à dix heures du matin, à la sortie du barbier de Topeka Street, le lendemain de leur première rencontre, pour lui remettre les 545 dollars -Victor avait dû insister la veille pour qu’Albert ne l’encombre pas de ses 50 cents- et tout s’était bien passé. Mais le matin suivant l’assassinat, Albert avait été pris d’une irrépressible trouille et sans réfléchir, ayant jeté quelques affaires dans des sacs de selle, avait sauté sur le vieux cheval de son père pour partir au hasard. Il avait laissé le cheval aller où il voulait et celui-ci l’avait mené à El Dorado, à trente miles de là, où Albert avait demandé l’hospitalité à de pauvres fermiers. Quatre jours après la mort de Julius -dont le corps avait été placé dans un des wagons réfrigérés de la Hole Refrigerator Line pour éviter sa décomposition- Blake Hole et son épouse arrivèrent à la gare de Wichita. Blake était long, sec, vêtu de noir -comme il l’était toujours -d’un abord sinistre, sa triste mine n’étant pas due à son deuil, elle lui était habituelle. La petite femme à l’air maussade, vêtue d’une stricte robe noire, tellement effacée qu’on en percevait à peine la présence, était Hélène Hole, son épouse. Le couple austère s’installa dans la clinquante demeure de Julius. Etonnamment, Blake Hole organisa des funérailles très sobres pour son frère : pas de grande cérémonie, de tombe surmontée de statues, de couronnes en quantité, de cortège interminable, d’éloges funèbres grandiloquents. Blake Hole avait une allure si terne que cela fit dire à l’adjoint de Paul Honor (qui avait assisté à l’enterrement avec son chef et le shérif de Wichita) : « Il paye vraiment pas de mine, ce type, si j’avais pas su qui il était je lui aurais donné un billet d’un dollar pour qu’il puisse aller manger à sa faim… Quant à son épouse… elle était où ? Je ne l’ai même pas vue.» Les vieux parents Hole avaient demandé à leur fils de rapatrier le corps à Boston, pour qu’il soit déposé dans le caveau familial mais Blake s’y était fermement opposé. Ses parents n’avaient pas compris pourquoi il s’obstinait ainsi, mais il avait insisté et affirmé qu’il fallait respecter les dernières volontés de Julius. Ils cédèrent sans trop de difficulté : Julius avait toujours mené la vie qu’il voulait alors qu’il en aille de même pour sa mort… Ce que Blake n’avait par contre révélé à personne, c’était que, juste après la mort de son frère, il s’était très longuement entretenu avec lui -enfin… avec son esprit- lors d’une séance de spiritisme particulièrement exaltante, Julius lui ayant fait d’extraordinaires révélations. - Il « exige », rien que ça, monsieur « exige » ! - Allez, dites-moi tout, ça vous soulagera et ça soulagera aussi Nellie, ça lui évitera de vous entendre maugréer pendant des heures ce soir. - Blake Hole, cette espèce d’oiseau de mauvais augure, « exige » que je lui donne régulièrement des nouvelles de l’enquête et il a ajouté :« Si vous trouvez le tueur rapidement, je vous récompenserai. » Comme si nous étions ses larbins. Il « exige », non mais, à quel titre ! Ah, il est peut-être habillé comme un quaker mais il agit en tout cas comme s’il était Dieu tout puissant. Il faut que tout et tous lui obéissent au doigt et à l’œil ! - Bah ! Vous en avez vu d’autres… - Il dit également qu’il va faire venir des détectives privés de Chicago, de cette agence connue, là, tu sais, de chez Pinkerton. Après un silence, l’adjoint de Paul Honor, qui avait compris à quoi pensait le shérif, reprit : - Vous vous faites du mouron pour Albert, c’est ça ? - Les gars de chez Pinkerton, ils font pas dans la dentelle, et s’ils le retrouvent avant nous… Je comprends pas qu’on ait pas encore mis la main dessus, où il s’est fourré, ce con-là ! - Et sa mère ? - J’ai télégraphié, non, rien de ce côté-là. - S’il faut ratisser tout le Kansas… Cela ne fut pas nécessaire. Albert Cooler revint à Wichita, comme l’avait prévu le shérif, au bout d’une quinzaine de jours. Quant aux quatre enquêteurs de chez Pinkerton que Blake avait fait venir, ils avaient jusque-là fait chou blanc eux aussi. Ils avaient eu beau interroger, fureter, tout retourner voire menacer, ils n’avaient rien trouvé et le shérif savait que nul ne leur avait parlé d’Albert Cooler. Paul Honor se rendit aussitôt au 16, Douglas Avenue, prévenant son adjoint de n’en rien dire à personne. Quand il vit le shérif à sa porte, Albert recula, effrayé, comme si la poignée l’avait brûlé. Il avait une mine épouvantable, les cheveux ébouriffés, les yeux injectés de sang. Il resta interdit et ce fut Paul Honor qui insista pour entrer. - Bonjour Albert, alors on a fait un petit voyage ? - Euh… Oui, enfin, non… - Si tu veux bien, on va un peu papoter tous les deux. Le shérif entra et s’assit à la table de la cuisine sans attendre l’invitation. Albert ressortit machinalement sa vieille bouteille de rhum. - Je ne sais pas si tu es au courant, mais Julius Hole est mort. - Ah… - Tu n’en as vraiment pas entendu parler ? - Non, pas du tout. - C’est étrange, tout le monde ne parle que de ça en ce moment à Wichita et à Delano. - Et il est mort comment ? - Eh bien, pas en avalant un noyau de cerise de travers, mais bien plutôt d’une balle de Winchester en plein dans la tête. Albert sursauta comme s’il venait d’entendre le coup de feu. - C’est pas moi, répliqua bêtement Albert sans réfléchir. - Oui, ça je m’en doutais un peu. Il y eut un assez long silence, Albert avait les yeux baissés, il n’osait pas regarder le shérif. - Moi, je le sais, que ça peut pas être toi, mais,…ça fait quand même un bon bout de temps que tu claironnes un peu partout que tu voulais sa mort, à Julius. Tu étais où la nuit du 25 au 26 mai ? - Je sais pas, ici sûrement. Il avait parlé avec une voix si faible que Paul dut se pencher pour entendre. - Tu comprends, quand je dis que je pense que c’est pas toi, c’est juste ma conviction personnelle, mais tu avoueras qu’un type qui crie sur tous les toits pendant deux ans qu’il veut en crever un autre, ça fait un sacré beau suspect. Tu te rappelles vraiment pas ce que tu faisais cette nuit-là ? Tout se mélangeait dans la tête d’Albert, ça bourdonnait, bourdonnait, il était incapable de réfléchir. Et encore plus incapable de se rappeler qu’il avait passé cette nuit-là seul, à faire ses maigres comptes, se demandant bien comment il allait payer les trois ouvriers qui lui restaient puisqu’il avait donné à Victor Brennan tout l’argent qui était encore en sa possession. - C’est que je vais quand même être obligé de t’emmener, comme suspect, pour t’interroger. Et là Paul s’arrêta, il savait que cela suffisait, Albert était suffisamment terrorisé, il dirait tout ce qu’il savait, il n’y avait pas besoin d’en faire plus. - Mais vous avez dit que vous saviez que ce n’était pas moi, dit Albert, toujours d’une voix blanche. - Oui, mais je te le répète, c’est ma conviction personnelle, je n’ai aucune preuve, tu es le principal suspect. Et puis, si c’est pas toi, t’as bien pu engager quelqu’un pour le faire… Albert répondit trop vite : « C’est que ça coûte cher ce genre de type, et moi j’ai pas d’argent. » - Tiens, tiens. Albert se mordit les lèvres. Il finit par lâcher : - De toute façon, je connais pas son nom. Le shérif sentait que ça allait venir, il n’y avait plus qu’à laisser aller… - Ah oui, mais tu sais peut-être des choses, à quoi il ressemble, par exemple? Comme Albert hésitait et que le silence durait trop, Paul Honor décida d’en rajouter un peu. - Bon, allez, hop, puisque tu ne veux rien dire ici, suis-moi. - Si je vous dis ce que je sais vous me laisserez tranquille ? - Ah, bien, voilà qui est plus raisonnable. Bien sûr, on en restera là. Ce que je veux, c’est arrêter l’assassin. Même si tu n’es pas blanc-bleu dans l’affaire, mais bon, je veux bien passer l’éponge, en souvenir de ton père. On dira que tu as eu un moment d’égarement. Albert tergiversa encore. - Oui, mais… Lui… S’il apprend que j’ai parlé, il pourrait bien… - Se retourner contre toi et venir un soir avec sa Winchester pour te régler ton compte ? Le shérif le rassura tout de suite. - Ne t’inquiètes pas, je prends tout sur moi, je dirai que quelqu’un l’a vu à la sortie du Red Orchard. Après une nouvelle pause, Albert chuchota : - Je sais quasiment rien, je sais pas son nom. - Ça tu l’as déjà dit. Mais à quoi il ressemble ? - Un grand gars, habillé en noir. - Tu peux pas en dire plus, couleur des cheveux, des yeux ? - Les cheveux, bruns ou noirs, les yeux, je sais pas, noirs je dirais, foncés en tout cas. - Gros, maigre ? Jeune ou vieux ? - Mince et jeune, dans les vingt, vingt-cinq ans. - Des cicatrices ? - Je crois pas, j’ai pas vu, non, pas de cicatrices. - Habillé en noir, mais comment ? - Oh, des vêtements luxueux, très élégant, on l’aurait cru sorti du Capitole… Il y eut encore un long silence, puis Albert se lança, avec une voix tremblante. - Un type, euh… Il s’arrêta juste à temps, il allait donner le nom de Peter Drabek… Enfin, on l’a appelé Vic devant moi et on m’a dit qu’il était originaire du Nebraska. - Oh, dis-donc, voilà que la mémoire te revient ! - Et aussi… - Quoi ? - Oh, non… c’est une bêtise… un détail. - Dis toujours. - Qu’il jouait du piano. Là, le shérif s’esclaffa. Il se voyait envoyer des télégrammes à tous ses collègues du Nebraska leur demandant s’ils connaissaient un tueur qui jouait du Colt et du Beethoven ! - Bon et c’est tout ? - Oui, je vous assure. - Je vais te laisser. Reste tranquille pour l’instant, je te dirai quoi faire. Ne parle à personne d’autre. Le shérif se leva et était déjà en train d’ouvrir la porte, quand Albert s’écria : - Ah ! et aussi … - Quoi ? Il joue du violon également ? C’est ça ? - Non, il est gaucher. Paul Honor regagna Delano, se demandant si ces maigres informations l’amèneraient quelque part. S’il avait réussi à tranquilliser cette tête de linotte d’Albert en lui faisant croire qu’il suffisait de retrouver le tueur pour ne plus rien avoir à craindre, il n’en allait pas ainsi en vérité. Car si Hole venait à apprendre -ou quiconque- qu’Albert était le commanditaire du meurtre, il serait forcément arrêté. Mais Paul avait sa petite idée. Il lui suffirait de débusquer l’assassin, de le mettre hors d’état de nuire en lui collant quelques balles dans la peau (et par là même dans l’impossibilité de révéler qui l’avait engagé !), il invoquerait bien sûr la légitime défense, puis inventerait le motif qui avait poussé ce pauvre type à se venger, par exemple, qu’il avait été mis sur la paille par Julius ou tiens, que sa femme…. ou sa fille, oui, ça c’était pas mal, sa toute jeune fille, une petite de quinze ans, avait été déflorée par Julius. Paul Honor était content de lui, content de sa trouvaille et c’est plein d’espoir qu’il rentra chez lui. Il ne lui restait plus qu’à découvrir qui était le tueur, à le retrouver et à le supprimer. A cette pensée, sa bonne humeur se flétrit un peu.
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
 Sujets récents
Sujets récents
|





 Messages récents
Messages récents