91
« Dernier message par Apogon le jeu. 19/01/2023 à 17:18 »
Le Rebound Guy de Sophie Lim Pour l'acheter : Librinova Amazon Fnac * Ce livre est disponible partout, y compris en librairie physique, sur commande. 1. En s’arrêtant au Drinks of the World de la gare de Cornavin, Victoria était à mille lieues de se douter qu’elle croiserait la route d’un jeune homme de 26 ans qui ébranlerait ses sentiments naissants pour Bruno ; le seul qu’elle jugeait digne d’intérêt depuis sa rupture. Âgée de 24 ans et titulaire d’un master en communication qui la maintenait au chômage, elle avait quitté Annecy dans la précipitation, en vue d’aider son oncle Roger, hospitalisé à la suite d’une infection nosocomiale qui le paralysait. Établi à Genève, il gérait avec sa fille Véronique l’agence Haut les cœurs, fondée sur le concept d’homme pansement ou de rebound guy. Les femmes brisées par l’amour recouraient à leurs services pour panser leurs blessures, avant d’entamer une nouvelle relation. Quelques rares clientes voulaient se divertir avec un jeune premier à la beauté parfaite ou entendre des paroles réconfortantes qu’elles ne trouvaient pas chez elles. Victoria, qui fuyait tout ce qui s’apparentait à des rencontres forcées, comme les rendez-vous arrangés et les soirées speed dating1, n’avait pas manqué de le répéter à son oncle. Seule l’affection qu’elle lui portait l’avait incitée à lui prêter main forte durant son absence et à emménager temporairement dans son appartement. Sans emploi et larguée comme une vieille chaussette, elle avait préféré passer la frontière. S’immerger dans un monde inconnu valait mieux que de broyer du noir sur le territoire français, en serinant « VDM2 » ; son refrain favori depuis que sa rupture lui avait dessillé les yeux sur sa vie de merde. Après avoir récupéré quelques affaires à Annecy, elle pénétra dans le magasin Drinks of the World, situé au niveau des quais, à côté des escaliers. Avec ses 2 000 produits, c’était le royaume des boissons alcoolisées et énergétiques par excellence. Au-delà de son envie de revoir Bruno, qui y travaillait à temps partiel pour financer ses études de droit, elle cherchait des spiritueux pour le pot de bienvenue organisé en son honneur. Pour son premier jour de boulot, il fallait marquer le coup. Son choix se porta sur une Lager3 aux herbes et aux épices, dont le goût et le packaging se démarquaient par leur originalité. Tandis qu’elle discutait avec Bruno près des caisses, une voix pleine d’exaspération l’apostropha. En se retournant, elle vit un apollon châtain, version glaçon. Alors qu’il la toisait en lui montrant l’étendue de sa langue vipérine, elle observa son visage, captivée par la régularité de ses traits. Comment un être à la plastique irréprochable pouvait-il se comporter comme le dernier des sagouins ? L’inconnu grossier avait des cheveux raides qu’on mourait d’envie de caresser, tant ils paraissaient soyeux. Les mèches rebelles qui tombaient sur son front laissaient deviner de magnifiques yeux pers dans lesquels beaucoup de femmes se noyaient volontiers. — Si j’étais toi, je testerais mon pouvoir de séduction sur mon miroir. C’est le seul nom masculin capable de te supporter. Tu perds ton temps et tu me fais perdre le mien. — On n’a pas élevé les cochons ensemble, que je sache ! Vous ne me connaissez même pas et vous me tutoyez. 1 Anglicisme qui désigne le fait de rencontrer des prétendants en quelques minutes, les uns après les autres. Le but consiste à déterminer s’il existe des affinités entre les individus, afin d’envisager, ou non, un deuxième rendez- vous galant. 2 Acronyme du site Web français viedemerde.fr. Le site recense des anecdotes de quelques lignes sur les désagréments de la vie quotidienne. Le ton employé se veut humoristique. 3 Terme se rapportant à des bières à fermentation basse. — Pff ! RI-DI-CU-LE ! On doit avoir le même âge. Si ça se trouve, t’es même plus jeune que moi. Un conseil : mets-la en veilleuse. Déjà que tu ne ressembles à rien, si tu l’ouvres, c’est encore pire. À cette allure-là, tu vas faire fuir tous les mecs et tu finiras vieille fille. Atterrée, Victoria scruta le pack de boissons énergétiques qu’il tenait entre les mains, avant de le fixer avec des éclairs. — Je ne vous permets pas ! Si vous êtes si pressé, pourquoi venir dans une boutique spécialisée, juste pour des Red Bull ? — J’ai… mes raisons. Je n’ai pas de temps à perdre avec une cruche sans charme comme toi. En plus d’être moche, t’as pas oublié d’être bête. Je dois apporter ces boissons à un pot de bienvenue. J’espère que la nouvelle recrue ne sera pas aussi cruche que toi et qu’elle les appréciera. Il a un pot de bienvenue, lui aussi ? C’est notre seul point commun… Mais pourquoi je cherche des points communs avec lui ? Ce n’est pas comme si c’était mon genre de mec. Je plains sa nouvelle collègue. Je me demande quel est son boulot. Vu comment il est méprisant, il est soit mannequin pour un petit catalogue de rien du tout, soit vendeur de produits de luxe. Tout dans l’apparence, rien dans la tête. — Quelle idée ! Les Red Bull ont un goût un peu spécial qui ne plaît pas à tout le monde, alors pourquoi vous… — Imagine qu’elle ait deux de tension. Ça la réveillera. Les Red Bull, c’est comme l’amour ; ça donne des ailes. Si elle n’aime vraiment pas, je les garderai pour moi. Dans les deux cas, je suis gagnant. De toute façon, je gagne toujours. — C’est sûr, au concours du plus antipathique, vous gagneriez à coup sûr, marmonna Victoria entre ses dents, en espérant ne pas se faire entendre. — Laisse-moi payer mes boissons, au lieu d’aggraver ton cas. Toi là, le p’tit brun, merci de faire ton job et de m’encaisser. L’individu poussa Victoria et déposa ses boissons sur le comptoir. Son attitude déconcertante la musela. Elle s’interrogea sur le bien-fondé des Red Bull dont la condamnation pour publicité mensongère avait été relatée dans les journaux et sur Internet. L’information avait notamment été relayée par le site Hitek que son âme de « geekette » exhortait à suivre. L’article, qui datait du mois d’août 2019, commençait ainsi : « Canada : Red Bull ne donne pas d’ailes ». Offrir des Red Bull en guise de cadeau de bienvenue constituait un pari risqué, bien que l’apollon ne semblât pas s’en soucier. D’ailleurs, lui arrivait-il de s’intéresser à autre chose qu’à sa petite personne ? Lorsqu’il se trouva face à Bruno, ce dernier lui jeta un regard rempli de haine qui semblait n’avoir aucun rapport avec Victoria. C’était le genre de regard fixe et appuyé qui signifiait : « Un jour, j’aurai ta peau… » * Les mots rassurants de Bruno n’avaient pas rasséréné Victoria qui courut vers l’appartement de son oncle pour se changer. Elle était attendue à l’agence, mais qu’importe, l’apollon cynique l’avait vexée. S’il n’était pas capable de déceler son charme, elle éblouirait d’autres hommes. Prouver qu’un peu de sex-appeal sommeillait en elle constituait sa revanche du moment. Les propos du connard ne représentaient rien de plus que des remarques désobligeantes émanant d’un inconnu, alors pourquoi était-elle autant perturbée ? Était-ce à cause de son joli minois ? Elle ne l’avait vu qu’une fois et elle ne le recroiserait sans doute jamais. D’habitude, elle ripostait et reprenait le cours de sa vie comme si de rien n’était. Des gens mal lunés et des chercheurs d’embrouilles polluaient régulièrement les rues, les supermarchés et les transports en commun ; et leurs insultes injustifiées ne symbolisaient qu’un pet dans l’eau, comme l’avait souligné une amie chinoise qui aimait filer les métaphores. Roger vivait dans le Vieux Genève, près de l’immeuble blanc où le compositeur Franz Liszt et Marie d’Agoult avaient vécu pendant un peu moins de deux ans. Certaines bâtisses méritaient d’être rénovées, mais Victoria adorait ce lieu chargé d’histoire avec ses rues pavées, ses arches et ses trésors médiévaux. Quinquagénaire fraîchement divorcé, Roger avait emménagé dans un trois-pièces avec deux chambres dont l’une était censée accueillir des invités. Elle lui servait en réalité de débarras. Peu avant la venue de Victoria, Véronique et son mari l’avaient désencombrée et arrangée pour qu’elle ressemble à une vraie chambre, à la hauteur de Vicky la cousine. Les meubles modernes blanc cassé juraient avec l’intérieur rustique de l’appartement, conçu dans les tons bruns. Malgré le désordre, Victoria s’y sentait bien, car il y régnait une atmosphère apaisante. Tandis qu’elle troquait son pantalon gris rayé contre une robe prune à la coupe évasée, son téléphone retentit. C’était Véronique au bout du fil. À cause du relooking, elle avait oublié de la prévenir de son retard. Bien que sa cousine trentenaire bougonnât, elle ne lui en tint pas rigueur, car Alban, la star des rebound guys, ne s’était pas encore manifesté. * Cinq mâles âgés d’une vingtaine d’années attendaient Victoria autour des canapés beige clair de la salle d’attente, pendant qu’Enzo, le standardiste gay aux cheveux ondulés, répondait au téléphone. Les discussions autour de la nouvelle recrue et les pronostics concernant le retard d’Alban allaient bon train. Véronique s’était installée à son bureau pour jeter un œil aux derniers chiffres, avant de rejoindre les garçons. L’agence Haut les cœurs se trouvait au quatrième étage d’un immeuble de la rue du Rhône, réputée pour ses boutiques prestigieuses, ses bureaux d’affaires et ses banques. Roger et Véronique l’avaient implantée dans des locaux lumineux et spacieux à l’architecture intemporelle, près du parking du Mont- Blanc et du magasin de chaussures Jimmy Choo. Située en contrebas de la vieille ville et très vaste, la rue revêtait des allures de boulevard ou d’avenue. Certains la comparaient à la Cinquième Avenue new- yorkaise. L’agence baignait dans un décor épuré et sobre avec ses murs gris perle, son mobilier blanc- beige et ses fenêtres aux châssis noir ébène. De prime abord, personne ne se doutait que les lieux abritaient une activité olé olé et non un cabinet de consulting notoire. Sitôt le vestibule franchi, Victoria atterrit dans un grand open-space comprenant deux bureaux à l’entrée, un bar américain dans le coin gauche et un espace salon, composé de trois canapés bordant une table basse et formant une sorte de carré autour de celle-ci. Deux fauteuils avaient été placés à côté du canapé qui était installé en face de l’écran géant. Plaqué contre le mur, il surplombait le reste du mobilier, à la manière des salles d’attente de certaines entreprises du CAC 40. Enzo et les rebound guys assaillirent Victoria. — Alors Miss Frouze, pas trop stressée ? s’exclama Willy, le plus jeune et le plus enjoué. « Miss Flouze » ? Comme si j’étais pleine aux as, s’interrogea Victoria pendant que Véronique lui expliquait que les termes « frouze » et « shadock » désignaient en Suisse « un Français frontalier ». Âgé de 22 ans et de petite taille, Willy avait les cheveux roux et une coupe Playmobil qui allait de pair avec un air moqueur qui ne le quittait jamais. Ses collègues semblaient plus sérieux et plus matures. Véronique réunit tout le monde autour du bureau réservé à Victoria et laissa Julian, le grand brun au look décontracté et aux cheveux hirsutes, lui exposer le système des rebound guys. Différentes classes les caractérisaient. Comme aux Jeux Olympiques, ils appartenaient à la classe bronze, argent ou or, dont dépendait l’étendue des prestations. Les rebound guys de la classe bronze se limitaient aux sorties et aux divertissements, alors que ceux de la classe argent comprenaient les bisous sur la bouche. Pour bénéficier de relations sexuelles, il fallait s’adresser à la classe or. Les rebound guys prirent tour à tour la parole pour se présenter. Willy et Arthur, le brun timide aux cheveux raides, faisaient partie de la classe bronze. Le premier préférait les sorties branchées, tandis que le second proposait des sorties culturelles. Parmi la classe argent, on recensait Julian, le passionné de danse, et Christophe, le rouquin taiseux aux cheveux bouclés, fan de mode et de surf. Au moment d’évoquer la classe or, Constant s’avança vers Victoria et lui baisa la main. Aimant déclamer des vers de Shakespeare et de Lord Byron, il portait une coupe au carré et des vêtements de l’époque victorienne. — J’espère qu’Alban ne va pas trop tarder, lança Véronique en regardant sa montre. — Alban ? réagit Victoria. — Oui, la classe or serait incomplète sans Alban. Monsieur se fait désirer. — S’il t’agace autant, pourquoi tu ne le sanctionnes pas ? — C’est la star de l’agence. Il est très convoité et il pèse lourd dans le chiffre d’affaires. Bref, si tu as quelque chose à dire, dis-le, car je vois bien à ta tête que quelque chose te mine. — Durant tout ce temps, Roger et toi teniez un commerce de gigolos. Si j’étais vous, j’aurais honte. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous restiez vagues sur votre activité. Et dire que j’ai accepté de vous aider. Se sentant insultés, les rebound guys et Enzo la mitraillèrent du regard. Véronique enjoignit à sa cousine de la suivre dans la cuisine. Pour se calmer, Victoria but un jus d’ananas. — Je te demande d’essayer avant de juger. Ce sont de bons gars, et les clientes sont satisfaites. Je comprends que tu sois choquée, mais en Suisse, « les gigolos », pour reprendre ton expression, sont des travailleurs comme les autres avec une couverture sociale. Constant et Alban te l’expliqueront mieux que moi, puisqu’ils sont directement concernés. Si tu veux rentrer à Annecy, fais-le maintenant. Sinon, aide-moi à sortir les petits fours et les boissons. C’est censé être ton pot de bienvenue. — Je vais y réfléchir. Laisse-moi juste cinq minutes. Pendant que Véronique retournait au salon, Victoria inspecta les autres pièces. À côté de la cuisine se trouvaient les toilettes et une salle de bains séparée. Une chambre à coucher, décorée avec goût dans les tons crème, lui faisait face. Un living-room, au milieu duquel trônaient un canapé vert pomme et un guéridon en merisier, jouxtait les bureaux des gérants, au fond du couloir. La star des rebound guys arriva enfin. Véronique pointa sa montre dans sa direction, avec un petit soupir de mécontentement. — Albanie ! C’est à cette heure-ci que t’arrives ? T’as fait des folies de ton corps, hier ? le railla Willy. — Ne m’appelle pas comme ça ! Non. Je suis tombé sur une idiote pendant que j’achetais les boissons. Elle m’a tellement énervé que j’ai dû retourner chez moi pour me calmer. — Tu ne te laisses pas facilement déstabiliser, d’habitude, remarqua Julian. Je me demande qui était cette jolie fille. — Personne. Juste une idiote. Mais… j’admets qu’elle était jolie. Elle est aussi jolie qu’elle est… idiote. Je hais les idiotes, donc pas la peine d’imaginer n’importe quoi. Au fait, elle est où, la nouvelle ? — Madame boude parce qu’on n’est pas assez bien pour elle. Elle est aussi mignonne qu’elle est méprisante, précisa Julian. Voyant Victoria venir dans leur direction, Véronique les interrompit et fixa sa cousine droit dans les yeux, dans l’attente d’une réponse. Dos à Victoria, Alban continua à déblatérer sur l’idiote de la gare. Ayant reconnu son haut à capuche et sa voix, cette dernière pouffa. — Toi ? — Victoria. Ta nouvelle collègue qui déteste les Red Bull. — Dois-je en déduire que tu restes ? demanda Véronique, soulagée. — Oui. Et je m’excuse auprès de vous tous pour mon attitude de tout à l’heure. Je vais faire de mon mieux pour vous aider. — Je n’ai pas tout suivi, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle n’a pas l’air très dégourdie. Avec elle, on va droit à la catastrophe. È una schiappa4, s’exclama Alban, en la détaillant de la tête aux pieds. — J’ignore ce que tu viens de nous balancer en italien, mais ça ne me dit rien qui vaille. Je ne te permets pas de me juger ! Tu ne me connais même pas. — Pas la peine. J’en sais suffisamment. Jusqu’ici, je ne me suis jamais trompé sur les femmes, et quand je dis qu’une femme est idiote, c’est une idiote. — Amen, Monsieur je fais tout mieux que les autres. Amusés par leurs piques, les rebound guys parièrent sur celui qui tomberait amoureux le premier et comptèrent leurs billets. Alban et Victoria protestèrent en chœur, ce qui décupla la sonorité de leurs rires. Le pot de bienvenue se déroula dans une ambiance détendue. Malgré les vacheries qui sortaient de sa bouche, Alban ne put détacher son regard de Victoria qui l’intriguait. Elle paraissait idiote et naïve, mais les mots qu’elle échangeait avec les rebound guys montraient qu’elle possédait un esprit vif et rebelle. Vers midi, Véronique expliqua à Victoria les tâches qui lui incomberaient. Assistée d’Enzo, elle devrait décrocher le téléphone, mettre à jour le site Internet et prendre les rendez-vous. La question des extras fut évoquée. Le rebound guy ayant obtenu le plus grand nombre de rendez-vous dans sa catégorie et dans le mois percevait une commission de cinq cents francs suisses et un bonus diamant qui consistait en une invitation pour deux dans un endroit sympa : une expo, une sortie au ciné, un resto de luxe ou un spa. Bien que la place d’homme du mois fût très prisée, la concurrence demeurait loyale. Saboter la réputation ou le rencard d’un rebound guy constituait un motif de licenciement. Avec l’hospitalisation de Roger, les chiffres de l’agence se révélaient moins bons. En vue de lui donner une seconde jeunesse, en permettant à Victoria de comprendre l’utilité des rebound guys, Véronique avait organisé une soirée speed dating. Elle avait privatisé L’Odéon ; une brasserie suisse et française, à l’ambiance chaleureuse et au style boisé, qui pouvait contenir jusqu’à cent personnes. L’événement visait à fidéliser la clientèle et à dérider Victoria. À l’issue du speed dating, elle passerait une semaine en compagnie du rebound guy de son choix, afin de lui suggérer des idées de rendez-vous, tout en découvrant le métier. Qui était mieux placé qu’elle pour connaître les attentes des femmes de moins de 30 ans ? Peu convaincue, elle accepta néanmoins de jouer le jeu, face aux regards insistants braqués sur elle. * L’Odéon était situé dans le quartier populaire et animé de Plainpalais Jonction, qui regorgeait de bars, de lieux culturels et d’universités. Surnommé la Jonquille, et entouré par l’Arve et le Rhône, Plainpalais était peuplé d’étudiants. Alban y avait élu domicile pour sa proximité avec tout. N’aimant pas le chiffre 7 qui lui rappelait le symbole nazi, Véronique avait dérogé à la règle classique du speed dating en sept minutes et avait fixé chaque tête-à-tête à dix. Malgré sa réticence, Victoria avait soigné son apparence et enfilé une robe de cocktail pourpre. Ses deux barrettes en strass mettaient en exergue sa chevelure marron qui s’arrêtait au niveau des omoplates. Son entrée fut aussitôt remarquée. Constant, le poetic lover, lui baisa la main pendant que Julian et Christophe la dévisageaient, épatés par 4 È una schiappa vient de l’italien. La phrase peut se traduire par : « Elle n’est pas douée. » En italien, essere una schiappa signifie « être nul dans un domaine ». sa beauté. Tandis que les clientes gloussaient à la vue des rebound guys, Willy donna un coup de coude à Alban qui jouait sur son téléphone. — Elle est belle, non ? — Qui ça ? demanda Alban, sans décoller ses yeux de l’écran. — Miss Frouze. Lâche ton natel et regarde ! En Suisse, le natel désignait le smartphone, en référence à l’ancienne marque de téléphones mobiles destinés aux voitures, Nationales Autotelefonnetz. Devant l’insistance de Willy, Alban releva la tête avant de poursuivre sa partie. — Quelconque. Une vache en robe, ça reste une vache. — Quoi ? C’est toi qui es vache. C’est comme ça qu’on dit en France ? — Ouais, c’est comme ça qu’on dit en France. Va boire un verre et fiche-moi la paix. Une fois seul, Alban observa Victoria avant de s’installer à une table. Quoi qu’elle entreprenne, elle l’agaçait. Même si tout en elle l’horripilait, ses yeux refusèrent de se poser ailleurs. Elle l’hypnotisait à la manière d’un fakir et il abhorrait ce qu’il ressentait en sa présence. Pourquoi je réagis comme ça ? Elle est stupide et c’est un moulin à paroles. Des belles filles, j’en croise tous les jours ; des idiotes aussi. Alors pourquoi je n’arrive pas à l’ignorer ? J’ai des problèmes de vue. Elle n’est pas si belle que ça, mais sa façon de plaisanter avec Julian m’énerve. Si elle ne fait pas plus attention, il va la dévorer toute crue. Après ce dernier vint le tour de Willy. Ne sachant quoi dire, il enchaîna les blagues. Victoria, qui croyait assister à un mauvais vaudeville, était pressée de passer au rebound guy suivant. Pour masquer son trouble devant sa cliente, dont le speed dating fut gâché par son inattention, Alban interpréta les Préludes de Bach sur le piano adossé au mur. Son morceau déclencha des cris d’excitation. Alors que ses fans se bousculaient vers lui, Victoria vit pour la première fois un sourire fleurir sur son visage. Bien qu’il parût faux, elle le trouvait beau. Elle se demandait donc à quoi il ressemblait lorsqu’il souriait en toute franchise. — Il est doué et il a l’air heureux quand il joue, fit-elle remarquer à Willy. — Quoi, tu ne le savais pas ? — Savoir quoi ? — Il a failli devenir pianiste professionnel, mais son père s’y est opposé. Tu connais Maître Costelli ? — L’avocat d’affaires dont toute la Suisse romande parle ? — C’est son père. Alban a abandonné la musique pour suivre ses traces. Tout ça à cause d’une fille… — À cause d’une fille ? L’heure de changer de table sonna. Les révélations de Willy avaient perturbé Victoria. Elle se positionna en face d’Arthur à reculons. Timide et appréciant la simplicité, il évoqua avec elle sa passion pour le bricolage, le grand air et le jardinage. Victoria passa un bon moment, malgré un côté timoré qui le rendait presque efféminé. Christophe lui raconta comment il souhaitait relooker chaque femme. Féru de mode et esthète dans l’âme, il projetait d’ouvrir son propre salon de coiffure. Constant la noya sous une série de vers et de citations, ce qui le faisait apparaître comme quelqu’un de pédant que Molière aurait pu parodier. Elle se dirigea vers la table d’Alban, la gorge nouée. Il l’attendait les bras croisés et le regard froid. Son sourire de star avait disparu. On dit souvent « le meilleur pour la fin ». Tu parles. Je sens que ça va être un cauchemar. Contrairement aux autres, qui avaient brisé la glace les premiers, il la fixa sans bouger d’un iota. Mal à l’aise, Victoria réfléchit à un sujet de conversation. Il détourna les yeux pour regarder l’heure et bâilla, en exagérant les mouvements de sa mâchoire. — Tu pourrais faire un effort ! — Ça va. On ne va pas se mentir. On ne se supporte pas. Je préfère que tu la boucles, plutôt que d’entendre tes conneries. — Pour une fois, on est d’accord. Je te trouve odieux. Pourtant, je fais un effort pour Véronique et mon oncle. S’il n’en tenait qu’à moi, je ne serais plus ici. Je t’ai vu sourire et parler avec les clientes, alors tu pourrais faire pareil avec moi. — Les clientes ne sont pas aussi idiotes que toi. Elles sont… Pendant qu’il la comparait à ses relations tarifées, une question lui traversa l’esprit. Il s’exprimait sans l’accent helvétique et il portait un prénom français, ce qui attisait sa curiosité. — Au lieu de me descendre, dis-moi pourquoi tu portes un prénom français. Tu n’as pas non plus l’accent suisse. — Puisque t’as fait l’effort de ressembler à une fille ce soir, je vais te répondre. Ma grand-mère est normande et mes grands-parents vivent à Deauville. Fin de l’histoire. Tu ne deviendras jamais assez proche de moi pour que je te raconte ma vie, donc si tu veux élucider les mystères qui m’entourent, bon courage, Sherlock Holmes. — J’en ai suffisamment entendu. — Où est-ce que tu vas ? Les dix minutes ne sont pas encore écoulées. — Je rentre. Je perds mon temps avec toi. — Attends ! Il attrapa son poignet et l’invita à se rasseoir. Elle lui jeta un regard noir. Vu son attitude, il allait devoir trouver une bonne excuse pour qu’elle reste. — Choisis-moi comme rebound guy. J’ai besoin d’argent pour monter un projet et ce n’est pas toujours évident de se mesurer à Constant pour conserver ses commissions. J’ai besoin d’idées novatrices pour vendre du rêve aux clientes. Tu as quasiment le même âge qu’elles et tu rêves sûrement du prince charmant, comme toutes les midinettes. Si tu m’aides, je te conseillerai pour que tu décroches un rencard avec le type qui bosse au magasin de boissons. J’ai vu qu’il te plaisait. — Où est l’arnaque ? — Nulle part. Tu me rends service, je te rends service. Tout le monde y gagne. — Désolée, mais c’est non. Tu l’as dit toi-même : « On ne se supporte pas ». Si je devais choisir quelqu’un, ce serait Julian. Julian… On dirait un ado attardé avec sa coupe en brosse. Pourquoi choisis-tu l’argent quand tu peux avoir l’or que tout le monde adule ? Victoria quitta la table sans lui laisser le temps de rebondir. Julian, qui souhaitait la raccompagner pour mieux la connaître, posa une main sur son épaule. — T’as passé une bonne soirée ? demanda-t-il. — Disons que ça s’est mieux passé que prévu. — T’as déjà fait ton choix ? — C’est-à-dire que… — T’as la nuit pour réfléchir. Tu rentres avec qui ? Je t’escorte, si tu veux. — Pas la peine. Je m’en charge, s’interposa Alban, en agrippant le bras de Victoria. — Mais tu habites… « Pas loin », s’apprêtait à prononcer Julian, tandis qu’Alban lui faisait signe de se taire. Déconcerté par son initiative, il rejoignit Willy et Christophe qui échangeaient leurs impressions sur les participantes. D’ordinaire, Alban écourtait les soirées de cet acabit et ne raccompagnait jamais personne. Il en allait de même pour ses rencards. Il maîtrisait l’art de s’éclipser sans vexer, et les clientes déboursaient des sommes folles pour le réserver. Respecté par ses homologues et encensé par les femmes, il érigeait une barrière autour de lui. Tout en entretenant de bonnes relations avec son entourage, il veillait à ne pas devenir trop intime, car pour lui, « proximité » rimait avec « perdition ». * Le trajet du retour se déroula dans le silence, ce qui décontenança Victoria. Elle aurait dû décliner l’offre d’Alban, mais sur le coup, aucun son n’était sorti de sa bouche. Si c’est pour la fermer, ce n’était pas la peine de me raccompagner. — À quoi tu penses ? la questionna Alban. — Qui te dit que je pense à quelque chose ? — Tu n’es pas douée pour masquer ce que tu ressens. Tu n’es qu’une idiote qui n’a aucun self- control. — Et t’arrives à voir ça dans le noir ? Cette conversation est stérile. Je préfère rentrer seule. Laisse- moi. Bientôt, il va me sortir qu’il est nyctalope. — Non. Ce n’est pas prudent. — Je saurai me défendre. — Ah oui ? Et si je fais ça ? Il la poussa contre le mur d’un immeuble et lui bloqua les poignets. Ses yeux plongèrent dans les siens et il approcha ses lèvres. Quelques badauds avaient beau les dévisager, Alban s’en fichait. Il descendit sa main gauche le long de sa cuisse et remonta le bas de sa robe, avant de reculer d’un geste brusque. Des sentiments confus s’emparèrent d’elle. Elle était à la fois tétanisée et frustrée. Elle éprouvait de la colère face à l’humiliation qu’elle venait de subir, et en même temps, elle aurait voulu qu’il continue. Bien qu’elle détestât Alban, le déplacement de ses mains sur son corps lui avait fait de l’effet. Des larmes embuèrent ses yeux. — Tu pleures ? demanda-t-il en relevant son menton. — Non. — Excuse-moi. Je ne voulais pas t’effrayer. Je voulais juste te montrer combien les rues de Genève peuvent être dangereuses. Viens là. Il la serra dans ses bras et elle trembla. — Tu as froid ou c’est la peur ? — Pourquoi tu fais ça ? — Chut. Une idiote n’est pas censée parler. Il ôta sa veste et la posa sur ses épaules. Elle lui jeta un regard inquisiteur avant de l’enfiler, mais il demeurait impassible. Sa minute de gentillesse l’avait déstabilisée et réduite au silence. Au moment de lui souhaiter « bonne nuit », il la prit de nouveau dans ses bras et lui murmura à l’oreille « choisis-moi », avant de s’éloigner. — Mais… et ta veste ? s’écria-t-elle, en la brandissant. — Tu me la rendras demain. Une fois à l’intérieur, elle s’affala sur le canapé et tenta de se remettre de ses émotions. Pourquoi Alban agissait-il ainsi avec elle ? Il soufflait le chaud et le froid. En bas de chez Roger, il s’était montré tendre après l’avoir torturée. Était-il en train de la manipuler pour qu’elle l’aide à amasser de l’argent, ou avait-il parié avec les autres qu’il lui volerait son cœur ? Elle avait perçu son je-m’en-foutisme, et Alban ne ressemblait pas à un coureur de jupons invétéré ne supportant pas la contrariété. Il maintenait une certaine distance avec les femmes, sauf lorsqu’il se trouvait en mode boulot. Elle se demandait s’il lui était déjà arrivé de tomber amoureux, car malgré son apparence humaine, il se montrait indifférent ou aussi froid qu’une statue. Il souriait sur commande et taclait de manière systématique, comme un robot. D’après les vagues propos de Willy, l’amour avait déjà frappé à sa porte. Bien qu’elle voulût en apprendre plus sur lui, ses phrases assassines l’excédaient. À cause des événements de la soirée, elle se retourna plusieurs fois dans son lit et se leva à maintes reprises. * — Comment se porte ma nièce chérie ? demanda Roger pendant qu’Alban le poussait en fauteuil roulant vers le distributeur de boissons. Elle ne m’a pas rendu visite, ces jours-ci. Roger recouvrerait l’usage de ses jambes dans trois ou quatre mois, hors rééducation. Son opération de la prostate avait occasionné une infection nosocomiale qui lui avait bloqué la colonne vertébrale. — Elle a bien failli partir, mais elle est restée. Elle n’est pas très futée. J’ai dû lui démontrer de façon musclée les dangers de la ville. Tu aurais pu charger quelqu’un d’autre de veiller sur elle. — Tu es le seul à venir à bout de toutes les femmes. J’espère que tu n’es pas trop dur avec elle. — Elle me fait l’effet d’un punching-ball ou d’un prunier ; ça dépend. J’ai soit envie de la cogner, soit envie de la secouer. Elle m’insupporte. C’est la première fois que je rencontre un cas comme celui- là. Il faut bien le dire, Victoria est un cas. — Il me semble que je te dédommage suffisamment pour ça. — Me donner des dessous de table pour éduquer Victoria, c’est ça que t’appelles « dédommager » ? Elle est impossible. Elle arrive même à polluer l’air que je respire. Je ne sais pas si je pourrai veiller sur elle. En même temps, les autres ne sont pas fiables. Autant que je m’y colle… Roger s’esclaffa. En tant que rebound guy, Alban était confronté à toutes sortes de clientes qu’il gérait sans broncher. Il vouait à Victoria une animosité gratuite et exacerbée, comme si sa présence mettait son cœur en péril. Dès qu’il s’agissait d’elle, ses propos et ses gestes constituaient une suite de contradictions. Il perdait pied sans s’en rendre compte. — Je me suis fait du souci pour rien. La graine a déjà germé, avant même que tu t’en aperçoives. Le train est en marche. Alban leva un sourcil. — Que veux-tu dire par là ? Je déteste les énigmes. — Dans quelque temps, tu comprendras. Les parents de Victoria vivaient à Canberra. Son père, ingénieur de profession, y avait été muté deux ans après son bac. Son oncle paternel veillait sur elle depuis Genève, situé à trois quarts d’heure de route d’Annecy. Le percevant comme un père de substitution, elle lui confiait ses peines de cœur, ainsi qu’à Anthony, son faux jumeau installé à Paris. L’éloignement géographique de son géniteur avait creusé un fossé entre eux. Autoritaire et peu démonstratif, John Decker avait élevé ses enfants à la dure, et en cas de pépin, ils se tournaient vers tonton Roger, le plus cool des tontons, qu’ils considéraient comme l’antithèse de leur père. La dernière rupture de Victoria, aussi récente que douloureuse, l’avait dévastée. Thomas, son ex, avait prétexté qu’elle était trop bien pour lui, sans rien ajouter de plus. Sa phrase de lâche s’avérait tellement bateau qu’on l’entendait régulièrement dans les films. Roger maudissait sa saleté d’infection qu’il voyait pourtant comme un mal pour un bien. À l’instar d’Alban, Victoria avait le cœur brisé et se méfiait de l’amour. Or, sa nature idéaliste la poussait à garder un infime espoir. Elle estimait que la situation ne pouvait que s’améliorer, une fois qu’on avait touché le fond. Malgré leur caractère opposé, Roger trouvait Alban et Victoria parfaitement assortis et envisageait de les rapprocher, avec la complicité de Véronique et d’Enzo. Assister de loin à leur amour vache en train d’éclore l’enchantait. « Les contraires s’attirent », répétait-il souvent. Son activité symbolisait une sorte de service après- vente du cœur féminin en miettes. S’il soignait les inconnues, pourquoi n’agirait-il pas de même avec sa nièce et ses rebound guys avec lesquels il avait noué une relation paternaliste ? * Véronique convoqua Victoria dans son bureau pendant qu’elle tapotait sur son clavier. — Alors, la soirée speed dating s’est bien passée ? — Je n’ai pas eu à m’en plaindre. — Qui est l’heureux élu ? C’est la question à cinquante francs que tout le monde se pose. Plus tôt dans la matinée, les rebound guys s’étaient précipités auprès de Victoria pour connaître l’identité du compagnon de la semaine. Bien qu’il fût exercé à temps partiel, leur job à l’agence leur rapportait gros. Victoria représentait la cerise sur le gâteau ou le petit plus qui ferait grimper leurs commissions en flèche. La veille, ils avaient découvert chez elle un côté mignon qu’ils souhaitaient davantage creuser. Ce qui s’apparentait à une corvée se révélait finalement plaisant pour eux. — Je ne sais pas. J’hésite entre Christophe et Julian. Qui me conseilles-tu ? Même si Victoria trouvait Julian fun, elle se demandait s’il pouvait se montrer sérieux. Quant à Christophe, elle se voyait mal lui tirer les vers du nez à chaque rendez-vous, bien qu’il possédât un certain charme. Il se murait dans le silence, sauf pour évoquer ses passions. — Que penses-tu d’Alban ? suggéra Véronique. Victoria écarquilla les yeux. — Tu le fais exprès ? J’ai dit Christophe ou Julian, pas Alban. De toute façon, il n’est pas là. — C’est un choix parfait pour toi. Vous vous connaissez à peine, et pourtant, vous vous disputez comme un vieux couple. La tension sexuelle qui règne entre vous est si palpable, renchérit Véronique avec un rictus lourd de sens. Mais si vraiment tu t’y opposes, laissons le destin décider à ta place. Elle lui fit signe de la suivre dans le salon et inscrivit les noms des rebound guys sur des bouts de papier. Elle ordonna à Enzo de les déposer dans un chapeau de magicien et de tirer au sort, mais l’arrivée d’Alban l’interrompit. Agacée de le voir et pressée d’en finir, Victoria soupira, ce qu’il lui rendit par un regard assassin tandis qu’Enzo lui expliquait la présence du chapeau entre ses mains. Willy l’invita à se dépêcher, sans quoi il procéderait au tirage lui-même. Au moment où Enzo s’exécuta, Victoria ferma les yeux et pria pour que les mains de Dieu ne désignent pas Alban. — Alban Costelli ! s’écria Enzo. — Ce n’est pas possible. T’as certainement mal lu, réagit-elle. — Ça ne me fait pas plus plaisir qu’à toi. Mais hier, tu m’as demandé de jouer le jeu, donc je joue le jeu, intervint Alban. — Alors pourquoi voulais-tu que je te choisisse ? — J’ai dit ça, moi ? Tu n’as quand même pas cru que j’étais sérieux ? Je vais devoir supporter une fille fade doublée d’une idiote. Et dire que je ne serai même pas payé pour ça… — Quoi ? Comment oses-tu ? — Temps mort ! s’exclama Véronique. À partir de maintenant, je te laisse entre les mains d’Alban. Alors que Victoria réfléchissait aux coups du sort et à la manière dont un vulgaire bout de papier avait influé sur son destin hebdomadaire, Alban l’entraîna par la main vers la sortie. En se retournant, elle croisa le regard de sa traîtresse de cousine trentenaire qui lui adressa un « au revoir », le sourire jusqu’aux oreilles. Réunis autour du canapé, les rebound guys relancèrent les paris sur Alban et Victoria, qu’ils comparaient à Laurel et Hardy. Avec sa petite corpulence de femme, Victoria incarnait Laurel. Alban s’arrêta quelques instants sur le trottoir et la dévisagea. — Guenilles, haillons, mais tu n’es pas Cendrillon, la déprécia-t-il, fier de sa rime. — Je te demande pardon ? rétorqua Victoria, en le fixant comme s’il parlait le martien. Ses propos, plus hermétiques que les poèmes récités par Constant, lui paraissaient aussi incompréhensibles que s’il s’était exprimé en langage codé ou en onomatopées ; en dépit de son aptitude pour les rimes, qui méritait d’être applaudie et louée. — Pour que tu ressembles à quelque chose, il va falloir t’acheter d’autres vêtements. On s’en occupera demain. — Ne décide pas de ces choses-là tout seul. Au fait, pourquoi m’as-tu fait passer pour une menteuse devant les autres ? — C’est ta faute. Je déteste devoir m’expliquer et je déteste raconter ma vie. Mais par-dessus tout, je déteste perdre mon temps, comme en ce moment. Avant de passer la semaine ensemble, il y a certaines règles à établir. Il la tira par la main jusque chez lui, en ignorant ses questions et ses remontrances. Elle songeait à ce qui aurait pu se produire s’il n’avait pas interrompu Enzo dans son tirage au sort. Elle aurait obtenu un résultat différent et serait tombée sur quelqu’un qui savait dialoguer, pas sur un apollon antipathique qui avait l’art de déprimer à lui seul toute une bande de joyeux lurons. Elle le percevait comme un poil à gratter ou comme la goutte d’eau qui faisait déborder le vase. Depuis qu’elle l’avait rencontré, il se manifestait toujours quand il ne fallait pas, et ses phrases assassines jetaient un tel froid que des scientifiques malveillants auraient pu faire appel à sa médisance pour inverser les climats de l’Égypte et du Groenland. * Alban vivait dans un vaste deux-pièces décoré façon fifties, faisant ainsi écho à la chaîne de restauration HD Diner. Dans le couloir menant aux toilettes, les affiches publicitaires des années cinquante avaient laissé place à du pop art. Alban raffolait des œuvres d’Andy Warhol, et à défaut de pouvoir s’en procurer des vraies, il chinait pour acquérir des copies fidèles aux originales. Tandis qu’il s’affairait en cuisine pour leur préparer à boire, Victoria fit le tour du salon en se disant que les couleurs vives de l’appartement, dont il émanait chaleur et gaieté, détonnaient avec le caractère inhospitalier de l’habitant des lieux. Elle le percevait davantage comme un troglodyte terré dans une grotte aussi obscure que lui, ou comme un termite lucifuge qui sortait la nuit pour croiser le moins de monde possible. Ses yeux furent rapidement attirés par la photo d’une jeune femme blonde d’environ leur âge, dont l’élégance et la beauté lui donnaient des complexes. Alban déposa un plateau au centre de la table et se racla la gorge pour arracher Victoria à ses pensées. — La fille sur la photo, c’est ta petite amie ? — C’est personne. — Tu conserves des photos de « personne » ? Elle est belle ! — Ouais. Tout le contraire de toi. — Pas besoin de te montrer aussi cassant. — Arrête de jouer les fouines. Il s’empara du cadre photo et le rangea dans un tiroir d’un geste brusque. Il ressemblait à un braqueur qui planquait le magot, et son regard lançait des éclairs. Vu son attitude, j’ai tapé là où ça fait mal. Je suis vraiment idiote. S’il avait eu une petite amie, elle n’aurait jamais accepté qu’il couche avec d’autres filles pour de l’argent. Ce n’est pas non plus une raison pour se montrer aussi odieux. Alban ne rouvrit la bouche que pour lui demander ce qu’elle souhaitait boire. Il l’abandonna quelques minutes et se rendit dans sa chambre. Muni de son PC, il pianota sur son clavier et ordonna à Victoria de se taire, avant même qu’elle n’émette le moindre son. Elle contint son agacement et l’observa. Il imprima son contenu en deux exemplaires dont l’un fut remis à Victoria. Après avoir lu les premières lignes, elle manqua de s’étrangler. Il se prend pour Dieu ? Gâcher de l’encre pour ça, franchement… Tu rêves, si tu crois que je vais te laisser faire. La feuille comportait des règles qui lui rappelaient Super Nanny ; l’émission de télé dans laquelle une nounou à lunettes qualifiée intervenait pour aider les parents démissionnaires. Cette dernière épinglait au mur des règles adressées à toute la famille, en vue de recadrer les gamins turbulents et réputés ingérables. La présentation soignée d’Alban contrastait avec le fond du document, qui s’avérait aussi détestable que son caractère. « Les dix commandements d’Alban Costelli pour Victoria Decker : 1) – apprendre à bien s’habiller pour ne pas faire honte à Alban ; 2) – apprendre à parler de façon utile (éviter les questions) ; 3) – suivre les conseils de séduction d’Alban pour séduire Bruno ; 4) – conseiller Alban pour ses rendez-vous, uniquement quand Alban l’ordonnera ; 5) – ne pas chercher à connaître la vie d’Alban ; 6) – ne pas parler d’Alban aux autres, ni en bien ni en mal ; 7) – ne pas se mettre en danger (Alban déteste jouer les sauveurs) ;  – jouer le rôle de la cliente si Alban le veut ; 9) – ne pas chercher à séduire Alban (c’est perdu d’avance) ; 10) – ne pas tomber amoureuse d’Alban, au risque de le refroidir encore plus. » — Je m’y oppose farouchement ! lança Victoria, d’une voix plus aiguë que la normale. — Tu n’as pas vraiment le choix, vois-tu. Tu ne voudrais pas décevoir ton cher oncle, si ? — Non, mais ça ne t’autorise pas pour autant… — J’ai une idée. Victoria le regarda d’un air méfiant. — Si tu arrives à me battre au bowling, on oublie les commandements et on fera comme tu voudras. Si tu le souhaites, je m’arrangerai pour que Julian me remplace. Sinon, tu seras obligée de respecter les règles. — C’est injuste ! Je n’y connais rien au bowling. — Arrête de piailler. Ne dit-on pas que la chance sourit aux débutants ? L’image de Laura Marconi dans Nicky Larson défila dans sa tête. Pourquoi ne l’imiterait-elle pas pour frapper Alban avec une massue ? Il le méritait. Depuis leur rencontre, il n’avait jamais entrepris le moindre effort en vue de lui faciliter la vie ou de pacifier leur relation. Contrairement aux autres rebound guys, il n’avait pas éprouvé d’empathie envers la frontalière dépaysée qu’elle représentait, et il se fichait royalement de ses éventuels problèmes d’acclimatation. Il lui renvoyait sa nullité en plein visage. Si elle lui en avait parlé, il aurait assumé, mais il se serait montré encore plus abject en dressant une liste exhaustive de ses défauts. Il l’aurait établie sous forme de puces ou de numéros, comme pour ses commandements débiles à respecter à la lettre. Aimant relever les défis, elle accepta sa proposition, même si celle-ci sentait le roussi. Il n’appréciait pas grand-chose, et ses grognements le rapprochaient de Grincheux dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Or, ce qu’il abhorrait par-dessus tout, c’était de perdre. En lui proposant le bowling, il avait effectué un choix judicieux, car il savait que ses chances de le battre se révélaient infimes. Elle ne croyait pas à la chance du débutant qu’elle qualifiait de pure billevesée. Elle songea au loto auquel elle n’avait jamais joué. En la matière, sa chance du débutant consisterait surtout à rentrer bredouille. 2. La Polo d’Alban se dirigea vers La Praille ; un quartier du canton de Genève connu pour ses zones industrielles, à mi-chemin entre les communes limitrophes de Carouge et de Lancy. Un centre commercial et un stade y avaient été construits. Victoria trouvait la dénomination hideuse. Elle évoquait pour elle l’enseigne d’une gargote ou une affaire louche, car La Praille rimait avec les restaurants Courtepaille et le mot « racaille ». À peine assis, Alban s’était transformé en pancarte d’interdiction avec ses phrases débutant par les adverbes « ne pas » suivis de l’infinitif. Victoria croyait entendre Jacques Dutronc dans Fais pas ci, fais pas ça dont le rythme et les paroles lui déplaisaient autant que les prohibitions d’Alban. À deux négations près, il aurait pu effectuer une reprise de cette chanson mythique qui était devenue le générique d’une série du même nom, en 2007. Son père, avec lequel elle avait toujours entretenu des rapports difficiles, ne se montrait pas aussi directif, ce qui ne jouait pas en faveur d’Alban. S’il se comportait ainsi à son âge, qu’adviendrait-il de lui dans vingt ans ? Dans ses consignes, il avait interdit à Victoria d’abaisser la vitre, d’allumer la radio et de s’endormir. Il ne voulait ni attraper froid, ni abîmer ses tympans, ni perdre son temps à la réveiller. Avec son gros plafond métallique et ses drapeaux bleus et blancs qui flottaient au vent, le centre commercial de La Praille ressemblait plus à une institution européenne qu’à un bâtiment imposant accueillant des boutiques. Victoria resta ébahie quelques instants, avant que la voix hargneuse d’Alban ne la fasse ciller. Le paysage qu’elle avait aperçu en voiture lui avait semblé peu ragoûtant, mais le centre commercial possédait une façade majestueuse qui donnait envie de s’y introduire. De mémoire, il n’existait pas de pareil endroit en France. Conformément aux desiderata d’Alban, ils s’arrêtèrent au bowling de La Praille, qui comportait une vingtaine de pistes. D’autres activités ludiques comme le billard, le ping-pong et les jeux d’arcade y étaient proposées, ce qui faisait ressurgir les impressions de Victoria par rapport au Laser Quest5 qu’elle avait testé en Irlande, lors d’un séjour linguistique. Tandis qu’Alban se renseignait sur la privatisation du lieu, elle se remémora l’aspect de son pistolet laser infrarouge qui aurait pu servir à équiper Yoda dans Star Wars. Elle n’avait jamais su viser et son équipe avait perdu à cause d’elle. L’assistance de son premier amour, accoutumé à endosser le rôle du sniper, n’avait rien changé. Alban prit des notes sur son téléphone pour ses futurs rendez-vous et lui reprocha son air rêveur. Il l’entraîna vers le bar qui faisait face aux pistes de bowling. Les prix affichés lui paraissaient excessifs, même en les convertissant en euros. Devant son hésitation à consommer, alors qu’elle mourait de soif, Alban proposa de prendre tous les frais à sa charge. D’humeur généreuse, il lui offrit la possibilité de le battre dans une autre discipline que le bowling. Après avoir tergiversé, elle s’en tint à l’option initiale. Si elle choisissait le billard, sa maladresse la conduirait à faire voltiger les boules avec la queue qu’elle estimait inadaptée aux petites mains comme les siennes. Elle ne fournit aucune explication à Alban, de peur que son vocabulaire ambigu ne l’amène à la considérer comme une fille en manque ou obsédée par le sexe. Quant au ping-pong, elle l’avait éliminé d’office. Vu ses piètres prestations au lycée, Alban remporterait la partie en moins de cinq minutes. Pendant qu’elle sirotait son Peace & Love, un cocktail floral sans alcool, il anticipa sur le programme de la journée et dressa sur son portable la liste des 5 Le Laser Quest désigne une chaîne de jeux laser en salle, avec des effets spéciaux. magasins où il l’accompagnerait. Elle protesta. Sans daigner lui jeter un regard, il lui rappela les termes de leur accord : seule une victoire lui permettrait d’y échapper. Pendant qu’il réglait l’addition et qu’il réservait une piste, elle observa la position des joueurs et évalua la distance qui les séparait des quilles. S’agissait-il d’une question de force, comme au base- ball ? Il existait apparemment plusieurs manières de réussir un strike6. C’était comme pour les romans. Stendhal et Agatha Christie avaient tous deux remporté le succès, même si leur style d’écriture et leur genre littéraire différaient. Analyser les lancers de chacun lui embrouillait l’esprit, d’autant plus que les joueurs ne possédaient pas tous une corpulence identique. En bon gentleman, Alban l’invita à débuter la partie. Elle choisit la boule en fonction de sa couleur, bien qu’elle s’aperçût, juste après l’avoir projetée, que certaines d’entre elles pesaient plus lourd. Elle s’en mordit les doigts. Bras croisés, Alban riait sous cape face à sa bêtise. Malgré une mauvaise trajectoire de départ, toutes les quilles furent renversées, à l’exception de deux, mais leur emplacement les rendait difficiles à atteindre. Elle allait devoir rivaliser d’adresse pour remporter avec un spare7. Contrairement à elle, Alban lança la boule en toute quiétude et réalisa un strike. — Shopping, ordonna-t-il, lorsque son téléphone retentit. Il s’absenta quelques minutes pour décrocher. La partie n’est pas encore finie. Ne crie pas victoire trop vite ; c’est le cas de le dire. Je m’appelle Victoria, tout comme la souveraine qui a régné sur l’Angleterre durant soixante-trois ans. C’est un signe, grogna-t-elle. Grâce à Stéphane Bern et à l’émission Secrets d’Histoire, je te résumerai sa vie pendant que tu avaleras chaque quille que je renverserai. Elle souleva les boules une par une et en évalua le poids. Lors du prochain tour, elle se saisirait de la plus légère pour obtenir plus d’élan. Pendant qu’elle élaborait sa stratégie, un jeune homme gringalet, et aux cheveux aussi bouclés que le footballeur Benjamin Pavard, s’avança vers elle. Si ses cheveux avaient été blonds, il aurait pu incarner Cupidon avec sa bouille d’ange. Il se présenta et lui expliqua les rudiments du bowling. Ses amis et lui fréquentaient souvent celui de La Praille. Lorsque Victoria avait effectué son lancer, il l’avait observée et sa maladresse l’avait touché. Installés au bar, ses amis le huèrent. Sans perdre contenance, il se positionna derrière elle et l’accompagna dans ses gestes. De loin, il donnait l’impression de l’étreindre. — On en profite. « Quand le chat n’est pas là, les souris dansent », s’agaça Alban qui s’était éloigné plus que prévu, en raison d’une mauvaise couverture mobile. — Et tu es son… — Ça ne te regarde pas. Alban le dévisagea et lui fit signe de s’en aller. Le brun à la chevelure frisée rejoignit ses amis sans un mot. Alors que Victoria s’apprêtait à ouvrir la bouche, Alban soupira et reporta sa mauvaise humeur sur elle. — Tu laisses souvent des inconnus te tripoter ? la suspecta-t-il, en croisant ses bras et en tapotant du pied. — Non. Il m’apprenait juste à jouer correctement au bowling. — Je vais t’apprendre. Elle lui lança un curieux regard, en se demandant quel événement s’était produit entre-temps pour qu’il fasse preuve d’empathie. Ne supportant pas son air hébété, il fronça de nouveau les sourcils. — Quoi ? Tu veux ma photo ? Tu veux que je t’apprenne ou pas ? À moins que tu ne préfères Frisette… 6 Au bowling, il s’agit de faire tomber l’ensemble des quilles lors du premier lancer de la boule. 7 Au bowling, le spare désigne le fait de renverser toutes les quilles en deux coups. — Non. Il s’appelle… — Ça ne m’intéresse pas. Prends la boule verte et mets-toi en position. Au bowling, ce n’est pas la force qui compte. C’est une question d’adresse et de vitesse. La position de tes pieds est primordiale. S’il existe des chaussures spéciales, réservées au bowling, ce n’est pas pour rien. Elle suivit ses indications sans rechigner pendant qu’il se tenait derrière son dos. Après avoir vérifié la position de ses pieds, il l’aida à lancer. Se sentir encerclée par les bras d’Alban la rendait toute chose. Ses joues s’empourprèrent et son cœur battait si fort qu’il aurait pu se détacher de sa poitrine. Elle ne prêta pas attention à la vitesse de la boule dont la direction lui permit de marquer son premier strike. Elle fixa le sol, les yeux dans le vide, et revint à elle lorsque Alban claqua des doigts. — Tu n’es pas contente ? Elle releva la tête vers lui, incapable de répondre. — Qu’est-ce que tu as ? Tu n’es pas malade, au moins ? Il posa la main sur son front, ce qui la fit tressaillir. — Ta température me semble correcte, mais… tu as les yeux anormalement brillants. À la réflexion, je crois que je les préfère comme ça. Ça te rend presque mignonne. — Non. C’est… c’est… c’est plutôt toi qui as de beaux yeux. Elle regretta aussitôt ses paroles et sa voix chevrotante. Comment allait-il réagir ? Le connaissant, il se moquerait d’elle et lui rétorquerait : « Oui, je sais, pas comme toi. » Contre toute attente, il esquissa un sourire radieux, avant de l’inviter à poursuivre la partie. Comme elle l’avait imaginé à L’Odéon, son véritable sourire se révélait magnifique et le rendait d’autant plus attirant. Ne pas craquer pour lui… Ne pas craquer pour lui… martela-t-elle tandis qu’Alban observait la piste. Il est tellement orgueilleux. J’ai envie de le mettre au tapis pour voir sa tête de mec penaud. Pleine de bonne volonté, elle lança chacune des boules en songeant aux conseils avisés de l’apollon grincheux. Face à ses gestes hésitants, celui-ci perdit patience et s’adressa à elle sur un ton militaire. L’enchaînement des verbes à l’impératif et les directives d’Alban la firent sortir de ses gonds, mais ce dernier ne semblait pas enclin à épargner ses oreilles. Plus elle protestait, plus il s’en donnait à cœur joie. Elle, qui souhaitait prendre son temps pour obtenir la meilleure trajectoire, vit ses espoirs anéantis. La chance du débutant, évoquée par Monsieur Je-sais-tout, l’avait lâchée. De toute façon, elle n’y avait jamais vraiment cru, et au vu des circonstances, elle trouvait plus judicieux de parler de poisse du débutant. Toutes les boules s’écartèrent de la piste, en raison du stress engendré par Alban le sadique. Des scènes de films, évoquant le harcèlement moral, défilèrent dans sa tête. Fulminer ne changerait rien au résultat. À moins d’un miracle qui remettrait les compteurs à zéro et ouvrirait la voie à une partie décisive, il ne lui restait plus qu’à savourer sa défaite, pendant qu’Alban, lui, fanfaronnerait. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », pensa-t-elle, au moment où celui-ci lança sa dernière boule, non sans une certaine fierté. Sans grande surprise, il battit Victoria à plate couture. Frustrée et en colère, elle le dévisagea en se mordant les lèvres, ce qui ne manqua pas de le faire réagir. — Tu tires une de ces têtes. Je trouve ton expression risible et particulièrement idiote. Sois fair-play ; j’ai gagné. — Que ? Quoi ? Tu… tu… Ce n’est pas… — Que, que, que. Quoi, quoi, quoi. Tu te prends pour un canard ? — Tu m’énerves à la fin ! Tu as vu de quelle manière tu as remporté la partie ? — Oui. Et alors ? Le talent, ça ne s’invente pas. Sois bonne joueuse, Coin-Coin. Malgré tous tes efforts, tu aurais perdu. Maintenant, shopping ! Tandis qu’Alban claquait des doigts pour clore la discussion, elle vociféra contre lui, comme pour vider son sac. Sa voix stridente lui perçait les tympans et lui donnait le sentiment d’être confronté à Chichi, la femme de Son Goku dans Dragon Ball. La ferme, bordel ! À ce rythme-là, je vais devenir sourd. Elle est vraiment infatigable, dès qu’il s’agit de se comporter en idiote. Il faut que je trouve un truc. Si ça continue, on sera encore là à la fermeture. Et le temps, c’est de l’argent. Il ferma les yeux et passa en revue toutes ses clientes, surtout les plus difficiles. Un cadeau hors de prix, une balade romantique ou des compliments appropriés suffisaient à calmer les ardeurs de n’importe quelle femme, mais pas celles de Victoria qui semblait plus coriace que la moyenne. Le déferlement de reproches qui lui était actuellement destiné retentissait suffisamment fort pour le lui rappeler. Plus il ruserait, plus elle l’éconduirait. Alors qu’elle continuait à dresser son CV de mauvais bougre en hurlant, il se jeta sur elle et l’embrassa avec une telle intensité que les jambes de Victoria se mirent à trembler. On ne lutte pas contre Alban, petite idiote. Chaque fois que tu me prendras la tête, je t’embrasserai de cette façon. J’ai l’habitude, alors un baiser de plus ou de moins… Et comme je ne tomberai jamais amoureux de toi, je te conseille de ne pas t’attacher à moi, songea-t-il, avant de mettre fin au baiser. Il fit de nouveau claquer ses doigts et s’éloigna des pistes avec nonchalance. Le voir récupérer leurs chaussures avec une telle indifférence raviva sa colère. — Pourquoi m’as-tu embrassée ? demanda-t-elle, honteuse d’avoir succombé à ses lèvres traîtresses qui ne visaient qu’à duper la gent féminine. — Pourquoi ? Parce que c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour te faire taire. — Et c’est tout ? Comment peux-tu embrasser sans rien ressentir ? — Ça suffit, les reproches. Agir de façon idiote ne te dérange pas, même si tu gênes les autres. Dis- toi que c’est pareil quand j’embrasse. Si les femmes tombent amoureuses, c’est leur problème, pas le mien. Et encore, je t’ai offert ma bouche, alors qu’il faut normalement payer pour en bénéficier. — Je ne sais pas si je dois te traiter de robot ou de monstre, mais je t’interdis de jouer avec moi. — Je ne suis ni l’un ni l’autre. Je ne fais que mon travail. Tu sauras désormais que je n’aime pas les femmes bruyantes. Tu détestes les flatteries, alors il fallait que je trouve une ruse. Tandis qu’elle s’apprêtait à riposter, Victoria sentit son ventre gargouiller. — Il ne manquait plus que ça ! — Qu’y a-t-il, encore ? — Mon estomac crie famine. Tu n’as qu’à me laisser. On se retrouve quelque part, d’accord ? Victoria se précipita vers la sortie. À l’affût du supermarché Coop, elle envisageait de se procurer des spécialités culinaires suisses qui apaiseraient son estomac affamé. L’index posé sur ses lèvres, elle songea même à s’approvisionner pour les jours suivants. Plus elle s’attarderait dans les rayons, plus Alban s’impatienterait. Il l’avait traînée à La Praille contre son gré et n’avait rien perdu de sa verve poétique de connard méprisant. En prenant en compte cet élément, Fortuna, la déesse de la Chance, allait peut-être œuvrer pour que les événements tournent à son avantage. Comme il se plaisait à le répéter, Alban gagnait toujours. La présence de la divinité à ses côtés se révélait donc superflue. Pour rentabiliser sa venue au centre commercial, Victoria devait acheter « utile ». Or, comme la chaîne Coop n’existait pas en France, elle prévoyait de dévaliser les rayons : d’une part, elle ravirait ses papilles, et d’autre part, Alban serait si agacé qu’il quitterait les lieux de son propre chef. Une fois les achats effectués, elle retournerait vers lui, le regard aussi suppliant et attendrissant que Le Chat Potté dans Shrek. En la voyant tout sucre, tout miel, il accepterait sûrement de l’emmener chez Wendy’s ; la chaîne de restauration rapide américaine, découverte à Genève lorsqu’elle avait 10 ans. Dans ses souvenirs, ils servaient de délicieuses gaufrettes glacées que l’on ne dénichait nulle part ailleurs. — Hé ! tu vas où, comme ça ? demanda ce dernier. — J’ai faim ! — Tu ne réponds pas à ma question. Au moment où il formula sa dernière phrase, Victoria se trouvait déjà quelques mètres plus loin. Tandis qu’elle hâtait le pas pour se débarrasser de lui au plus vite, une scène de l’anime Great Teacher Onizuka lui traversa l’esprit. Celui-ci portait sur les tribulations d’un professeur déjanté, aux méthodes d’enseignement peu ordinaires et jugées peu orthodoxes. Dans l’épisode 8 du manga, dont une partie se déroulait dans un bowling, Kunio Murai, l’un des élèves rebelles qui détestait le jeune professeur, avait lâché une boule sur les pieds de ce dernier. Cette vision comique déclencha un fou rire chez Victoria qui aurait bien voulu réserver le même sort à Alban, lors de leur session « combat de quilles ». Chancelante et sentant que ses ricanements sonores l’amenaient à dévier de sa trajectoire, elle se mit sur le côté, entre deux enseignes. Qu’est-ce qu’elle fiche ? s’impatienta Alban en l’observant de loin. Elle fatigue déjà ? Pas très courageuse, la petite. Une fois calmée, Victoria sortit un miroir de poche et vérifia que ni son eye-liner ni son mascara n’avaient coulé, à force de rire jusqu’aux larmes. Les marques avaient beau indiquer sur l’emballage que leurs produits de maquillage s’avéraient waterproof, on n’était jamais à l’abri d’une mauvaise surprise. D’ailleurs, elle l’avait d’ores et déjà expérimenté. Un peu de noir avait dégouliné au niveau des cils inférieurs ; et comme elle l’affirmait si bien, elle commençait à ressembler à un « panda ». — Il faut que j’aille aux toilettes pour arranger ça ! s’écria-t-elle pendant qu’on lui agrippait le bras. Mais eh ! — Pas sans moi. « Le temps c’est de l’argent », rouspéta une voix qu’elle pouvait aisément reconnaître entre mille. Elle se retourna brusquement et ne fut pas surprise de découvrir Alban, les sourcils froncés. — Tu ne vois pas dans quel état je suis ? J’irai aux toilettes, que tu le veuilles ou non. Et puis, si t’es pas content, tu n’as qu’à retourner à l’agence ; ça me fera des vacances. Le regard de son interlocuteur se durcit. Il ne décrocha pas un mot. Passablement énervé, il introduisit son pouce dans sa bouche, avant de frotter les yeux de « l’insupportable Victoria » avec vigueur. — Problème résolu, fit-il, avant de jeter un œil à son pouce teinté de noir. — T’es vraiment dégoûtant ! J’ai ta salive sur mes yeux, maintenant ! Je vais encore plus devoir aller aux toilettes, protesta-t-elle, en repoussant violemment son torse pour l’éloigner d’elle. — Tu avais faim, je crois. Si t’arrives à la boucler, je t’emmènerai dans un endroit sympa, comme je le fais d’habitude avec mes clientes. — Et je devrais me sentir flattée ? Il n’y a qu’un endroit qui m’intéresse : Wendy’s, mais je veux d’abord m’approvisionner en spécialités suisses chez Coop. Maintenant, je vais aux toilettes. Hors de question que je me balade avec ta bave sur moi. Puisque pour toi « le temps c’est de l’argent », on n’a qu’à se donner rendez-vous au supermarché. Toi, qui te vantes d’être un rebound guy en or, c’est l’occasion de te montrer sympa, en m’achetant de la bouffe suisse bien goûteuse. Tu ne vas pas être déçue, songea-t-il, en affichant un rictus qui n’augurait rien de bon pour la suite. Pendant qu’il réfléchissait à ses emplettes culinaires, il frictionna ses mains avec du gel hydroalcoolique qu’il gardait toujours sur lui. À l’instar des toilettes, les lavabos étaient tous occupés. Victoria s’impatienta. Voir ces femmes en file indienne, dont certaines étaient accompagnées de « leurs chiards braillards », lui rappelait les aires d’autoroute bondées et peu hygiéniques où elle s’était si souvent arrêtée. Sa nervosité augmenta lorsque son portable retentit. Alban, peu adepte des longs textos, lui avait envoyé plusieurs sms à la suite pour l’inciter à se dépêcher. Chacun d’eux ne dépassait pas deux lignes. En la stressant ainsi, il se comportait comme le tortionnaire romain qui avait cherché à fouetter Ben-Hur sur la galère, afin qu’il rame plus vite. Seuls les moyens employés différaient. Le « harcèlement moral », lui, demeurait identique. Une fois les lavabos vacants, elle s’appliqua à rendre sa bouille présentable avec toute la lenteur du monde, en espérant avoir découragé Alban de l’attendre. Elle obtint gain de cause au bout du quinzième message reçu dans lequel il lui annonçait qu’il partait chez Coop avant elle. Le regard de ce dernier se posa sur les boissons au cannabis de la marque Hempfy. Pas une bonne idée, se dit-il. Elle va être défoncée et elle pourrait faire n’importe quoi. Déjà qu’elle n’est pas très fute-fute, on ne va pas en rajouter. Cela dit, il me vient quand même une idée… Il sortit son téléphone et chercha son application dédiée aux listes de courses. Il l’avait choisie colorée afin de mieux s’y retrouver, car derrière son air je-m’en-foutiste et méprisant, on le considérait comme un professionnel de l’organisation, fana des listes en tous genres : liste des tâches, des clientes, des événements de l’agence, etc. Victoria avait bien spécifié qu’elle souhaitait découvrir des spécialités culinaires suisses. Qu’à cela ne tienne, ses papilles s’en souviendraient. Pendant qu’il composait le nom des articles sur son smartphone, un sourire digne de Lucifer déforma le visage d’Alban. Il parcourut les rayons en quête des produits alimentaires Essento, conçus à base d’insectes. Il hésitait entre les snacks au « bon goût » de grillon et les steaks aux vers de farine. Il avait même anticipé la manière dont il s’y prendrait pour tromper Victoria sur « la marchandise » : il noierait les snacks insolites dans un gros bol de chips et intercalerait « la viande » entre deux pains burger. Ainsi, elle n’y verrait que du feu. Si elle se plaignait après avoir ingéré la nourriture, il agiterait sous son nez tout un tas d’articles de presse, vantant le succès de la start-up Essento, et portant sur la valeur nutritionnelle des insectes. Pour appuyer ses propos, il citerait en exemple Timon et Pumbaa qui devaient leur survie grâce à ces bestioles, dans le dessin animé Disney Le Roi Lion. Sa joie s’estompa lorsqu’il découvrit que les étagères du supermarché ne contenaient aucun produit de la marque Essento. Les denrées aux insectes étaient vendues en quantités limitées dans une cinquantaine de Coop et il venait tout juste de s’en souvenir. Abandonner la partie ne lui ressemblait pas. Il contacta donc Willy, le plus farceur des rebound guys, pour qu’il effectue quelques emplettes. Il prétexta vouloir organiser un apéro afin de fêter dignement l’arrivée de Victoria au sein de l’agence. Il s’était mal comporté et prétendit auprès de son collègue qu’il souhaitait s’amender en satisfaisant ses désirs culinaires. D’abord étonné qu’une Frouze puisse réclamer « des douceurs aux bestioles », Willy se laissa convaincre par les explications d’Alban dont le sourire narquois rappelait le smiley malicieux et débordant de suffisance, auquel on associait la devise suivante : « Fais gaffe. Quelqu’un pourrait te jouer un mauvais tour. » Vers la fin de l’appel, l’oreille de ce dernier fut distraite par les chamailleries du couple de quadras, stationné à côté de lui, le chariot vide. L’homme et la femme se querellaient à propos des boissons à servir aux six convives attendus pour le dîner. Après avoir passé en revue chaque invité, le nom de Rivella fut évoqué. Il s’agissait d’une boisson rafraîchissante suisse, fabriquée à base de lactosérum ou de petit-lait. Bien qu’exaspéré par les éclats de voix du couple, Alban estimait que leur dispute tombait à point nommé, car sans elle, l’idée de « la boisson jaune-verdâtre au lait coagulé » ne lui aurait jamais traversé l’esprit. La perspective de Victoria s’étouffant avec un verre de Rivella produisait sur lui le même effet que la caféine ou la vitamine C : il avait recouvré la même énergie que le lapin rose et sautillant des pubs Duracell, relatives à des piles qui se voulaient durables. S’il avait joué de malchance avec les « amuse- bouches aux bestioles », il n’en allait pas de même avec les boissons tant désirées. Le rayon en était rempli et les cinq saveurs proposées par la marque y figuraient. Le Rivella original, muni d’une étiquette rouge vif, fut d’emblée écarté par Alban qui jugeait son arôme trop insolite pour Victoria. Il préférait se moquer d’elle avec une boisson aux saveurs mélangées dont certaines sembleraient familières au palais de la jeune femme. Ainsi, il pourrait lui faire croire que la cause du problème n’était autre qu’elle, en cas de plainte ou de nausée. Le Rivella Refresh, dont l’inscription renvoyait à l’été et au bleu des vagues, était décrit par l’enseigne comme quelque chose de « frais, pétillant, léger. » Alban était tenté, mais se demandait si les bulles n’allaient pas indisposer Victoria au point de la conduire directement aux toilettes. La scène provoquerait chez lui un fou rire de quelques secondes. Et après ? Elle resterait enfermée, assise sur une cuvette, et sa blague retomberait comme un soufflé. Il se mit à compter les points à voix haute : — Drôlerie : un point. Durée : zéro. On peut trouver mieux… Le Rivella bleu foncé et pauvre en calories ne l’intéressait pas. Hormis la couleur et le sucre en moins, il ne différait pas vraiment du Rivella original. Alban hésitait surtout entre les Rivella vert et mauve. Opterait-il pour le thé vert ou la fleur de sureau ? Il cessa de gigoter et se gratta l’arrière du crâne, perdu dans ses réflexions. À ses yeux, Victoria incarnait « la cruche dans toute sa splendeur ». Il se l’imaginait bien en train de déguster un thé accompagné de gâteaux secs, entourée d’amies frustrées avec lesquelles elle passerait son temps à geindre, en utilisant une voix plaintive de circonstance. Le café était réservé aux « conquérants punchy » qui avaient besoin de carburer, contrairement à « l’autre idiote de Victoria ». La fleur de sureau, dont on louait l’action diaphorétique, qui consistait à faciliter la transpiration, était préconisée en cas de surpoids et de troubles digestifs. Avec un tel argument, Victoria avalerait peut- être le Rivella mauve d’une traite, en faisant fi du goût qu’il trouvait aussi détestable que la personnalité de celle-ci, car pour lui, la plupart des femmes accordaient beaucoup d’importance à l’apparence physique. Il tirait cette conclusion des rendez-vous qu’il enchaînait. Il avait découvert la fleur de sureau par le biais des bonbons à sucer Ricola. Quelques mois auparavant, il était arrivé à l’agence Haut les cœurs, la voix enrouée. Pour s’éclaircir la gorge avant un rencard qui lui rapporterait gros, il avait accepté les pastilles de Julian qui achetait toujours des sucreries sur le trajet. Il se souvenait du goût « infect » de la fleur de sureau, qui l’avait amené à se brosser les dents à trois reprises et de façon successive. La fleur de sureau, c’est très bof ! songea-t-il, l’index posé sur ses lèvres, comme pour dire « chut ! ». Elle a plus une tête à avaler du thé vert, quelle que soit sa catégorie. Je la vois même préférer le Matcha, car c’est le plus répandu en Europe. Victoria est si… « quelconque ». Si elle n’aime pas la fleur de sureau, je vais être obligé de finir le Rivella « dégueu ». Je n’aime pas gâcher, et les mecs me laisseront me dépatouiller avec ma boisson. La solidarité « entre couilles » n’a plus aucune valeur de nos jours ! Depuis son téléphone, il se rendit sur le site Thé vert dont l’interface rappelait la couleur du bambou. Les noms des différents thés apparaissaient en haut à droite et il ne retint que les noms japonais avec une terminaison en cha, signifiant thé en mandarin : « Shincha : thé vert de printemps ; Sencha : roi des thés verts, bénéfique pour la santé ; Genmaicha : apaisant et réchauffant ; Bancha : anti-acidité et faible en caféine ; Matcha : détox et antioxydant. » Il s’était ainsi renseigné pour concocter à Victoria un mélange « épicé », si jamais elle l’enquiquinait trop durant leur semaine en tête-à-tête, mais il devait préalablement s’assurer qu’elle aime véritablement le thé vert. La voyant déjà en train de vomir, il arbora un sourire espiègle et éloquent, indiquant qu’il préparerait un mauvais coup sous peu. Après avoir déposé deux bouteilles de Rivella au thé vert dans son panier, il reprit sa liste de courses numérique, sur laquelle il avait noté toutes les provisions nécessaires à un « bon sandwich ». Il avait caché à Victoria que la chaîne de restauration rapide Wendy’s avait fermé ses portes sur le territoire suisse. Or, bien qu’il l’eût envisagé, le but de la manœuvre ne consistait pas à l’affamer. Car s’il agissait ainsi, il s’attirerait de gros ennuis. Roger et Véronique l’avaient confiée à lui et il se sentait investi d’une « mission » auprès d’eux : celle de prendre soin de Victoria comme d’un tacot pouvant s’avérer utile. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, se dit-il, en se demandant pourquoi Victoria ne répondait pas aux messages. Lui jouer un tour l’avait tellement absorbé qu’il avait presque oublié la halte de cette dernière aux toilettes, ainsi que les sms qui avaient suivi. Il se promit de l’appeler en sortant du supermarché et avait prévu de la retrouver près de la voiture si elle ne décrochait pas. Abhorrant la foule, le vacarme et les activités en lien avec Victoria, qu’il considérait comme une perte de temps, il se surprit néanmoins à fureter dans les rayons, la mine réjouie. Il tâta et inspecta les produits culinaires de la même gamme, allant jusqu’à chercher ce qui justifiait l’écart de prix entre les différentes marques. Lui, d’ordinaire si peu enthousiaste, dès qu’on évoquait devant lui le champ lexical du mot « achat », fut étonné d’être devenu un « maniaque du supermarché ». Décortiquer les étiquettes nutritionnelles lui paraissait même plaisant. La minutie avec laquelle il choisissait chaque article pouvait laisser penser qu’il préparerait, dans quelques heures, un plat gastronomique pour sa dulcinée qu’il essayait d’impressionner. La gaieté qu’il avait ressentie en sillonnant les rayons disparut lorsqu’il arriva à la caisse. L’hôtesse, qui s’apprêtait à partir en pause, beugla contre une cliente d’environ 20 ans, dont les réponses à côté de la plaque la faisaient apparaître comme une extraterrestre quittant son ovni pour la première fois. Méconnaissant le mot cornet qu’elle associait aux glaces italiennes, cette dernière lui fit part de son incompréhension. La caissière, de nature peu patiente, bouscula davantage la jeune femme : — Elle est sur Soleure, la bobette tablarde qui met le cheni ? Il faut arrêter de se rincer le gosier ! — Ne me prenez pas pour une inculte et restez bien à votre place. Vous feriez mieux de répondre à ma question au lieu de m’insulter. Pourquoi me parlez-vous de cornet, alors que je n’ai pas acheté de crème glacée ? ! Je ne comprends pas tout, mais je sais que bobette signifie idiote et que tablarde veut dire dérangée ou folle, en Suisse… Donnez-moi un sac maintenant ou j’appelle votre responsable. Alban, qui avait reconnu la voix tendue de Victoria et assisté au différend deux mètres plus loin, lui envoya un texto avant de bousculer les clients qui se trouvaient devant lui. Ne souhaitant pas s’attarder plus que de raison chez Coop, il se résigna à calmer le jeu avec la caissière. Au moment où il apparut devant elle, celle-ci le fixa avec des yeux médusés, en se demandant comment il avait pu jaillir sous ses yeux, tel un diable sortant de sa boîte. Victoria consulta le sms reçu dont le contenu ressemblait à un cours de vocabulaire suisse : « Tu n’en manques vraiment pas une ! Instruis-toi. Être sur Soleure = être pompette, mettre le cheni = foutre le bordel ou mettre le désordre, se rincer le gosier = boire un petit coup, CORNET = SAC OU SACHET DE MAGASIN ! ! ! Ne me dis surtout pas merci. C’est vrai que t’es bobette. On a dû te le dire tellement de fois que tu connais ce mot par cœur… » Ne supportant pas de se faire traiter de bobette deux fois de suite, et entendant des bribes de la conversation d’Alban avec la caissière, elle cria après lui. Pour arranger la situation, il se montra compatissant avec l’hôtesse, allant jusqu’à confirmer le statut de bobette de Victoria. — Pour qui tu te prends ? Tu n’es pas obligé de me rabaisser. Et tu oses répéter que je suis une bobette ? Je ne t’ai jamais demandé d’intervenir, surtout si c’est pour me ridiculiser. Je me débrouille très bien toute seule. — Ah oui, ça se voit. Je te signale que je fais ça pour ton bien. Attrape et attends-moi dans la voiture au lieu de chouiner, lui somma-t-il, en lui lançant son trousseau de clés et la carte magnétique donnant accès au parking. — Pourquoi me balances-tu la carte du parking ? Ne me dis pas que je vais devoir payer ? ! — Quoi ? Ça te pose un problème ? On gagnera du temps si tu règles. Je paie déjà tes « spécialités suisses ». Sur le point de répliquer, Victoria se ravisa. Une idée venait de lui traverser l’esprit, et elle sortit du supermarché sans demander son reste. Je lui aurais bien fait bouffer sa carte, moi. Tu veux que je paie et tu veux te la jouer beau gosse ? Crois-moi, tu ne vas pas être déçu du voyage…
92
« Dernier message par Apogon le jeu. 05/01/2023 à 17:44 »
La Perle des confins de Philippe Rimauro Pour l'acheter : Librinova AmazonPROLOGUE Longtemps, je me suis crue au cœur de l'Histoire des hommes. Je pensais la façonner, je pensais même qu'elle m'appartenait. Mais l'on n'est jamais que son jouet. Après avoir balayé mon existence en un instant, elle s'était récrite, sans moi. Jusqu'à ce jour où, bien des années après que l'on m'eut oubliée, sans mobile, elle me rappela à elle.*** Semblables à de fragiles araignées acrobates suspendues à leur fil, deux silhouettes se balançaient le long d'une paroi rocheuse. Avec nonchalance, elles toisaient un dédale de falaises vertigineuses qui se disputaient l'écho d'un torrent rugissant dans le tréfonds. — Ça va Marcik ? hurla l'homme de tête. — Tu parles, on est chargé comm'des mules ! — Arrête de râler et magne-toi de remonter, on a déjà pris trop de retard ! — J't'en foutrai moi du r'tard, maugréa Marcik pour lui-même. Accrochées à leur dos, d'énormes hottes dégorgeaient des fleurs d'une plante grasse qui poussait sur la roche. Les muscles luisants d'efforts, ils se hissaient de prise en prise, assurés de leur seule corde aussi usée et crasseuse que leurs vêtements. Les deux forçats semblaient souffrir le martyre ; car à l'épreuve physique, s'ajoutait une chaleur accablante que le crépuscule qui envahissait les gorges ne suffisait pas à apaiser. Soudain, un pan entier de la falaise se disloqua sous les pieds de Marcik. Surpris, il perdit prise et chuta de quelques mètres avant que sa corde ne le stoppât net dans un claquement sourd. Au-dessous, les rochers rebondissaient lourdement sur les reliefs de la paroi, tandis que le contenu de sa hotte se répandait au fond des gorges. — Rien de cassé ? s'inquiéta mollement son compagnon alerté par le bruit. Marcik était sain et sauf, mais le labeur d'une journée harassante avait été réduit à néant. — Putain, fait chier ! ragea-t-il tant de douleur que de colère. Son acolyte haussa les épaules et continua son ascension sans montrer plus de compassion. — Quelle merde ! exulta Marcik. Péniblement, il reprit l'escalade jusqu'à arriver à hauteur d'une caverne mise au jour par l'éboulis. Meurtri et à bout de souffle, il s'y hissa avant de s'asseoir sur le rebord et d'y déposer sa hotte. Tout en époussetant ses hardes, il vérifia qu'il n'était pas blessé. La corde lui avait brûlé le dos et le torse, mais il n'y prêta pas plus d'attention. Ce qui semblait l'inquiéter davantage, c'était sa hotte, vide, qu'il regardait dépité. — C'tait bien la peine... soupira-t-il au bord des larmes. En se relevant, il se rendit compte que l'excavation était profonde, et à la faveur des rayons d'un soleil rasant, un reflet attira son attention. Il y regarda plus attentivement et aperçut ce qui ressemblait à un ancien véhicule partiellement enseveli. Soutenu par sa corde, il se pencha vers l'extérieur de la caverne. — Galen ! Y'a quelqu'chose ici ! J'vais voir. — Tu fais chier Marcik, on n'a pas toute la journée ! Ignorant la réponse de Galen, il donna du mou à la corde et s'avança dans la pénombre. À peine eut-il fait quelques pas que ses pieds heurtèrent quelque chose. Baissant les yeux, il découvrit un crâne et des ossements humains. — Bordel, mais qu'est-ce que c'est qu'ça... s'exclama-t-il dans un mouvement de recul. *** L'heure de mon rappel à l'Histoire avait sonné. 1ÈRE PARTIE - REVENANTE LE RÉVEIL Suspendus dans un ailleurs insondable, le temps et l'espace s'abandonnaient à une danse éthérée, à une danse incessante, enivrante, une danse où vie et mort se mêlaient, se muaient. Sans cesse, se modelaient des ersatz de mondes éphémères où ce qui avait été côtoyait ce qui serait, où ce qui était n'avait plus rien de tangible. Un instant, il y avait tout, il n'y avait rien. L'instant d'après, il n'y avait rien, il y avait tout. Un chaos des plus absolu. Mais pourtant, ébranlant chaque fois un peu plus les récursions infernales, irrésistiblement, une chronologie s'imposait à la paralysie du temps, une logique d'existence tentait de dompter l'espace. Et soudain, il y eut une déchirure, un éclair d'une violence inouïe qui fit que tout se volatilisa. Ma conscience avait jailli. D'abord, je fus perdue : « Qui ? Quoi ? Où ?». Ces questions étaient restées si longtemps sans réponse que déjà un voile de folie menaçait de m'envelopper, que déjà mon esprit à peine éveillé se délitait. C'est alors que je le sentis. Las, engourdi, comme endormi depuis des jours. Mon corps criait : « J'ai froid ! J'ai mal ! ». Je n'avais pourtant aucun moyen de l'apaiser tant il refusait de se mouvoir, tant il demeurait inerte, déconnecté. Et puis, lentement, j'entendis monter des bruits de pas, irréguliers, lourds et inquiétants. Une angoisse aveugle me saisit. Le son se fit plus net, plus rapide ; il prit méthodiquement le rythme cadencé d'un métronome. Naïvement, je compris. Ces battements sourds était ceux de mon cœur. Et tandis que la froide douleur lancinante qui m'habitait se transformait peu à peu en de tièdes fourmillements, je m'éveillais. Calme et réconfortante, une voix d'homme se fit entendre. Quelqu'un me chuchotait des mots à l'oreille, des mots inintelligibles. De tout mon être, j'essayai de rompre l'isolement, de répondre à cet appel. Mais, éteint, mon corps se dérobait toujours aussi puissamment à ma volonté. Soudain, cédant enfin à mes injonctions, mes paupières s'ouvrirent. La voix qui s'étaient un instant tue résonna à nouveau, plus insistante, accompagnée de caresses sur mes mains muettes. Doucement, le brouillard blanc qui tapissait ma vue s'estompa, et je découvris cet homme qui était penché sur moi. Ce fut d'abord ses yeux qui captèrent mon regard. Ils étaient d'un bleu céleste qui brillait d'un éclat magnifique, presque hypnotique. Je remarquai ensuite son collier de barbe grisonnante et le large sourire bienveillant qui s'y faufilait. C'est seulement après quelques instants que je finis par m'étonner de sa tenue, une grossière tunique sombre, brodée ça et là de petites étoiles blanches ; on aurait dit un costume de carnaval. Étais-je en plein songe ? Moi, je gisais sur un étroit lit au milieu d'une petite pièce faiblement éclairée. Le lieu m'était familier, mais mes souvenirs peinaient à revenir. L'air frais et âcre, la forte odeur de renfermé. Était-ce une cellule ? Avaient-ils fini par me capturer ? La confusion régnait toujours dans mon esprit. Sans même le désirer, dans un gémissement haletant, mes premiers mots surgirent : « Je... boire ». Le vieillard, interloqué, me répondit par des paroles incompréhensibles. Je grimaçai. Il me fit un signe amical de la main, puis se pencha pour fouiller ce que je devinais être un sac posé à ses pieds. Complétant une scène que je trouvais toujours aussi improbable, il se releva tenant en main une gourde en métal cabossé et une grappe de gros raisins noirs. Il me mima alors consécutivement les actions de boire et de manger, les associant chacune à un mot différent. Péniblement, je répétai celui correspondant à la gourde. Aussitôt, il en ôta le capuchon, et avec une extrême attention, il fit couler un mince filet entre mes lèvres encore insensibles. Et moi de sentir cette eau fraîche glissant dans ma gorge. Je ne rêvais pas. L'homme agita ensuite la grappe de raisins au-dessus de ma tête. Comme j'acquiesçai du regard, toujours avec la plus grande des attentions, il m'aida à me redresser sur ma couche, osant à peine me frôler, manipulant mon corps engourdi comme si mes os étaient faits de cristal, comme si ma chair était la plus précieuse et la plus fragile des chairs. Voyant la combinaison qui m'habillait, j'eus un flash : j'étais dans le sarcophage thérapeutique, dans l'ambulance ! Peu à peu, tout se remit en place dans ma tête : le coup d'état, le raid à l'Ascenseur Spatial avec Longar et Valec, la gigantesque explosion dans la partie urbaine au loin, la fuite à bord de ce véhicule, l'onde choc, le crash. — Tenez, mangez, me dit l'étranger d'un ton paternel en approchant un grain de raisin de ma bouche. Derrière un petit accent râpeux auquel je n'étais pas habituée, j'avais enfin compris ses paroles ; j'avais reconnu sa langue à la sonorité familière, fatidique. Submergée de souvenirs, de sensations, je n'eus le temps ni de m'en rassurer ni de m'en inquiéter, n'ayant pas la force de lutter face au vertige qui me prit, je m'évanouis. *** Flottant dans les airs équipés de nos ceintures anti-G, Longar, Valec et moi placions les explosifs sur les câbles de l'Ascenseur Spatial. Notre sabotage touchait à sa fin lorsque Longar me fit signe de regarder derrière moi. Me retournant, je fus figée d'horreur. Une explosion gigantesque venait d'avoir lieu dans la cité principale, et bien qu'encore loin sur l'horizon, la boule de feu engendrée semblait embraser le ciel lui-même. — Il ne faut pas rester là ! me cria Valec à plusieurs reprises. Mais je bougeai pas. Vide de tout sentiment, je regardai le déluge de flammes s'avancer jusqu'à ce qu'il finît par m'envelopper, jusqu'à mon réveil, étonnamment sereine. *** Attentif, l'homme en tunique m'observait. — Hé-ho, fit-il en penchant la tête vers moi. Comment vous sentez-vous ? Je me mis à le fixer sans penser à lui répondre. — Je vous ai trop brusquée tout à l'heure. Je vous prie de m'excuser. Encore, je le regardai sans parole, toute étonnée de son accent, de son élocution singulière. Il sourit complaisamment. — Je vous parle, mais... Peut-être ne me comprenez-vous pas. À mon tour je tentai de lui sourire de mes lèvres encore atrophiée. — Si... je vous comprends, dis-je dans sa langue. Tout à l'heure, ce n'était pas de votre faute. Je suis... si faible. Ma voix était chancelante, elle sonnait comme un râle. J'en fus mortifiée. — Par les Stellaires ! Vous me comprenez ? Ses yeux luisaient d'espoir. — Par les stellaires ? ... Oui... Bonjour. Qui êtes-vous ? — Bonjour, répéta-t-il enjoué. Je suis Maître Kritonsk. Vous venez de sortir d'une longue période de dormance. Vous êtes en phase de réveil depuis plusieurs jours. D'après les moniteurs, vous êtes en parfaite santé. Vos forces vous reviendront. — Qu'est-ce qui s'est passé ? L'explosion ? — Je suis désolé, j'ignore ce qu'il s'est passé. Nous avons retrouvé votre véhicule enseveli sous des tonnes de gravas. Sa réponse m'inquiéta. — Combien de temps j'ai été en sommeil ? — Reposez-vous. Nous parlerons de tout cela plus tard. Il me contempla un instant de ses yeux transparents. Sa bienveillance semblait sincère, sa fascination aussi. Pourtant, sa question qui fusa ensuite éveilla ma vigilance. — Puis-je vous demander votre nom ? S'il n'avait pas pu savoir par lui-même, c'était qu'il n'était pas des leurs. Cet accent, cette tenue ; bien sûr qu'il n'était pas des leurs. Mais je n'avais de toute manière guère le choix de ma réponse ; je me devais de rester fidèle cette imposture qui me préservait depuis si longtemps maintenant. — Elikya. Comme il restait interdit, je me répétai d'un ton plus appliqué. — Je m'appelle Elikya. Elikya Keito. — Enchanté, réagit-il enfin. Elikya, vous pourrez compter sur moi jusqu'à votre total rétablissement. J'exhalai un gémissement plaintif en tentant de redresser la tête. — Attendez, ne forcez pas, je vais vous aider. Toujours aussi prévenant, il me releva légèrement dans le sarcophage. À nouveau, ma tête se mit à tourner, mais je parvins cette fois-ci à ne pas perdre connaissance. — Merci, balbutiai-je. Il faisait sombre ; seuls de timides rayons de soleil s'immisçaient à l'intérieur par les vitres de la double porte du fond. Je me trouvais bien dans le véhicule ambulancier que Longar, Valec et moi avions pris pour fuir cette immense explosion dont Kritonsk semblait tout ignorer. Assis sur le siège infirmier, il se tenait à ma droite. Sur le mur derrière lui, visiblement intacte, clignotait la console de commande des équipements médicaux. Enfin, dans mon dos, je devinais l'accès vers la cabine de pilotage. Rien n'avait bougé, tout semblait en ordre. — S'il vous plaît, suppliai-je d'un regard plaintif, j'ai vraiment besoin de savoir ; depuis combien de temps je suis ici ? Son front se creusa de rides embarrassées. — Je... Autant vous l'avouer de suite, vous êtes restée en dormance pendant très longtemps. Trop longtemps. — Combien de temps ? — Un peu plus de 34 Révols, répondit-il posément à l'affût de ma réaction. Le nombre me parut monstrueux. — On est quelle année ? demandai-je paniquée. Je savais que, sur Desdéra, une Révol représentait plus de 4,5 années universelles, mais je n'osais pas faire le calcul ; je voulais l'entendre de sa bouche. Il sembla désarçonné par ma question, et au lieu de me répondre, il se contenta de quelques mots compatissants qui échouèrent à m'apaiser. En réflexe, comme pour tenter de conjurer de cette réalité trop abrupte, frénétiquement, j'entamai un long monologue artificiel de ma voix encore frêle. — Je suis le docteur Keito. J'étais en poste à l'hôpital central de l'Ascenseur Spatial. De là-haut, j'ai vu une immense explosion, au loin, dans la ville. J'ai pu fuir, avec deux autres personnes, à bord de cette ambulance, puis... puis le souffle de l'explosion nous a rattrapé. Nous ne contrôlions plus rien, l'aéronef a été projeté au sol et... nous avons été ensevelis. Un des hommes est mort dans l'accident. J'étais grièvement blessée. L'autre homme m'a aidé à m'installer dans le sarcophage thérapeutique pour que je puisse être soignée. Il... il devait ensuite sortir chercher des secours et... c'était il y a 34 Révols ? Je m'étais effondrée dans un sanglot. — Chut, me souffla-t-il. Calmez-vous. Tout va bien. Vous êtes en sécurité ici. Mais je ne l'écoutais plus. Je tressaillais de désespoir, d'angoisse, de sidération. Je m'entendis gémir. Je sentis mon corps choir. Mon regard se figea, s'éteignit au monde extérieur, et se posa sur mon âme, égaré. CLOÎTRÉE DANS LE VÉHICULE Jour après jour, Kritonsk m'avait veillée. Mais il semblait déçu – ou peut-être même contrarié – de la lenteur de mon éveil à la vie. Car entre mutisme et discours décousus, captive de mes pires tourments, j'avais passé la majeure partie du temps à somnoler, laissant la mélancolie la plus aigre m'accompagner dans une torpeur morbide. J'avais perdu tout ce qui pouvait l'être. Je crus ne jamais pouvoir surmonter mon désespoir. Je crus ne plus rien souhaiter d'autre que la fin. Pourtant, un matin, le déclic se produisit. Réveillée avant lui par les rayons du soleil qui dardaient au travers des fenêtres du véhicule, je m'étais mise à l'observer, assoupi sur la banquette murale, enroulé dans une belle cape assortie à ses yeux. « Il m'a encore veillée toute la nuit » avais-je pensé attendrie. Et j'avais osé laisser mon esprit s'aventurer dans quelques souvenirs de bonheur refoulés : ma petite enfance sur Ténova, nos vacances en famille au chalet, la sieste digestive du grand-père à l'ombre des arbres, le petit marais où nous allions attraper grenouilles et têtards avec Kiya... bien avant le cauchemar de notre séparation. Je venais de comprendre. Voilà bien longtemps que j'avais tout perdu, bien avant ces 34 Révols volées. Et même si j'étais désormais orpheline de ma vie – orpheline de ma sœur – j'avais peut-être là une nouvelle chance. Le regard rivé au plafond, je me surpris à savourer l'instant, je sentis à nouveau cette soif d'espoir qui m'avait toujours guidé. Le silence était total. Il devait être encore très tôt. J'entendis Kritonsk bouger. Je tournai la tête vers lui et le découvris en train de me scruter. — Bonjour, lui dis-je en esquissant mon plus beau sourire. — Bonjour. — Je vous remercie de m'avoir veillée. D'une mimique un peu lasse, il me sourit à son tour. — Je veux dire, durant tous ces jours, j'étais tellement... et vous étiez là, tout le temps. — Je vous l'ai dit. Vous pourrez compter sur moi jusqu'à votre total rétablissement. Il se leva et s'avança vers la double porte. Il en ouvrit doucement un battant et se pencha au dehors. Malgré son âge, il avait fière allure, et son étrange tunique lui donnait l'apparence d'une altesse toute droit sortie des livres d'antiquité. — Allez quérir Marco, qu'il prépare nos petits-déjeuner, lança-t-il. Je n'entendis pas de réponse, juste des bruits de pas s'éloignant. Kritonsk referma la porte et revint vers moi, toujours avec cette même prestance, comme si chacun de ses gestes était calculé. — Vous avez bonne mine ce matin. Comment vous sentez-vous ? — Mieux, bien mieux. Ma réponse avait fusé d'un ton si enjoué qu'il s'arrêta net et me fixa d'une attention ravivée. — Vous semblez de belle humeur, seriez-vous d'attaque pour que nous discutions un peu ? — Oui, bien sûr, avec plaisir. — Je suis heureux de l'entendre. Enfin. J'ai tant de choses à te demander ! Pour la première fois, il m'avait tutoyée. Je le remarquai, mais ne réagis pas. Il poursuivit. — J'ai eu le temps d'analyser le véhicule avant ta sortie d'hibernation. J'y ai trouvé une multitude d'équipements. Si tu le veux bien, je vais te les montrer ; j'aurais quelques questions à te poser. — D'accord, lui répondis-je toujours aussi allègre. Il m'aida à me mettre en position assise dans le sarcophage, puis se pencha pour ouvrir une première cassette posée à ses pieds. Je l'observai. Sa gestuelle était exquise, chacun de ses mouvements était toujours légèrement plus ample que nécessaire, tantôt élégant, tantôt surfait. — Dans cette boîte, dit-il, j'ai retrouvé des vêtements de femme très élaborés. Tes vêtements sans doute. Il en sortit un débardeur, un pantalon, des sous-vêtements, et enfin, une paire de chaussures. — Le tissu est vraiment de très bonne facture. Le plus surprenant est la qualité de ces chaussures ; nous serions aujourd'hui bien incapables de telles prouesses. Les bras et les mains encore partiellement atrophiés, je manipulai lentement les vêtements qu'il avait déposés sur mon ventre. C'était bien les miens ; je revoyais Valec les ranger dans la cassette après m'avoir aidé à me glisser dans le sarcophage thérapeutique. Un petit bracelet noir tomba du milieu des affaires. Kritonsk le vit, mais ne s'y intéressa pas. Pour ma part, je le reconnus aussitôt, c'était mon Polymorphe. — Ces habits sont bien les miens, dis-je feignant de ne pas le remarquer. Je remis le précieux objet dans la boule de vêtements et la poussai en sa direction. Il les rangea dans leur cassette, la posa par terre et en prit une autre. — Ensuite, il y a celle-ci dont le contenu m'intrigue ; peut-être sauras-tu m'expliquer ? Il en sortit quelques uns des équipements du raid que Valec avait dû laisser ici pour moi. À leur vue, un frisson fit palpiter mon cœur ; j'eus peur qu'il ne finît par avoir des soupçons. Je tâchai de rester aussi naturelle que possible tandis qu'il me les décrivait. — Il y a cette ceinture pour le moins curieuse, deux petits sacs à dos, et cet espèce de pistolet à gâchette. Il avait dit ce dernier mot en renâclant comme s'il s'eut agit d'une incongruité. Puis il se mit à me fixer ; son regard limpide semblait vouloir me mettre à nu. — Reconnais-tu ces équipements ? Essayait-il de me piéger ? D'un œil avisé, j'avais rapidement remarqué que le pistolet était totalement déchargé, sa nature non-conventionnelle lui avait donc sans doute échappé. Je tentai une réponse prudente en embrassant son regard. — Ce pistolet, je crois que c'est une arme incapacitante. — Oh, je vois... La ceinture semblait également vide de toute énergie. — Et cette ceinture, c'est une anti-G. — Une anti-G ? grimaça-t-il. — Oui, une anti-G, réaffirmai-je circonspecte face à son ignorance. Ça permet de se déplacer dans les airs sur de courtes distances. — Oh, voilà qui est très intéressant, s'illumina-t-il. Il se mit à scruter le pistolet et la ceinture sous toutes les coutures. Je fus surprise qu'il n'essayât pas de les mettre en marche ; peut-être avait-il déjà constaté qu'il n'y avait plus d'énergie. — Quant aux sacs à dos, lui lançai-je rassurée par son air curieux, je pense que vous aviez deviné tout seul. — Oui, effectivement, s'amusa-t-il. Je te remercie pour ces quelques éclaircissements. Pensif, il rangea le tout dans le caisson. — Mais je m'interroge quant à la présence de tels objets dans un véhicule médical, lança-t-il en se redressant vers moi. Cherchant également à justifier sa possible découverte d'autres équipements du commando, j'improvisai. — Un des hommes qui a fuit avec moi était agent de sécurité à l'hôpital, il s'agit de ses équipements, rangés ici dans l'urgence après le crash. Il ne sembla qu'à moitié satisfait de ma réponse, mais n'osa pas insister. — Bien, bien, médita-t-il. Quoi qu'il en soit, les Sachems seront fascinés par tous ces objets en si bon état de conservation. — Les Sachems ? répétai-je dubitative. — Ah ! Les Sachems ! Ce sont nos dirigeants, un peu plus que ça à vrai dire. Ce sont eux qui assurent notre survie depuis le Grand Cataclysme, grâce à l'héritage des Stellaires. — Le Grand Cataclysme ? Les Stellaires ? Je suis désolée, je suis un peu perdue. — Oh, ce n'est rien. Tu apprendras à te faire à notre nouveau monde. D'autant que d'après ton témoignage, tu as assisté au Grand Cataclysme ! Te rends-tu compte ! Toi et tes compagnons disparus êtes contemporains des Stellaires ! Il semblait exalté et allait se lancer dans un monologue lorsque l'on frappa à la porte. — Ah ! Notre petit-déjeuner ! s'interrompit-il. Il alla ouvrir d'un pas guilleret. J'étais perplexe. C'était à se demander qui était le plus ignorant des deux. Et même s'il semblait bienveillant, j'allais devoir être très prudente. — Elikya ? m’interpella-t-il. Perdue dans mes pensées, je sursautai. — Tu es bien rêveuse. Ne te fais pas de souci. Je suis sûr que ta découverte sera une bénédiction pour tout le monde. Sans attendre de réponse de ma part, il posa sur mes cuisses un bol de fruits coupés en petits morceaux, et toujours cette vieille gourde bosselée. — Vas-y, mange ! Tu as encore besoin de reprendre des forces. Avec une certaine maladresse, je commençai à porter à ma bouche les dés de fruit. Kritonsk m'observa un temps, puis finit par intervenir face à ma détresse. — Attends, je vais t'aider. — Je... je suis désolée. Je bafouillais. J'étais honteuse – vexée – de ma déchéance. — Ne sois pas si dure avec toi. Tes forces reviendront vite. Il m'assista ainsi dans ma tâche, patiemment, pendant de longues minutes. Et peu à peu, mon embarras fit place à du soulagement. Car sous son regard affable, je parvins fièrement à terminer mon bol de fruits sans son assistance. Toutefois, ces quelques efforts m'avaient épuisée ; Kritonsk s'en rendit compte et il partit s'affairer à l'avant du véhicule, me laissant seule quelques instants. Lasse, je m'assoupis rapidement. *** « Kiya, sœurette, j'avais toujours espéré que nous nous retrouverions un jour, une fois le conflit terminé. En fait, je ne vivais que pour ça, pour te revoir. Avais-tu reçu mes messages ? Avais-tu compris ma fuite, ma disparition ? Tu donnais un sens à ma vie – à ma lutte – et je ressens un terrible vide, désormais que je te survis. » Je venais doucement de me réveiller, sans chagrin, mais avec un énorme sentiment de vide. À nouveau, mes songes avaient été envahis d'images du passé. Kritonsk était à mes côtés. — J'ai dormi longtemps ? — Non, à peine quelques minutes. Un peu fourbue, je bougeai péniblement mes membres pour me délasser. Il me regarda sans rien dire, attendant que j'eus fini. — Je suis heureux de voir que tu vas de mieux en mieux. Curieuse de relier les événements qui m'avaient mené ici, je ne pus m'empêcher de le questionner à propos de mes compagnons. — J'aimerais savoir... vous avez retrouvé d'autres personnes ? — Oh. Tu sais, beaucoup de temps s'est écoulé ; tu étais seule ici... Il hésita un moment. — Mais puisque tu vas mieux, je pense qu'il faut que je te montre quelque chose. Je lui lançai un regard avide. — En fait, poursuivit-il, il s'agit de la vidéo enregistrée dans l'ordinateur de bord. On peut y voir un homme qui s'adresse à toi, je crois. À ces mots, mon cœur se mit à battre la chamade. — S'il vous plaît, montrez-la moi. — Fort bien. Il se retourna, puis, un peu gauche, manipula la console. Un écran holographique apparut devant moi. Annoncé par un petit bip sonore, un premier message commença. Il était daté du 112ème sol d'hiver de la 5ème Révol, il était 2 heures 43. J'y reconnus aussitôt Valec. — Après des heures à creuser le sol, commença-t-il, j'ai finalement réussi à atteindre la surface. J'y ai installé une balise de détresse, mais les choses me semblent plutôt mal engagées. C'était il y a deux jours déjà, et je n'ai reçu aucune nouvelle des secours, aucun message du tout à vrai dire. Dehors l'atmosphère est terriblement polluée. Un épais nuage de poussières cache partiellement la lumière du soleil ; on n'y voit pas à dix mètres ! Comme j'ai encore suffisamment d'eau et de nourriture pour plusieurs jours, je... j'ai décidé de partir en exploration vers le nord ; ils ont peut-être été moins touchés là-bas. Son regard se troubla et il n'osa plus fixer la caméra. — Je sais que tu vas m'en vouloir, reprit-il, mais... j'ai décidé de ne pas te réveiller. Tes soins étaient terminés, mais j'ai préféré te plonger en dormance profonde, pour te préserver, pour économiser les vivres. Ici, tu ne crains rien, la caverne est abritée et les réserves d'énergie sont largement suffisantes. Je reviens vite. — Fin de message, clôtura laconiquement l'ordinateur de bord. Un bip retentit à nouveau ; un deuxième message suivait. Il avait été enregistré douze jours plus tard, à 3 heures 51. Valec y apparut abattu, visiblement épuisé. — J'ai exploré les environs. Je n'ai pas trouvé âme qui vive, je... j'ai bien peur que nous ne soyons les seuls survivants. Dehors, je n'ai rien reconnu, tout est dévasté, c'est horrible. Mes réserves d'eau et de nourriture sont épuisées. Je suis juste revenu me reposer et récupérer quelques équipements. Je vais tenter une exploration vers l'ouest, peut-être que des gens auront trouvé refuge dans les montagnes... si elles sont toujours là. Je... Il soupira puis fit un sourire qui cachait mal son désespoir. — Je te promets de revenir te chercher. Je... Souhaite-moi bonne chance ! — Fin d'enregistrement, coupa la voix monocorde de l'ordinateur. — C'est tout, confirma Kritonsk. Il n'y a rien d'autre. Est-ce bien un des hommes qui était avec toi ? — Oui, répondis-je sans voix. Valec avait bel et bien réussi à sortir, mais il avait échoué à trouver des secours... il y avait plus de 34 Révols de cela. Doucement, sans bruit, je me mis à pleurer. 34 Révols, plus de 153 ans, une éternité. 153, ce nombre hantait mon esprit, lorsque soudain, une idée incongrue me vint et me glaça le sang. — Je...
93
« Dernier message par Apogon le jeu. 22/12/2022 à 17:59 »
Là où ronronnent les pumas de Mélodie Miller Pour l'acheter : Amazon Les souvenirs oubliés ne sont pas perdus.
Sigmund Freud
Tous les souvenirs de nos parents, de nos ancêtres sont inclus dans nous.
Françoise Dolto
Les plus beaux souvenirs sont ceux que l’on s’invente.
Maxime Le Forestier
On n'oublie rien, on vit avec ses souvenirs et on essaye de les dominer pour qu'ils ne nous blessent plus.
Philippe Besson 1 Chère Manon, de 10 ans J’ai relu ta lettre. Toutes ces années, maman l’avait gardée dans son portefeuille. En espérant qu’un jour, Manon des étoiles reviendrait. Il m’en a fallu du temps… pour comprendre et accepter. Pour grandir et me souvenir de toi, de ta fantaisie et de tes fous rires. Il aura fallu ce séjour à Ibiza, l’île à remonter le temps, pour te retrouver et me rapprocher, enfin, de maman et Théo. Ma chère petite Manon, je me sens si coupable de t’avoir oubliée et délaissée à ce point. J’aurais dû te chérir. Au lieu de cela, je t’ai détestée. Je t’ai enfermée alors que tu portais tant d’espoirs en moi. J’espère me rattraper et ne plus jamais te faire de peine, ni à toi, ni à maman, ni à Théo… Plus jamais… Aujourd’hui, je comprends tout. La violence de papa, la détresse de maman, la colère de Théo. Je comprends la souffrance et la rancœur. Je comprends et j’accepte les reproches de ce frère tant aimé. Je prends maman dans mes bras et je la berce comme j’aurais dû la bercer, le jour de l’accident. Ce jour où je n’ai montré que du mépris. Je m’en veux et je m’en voudrai toujours. Elle m’a aimée tout du long et je ne voulais rien voir. Mattéo m’a accompagnée. Maman l’a adoré au premier regard, Théo aussi, j’en étais sûre. Il ne s’appelle pas Pierre, mon amoureux, non. Il n’a pas de vélo rouillé, mais son piano m’emmène sur la lune et ses yeux me transportent de la même façon. Peut-être qu’un jour, je reverrai Pierre, Clarinette l’a retrouvé sur Facebook. Mais je ne suis pas sûre de vouloir. Mattéo et moi rêvons d’une petite Jeanne et d’un petit Jean, comme tu y songeais toi aussi. Un jour, peut-être. Claire est toujours mon amie, plus que jamais. Et j’ai agrandi ma famille. Aujourd’hui, Jeanne, Arturo, Isabella et Juan font partie de mon avenir. Dans quelques mois, nous nous envolerons ensemble pour un nouveau rêve, celui de Jeanne, devenu le nôtre. Nous nous installerons plusieurs semaines, à Buenos Aires, dans un grand appartement. C’est Arturo qui l’a trouvé, en échange de maison contre la villa d’Ibiza. J’ai quitté l’agence Stella, embrassé Susana, laissé Jorge et Tina à leurs affaires, à leur passé douteux. Je veux imaginer le futur et je sais que je peux le faire depuis n’importe où. Je rêve d’aller explorer le désert d’Atacama, de contempler les étoiles et d’aider à construire un avenir meilleur, partout où ce sera possible. Je sais que, dans ce monde, rêver et organiser iront ensemble. Je n’ai toujours pas de lézards ni de poneys, mais Georges le labrador part avec nous. Ma petite Manon, j’ai retrouvé tes licornes, je les ai libérées, je vis enfin dans un monde en couleurs, plus grand, plus haut que la coupole de l’Opéra. Je t’embrasse. Manon, mon étoile, c’est comme ça que Mattéo m’appelle. P-S : J’ai cherché ton trésor dans le jardin, à Fontainebleau. Les pièces en chocolat ont disparu, mais je porte ta barrette dorée pour toujours me souvenir que tu existes au fond de moi, à jamais. P-S2 : Un jour, je la donnerai à ma fille… ou à mon fils et je leur dirai… qu’il n’est jamais trop tard pour libérer les licornes. 2 Paris Chez Manon Ils sont allongés nus, après l’amour, dans le grand lit douillet de Manon, sous les toits de Paris. Moment suspendu, hors du temps. Parenthèse toute en douceur. Une bulle de bonheur, à l’abri des soucis du monde. Les amoureux se confient et déclinent leur passion. — J’aime ta peau, commence Mattéo. — J’aime tes yeux, dit Manon. — J’aime ton odeur, continue Mattéo. — J’aime ta voix, précise Manon. — J’aime tes cheveux, détaille Mattéo. — J’aime tes mains, ajoute Manon. Mattéo aime Manon et Manon aime Mattéo. Depuis leur retour d’Ibiza fin avril, il y a presque un an, c’est comme une ritournelle qu’ils se répètent à l’infini, chaque jour, émerveillés de cet amour tout neuf. Comme une sérénade sous les balcons de Vérone, comme l’arc-en-ciel après la pluie, comme la lune là-haut dans la nuit. Cet amour, ils en sont les premiers surpris. Elle ne pensait pas tomber amoureuse de ce Casanova. Il n’aurait pas imaginé s’éprendre de cette jeune femme sérieuse. Ils s’aiment et se le répètent à l’envie, jour après jour, nuit après nuit, dans le lit de Manon, ou dans celui de Mattéo, dans l’appartement du dessous, dans le bel immeuble face à l’Opéra de Paris. Ils s’aiment, mais ont choisi de ne pas vivre ensemble. Enfin, Manon un peu plus que Mattéo ! Manon a craint de partager son appartement. Alors, quand sa gardienne a mentionné le déménagement du voisin, elle a saisi l’occasion. Manon a préféré laisser emménager Mattéo un étage plus bas avec son piano volumineux, ses dizaines de partitions et tout son barda. Il n’a pas hésité une seconde à s’installer auprès d’elle. Lui qui, quelques mois auparavant, aurait levé les yeux au ciel à une telle idée. Il était tombé amoureux, sans s’y attendre. Elle avait réveillé tant d’émotions enfouies. Il avait eu envie de vivre avec elle très vite. Il le lui avait dit. — On équipera une roulotte avec un piano ! Et je te suivrai partout où tu iras. Elle l’avait repoussé. — Ah non ! N’importe quoi ! Pas une roulotte ! Je ne suis pas une romanichelle. Pas comme elle . Mais ça, c’était avant, avant qu’elle ne fasse la paix avec sa mère et Théo, son frère adoré. Et maintenant, lovés dans la douceur des draps de percale de Manon, ils roucoulent de bonheur. — Tu m’aimes ? commence Manon. — Oui, et toi ? — Je t’aime. Mais toi, pourquoi tu m’aimes ? — Parce que je t’aime, c’est tout, parce que c’est une évidence, répète chaque jour Mattéo. — Mais encore ? demande-t-elle, jamais lassée de l’entendre raconter. — Je t’ai déjà dit. — Oui, mais j’aime quand tu détailles. Il se redresse sur ses coudes, relève ses boucles châtains, dégageant ses yeux bleus azur, son regard de velours qui la fait chavirer. Il prend sa main et l’embrasse avec tendresse. Tous ses gestes, tout son corps sont pour elle, désormais, pour ces yeux vert amande et cette peau de porcelaine. — Alors ? insiste-t-elle, en minaudant. — J’ai besoin de toi, tout le temps, de te voir, de savoir ce que tu fais. Lorsque tu n’es pas là, je te cherche. J’aimerais vivre à tes côtés, me réveiller près de toi et te faire l’amour tous les jours. J’aime ta peau, ton odeur, tes yeux, tes cheveux. Manon, bella, je suis fou de toi. Tu m’as ensorcelé. Elle sourit, moqueuse. — En fait, tu n’en veux qu’à mon corps. — Beaucoup, oui, mais pas seulement. — Ah ? insiste-t-elle, taquine. — J’aime ton intelligence, ton esprit carré et fantaisiste à la fois. — Fantaisiste, moi ? — Oui, depuis notre retour d’Ibiza, tu te lâches, tu te libères. Regarde ton appartement, tes tenues. Tu as ajouté de la couleur. Tu n’as plus besoin de ce programme rigoureux. Tu laisses libre cours à ton imagination. Ça me plait. Voilà, ça te va ? Et toi ? Tu ne me dis jamais pour moi. Alors ? — J’aime tes yeux, j’aime ta bouche, j’aime ta peau, j’aime ton odeur. — Tu aimes mon corps, c’est ça ? demande-t-il, inquiet de n’être qu’un lover italien. Elle penche la tête un moment. Ça c’est sûr, tu l’aimes son corps, et tout ce qu’il te fait, minaude sa licorne intérieure, sa touche de fantaisie, bien libérée depuis leur retour. Mais pas que, pense Manon. — J’aime tes mains sur le piano, ta musique, j’aime ta douceur, ta gentillesse, j’aime tes rires, j’aime ta cuisine, j’aime comme tu prends soin de moi. Il la regarde avec amour, encore émerveillé de ce sentiment si fort. Elle le regarde avec amour, encore émerveillée de ce sentiment si fort. Ils ronronnent, les yeux dans les yeux. Et les nuages dans le ciel, les fleurs dans les prairies, les oiseaux dans les arbres n’en reviennent pas de tant d’amour. Chaque jour, c’est comme une première fois, ils ne s’en lassent pas. Le matin, elle descend prendre le petit déjeuner chez lui. Il a préparé tout ce qu’elle aime, thé vert, pain complet et fruits frais. Il se contente d’un café serré et d’une part de panettone en la regardant dévorer. Il aime son appétit. Elle lève les yeux, joueuse. — Tu n’en as pas marre de me regarder, Casanova ? — Jamais. Je te veux pour la vie, pourquoi on ne s’installerait pas vraiment ensemble ? Elle marque une pause et le regarde, mi-surprise, mi-tendre. — On en a déjà parlé, Mattéo. J’ai besoin de mon espace, de mes temps à moi. J’aime que ce soit bien rangé et qu’il n’y ait pas de partitions qui traînent partout sur le canapé. J’ai besoin de calme pour mes consultations à distance avec les entreprises que je conseille. Et puis, ton piano prendrait toute la place. C’est leur unique point de discorde. Il ne comprend pas, il pourrait s’enivrer d’elle, lui qui, avant, s’enivrait de toutes les filles. Il n’a plus besoin que d’elle. Il la cherche du soir au matin. Il écoute ses petits pas résonner sur le parquet au-dessus. Il sait ce qu’elle fait, il connait sa routine. Tiens, elle fait sa gym. Et là, elle s’est installée avec son ordinateur. Ah, voilà l’heure du déjeuner, l’heure de bientôt la revoir. — Tu ne trouves pas ça pesant tout cet amour ? demande Claire, son amie de toujours. — Non, ça me va, j’ai dû manquer, petite. Claire sourit. — Dis donc, tu es sacrément in love, on dirait. — On dirait, répond Manon. — Qui l’aurait cru ? — Tu m’étonnes, s’enchante Manon. Ce matin, ils doivent parler de la fête qu’ils organisent avant leur départ pour Buenos Aires. Les billets sont pris depuis des semaines, les passeports vérifiés, les vaccins réglés. Tout est prêt pour cette nouvelle aventure qui les attend en Argentine. Jeanne, la fée bohème a déjà embarqué, dix jours plus tôt, sur un catamaran qui traverse l'Atlantique. Claire part avec eux depuis Paris. Arturo les rejoindra à Madrid, pour le voyage. Juan et Isabella ont commencé à travailler à Ibiza, embauchés par la mairie et ont décliné à regret. Quant à Georges, le labrador, Tina, la grand-mère d’Arturo vient de les prévenir qu’elle le garderait avec elle. — Chez toi ou chez moi ? demande Manon. — Chez toi, c’est plus grand. — Ah ! Tu vois que ton piano prend toute la place. Mais je n’ai pas envie de tout salir. — Je t’aiderai à ranger. — Bon, alors OK, c’est décidé, ce sera chez moi. Attends, je regarde la liste que j’avais préparée. Elle attrape son téléphone pour consulter ses notes. Il sourit. Cette manie qu’elle a de préparer des listes à l’avance, de tout prévoir. Mattéo saisit son téléphone aussi, il n’a pas fait de liste, mais pensé à la playlist de la soirée. Il consulte sa sélection, lorsque son téléphone vibre. — Attends, Mattéo, reste concentré, on a presque fini, demande Manon. Il laisse le téléphone sonner dans le vide. Une fois, deux fois, trois fois. Il le saisit de nouveau. — Ce doit être urgent, s’excuse-t-il. La production du film sûrement. Donne-moi deux minutes. Il saisit son portable, le déverrouille et…change de tête. C’est un message d’Elena, une de ses ex, celle qu’il a quittée lorsqu’il a rencontré Manon. Elena Je suis à Paris, je dois te voir, c’est urgent. Il sort du lit, s’éloigne vers la fenêtre et répond aussitôt, tapant à toute vitesse, comme le virtuose qu’il est. — Arrête de m’appeler, Elena, je t’ai dit que c’était fini, basta ! — C’est urgent, punto final ! Je t’attends au café, en bas de chez toi, dans une heure. Tu as intérêt à être là, sinon je monte. — Mais comment ? — Tina m’a donné ton adresse ! Manon le regarde en biais. Il a blêmi. — C’est qui ? demande-t-elle. — Elena, répond-il, sans mentir. Manon ferme les yeux, elle se rappelle cette scène, à son arrivée dans la finca à Ibiza… … Elle venait de le rencontrer. Elle s’était dit qu’il ressemblait à Thor ! 1,90 mètre de beauté brute, des yeux bleus d’eau, une adorable fossette au coin droit de lèvres pulpeuses, un sourire immense encadré par des cheveux châtain clair qu’il venait de détacher, en secouant la tête comme dans les publicités. Elle se souvient, mot pour mot, de ses pensées. « Seigneur, retenez-moi, je pensais arriver en enfer, je viens de débarquer au paradis ! Le gars est, non seulement, beau à tomber par terre, pianiste-compositeur et, en plus, il prépare des gâteaux au chocolat. Faites qu’il m’épouse sur le champ ! » Mais elle se rappelle aussi son téléphone qui avait vibré, presque comme aujourd’hui, et lui s’éloignant vers la cuisine pour répondre. — Ciao Elena, claro que je pense à toi moi aussi, et bien sûr qu’on se voit pour le lunch, ciao ciao, amore mio, avait-il dit alors. « Oups ! L’homme de ma vie est déjà pris ! » avait-elle pensé. « Oups ! L’homme de ma vie est encore pris ! » pense-t-elle, à l’instant même. Ce message qui vient d’arriver va bouleverser leur vie. 2 Paris Café de l’Opéra Il entre dans le café et les femmes se retournent sur son passage. Mattéo est ce genre d’hommes, celui qui fait battre les cœurs et allumer des étoiles dans les yeux. Les mamies raffolent de ses mains de pianiste et les plus jeunes de son corps. Il fut un temps où il en a abusé. Ce temps est révolu. Bernard, le patron lui adresse un clin d’œil et joint le geste à la parole. — Holà ! La belle demoiselle vient d’arriver, elle t’attend à l’étage, fait-il en désignant l’escalier du fond. Bon courage, amigo. Les consommations sont pour moi ! Depuis son retour d’Ibiza, Mattéo vient deux à trois fois par jour dans ce café. Il a besoin de cette pause, en milieu de composition, de rencontrer du monde. Bernard s’adresse toujours à lui en espagnol. Mattéo a eu beau expliquer qu’il était italien. Rien n’y fait. Bon courage ? Pourquoi ? se demande Mattéo en grimpant les marches. La salle de l’étage est vide. À l’exception d’Elena, assise au fond sur une banquette en cuir rouge. Elle le regarde arriver sans se lever. Ses grands yeux noisette pétillent sous sa frange brune. Ses joues rosies par le froid extérieur lui mangent le visage. Elle a pris du poids ? Et teint ses cheveux ? pense Mattéo. — Ciao, Elena, lance-t-il depuis le haut de l’escalier, comme s’il ne l’avait jamais quittée. — Ciao, Mattéo. — Toujours aussi ravissante, charme-t-il. — Toujours aussi beau parleur ! Elle l’accueille en souriant et dépose un baiser sonore sur ses joues. Il a toujours bien aimé Elena, une bonne copine, une camarade de couette inventive et joyeuse. Rien de plus. Il n’a jamais souhaité aller plus loin et elle non plus. Elle vit à Ibiza et tient le commerce de ses parents, un bar-épicerie. C’est la petite dernière d’une famille de quatre, croit-il se rappeler. Il a connu l’une de ses sœurs également. Il fut un temps où il a pas mal flirté. Voire plus… — Viens, installe-toi. Tu veux un café, ou un alcool ? Peut-être un alcool ! C’est ma tournée ! annonce-t-elle, mutine. Il s’installe, face à elle, sur le fauteuil en rotin. — Que se passe-t-il, Elena ? Pourquoi cette urgence ? — Du calme ! Tu n’es pas content de me voir ? — Certo ! Bien sûr. — La dernière fois, c’était quand déjà ? — Ohhh il y a quoi, presque un an ? essaie de se rappeler Mattéo. — Un peu moins ! L’anniversaire de Jeanne, ça te dit quelque chose ? L’anniversaire de Jeanne, s’il s’en souvient ? Il a perdu le contrôle au bout du huitième verre et se rappelle s’être réveillé au bord de la piscine, Elena d’un côté et sa sœur de l’autre. Aucun autre souvenir de la soirée. A moins que… non, il n’est pas sûr. Le lendemain, Manon lui avait fait une scène. Elle avait tapé du pied par terre et juré de ne pas devenir l’une de ses conquêtes. Elle l’avait traité de gosse immature. — Quelle soirée ! évoque Elena, interrompant ses pensées. Son regard de poupée et sa bouche gourmande lui évoquent de vagues souvenirs. Il y avait deux personnes, ou trois peut-être, dans son lit. — On a dansé une grande partie de la nuit, puis on est allés dans ta chambre. Tu étais en grande forme, Mattéo, une forme olympique ! On a partagé une sex party torride. — Oh ?! fait-il gêné à l’évocation de cet ancien moi. — Ah oui, je ne te tenais plus, exagère-t-elle, sur un ton ironique. — Hum… — D’ailleurs, je t’ai rapporté un petit souvenir de la soirée. Dont je ne sais que faire aujourd’hui. Tu sais qu’à l’époque, je passais pas mal de castings ? — Si ! — J’ai été prise ! — Félicitations ! — Pour un tournage d’un mois en Colombie. — En Colombie ? Bravo ! — Et j’ai besoin de toi. Il recule sur le fauteuil et fronce les sourcils, déjà inquiet. — Ah ! Pourquoi ? — Ma sœur s’en serait bien occupé, pas mes frères tu t’en doutes, mais elle étudie à Barcelone. Pas pratique. Quant à ma mère, elle est malade en ce moment. Et puis, je ne sais pas, je crois qu’elle te déteste un peu ! — Me détester ? Elle m’aimait bien, non ? — Peut-être qu’elle t’aime un peu moins, alors ! Il se penche vers elle, attentif. Il la fixe du regard. — Elena, je ne te suis pas. Que veux-tu ? Elle détourne le regard, gênée. Ces yeux couleur océan, cette fossette… Le souvenir de leurs nuits torrides lui revient en mémoire. Mattéo était un amant doux et généreux. Avec elle et avec les autres filles de l’île. Elle avait chaviré pour lui, sans oser le dire. Tout en espérant le contraire, elle savait qu’il ne se fixerait pas. Tout du moins, le croyait-elle. Et puis, Manon était arrivée… et il avait oublié jusqu’à son numéro de téléphone. Elena lui attrape la main, dépose un baiser à l’intérieur, comme il avait coutume de le faire. Elle le fixe dans les yeux, hésite encore un moment, pensive. Elle n’a pas d’autre solution de toute façon. Elle se baisse, ramasse quelque chose par terre et le dépose sur la table. C’est pile à ce moment que Bernard entre dans la salle avec les consommations. — Félicitations, petit cachotier ! Champagne ! Devant Mattéo, sur la table en acajou, Elena a déposé un couffin en osier bordé de dentelles roses et bleus. De l’intérieur, deux petites têtes endormies émergent. Des bouilles rondes, aux joues dodues et aux boucles châtains, avec de longs cils bruns. — Je te présente Ruben et Marta, tes souvenirs ! 3 Paris Chez Mattéo Sur le chemin du retour, dans l’ascenseur, la tête de Mattéo bourdonne. Il a bu le champagne pour faire plaisir à Bernard. Il n’a pas su dire non à Elena. Il se remémore leur conversation. — C’est juste pour un mois, pendant le tournage. Je n’ai personne d’autre pour s’en occuper. — Mais tu es sûre ? — Sûre de quoi ? Que ce sont les tiens ? — Oui ! — Absolument, mon chéri ! Je ne voyais que toi à l’époque et la date coïncide exactement avec celle de l’anniversaire de Jeanne. On avait tellement bu. Tu étais si hot ! On a dû manquer de prudence, je ne me rappelle pas tout. Au réveil, on était assis au bord de la piscine, complètement défoncés, tu t’en souviens ? Il a mis ses poings sur les yeux, terrassé par la situation. — De la piscine, oui. Et j’ai des bribes de nous dans ma chambre. Ohhh… Mais, pourquoi n’as-tu rien dit avant ? — J’ai toujours voulu des enfants. Quand tu es la dernière, tu rêves d’avoir des petits frères et sœurs, mais les parents n’en veulent plus. Et puis, je t’apprécie, Mattéo, j’étais contente que ce soit les tiens. Maman était furieuse bien sûr et je ne te parle pas de mon père qui voulait monter te casser la figure. Mais, tu sais, chez nous, famille espagnole traditionnelle, pas question d’avorter. Alors, je les ai gardés. — Mais pourquoi ne pas m’avoir prévenu ? — J’étais heureuse de les avoir, je ne voulais pas que tu viennes les prendre. — Mais enfin, c’est n’importe quoi ! Tu aurais dû m’avertir. Tu te rends compte dans quelle galère tu me mets ? Elle a fait la moue, levé les yeux au ciel. — Comment va le prendre ta copine ? — Mal ! Très mal ! On part en Argentine la semaine prochaine. Comment veux-tu que je fasse ? — Je ne sais pas, mais là c’est ton tour. Tiens, je t’ai laissé toutes les consignes dans le couffin. Et voilà un sac avec le lait, les biberons et leurs doudous. C’est super dur de les laisser, mais je n’ai pas le choix. Ce tournage, c’est la chance de ma vie ! Je suis sûre que tu te débrouilleras parfaitement. Et tu me dois bien ça, non ? — Mais t’es dingue ! Je saurai pas m’en occuper ! Comme ça, du jour au lendemain, c’est gonflé, non ? Elle a frappé du poing sur la table, l’œil noir. — Dis-donc, quand tu m’as larguée du jour au lendemain, tu t’es posé des questions ? — On n’était pas vraiment ensemble, quand même ! — Pour toi, peut-être. Pas pour moi ! — Comment ça ? — Bref, c’est comme ça et c’est tout ! Ce sont tes enfants aussi. On s’appellera en visio tous les jours. On sera sur le même fuseau horaire, si tu es en Argentine. Comme ça, je pourrai les voir et leur parler. Si tu crois qu’ils ne vont pas me manquer ! C’est déjà suffisamment difficile et ça me déchire le cœur. Alors, s’il te plait, n’en rajoute pas. Il a tendu la main vers elle dans un ultime essai. — Mais ? — Il n’y a pas de mais ! Il a finalement capitulé. — OK, OK ! Et comment je les reconnais ? — Ruben a un ruban bleu au poignet. Marta, un ruban rose. Fais attention à ne pas les perdre ! Ah ah ! Je plaisante. Tu vois, Mattéo, ton fils est un garçon, tu sais ? Avec tout ce qu’il faut, là où il faut, comme toi. Tu sauras le reconnaitre, je suis sûre. Quant à Marta, elle a ta petite fossette au coin de la lèvre. Ils adorent la musique, tous les deux. C’est la seule chose qui les calme. Elle s’est levée, a embrassé ses bébés avant de partir, puis de revenir les câliner de nouveau et descendre enfin, le cœur lourd et des larmes plein les yeux. — On se connecte tous les jours, promis ? Dans l’ascenseur, Mattéo secoue la tête pour chasser ses pensées. Mais, dans ses bras, le couffin gigotant lui rappelle que le pire est à venir ! Quatre petits pieds s’agitent dans tous les sens. Quatre grands yeux le dévisagent avec effroi. Et deux minuscules bouches s’ouvrent sur un cri strident. Mattéo panique. Comment va réagir Manon ? L’ascenseur arrive à son étage. Mattéo décide de s’arrêter d’abord chez lui, poser les bébés avant d’affronter Manon. Mais, lorsqu’il pousse la porte, elle s’y trouve déjà, assise bien droite sur le sofa, son plaid beige posé sur les épaules. Elle le regarde entrer et ses yeux fixent le panier. Mattéo prend les devants. — J’ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Par laquelle, je commence ? Elle croise les bras sur sa poitrine, le regard glacial. — Laisse-moi deviner ! La mauvaise peut-être. — OK, la mauvaise, ce sont les bébés ! — Les ? — Oui, ce sont des jumeaux ! Manon bondit du sofa, les traits sévères, la bouche pincée. — Quoi ? Mattéo, tu plaisantes ? — Non, amore, attends, ne t’énerve pas ! La bonne, c’est juste pour un mois ! — C’est une blague ? Tu oses dire une bonne nouvelle ? Mais t’aurais pas pu faire attention ? Et puis juste pour un mois, ça veut dire quoi ? Genre, dans un mois, c’est fini, les bébés repartent dans les choux ! Et puis, on va s’en occuper comment ? Non, je rêve, Mattéo, vraiment, c’est pas possible ! Elle part en claquant la porte. Manon n’a jamais su gérer sa colère. Elle tient ça de son père. Il l’entend crier. — Tu les gardes chez toi ! Et tu fais un test ! Moi qui pensais que je pouvais te faire confiance ! 4 Paris Chez Claire Manon et Claire sont installées sur les poufs en toile, dans la péniche partagée avec d’autres artistes. Mélange éclectique d’objets glanés dans des brocantes et de tissus colorés. Les cendriers débordent, la vaisselle sale s’empile dans l’évier. Tout ce que Manon déteste. Mais il fait bon, la Seine s’étire dans les hublots, elles sont seules, pour l’instant, et Claire, sa Clarinette, est son amie de toujours. Consciente de la gravité de la situation, celle-ci a préparé le kit de survie, chocolat à volonté et liqueur d’Amaretto, l’un des seuls alcools que Manon apprécie. — Il n’est que 16 heures, on ne va pas boire maintenant ? lance cette dernière. — Et pourquoi pas ? répond Claire. Tu en as bien besoin. — J’ai surtout besoin d’avoir les idées claires. Cette nouvelle-là, vraiment, je ne m’y attendais pas ! J’ai toujours redouté que Mattéo reprenne ses habitudes de séducteur. Et je l’aurais quitté tout de suite ! — Tu es sûre ? — Certaine ! Manon fronce les sourcils et marque un blanc. Cette situation la dépasse. — Quelle galère ! se plaint-elle à voix haute. On était tellement bien. Ce matin, encore, on se disait des mots d’amour. Et voilà que, maintenant, le passé de Mattéo nous rattrape ! Et que je le déteste de tout gâcher. Elle est en colère contre lui. Elle s’en veut de lui avoir accordé sa confiance. Elle a beau avoir libéré ses licornes depuis sa colocation à la finca, elle n’en est pas encore au stade d’accueillir tous les souvenirs que la cigogne dépose sur son palier. Surtout un binôme de bébés dans un couffin XXL ! Tu m’étonnes, qu’est-ce qu’on va faire de ces petits chouineurs ? s’émeut intérieurement sa licorne. — Et alors ? D’un coup, tu ne l’aimes plus ? — Bien sûr que non, Clarinette. Mais de là à accepter son passé, comme ça. Tu te rends compte ? Il n’y en a pas qu’un, en plus. Ils sont deux. — Oui, des jumeaux, quoi ! Tu m’as dit. — Merde, des jumeaux, oui ! Qui braillent à toute heure ! Et nos siestes coquines ? Nos nuits passionnées… Oust à la porte, les mioches. Pas les nôtres en plus, peste la licorne furieuse. Sous ses boucles rousses et son allure fofolle, Claire l’observe, sérieuse. — Il avait une sœur jumelle, non ? Tu sais, dans ce cas, s’il y a des jumeaux dans la famille du père, les probabilités sont plus importantes. — Oui, je sais, on en parlait un peu. Un jour… Un jour très lointain ! souffle la licorne. — Pas tout de suite. Mais ça aurait été les nôtres, choisis, décidés, au bon moment, explique Manon. Dans sa tunique en pilou orange, Claire se rapproche et vient s’assoir par terre, près de son amie, les genoux relevés dans ses bras, la tête penchée sur le côté. Aux pieds, elle porte de drôles de chaussons en polaire, rouge avec des points blancs, comme des champignons d’intérieur. Elle lui tapote la main. — Oh, ma choute. Parce que tu crois qu’on peut tout contrôler dans la vie ? La vie, ça va, ça vient. Tu le sais, pourtant. Manon boude et lâche sur un ton sec. — Donc toi, tu dis que, voilà, je n’ai qu’à accepter sans rien dire. Tu me fais marrer, Clarinette, tu ne supportes pas un mec plus de trois semaines. Et moi, je devrais tolérer le mec et les compléments qui vont avec, même s’ils ne sont pas de moi ! — Oui ! Toi, tu en es raide dingue de ton Mattéo. Moi, j’ai pas trouvé le mien encore. C’est tout ! lâche Claire, vexée par la remarque de Manon sur la durée de ses amours. Manon attrape son amie par les épaules et l’embrasse sur la joue. — Excuse-moi, je suis désolée, Clarinette, je ne voulais pas te blesser, c’est juste que je suis choquée par la situation. En plus, il y a l’Argentine. Et Jeanne, Arturo, qu’est-ce qu’ils vont dire ? — C’est sûr, c’est pas simple. Au fait, t’as une photo ? Ils sont comment ? Ils doivent être choux, non ? — Ben non, je n’ai pas fait de photo. Et je ne les ai pas regardés. Je suis partie en claquant la porte ! — Oh, dommage ! Manon se tait. Elle ne sait que penser de cette situation. A-t-elle raison ? A-t-elle-tort d’en vouloir à Mattéo ? Comment réagir ? Elle se renfrogne au fond du pouf tout en mordillant ses ongles. Claire soupire et reprend la parole. — Tu te rappelles la naissance de Théo ? — Mon frère ? — Oui ! T’en connais un autre ? Manon ferme les yeux, un court instant. Bien sûr qu’elle s’en souvient. Elle avait sept ans. Elle venait de rentrer de son cours de piano. Ses parents étaient arrivés de la maternité. Le bébé dormait dans son berceau, dans la nursery qu’elle avait aidé maman à aménager. Une chambre de dessin animé, avec des nuages souriants dessinés sur les murs bleu ciel, des girafes en carton étirées le long de la fenêtre, des commodes en forme de bulles, et cette énorme peluche de dinosaure, debout près de la porte. Maman avait laissé libre cours à son imagination et Manon aussi, malgré les railleries de son père. Elle s’était approchée du berceau. Son frère avait ouvert les yeux, de grandes prunelles encore brumeuses. Il l’avait fixée sans la lâcher du regard. Il avait tordu la bouche, pas un sourire, non, mais une intention, quelque chose qui avait touché le cœur de Manon, direct. Un aller sans retour. Un uppercut sentimental, un plein d’amour qui l’avait submergée. — Alors, tu t’en souviens ? insiste Claire. — Oui, fait Manon, les yeux brillants, encore sous l’émotion de ce souvenir. Oh non pitié ! Pas les tralalas, on ne se laisse pas aller, ces petits morveux vont nous gâcher la vie, bouscule la licorne. C’est peut-être son devoir, propose le censeur interne, un Dark Vador qui a bien du mal à se positionner sur le sujet. — Tu vois, je vais t’avouer quelque chose, dit Claire. Ce jour-là, quand ton frère est arrivé, je l’ai détesté. — Quoi ? — Oui, d’abord parce qu’il allait t’éloigner de moi. Et, ensuite, parce que j’étais jalouse. Mes parents ne voulaient pas d’autre enfant. Je savais que je resterai fille unique alors que j’aurais rêvé d’être grande sœur, comme toi. — Oh… — Et ensuite, je l’ai adoré ! — Oui, je me souviens, une vraie petite mère. Tu le portais tout le temps. — Oui. Et tu sais quoi ? — Non. — Même si ça t’embête un peu, je rêverais de les voir, les jumeaux, ils doivent être adorables. Manon se frotte le nez. Elle est gênée. D’aussi loin qu’elle s’en rappelle, sa Clarinette a toujours vécu entourée de poupées et de peluches. Et depuis qu’elle habite sur la péniche, elle recueille les oiseaux blessés, les chats abandonnés et même les souris en détresse. Au grand dam de ses colocataires. Claire a l’instinct maternel ouvert et généreux. Et la patience et l’enthousiasme admirables. — Donc, toi, tu accepterais ? — Oui, répond Claire. En plus, c’est juste pour un mois. Et je serai avec toi, je pourrai vous aider, Mattéo et toi. — Tu ferais ça ? — Trente petits jours, Nounette. Et trente nuits ! Elle oublie les nuits, la copine en champignon ! siffle la licorne. — Les billets sont pris de toute façon, non ? Alors, un couffin de plus ! ajoute Claire. — Les billets ? Attends, je ne sais même pas s’ils ont un passeport à leur nom ! — Alors, renseigne-toi et compte sur moi. Je veux bien les trimballer dans le porte-bébé toute la journée. — Mais, il y en deux, Clarinette ! Comment tu feras ? — Un devant, un derrière ! répond son amie dans un éclat de rire. Allez, santé, ma choute ! Trinquons à nos nuits blanches et à ton amour. Pas question que tu laisses filer ton Mattéo. Il me plait bien celui-là ! — Oups, chasse gardée, fait mine de gronder Manon. — Et puis qui sait ? L’Argentine, le tango, les hommes aux yeux de braise… peut-être trouverai-je un co-baby-sitter là-bas ? — Ah Clarinette, je t’adore ! répond Manon, émue et rassurée. Punaise, je le savais, on ne m’écoute jamais ! s’énerve la licorne. Tais-toi, elles ont raison, il s’agit d’être adulte ici ! tance Dark Vador.
94
« Dernier message par Apogon le jeu. 08/12/2022 à 17:49 »
Linko-T2- D'or et de flammes de Frédéric Faurite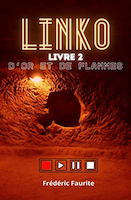 Pour l'acheter : Amazon Librinova
Peu d’archives ont été retrouvées au sujet de ce qu’il convient d’appeler le plus grand scandale télévisuel du XXIème siècle en matière de téléréalité. Dans un souci de clarté et d’exactitude, ce récit comporte quelques morceaux choisis qui permettront au lecteur d’en apprendre davantage sur les événements qui ont suivi l’émission « La Villa de la Gloire ». Son interruption brutale n’a pas pour autant marqué celle de son jeu dont la violence et le principe cruel semblent désormais coller à la peau des candidats, livrés à eux-mêmes dans la nature. Traqués. Désespérés. Répandant sur leur chemin un malheur presque contagieux. De multiples caméras, parfois dissimulées, ainsi que toutes sortes d’appareils destinés à capter la voix et l’image ont permis de constituer ce dossier.
Ces retranscriptions qui peuvent être perçues comme des « bonus télévisuels » ont été classées dans la rubrique intitulée « La Suite du Programme ». L’extrait suivant au cours duquel le principal protagoniste réalise l’étendue du caractère horrible de la situation dans laquelle il se trouve nous a semblé approprié pour ouvrir ce second volume.
LA SUITE DU PROGRAMME – PROLOGUE TÉLÉVISUEL Une pinède baignée de lumière, surexposée. Plan américain sur un corps affalé contre un arbre. Plus mort que vif, le jeune homme est couvert d’une crasse sanguinolente ponctuée de brûlures et de blessures. Une voix sucrée commente la mise en scène dans un murmure. — Est-ce que l’image est bonne ? Hmm… La lumière est peut-être un peu trop vive… Tant pis, on va s’en contenter et reprendre le tournage… Un bon programme télévisé, si tant est qu’il en existe, s’ouvre souvent sur des paroles enthousiastes et enjôleuses. Il ne faut toutefois pas s’y fier car c’est également le cas pour beaucoup de mauvais, y compris les pires. — Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, clame fièrement la voix, soyez les bienvenus dans la « Villa de la Gloire » ! Votre émission continue dès à présent ! Rien ne vaut un commentaire joyeux pour reprendre le fil, n’est-ce pas ? Quelle surprise ! Même une émission comme la « Villa de la Gloire » que l’on croyait en fin de course trouve toujours un moyen de se relancer… Ceci étant, les téléspectateurs ont-ils vraiment envie de voir revenir un tel programme ? — Qu’en dis-tu, cher public ? Toi qui attends la suite de l’aventure ! Toi qui es aussi impatient que moi ! Très bonne question ! Il faut dire que le contenu de l’émission avait de quoi surprendre, même pour de la téléréalité. Alors, public ? Estimes-tu que cette téléréalité mérite une seconde chance ? — Votre imagination s’enflamme ? Elle n’est pas la seule… Si vous êtes prêts, contemplons ensemble ce nouveau décor. Une pinède illuminée par le soleil d’été, une nature sauvage aux parfums du sud, un magnifique ciel azur et une épaisse colonne de fumée recouvrant tout peu à peu… Et d’ailleurs, qu’en penseraient les candidats ? Seraient-ils d’accord pour prolonger la partie après tout ce qu’ils ont pu subir ? — Il est environ treize heures et la journée a commencé sur les chapeaux de roue. Nous avons cependant la chance d’avoir sous la main quelqu’un de disponible pour ce nouveau départ. Un candidat qui a su tirer son épingle du jeu lors de la saison précédente ! Un volontaire – ou peu s’en faut – pour un tour de piste supplémentaire ! Le volontaire en question restait muet comme si le redémarrage de l’émission ne le concernait pas. En réalité, il n’était pas en mesure de répondre. D’ailleurs, s’il avait pu le faire, il y a fort à parier que cela n’aurait pas été en termes fleuris. Encore… Encore et toujours l’émission… Ça n’en finira jamais… Perdu dans un épais brouillard, Colin Roy se sentait flotter, le corps endolori et l’esprit à la dérive, bien loin du réel. Son début de journée n’avait pas été des plus tendres : il avait failli mourir un nombre incalculable de fois. Battu, abattu, poignardé, mordu, dévoré, pulvérisé, brûlé, asphyxié… Les possibilités ne manquaient pas. Lui-même avait dû commettre des actes qui hanteraient les plus affreux de ses cauchemars pour le restant de ses jours. Tuer à défaut d’être tué. Ce trop-plein de fatigue, de violence et d’émotions avait eu raison de lui. À présent qu’il commençait à retrouver un usage minimal de ses pensées, celles-ci se focalisaient sur les sons ambiants. Quelqu’un parlait, discourait à n’en plus finir. Une voix pleine de promesses incertaines, interprétant aussi mélodieusement que dans un rêve des paroles de cauchemar. — Pour les rares téléspectateurs qui ne le connaitraient pas, laissez-moi vous présenter, sans plus attendre, l’un de nos plus impressionnants candidats, ou plutôt ce qu’il en reste, j’ai nommé : Linko ! Linko… C’est bien de moi qu’il s’agit. Je suis donc toujours ce pseudonyme idiot, même après tout ce qu’il s’est passé. — Comme vous pouvez le constater, notre chanteur à la voix d’or n’est pas au meilleur de sa forme mais il sera bientôt capable de nous voir et de nous entendre, faites-moi confiance. Allons, Linko ! Une grasse matinée qui déborde sur l’après-midi, ce n’est pas raisonnable, surtout le jour de ton anniversaire. Allez, debout ! Tout le monde t’attend ! Qui me parle ? Je connais cette voix… Une gifle magistrale vint frapper Colin en plein visage. Incapable d’ouvrir les yeux, il n’avait pas vu venir l’attaque. La brûlure n’en était que plus cuisante. Ses mains tentèrent de bouger pour élever une garde et le protéger mais elles semblaient aussi lourdes qu’impuissantes. — Réveille-toi, Linko ! Je te préviens, je continuerai à prendre soin de ton visage jusqu’à ce que tu sortes du cirage. Les baffes, les claques, les gifles, les roustes et toutes ces joyeusetés que distribuent la paume et le revers de la main défilèrent contre sa figure. Cependant, ce n’était pas tant leurs impacts répétés qui faisaient souffrir Colin mais bien le son particulier de cette voix : si familière et si lointaine à la fois. Il fallait qu’il ouvre les yeux, même s’il craignait plus que tout ce qu’il allait découvrir face à lui. Je dois reprendre conscience… Il faut que je vérifie si… Peut-être que j’ai mal vu avant de m’évanouir ? Peut-être que j’ai rêvé ou qu’il ne s’agit que d’une ressemblance ? Le jeune homme s’assura qu’il pouvait remuer la mâchoire puis vint refermer lentement ses dents sur l’intérieur de sa joue droite. Il enserra sa prise et la tortura aussi longtemps que nécessaire pour que ses paupières se mettent à trembler, subtil vacillement des cils. — Regardez ! s’exclama alors la voix et, aussitôt, la grêle de coups cessa. On dirait bien qu’il est en train de s’éveiller… Cher public, c’est un moment faste ! Celui du retour de notre chanteur et champion ! Blancheur intense de la lumière solaire. Ébloui, Colin ne parvint à ouvrir les yeux que partiellement. Tout ce qu’il pouvait distinguer dans un rayon compris entre vingt et trente centimètres était à peu près net. Ce qui allait au-delà devenait une bouillie floue, saturée de soleil. — Oh non… gémit-il, agacé et désespéré. Dans cette fameuse zone de confort visuel se trouvait un élément qui l’oppressa instantanément : un objectif noir et luisant braqué sur lui. — Encore ces saloperies de caméra… — Tu fais erreur, lui répondit la voix qu’il rattacha aussitôt à la main gantée qui tenait l’appareil. On se la joue plus intime à partir de maintenant, simplement avec les moyens du bord. À y regarder de plus près, il s’agissait d’un smartphone dernier cri et non d’une de ces caméras sophistiquées qui avaient capté chaque seconde de sa vie lors de ces derniers jours dans la « Villa de la Gloire ». — J’utilise mon portable par défaut et parce que je ne peux pas me permettre de perdre ne serait-ce qu’une seconde de l’émission, reprit la voix. De nombreux spectateurs exigeants veulent la suite ! Allez, Colin, ouvre les yeux ! Tu dois savoir ! Fais-toi violence et regarde ! Regarde la vérité en face et tiens-toi prêt à déguster ! Au prix d’un effort qui lui sembla surhumain, Colin s’extirpa de sa torpeur. Ses yeux s’ouvrirent en grand, le soleil lui brûla la rétine mais il se débarrassa de ses lueurs en clignant à plusieurs reprises et en portant son regard sur cette main gantée. Ce dernier remonta le long d’un bras enveloppé dans une combinaison noire, glissa sur une armure en kevlar, escalada une nuque longue et fine avant de finir sa course contre un visage. De nouveau, ce fut le choc. La même surprise qui l’avait fait s’évanouir quelques heures auparavant, aussi agréable qu’un coup de genou dans les parties génitales. — Alors je ne rêvais pas ? Tu es des leurs, toi aussi ! déclara-t-il froidement avec le même état d’esprit qu’un César reconnaissant Brutus parmi les rangs des conjurés qui le perçaient de coups de poignard. — Moi surtout ! Qu’est-ce que tu penses du nouveau choix de la production pour ce qui est de l’animation ? — Ils doivent avoir beaucoup de budget s’ils ont pu se payer la plus ravissante des garces. Pas vrai, Mouza Vorobiev ? La pianiste partit d’un grand rire qui résonna dans la pinède et fit danser une vague étincelante de mèches blondes, cadre doré autour de son visage. 1 ALINE BREMOND ET LES SOLDATS DU FEU 1 Une colonne de véhicules de pompiers gravissait le flanc d’un coteau couvert de garrigue. Sous leur passage, le bitume épuisé par le temps et désagrégé par les intempéries achevait par endroits de se disloquer, laissant apparaître un sol de poussière semblable à du safran. Poussés au maximum par leurs chauffeurs, les fourgons chargés d’hommes, les 4x4 et les lourds camions à échelle mugissaient dans les montées et ahanaient dans les tournants. Le soleil matinal déjà haut faisait reluire chaque pièce de métal et rendait les parebrises étincelants. La chaleur étouffante distordait les formes et, de loin, l’œil humain aurait eu de quoi s’étonner devant cette ondoyante procession de briques rouges et ardentes. D’un peu plus près, on distinguait dans ce convoi vermeil les taches sombres des soldats du feu, scrupuleusement semblables et solidaires dans leur uniforme. Seul un binôme, installé dans le camion à échelle occupant la troisième position du cortège, sortait du lot. Ces deux pompiers-là étaient dissemblables au point de paraître incompatibles, tellement différents sur tant d’aspects que l’on aurait pu penser à un tandem comique. Des Laurel et Hardy de la lance à incendie. — Allez, avancez un peu, là ! grogna le conducteur, un grand gaillard d’âge mur au teint hâlé et au visage buriné par la lumière du midi. C’est vrai qu’il n’y a qu’une seule route pour grimper ici et qu’elle est complétement pourrie mais quand même… On perd un temps pas possible et Dieu sait qu’on n’en a pas en réserve ! Ses doigts pianotaient fiévreusement sur le large volant dont il retirait parfois une main pour se soulager de la brûlure solaire et chasser la sueur qui émergeait à grosses gouttes de tous les pores de son visage. — On dirait que certains des collègues ne sont pas des gars de chez nous… s’intrigua sa coéquipière, nettement plus jeune mais tout aussi accablée par la chaleur. — Non, tu vois bien qu’il n’y a jamais eu autant de véhicules à Carros. Je crois que les deux tout-terrains devant nous viennent de Nice ou de Vence. Tous les copains de la région ont dû se mettre en route en voyant ce carnage. La jeune fille se pencha alors par la fenêtre ouverte et le vent fouetta par saccades ses cheveux roux. Ces entrelacs de boucles cuivrées voilaient par instants deux yeux couleur de forêt écarquillés, des traits doux, une peau de méridionale légèrement hâlée ainsi que des lèvres incarnates à peine desserrées. Sans se préoccuper du brasier capillaire qui obstruait partiellement sa vue, l’inquiète héroïne regardait l’immense colonne de fumée qui s’élevait au-dessus des collines. Une rature sur la page bleue du ciel. Ce n’était malheureusement pas la première fois que l’un des massifs de la région s’embrasait mais jamais un départ de feu n’avait été aussi subit ni une colonne de fumée aussi dense. — Quel truc de malade, quand même ! C’est du délire ! — Le véritable délire, c’est que nous n’ayons rien reçu à la caserne. Pas le moindre message d’alerte de la part de qui que ce soit… — À part moi bien sûr, mais c’était du pur hasard. — Ouais, une chance que tu aies remarqué ce début d’incendie en venant. Je te tire mon chapeau, ou plutôt mon casque, Aline ! Tu nous auras fait gagner de précieuses minutes pour contenir ce bordel. La rouquine le regarda avec un grand sourire. Ce n’était pas souvent que son mentor daignait la gratifier d’un compliment. Elle n’avait cependant pas fait grand-chose, simplement un mouvement de tête vers la montagne en roulant sur l’autoroute. La vision des monts et des pinèdes lui communiquait toujours une joie légère et agréable, légèrement teintée de nostalgie. Depuis son enfance, elle s’y promenait avec sa famille et gambadait dans la garrigue sans jamais éprouver la moindre lassitude. Sentir les odeurs pourtant si familières du thym, du romarin et du fenouil était chaque fois une redécouverte et la musique des cigales lui paraissait sans cesse plus belle et plus complexe, comme une mélodie qui s’enrichirait de saison en saison. Aline Brémond débordait de souvenirs ensoleillés qui la consolaient des quelques chagrins qu’elle avait pu rencontrer dans sa vie. Certains des membres de sa famille, ses grands-parents notamment, s’en étaient allés vers un ailleurs qu’elle imaginait comme un été sans fin. Si ses aïeux étaient partis, les montagnes demeuraient sagement à leur place et cette simple idée offrait déjà un grand réconfort. Un jour, ce serait à son tour de parcourir ces lieux en tenant la main à ses petits-enfants tout en leur racontant ce qu’elle savait du folklore : l’histoire comique de la sardine qui boucha le Vieux Port à Marseille, un ou deux contes horrifiques liés à la Tarasque ou bien la légende de la mythique cité engloutie de Tauroentum. Voilà à peu près à quoi songeait Aline lorsque ses yeux s’étaient écarquillés à la vue de cette colonne de fumée déjà épaisse qui barrait le paysage à la manière d’un ruban noir sur un faire-part de décès. Alors avait enflé dans son cœur une peur sourde que rien n’avait pu atténuer. Elle avait foncé jusqu’à la caserne et donné l’alerte, faisant bondir l’essentiel de leur effectif d’intervention. Seul point positif, son mentor semblait lui en être reconnaissant. — Merci beaucoup, René ! — T’emballe pas, la bleue ! — Je te signale qu’on est tous rouges chez les pompiers, rétorqua-t-elle en tirant la langue avant de se rendre compte que son capitaine gardé les yeux fixés sur la route, l’air sérieux. — N’importe qui aurait fini par remarquer la colonne de fumée noire et je parie que la caserne doit maintenant crouler sous les appels de tous ceux qui auront jeté un coup d’œil aux montagnes. Sacré René… Il est toujours aussi incapable de faire un compliment et de s’y tenir, il aura toujours une petite phrase pour contrebalancer. La jeune femme, pompier volontaire venant à peine de fêter ses dix-neuf printemps, ne se départit pas de son enthousiasme. En deux ans de formation, Aline s’était habituée au caractère bien trempé et à l’humeur parfois changeante du capitaine Grimaud. Certes, René ne mâchait pas ses mots, émettait souvent des remarques déplacées sur les femmes ou des opinions politiques douteuses mais elle le lui pardonnait car il était ainsi par tradition plus que par conviction. Après l’avoir officiellement et irrévocablement identifié comme un vieux con raciste et misogyne lors de ses débuts, Aline avait pourtant fini par réviser son jugement. René débitait simplement les niaiseries dont avait dû l’abreuver sa famille et qu’il révisait à l’occasion lors de ses passages au bistrot du coin au cours de son temps libre. Toutefois, il n’avait jamais émis le moindre jugement négatif sur Aline contrairement à d’autres hommes, y compris dans sa propre famille, qui ne se gênaient pas pour lui faire comprendre qu’elle serait mieux occupée à astiquer les cuivres d’une batterie de cuisine plutôt que ceux du grand camion échelle de la caserne de Carros. La palme d’or de l’indélicatesse revenait à un beauf qui, lors d’une intervention chez une vieille dame ayant glissé sur l’une des tomettes de sa cuisine, l’avait interpellée alors qu’elle chargeait le brancard dans le camion. — J’ai une belle lance à incendie juste pour toi, poupée, lui avait soufflé une voix goguenarde et nasillarde filtrant à travers une rangée de poils graisseux. Aline était restée interdite, muette et gênée face à un gros type rond et moustachu qui avait probablement dû servir de modèle à Binet pour dessiner Robert Bidochon. En revanche, René n’avait fait ni une ni deux et était allé directement défier le gaillard. — Et moi, j’ai une belle botte d’intervention juste pour calmer les ardeurs de ta lance à incendie si je t’ai encore sous les yeux dans cinq secondes ! L’homme avait aussitôt tourné les talons sans demander son reste. Il n’y avait que très peu de personnes capables de soutenir le regard du capitaine Grimaud lorsqu’il s’énervait. Aline savait aussi qu’il ne balançait pas de paroles en l’air et que l’entrejambe du moustachu avait manqué de peu de faire connaissance avec la coque de protection en cuir de la ranger de René. — Maintenant, tu sais quoi répondre la prochaine fois, avait-il simplement déclaré à Aline. Ce n’était pourtant pas cet incident isolé qui avait définitivement réhabilité René aux yeux d’Aline. En réalité, il s’agissait des multiples moments où tous deux se trouvaient en intervention. Elle avait perçu le soin et le zèle qu’il apportait à son métier auquel il se consacrait corps et âme, ne comptant pas les heures passées auprès des victimes. Elle-même avait choisi d’intégrer la brigade en tant que pompier volontaire par envie de se rendre utile et de venir en aide à tous ceux qui en avaient besoin, que ce soit un chat coincé en haut d’un arbre, un enfant tombé de la cage à singes au parc ou une personne âgée en détresse. Les grands airs et les mots durs de René cachaient en réalité une personnalité plus fragile qu’il n’aurait voulu l’admettre. L’armure du capitaine Grimaud peinait parfois à contenir l’éclat de l’âme lumineuse qu’elle renfermait. Aline avait bien remarqué à quel point son regard vif perdait sa lumière lorsque les victimes passaient de l’autre côté, particulièrement lorsque celles-ci étaient bien trop jeunes pour mourir. Alors, elle avait fini par se dire que son capitaine ne se rendait pas au bistrot pour râler sur les femmes ou les immigrés mais pour boire jusqu’à oublier les mauvaises journées. Un jour, elle avait même vu une unique larme rouler sur les joues rugueuses de son mentor alors qu’ils s’efforçaient en vain de sauver les derniers hectares d’une pinède en proie aux flammes. — Tu vois… avait-il murmuré en étouffant un sanglot. Ça, c’est le pays qui part en fumée… La colère avait empourpré les joues de la volontaire Brémond en songeant que quelqu’un avait volontairement contribué à anéantir cette forêt. La gendarmerie les avait informés que la ou les ordures à l’origine de l’incendie s’étaient montrés particulièrement efficaces et méthodiques en utilisant un chat qu’ils avaient arrosé d’alcool ou d’essence à briquet. Ils avaient ensuite enflammé l’animal avant de le lâcher dans les bois où la bête affolée s’était précipitée partout où elle pouvait pour essayer d’échapper à la souffrance, embrasant brindilles et bosquets dans sa course désespérée. Aline ne s’était sentie mieux qu’en imaginant sa propre botte pilonner les responsables selon la méthode préconisée par son capitaine. Aujourd’hui, face à la fumée noire qui obscurcissait peu à peu le ciel, la jeune femme ne pouvait s’empêcher de prier pour que les dégâts ne soient pas aussi importants que la dernière fois, pour que la forêt ne souffre pas trop et, surtout, pour qu’aucun de ses collègues ne soit blessé au cours de leur intervention. La conviction qu’ils fonçaient tous tête baissée vers un danger mortel ne la lâchait pas. — Tu n’as pas trop chaud ? lui demanda René dont le front ruisselait. — Ça va… J’ai juste l’impression d’être au sauna. — Tiens le choc ! Je préfère ne pas mettre la climatisation, le moteur galère déjà assez comme ça. — Sans compter les possibles émanations toxiques… — On doit être encore un peu loin pour souffrir de quoi que ce soit mais on sortira les masques si le besoin s’en fait sentir. Ce qui préoccupait avant tout Aline, c’était le caractère insolite de ce départ de feu dans une zone qu’elle ne connaissait que très peu et qu’elle pensait entièrement déserte. — Mais qu’est-ce qu’il peut bien y avoir là-haut pour qu’il y ait une telle fumée ? On pourrait tout imaginer : une baraque construite avec des matériaux douteux, une grange pleine de foin moisi, une cache de produits stupéfiants ou, pire, un dépôt secret militaire contenant des armes dangereuses… — Qui sait ? répondit René. On a beau être à la lisière d’un parc naturel, il y a toujours quelques richards suffisamment friqués ou quelques mecs assez audacieux pour contourner les interdictions. — C’est quand même étrange de vouloir aller se planquer loin de tout… La jeune pompière s’imagina une fraction de seconde vivant dans une maison aussi retirée. Elle frissonna en pensant à ce qu’elle pourrait éprouver au cours d’une froide nuit d’hiver ou bien lors d’un été aride, cernée par une pinède en flammes. S’efforçant de chasser de son esprit ces pensées peu réjouissantes, elle choisit de se préparer au mieux à affronter le sinistre en glanant quelques conseils auprès de son collègue. — Comment tu le sens, cet incendie, toi ? — On l’a vu à temps donc ça devrait aller et je pense que nous sommes assez nombreux pour le maîtriser. Cela dit, quand on voit comment le ciel se couvre… Je me demande si toute cette putain de chaleur ne va pas nous déclencher un orage. Il faudra être très vigilants : là-bas, ce sera la nuit. — La nuit ? — Avec toutes ces fumées et ces nuages, on aura sûrement l’impression qu’il fait noir comme dans un four. En effet, la luminosité diminuait peu à peu et la colonne de véhicules s’engouffrait dans un brouillard dont les fumées piquaient les yeux et la gorge. Les incisives en tenailles, Aline ne put s’empêcher de happer sa lèvre inférieure pour la mordiller nerveusement. 2 Moins d’un quart d’heure plus tard, le brouillard s’était effectivement mué en une nuit enfumée. Les véhicules roulaient tous phares allumés dans une obscurité aussi oppressante qu’artificielle, leurs essuie-glaces déblayant de temps à autres les cendres qui se posaient sur les vitres. Alors qu’Aline se demandait s’ils ne s’étaient pas perdus, les deux véhicules qui ouvraient la route pilèrent brusquement. René freina violemment, aussitôt après avoir été alerté par les éclairs rouges de leurs feux stop. Sa coéquipière se sentit partir en avant puis fut cisaillée et renvoyée illico à sa place par la ceinture de sécurité. — Ils auraient pu anticiper, ces idiots ! rouspéta-t-elle. — Je doute qu’ils en aient eu le temps… Mets ton casque et attache bien tes cheveux, on descend ! Tous deux bondirent hors du camion et s’avancèrent en direction des deux 4x4 dont les occupants étaient également sortis. — Qu’est-ce que vous attendez ? demanda René en les voyant tous immobiles. — La route s’arrête là. On a un portail devant et un mur d’enceinte immense. — Merde… Deux pompiers qui s’étaient avancés jusqu’aux immenses battants de fer en revinrent en courant. L’agacement se lisait sur leur visage. — C’est fermé, le portail est verrouillé ! Il n’y a pas de sonnette ! — Je ne crois pas que le propriétaire ait le temps de te répondre, ironisa le second avant de se tourner vers René. Toi qui es du coin, tu as une idée de ce qu’il y a derrière ces murs à la con ? Le repaire d’un spécialiste des remparts et fortifications ? — Je n’en sais foutre rien mais quoi que ce soit, ça flambe sous le mistral depuis un bon moment déjà. — En chemin, reprit le premier pompier, on a demandé un appui aérien et on a au moins deux Canadairs qui vont se relayer pour arroser la zone. — C’est une bonne nouvelle mais ça ne suffira pas. On ne sert à rien si on reste à attendre comme des piquets devant ce portail. Je vais tenter quelque chose, quitte à me faire taper sur les doigts pour destruction de matériel. — À quoi tu penses ? — Vous allez parquer vos véhicules sur le côté et commencer à mettre en place les dispositifs de coupe-feu. Toi, Aline, tu vas aller prévenir les copains qui attendent derrière en leur demandant de reculer autant que possible. — Ne me dis pas que tu comptes enfoncer le portail ! s’exclama la jeune femme, stupéfaite par le procédé et, plus encore, par le fait de voir René Grimaud mettre en péril son précieux camion. — Tu vois une autre solution ? Il me faudra peut-être plusieurs essais mais le pare-chocs du camion devrait supporter les coups. Une fois que ce sera fait, on pourra intervenir. Le plan de René étant le meilleur et le seul, tout le monde s’employa à l’exécuter au mieux. Aline s’arrangea pour que le camion gagne quelques mètres de recul. Le moteur vrombit puis l’entraîna en avant. Le mastodonte rouge sembla se perdre dans la fumée, puis il y eut le choc. La jeune femme eut l’impression qu’une immense baguette venait de s’écraser contre un gong monumental. Elle courut jusqu’au portail et fut heureuse de constater que les plaques d’acier venaient de perdre un peu de leur rigidité. La collision avait ouvert un espace d’à peine un centimètre entre les battants. Ce qu’Aline distingua à travers lui apprit qu’il n’y avait pas une seconde à perdre. Un incendie qui jette de telles lueurs n’a strictement rien d’ordinaire. — On remet ça ! hurla René en actionnant la marche-arrière. Lorsque la machine percuta de nouveau le portail dans une désagréable détonation accompagnée de divers crissements, le pare-chocs sembla souffrir davantage que la cible elle-même. Les barres blanches métalliques s’étaient tordues sur les extrémités. — Bon sang ! Qu’est-ce que c’est que cette barrière ? — Recommence, René ! s’écria Aline. Le bruit était différent cette fois et l’espace entre les battants s’est encore agrandi. Le capitaine fit une ultime fois machine arrière. Aline contempla le camion d’un point de vue qui aurait été celui du portail s’il avait été vivant. Elle constata à quel point le véhicule allait vite et elle s’écarta prudemment. Depuis le bord de la route, elle vit le camion heurter le portail avec fracas… puis disparaître ! — Mais ! s’exclama-t-elle, un peu bêtement, avant de comprendre que l’obstacle avait enfin cédé face à ce dernier assaut. — Il a réussi ! s’écria un des pompiers qui patientait sur le côté. On y va ! Aline fut la première à se précipiter à la suite du camion tandis que ses collègues regagnaient leurs véhicules. Le spectacle qui s’offrit à elle était celui d’un vaste et rougeoyant chaos. Le gigantesque parc qui s’étalait devant ses yeux flambait de toutes parts. Plusieurs foyers s’étaient déclarés qu’il s’agisse des pelouses, des massifs de fleurs ou, encore, des parcelles de pinède conservées çà et là. Elle comprit que les brigades devaient progresser avec la plus extrême précaution pour ne pas se retrouver cernées en plein milieu de ce cauchemar. La source principale de l’incendie paraissait encore lointaine mais la combattre directement était secondaire. Pour l’heure, il s’agissait avant tout de sécuriser le périmètre ainsi que le reste de la colline. Le camion de René, qui avait stoppé une vingtaine de mètres après le portail, reculait prudemment. Il l’arrêta au beau milieu de la zone de gravier situé à l’entrée, à proximité de ce qui semblait être un héliport où flambaient les restes d’une carcasse. — Déployez-vous en vitesse ! hurla le capitaine en bondissant du véhicule et en courant vers la lance à incendie. — Ça va, René ? s’enquit Aline en accourant pour lui prêter main-forte. — J’ai rarement vu un bordel pareil, on dirait une scène de guerre ! Quelque chose a dû exploser et arroser la zone pour qu’il y ait autant de foyers d’incendie dans ce parc ! — Est-ce qu’on aura assez d’eau ? — On a un bon stock mais on n’en aura jamais assez pour éteindre ce merdier. La seule solution serait de trouver des bornes sur le terrain pour brancher les lances. — On va y arriver ! On n’a pas le choix ! L’ensemble du convoi se hâta de se mettre en position puis ils s’attaquèrent à l’incendie. Les camions lourds furent déployés le long du mur de l’enceinte, profitant de l’espace entre celui-ci et les arbres du parc. Les véhicules plus légers tentèrent d’ouvrir un périmètre sûr tout en remontant l’allée principale. Chaque pompier voyait avec appréhension les réserves d’eau diminuer à vue d’œil. Enfin, après une demi-heure de lutte contre les flammes, les soldats du feu parvinrent à dénicher une arrivée d’eau destinée à l’arrosage des massifs de fleurs. Aussitôt, le tuyau d’arrosage fut exploité et permit de compenser un tant soit peu l’amenuisement des réserves. Quelques instants plus tard, une prise d’eau exclusivement destinée à lutter contre un incendie fut découverte par un groupe de pompiers qui s’empressèrent de la mettre à contribution. Malgré ces bonnes surprises et tous les efforts mis en œuvre pour lutter contre le brasier, la situation demeurait stable. Le vent attisait les flammes et projetait des flammèches au loin, y compris par-dessus le mur d’enceinte. Seule l’arrivée du premier avion jaune fut salutaire et permit d’apaiser la fureur du feu. Leur « pélican », plus connu sous le nom technique de Canadair CL-415, largua ses six tonnes d’eau quelques dizaines de mètres au large de leur position, leur offrant un peu de sécurité et de fraîcheur. — On s’en sort bien finalement, murmura Aline soulagée. — C’est loin d’être fini, pourtant ! lui lança un de ses collègues qui s’efforçait de faire barrage aux flammes qui les entouraient. Il faudra encore de nombreux passages pour que tout soit sous notre contrôle et le vent peut encore nous jouer des tours entretemps. — Je préfère envisager le meilleur plutôt que le pire. Il faut en venir à bout, c’est tout ce qui compte. Un large sourire glissa sur les lèvres du capitaine Grimaud, fier de la ténacité de son élève, heureux de lui entendre prononcer des paroles qui auraient tout à fait pu être les siennes. Il songea qu’Aline avait déjà l’arme essentielle que le pompier doit opposer à un incendie : la ténacité. Deux heures durant, confortés par l’appui aérien, ils disputèrent à l’incendie chaque pouce de terrain. Des hélicoptères porteurs d’eau ainsi que des renforts terrestres étaient venus grossir leur nombre et ils commençaient à se rendre maître de la première moitié du parc. La villa au centre ainsi que le reste de la propriété semblaient malheureusement perdus. Une partie des nouveaux arrivants fut envoyée à l’extérieur du mur d’enceinte afin de tenter de contenir l’incendie en allumant des coupe-feux. Cette manœuvre impliquait de faire brûler préalablement des bandes de végétation afin d’épuiser l’incendie. Cela ne limitait toutefois pas les sauts de flammes mais, par chance, le vent avait fini par tomber. Enfin, après un travail de tous les instants, une issue heureuse sembla se dessiner. Ce fut avant que l’on ne découvre le premier blessé. Un groupe de trois pompiers passa brusquement devant eux, portant un brancard de fortune sur lequel reposait un corps hâtivement recouvert d’une couverture de secours. Aline eut le temps de voir une main couverte de cloques noires et violacées s’agiter sur le côté. Ce détail ainsi que la forme pratiquement crochue de ces doigts aux mouvements saccadés et convulsifs lui saisirent le cœur. — Un blessé ? s’étrangla René. Dans cette fournaise ? — Je t’assure ! s’écria le gars qui dirigeait l’autre section. C’est un type qui a des brûlures au troisième degré sur la majorité de son corps mais il bouge encore. Comme il convulse, on l’a sanglé dans le brancard. — Après tout ce temps au cœur de l’incendie, c’est un véritable miraculé ! s’étonna Aline. — Miraculé, il faut le dire vite... Vu ce qu’il en reste et ce que la vie lui réserve, je me demande si la mort n’aurait pas été préférable… déclara sombrement René. Comment tu comptes procéder, mon gars ? — Mes hommes le transportent actuellement vers notre point de départ, dans le camion de l’entrée. L’un d’eux va rester avec lui pour tenter de le maintenir en vie en attendant l’arrivée d’un hélico puis ce sera direction le CHU de Nice et le service des grands brûlés. — En espérant qu’il tienne le choc… De notre côté, on va progresser dans la même direction en ouvrant doublement l’œil maintenant qu’on sait que la propriété n’était pas déserte. Le groupe poursuivit son avancée parmi le parc embrasé, laissant derrière lui une traînée de cendres mouillées. Les jets d’eau leur permettaient de s’ouvrir un passage parmi les flammes mais aucun d’eux n’osait se risquer immédiatement en avant de peur d’être pris en tenaille par l’incendie. Le passage d’un second Canadair dissipa subitement l’ensemble des foyers qui se trouvaient devant eux et ils purent enfin se rapprocher de la villa, déjà partiellement effondrée. — Mais qu’est-ce qui s’est passé, ici ? gémit un pompier en contemplant la vision infernale de cet ancienne allée principale durement rachetée aux flammes. En-dehors des cendres, de quelques braises encore ardentes et des flaques d’eau, le chemin était parsemé d’informes rouleaux d’étoupe noirâtre disposés de façon anarchique. Il fallut quelques secondes à Aline pour comprendre qu’il s’agissait de corps humains carbonisés. Elle ne put retenir un cri d’effroi, une plainte aiguë qui semblait sortir de la bouche de chacun de ceux qui contemplaient la scène, muets de terreur. — Bordel de merde ! s’exclama enfin un pompier. Tous ces morts… — Ils sont complètement cramés… murmura un autre. Ils essayaient sûrement de fuir la villa en flammes… — Tu es sûr ? demanda René en s’avançant. Il s’accroupit auprès de l’un des corps et l’observa un instant. — Peut-être que ces gens fuyaient mais je trouve curieux qu’ils ne soient pas parvenus plus loin. La concentration de corps dans cette zone est plutôt surprenante, on croirait plutôt une scène de bataille ou d’exécution. D’ailleurs, regardez ! Sa main se referma sur un objet noirâtre qu’il brandit en direction de ses coéquipiers. En dépit des dommages que lui avait causés l’incendie, on pouvait clairement reconnaître la forme d’une arme de poing dont les parties métalliques étaient restées intactes tandis que tout le plastique avait fondu. — Un pistolet ! s’écria Aline. — Il s’est passé quelque chose de très louche ici. Un sale truc ! — Ça doit être un règlement de comptes entre des mafieux ou des gangs rivaux, suggéra l’un des pompiers. René s’efforçait de garder son calme malgré le fait qu’il ne pouvait qu’approuver l’hypothèse de son collègue. De nouveau, il observa l’allée du parc et s’aperçut que d’autres armes jonchaient le sol et que certains des corps étaient enchevêtrés comme si le feu les avait figés au cours de leur lutte. — Regarde, René ! lui lança Aline. Certains de ces cadavres avaient des casques et des tenues de combat. — Elle a raison ! renchérit l’un des pompiers. On dirait des gilets pare-balles ! — De toute évidence, cet incendie est criminel ! trancha le capitaine Grimaud. Inutile de se perdre en réflexions, nous devons continuer le travail. La gendarmerie est sûrement déjà en route, j’aimerais que l’un de vous les contacte par radio pour les prévenir qu’on se trouve sur une scène de crime. Aline, brusquement suffoquée par la multitude de cadavres noirâtres aux visages de cauchemar, se porta volontaire et s’élança en direction de l’entrée du parc. Elle n’entendit donc pas l’étrange gémissement que lança un blessé alors que les pompiers venaient de reprendre leur activité. Ce son bas et curieusement rauque attira aussitôt leur attention et ils se précipitèrent vers l’un des corps, étendu entre deux buissons de chêne kermès carbonisés. — Encore un mec vivant ? s’intrigua un pompier. Ça dépasse le miracle à ce stade ! — Il bouge ! — Incroyable ! — Aidez-moi à le sortir de là ! ordonna René. C’est sûrement son casque et son armure qui lui ont sauvé la mise. Avec d’infinies précautions, ils transportèrent le corps jusqu’à l’allée pour l’écarter et le préserver des flammes. Puis, l’un des soldats du feu releva lentement la visière du casque. 3 Remontant à toute vitesse l’allée en direction du camion, Aline s’efforçait de chasser de son esprit le spectacle de fin du monde auquel elle venait d’assister. Cet incendie, ce parc ravagé et, surtout, tous ces corps transformés en masses d’étoupe… Elle n’était pas prête pour ce genre de vision. Aucune personne douée de sentiments n’aurait pu l’être et aucune formation n’aurait pu la préparer à contenir ses émotions. Même ses collègues ayant des années d’expérience au compteur s’étaient décomposés devant ce cauchemar. Toute essoufflée, la jeune fille aperçut enfin les véhicules stationnant à l’entrée et remarqua du mouvement dans l’un des fourgons médicalisés. Sûrement celui où l’on avait emmené le blessé. Elle se précipita vers son collègue qui était penché sur la civière, lui tournant le dos. — Alors, comment est-ce qu’il s’en sort ? demanda-t-elle lorsqu’elle eut récupéré un peu d’air. Pas de réponse. Aline supposa que le soigneur était trop occupé pour lui faire un compte-rendu. Peut-être même ne l’avait-il pas entendue ? Sans prendre ombrage, elle se recentra sur sa mission et s’engouffra à l’avant du véhicule par la portière du côté passager. — Je t’emprunte ta radio. Il faut que je prévienne les gendarmes que ce n’est pas un simple incendie. Aline s’installa et décrocha le combiné. Le message parviendrait auparavant au centre de secours où un stationnaire le ferait suivre à la gendarmerie. Toutefois, à peine fut-elle installée qu’une main se referma sur son épaule et qu’elle sentit qu’on lui tirait douloureusement les cheveux. — Qu’est-ce qui se passe ? gémit-elle, pensant que son collègue réclamait un peu brutalement son aide. Lorsqu’elle tourna la tête, elle constata que ce n’était pas un pompier qui lui faisait face mais un visage noirâtre, partiellement décomposé dont les yeux semblaient encore contenir des flammes. Le supposé blessé venait de refermer ses dents sur une bonne partie des cheveux d’Aline ainsi que sur l’appui-tête de son siège, l’éventrant jusqu’à son rembourrage de mousse. — Lâche-moi ! hurla-t-elle de façon hystérique tandis que l’étreinte sur son épaule et sur ses cheveux se resserrait. Folle de terreur, Aline entendait juste contre ses oreilles les grognements et les cris du monstre, écœurant mélange de gargouillements et d’aboiements. Qu’est-ce que c’est qui se passe ? Qu’est-ce que c’est que cette chose ? Ses yeux rouges ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! LÂCHE-MOI ! Elle chercha des yeux une arme durant une fraction de seconde mais ne trouva rien de mieux que le combiné qu’elle serrait dans sa main droite. Avec toute la vivacité acquise dans ses entraînements réguliers, elle vint frapper à plusieurs reprises la hideuse apparition au visage avec l’objet. Coup sur le nez. Le front. La joue. Lambeaux de papyrus noirs. Puis, l’antenne vint directement se ficher dans l’un des yeux rougeâtres, lequel se perça de la même manière qu’un œuf mollet. Un liquide roux et brûlant se déversa sur la main d’Aline tandis que le monstre relâchait sa prise. Bondissant hors du fourgon, Aline se félicita d’avoir laissé la porte ouverte. Lorsqu’elle atterrit sur le gravier, elle contempla le véhicule tout en s’essuyant frénétiquement la main à son treillis. Son collègue pompier se trouvait toujours à l’intérieur, parfaitement immobile au niveau de la porte latérale. — Sors de là ! lui lança-t-elle. L’homme sembla bouger un instant mais ce n’était que sous l’impulsion de la créature qui essayait de sortir du véhicule. Le corps du pompier bascula en arrière et vint choir lourdement à terre. Son visage et son cou étaient barbouillés de sang frais, une large morsure avait réduit sa gorge en une indescriptible bouillie. Aline sentit un hurlement monter en elle et exploser depuis ses cordes vocales. Un cri de terreur aigu et désespéré, réaction épidermique et animale qui la soulagea presque avant que son esprit ne reprenne le dessus. — À l’aide ! s’écria-t-elle, désemparée en se précipitant vers son camarade prête à tout mettre en œuvre pour le secourir et conscient qu’elle ne pouvait sûrement plus rien pour lui au vu de sa blessure. On a un pompier à terre ! Son appel sembla se perdre dans les crépitements de l’incendie. Toutes les équipes s’occupaient de contenir les flammes loin de sa position, aucune aide à espérer pour le moment. Par ailleurs, Aline n’avait guère le temps de prodiguer des soins à son collègue car son agresseur occupait toujours le fourgon, prêt à lui tomber dessus pour la saigner à son tour. Heureusement pour elle, la chose monstrueuse qui venait de tenter de la mordre se trouvait partiellement empêtrée dans sa civière, les jambes immobilisées par la couverture que maintenait une sangle. La jeune volontaire eut la tentation de s’enfuir mais elle se ravisa en songeant que, tôt ou tard, la créature parviendrait à se rendre libre de ses mouvements. Sans écouter sa peur, elle bondit jusqu’à la porte latérale qu’elle referma aussitôt. Dans la foulée, elle fit claquer la portière avant par laquelle elle s’était jetée hors du véhicule. — Il ne peut plus sortir, tout va bien… murmura-t-elle sans toutefois retirer ses mains de la portière comme si elle craignait de la voir s’ouvrir vers elle et non plus glisser sur le côté. À l’intérieur, le monstre s’agitait tel un dément. Il martelait de coups désordonnés tout ce qui se trouvait à sa portée. Chocs métalliques. Pulsation chaotique dans l’incendie. — À l’aide ! s’égosilla la malheureuse Aline. Venez m’aider, s’il vous plait ! Seule face à cet être qui lui semblait venir tout droit de l’enfer, Aline aurait voulu pouvoir verrouiller le camion. Elle doutait que son unique passager soit en état de se servir d’une poignée de portière mais elle préférait s’assurer qu’il ne puisse pas en actionner une par hasard. Elle s’approcha donc du corps de son collègue qu’elle se mit à fouiller en prenant sur elle pour oublier qu’elle avait affaire à un mort. Quelques secondes plus tard, dans la poche du pantalon, ses doigts se refermèrent sur les clés. Elle actionna le verrouillage automatique et se détendit en entendant le véhicule réagir au doigt et à l’œil. Quel son magnifique lorsqu’il permet de sauver une vie ! Elle regarda à travers la vitre de la cabine la chose qui s’agitait à l’intérieur du camion, condamnée pour l’instant à hanter cet espace réduit. Ce fut seulement dans ce moment de repos où ses facultés intellectuelles n’étaient pas intégralement occupées à assurer sa survie qu’elle se permit de se poser quelques questions essentielles. Comment quelqu’un ayant subi de telles brûlures peut-il encore bouger à ce point ? Est-ce que ce serait une réaction désespérée pour survivre ? Pourquoi est-il aussi agressif dans ce cas ? Il a quand même tué un pompier, putain ! Et puis, il y a son regard ! Ses yeux n’étaient vraiment pas normaux ! Il lui apparut rapidement que rien ne semblait pouvoir expliquer l’état de démence sauvage et violente dans lequel se trouvait le mystérieux blessé du camion. La seule véritable conclusion qu’elle put tirer, c’est que l’incendie n’était plus leur principale préoccupation désormais. Elle hésita à lancer un autre appel en direction de ses collègues. — Tout le monde est trop loin… Je devrais aller les rejoindre et les prévenir… Cependant, elle obtint soudainement une réponse. Un bruit insolite. Un infâme gargouillement. Elle fit aussitôt volte-face et découvrit son collègue pompier en train de se relever, en dépit de sa plaie béante à la gorge. — Il est vivant ! s’exclama-t-elle en se précipitant vers lui. Ne bouge pas ! Tu vas aggraver ta blessure. Je vais te… Aline s’apprêtait à lui faire une compresse et à mettre en pratique tout ce qu’elle avait pu apprendre dans ses modules de secourisme mais sa voix se cassa brusquement. Le pompier venait de tourner ses yeux vers elle et de lui lancer un regard qu’elle reconnut instantanément. Un regard rouge ! — Non… balbutia-t-elle en contemplant le blessé se relever. Non… Aline demeura un instant paralysée, presque envoûtée par ce qui se produisait. Son collègue titubait mais parvint à se stabiliser. Une fois sur ses jambes, il la dévisagea un instant. Ce qu’elle put lire sur son visage lui donna aussitôt la nausée et elle détourna légèrement les yeux, juste assez pour ne pas avoir à fixer les pupilles rougeâtres qui la détaillaient. Juste assez pour ne pas le perdre de vue. — Je rêve… On dirait que la morsure l’a… l’a contaminé… Quelques films d’épouvante lui revinrent soudain à l’esprit ainsi qu’un mot. Simple et net. Zombie. Deux syllabes qui suffisaient à planter instantanément tout un contexte, tout un univers dont l’espoir ne faisait plus partie. — Ce n’est pas possible… Ça n’existe pas… Chancelant, couvert de sang, le pompier se mit à avancer vers elle. Ses bras tendus auraient pu passer pour une demande d’aide, un appel au secours mais la jeune femme ne s’y trompait pas. Elle était certaine que les mains qui s’agitaient à quelques mètres d’elle ne demandaient qu’à se refermer autour de son cou. Leurs doigts crispés l’attireraient ensuite jusqu’aux mâchoires barbouillées de sang et il n’aurait plus qu’à… — Jamais… chuchota-t-elle en sortant de sa torpeur et en se mettant à reculer. Sans quitter du regard ce qui avait été son collègue, elle gagna à reculons un des véhicules tout-terrain garés à proximité. Par chance, le coffre était resté grand ouvert et contenait une grande quantité d’équipement dont des bombonnes d’oxygène, quelques battes à feu, divers projecteurs et lampes-torches ainsi qu’un objet qu’elle attrapa aussitôt qu’elle l’aperçut. Une étrange forme de soulagement la gagna en même temps qu’elle refermait ses mains sur le manche d’une hache d’intervention. Elle se sentait mieux maintenant qu’elle possédait cet outil familier. Pourtant, jamais jusqu’alors elle ne l’avait envisagé comme arme d’auto-défense. — JAMAIS ! répéta-t-elle avec fermeté et colère en serrant farouchement sa trouvaille. Le cadavre avançait toujours vers elle, la fixant de son regard vide et pourpre. L’énergie qui l’animait était presque écœurante tant elle traduisait une insatiable faim et soif de chair et de sang humains. L’instinct d’Aline ne lui commandait plus de fuir, il exigeait d’elle qu’elle fasse disparaître par tous les moyens nécessaires l’abomination qui se dandinait grotesquement vers elle. Son arme comportait une double-tête, hache d’un côté et pic de l’autre, qui offrait de nombreuses possibilités. Elle n’aurait qu’un geste précis et nerveux à faire pour venir à bout de la chose. — Je ne peux pas… Aline ne se voyait pas balayer ainsi la vie de l’un de ses collègues. Certes, cela abrégerait peut-être ses souffrances – surtout les miennes – mais il y avait peut-être autre chose à tenter pour le sauver. Et, même si sa vie était perdue, il permettrait peut-être d’en apprendre plus sur le phénomène qui venait de le frapper. — Je dois prévenir René et les autres sans perdre une seconde ! Ils risquent de tomber sur d’autres blessés dans le même état ! Sa hache à la main, elle s’élança sur l’allée en direction de son équipe. Son poursuivant se mit à se traîner dans la même direction tout en continuant à pousser ses horribles gargouillements et à cracher des gerbes de sang. Il évoluait lentement mais quelque chose dans l’esprit d’Aline lui disait qu’il ne s’arrêterait pas. Qu’il ne s’arrêterait plus. 4 Jamais Aline n’aurait pensé qu’un problème tel que l’incendie qui ravageait le parc et une partie du massif puisse passer au second plan. Elle courait sur l’allée en songeant à ce qui allait se passer si ses collègues découvraient d’autres blessés dans le même état que celui-ci. Elle priait également pour qu’aucun membre des deux équipes qui contenaient l’incendie au niveau des enceintes n’ait la mauvaise idée de revenir à leur point de départ. Comme le pompier transformé se traînait derrière elle, personne ne risquait de tomber dessus mais il y avait toujours la possibilité pour qu’un collègue tente d’ouvrir le véhicule dans lequel était enfermé le zombie à moitié carbonisé en l’entendant tambouriner contre les parois. J’ai l’impression que l’incendie est en train de reprendre le dessus. La fumée est de plus en plus épaisse… Le vent a l’air de se lever de nouveau ! On n’est pas sortis de l’auberge… Toussant et crachant, luttant contre la fumée qui emplissait ses narines et lui piquait les yeux et la gorge, elle dut ralentir l’allure pour reprendre son souffle et s’assurer qu’elle allait bien dans la bonne direction. Tout à coup, des cris effrayés puis des hurlements terrorisés lui parvinrent. Des ombres approchaient à vive allure, toute une flopée de formes indistinctes parmi les volutes de fumée. Tout un groupe fonce sur moi ! songea-t-elle, apeurée et en levant sa hache. Aline fut soulagée lorsqu’elle entrevit à travers la purée de pois des uniformes noirs de pompiers, bien reconnaissables à leur bande rouge. Elle s’attendait pour de bon à voir jaillir du néant d’horribles marcheurs carbonisés. — Je suis là, les gars ! Ce ne furent que des coureurs éperdus qui passèrent à côté d’elle, la bousculant pour se ruer dans la direction opposée. Ils ne l’entendaient pas et ne semblaient même pas la voir tant ils étaient terrifiés. Leurs yeux exorbités et larmoyants parlaient pour eux. — Qu’est-ce qui se passe ? s’enquit-elle, craignant déjà la réponse. Sa question se perdit dans le bruit de la cavalcade. Tous ses collègues de travail, qu’ils soient de Carros ou d’une des autres casernes de la région avaient pris leurs jambes à leur cou. Aline se fit alors la remarque qu’ils allaient se jeter dans les bras du zombie qui la poursuivait. — N’allez pas par là ! C’est dangereux ! Ce fut alors qu’elle remarqua que René ne se trouvait pas parmi les fuyards. Lâchant sa hache pour ne blesser personne, elle bondit pour intercepter un de ceux qui fermaient la course, l’attrapa à bras-le-corps et parvint de justesse à bloquer sa course. Les bras autour de ses épaules, elle constata qu’elle venait d’arrêter un gars de chez eux, elle reconnaissait parfaitement le tatouage de dragon couleur d’émeraude sur sa nuque. — Cédric ! — Aline ? Lâche-moi, putain ! On va tous y passer ! — Qu’est-ce qui se passe ? Où est René ? — Il s’est fait avoir ! C’est l’enfer ! On ne peut plus rien pour lui ! Viens avec moi, on dégage d’ici ! Dans son désespoir, il déployait une telle énergie qu’Aline n’eut d’autre choix que de relâcher son étreinte. Aussitôt, Cédric disparut à toutes jambes dans la fumée sans se retourner. La jeune femme resta un instant statique, ne sachant si elle devait fuir ou partir à la recherche de son mentor. René s’est fait attaquer… Il est peut-être blessé ou mort. Est-ce que j’y vais ? Si jamais lui aussi se transforme en… Non ! Je ne peux pas le laisser seul là-bas ! Il y a peut-être encore un moyen de le sauver… Ramassant sa hache, elle s’élança dans le brouillard vers l’endroit où elle avait vu René en vie pour la dernière fois. Elle courait l’arme brandie, prête à l’abattre sur la première menace qui se présenterait. Une trentaine de mètres plus loin, des cris attirèrent son attention et elle redoubla son allure en espérant arriver à temps. Une bourrasque ardente leva momentanément le voile de fumée, révélant un coin de pinède bordé par l’allée. René était affalé, étendu sur le ventre partiellement hors de l’allée, gladiateur sans vie dans une arène cernée par les flammes. Un monstre fumant se trainait vers lui, masse charbonneuse et vaguement humanoïde. — René ! hurla Aline en accourant à son secours. Dans le cours normal de sa petite vie ordinaire, jamais elle n’aurait voulu ni même songé à fendre un crâne d’un coup de hache pour défendre quelqu’un. La violence l’écœurait et l’exaspérait au plus haut point, qu’elle soit dans un film, dans un jeu-vidéo ou même dans un cours d’Histoire. L’homme ayant toujours déployé plus d’inventivité pour tuer ou torturer ses semblables que pour les soigner ou leur venir en aide. Pourtant, son état d’esprit non-violent semblait être parti en vacances à moins qu’il ne se fût évaporé dans le brasier. Pour l’heure, la jeune volontaire était déterminée à éliminer le monstre qui pourchassait son capitaine car la simple existence de cette chose inhumaine mais toutefois enracinée sur un humain lui était insupportable. — Ne touche pas à René ! s’écria-t-elle en armant son coup. — Relax, fille ! lança une voix qu’elle connaissait bien. Le capitaine Grimaud venait de rouler sur le côté et Aline reconnut instinctivement ce qu’il tenait entre ses mains avant qu’elles ne semblent disparaître dans une puissante gerbe blanche. Un flot puissant, jailli des mains de René, vint balayer la monstruosité qui le dominait. Incrédule, Aline la regarda voltiger plusieurs mètres en arrière et achever sa course contre le tronc d’un pin. Quelques secondes lui furent nécessaires pour comprendre que son mentor n’était pas doté de pouvoirs magiques. — Tu… tu lui as mis un coup de jet d’eau ? — La pression de nos lances est suffisamment importante pour mettre quelqu’un hors d’état de nuire. Un doute affreux s’empara d’Aline. — René, tu n’es pas blessé ? Il n’a pas eu le temps de te... mordre ? Pitié ! Non ! Si jamais c’est le cas, je vais probablement devoir le neutraliser moi-même si jamais il se transforme. Merde ! Je n’en serai jamais capable, même s’il me le demande. — Non, il ne m’a rien fait, je suis bien trop coriace pour terminer en steak. Aide-moi à me relever, tu veux ? — Qu’est-ce qu’il s’est passé ? demanda-t-elle avec soulagement et en lui prêtant aussitôt main-forte. — Nous avons trouvé un autre blessé, dans un état affreux. Il grognait et semblait souffrir donc deux gars sont venus lui apporter des soins mais il les a repoussés avant de mordre l’un deux à la gorge. — Putain… — D’autres ont essayé de le neutraliser mais on avait affaire à un fou. — Ça craint ! Il faut vite qu’on se tire d’ici, René ! Sinon on est tous morts ! — Pourquoi ? Qu’est-ce qui se passe ? Avant qu’elle ait articulé le moindre mot, Aline remarqua que le zombie heurté par le jet d’eau se redressait déjà. René se frotta les yeux en observant la gigantesque poupée désarticulée et carbonisée. — Ne discute pas et suis-moi ! Je t’expliquerai en chemin ! Blême et incapable pour une fois de trouver ses mots, le capitaine se laissa entraîner le long de l’allée. Le monde venait de basculer dans la folie suprême mais sa jeune collègue gardait les pieds sur terre avec un aplomb déconcertant. Il ne put s’empêcher de ressentir une forme ténue d’admiration dans l’un des rares recoins de son esprit qui n’était pas occupé par la peur. De son côté, Aline ne pensait plus qu’à une chose : partir le plus vite et le plus loin possible. Ce n’est plus pour nous là… On n’est pas de taille… Il faut prévenir la gendarmerie ou n’importe qui avec une arme. En chemin, Aline regretta d’avoir abandonné la lance à incendie. À tout moment, elle s’attendait à voir une ombre carbonisée bondir sur eux depuis le décor étouffant et fantomatique. La hache ne suffirait pas s’ils tombaient nez-à-nez avec un groupe de ces choses. Tout pouvait se produire dans ce brasier qui ralentissait leur course. La fumée était telle qu’ils se seraient perdus sans la délimitation de l’allée pour les guider. Soudain, alors qu’ils se trouvaient à mi-chemin, ils purent entendre un son nouveau, fort et rassurant. Un véritable échantillon auditif d’espoir. — Des hélicoptères ! s’exclama René. — Tu crois ? — Sûr ! Ils sont au moins trois et, vu le raffut, je pense que ce sont des appareils militaires. — C’est génial ! La police ou les militaires ont dû repérer l’incendie. Si c’est bien eux, nous sommes tirés d’affaire ! — On ne les voit pas avec la fumée mais je crois qu’ils se dirigent vers la zone que nous avons sécurisée en arrivant. — Dépêchons-nous ! Il n’y a plus qu’eux qui pourront nous protéger avec ce qui se prépare… Ragaillardis par la perspective d’être sauvés, ils pressèrent leur allure, progressant aussi rapidement que le souffle âcre de l’incendie le leur permettait. Aline rappela à son mentor de rester prudent, deux monstres les attendaient encore auprès des véhicules. Pourvu que les collègues se tiennent à l’écart. Pourvu qu’ils n’aient pas ouvert le camion. 5 Le groupe des pompiers avait stoppé sa course auprès de leur base de fortune. Les soldats du feu venaient de découvrir leur camarade qui errait au milieu du chemin, grognant et gargouillant. Ils avaient tenté tant bien que mal de lui venir en aide et de l’entraîner vers les camions sans pouvoir maîtriser la fureur du dément. Déjà deux d’entre eux venaient d’être mordus et hurlaient de douleur et de terreur. Pétrifiés, les autres tentaient de contenir leur collègue, contemplant le triste spectacle de sa gorge ouverte comme une deuxième bouche sanguinolente et prête à vomir des flots d’hémoglobine. Aucun d’eux ne savait quoi faire face à une telle blessure. Bien entendu, chacun avait vu bien pire en matière de plaie et de coupure au cours de sa carrière mais, pourtant, aucun ne savait comment se comporter en pareille situation. Ce n’était pas la quantité de sang ou la profondeur de l’entaille qui les paralysait mais le fait que le blessé soit encore sur ses jambes. Leur cerveau ne parvenait pas à traiter ce problème surréel. Lorsqu’Aline et René émergèrent de la fumée et purent contempler le camp et les véhicules, ce fut pour découvrir que les pompiers encerclaient leur collègue transformé. Plusieurs corps gisaient à terre et Aline se doutait déjà de ce qui n’allait pas tarder à se produire. Sa hache à la main, elle s’élança vers eux, toujours suivie par René. — C’est pile ce que je craignais, ils se sont jetés directement dans la gueule du loup ! — Ecartez-vous tous de lui ! hurla René. Il est dangereux ! Cependant, la fin de sa phrase se perdit dans le vacarme infernal des rotors des hélicoptères qui évoluaient dans les nuées, quelque part au-dessus d’eux. Disposés en cercle autour de leur collègue ensanglanté, à la manière d’un groupe de badauds autour d’un cracheur de feu, les digues de leur raison sautaient les unes après les autres sous l’effet d’un monstrueux torrent de folie. Un grand costaud nommé Nicolas Goyet, surnommé le « Foyer » pour sa convivialité et son habitude de tuer les incendies dans l’œuf, se mit brusquement à sangloter d’une curieuse voix de fausset que nul ne lui connaissait. Juste à côté de lui, un vétéran du nom de Serge Diallo mouillait sans même s’en rendre compte son pantalon ce qui n’avait pas dû lui arriver depuis une bonne quarantaine d’années. Le sapeur Karim Arfa se mit tout à coup à rire bêtement, titubant presque, avec l’air de celui qui vient d’entendre la blague la plus hilarante du monde et ne parvient pas à s’en remettre. — Je lui avais toujours… balbutia-t-il entre deux éclats de rire. — Qu’est-ce qu’il y a ? le pressa Sandra Lin, luttant avec peine pour conserver sa santé mentale. C’était une jeune femme aux traits asiatiques très fins et au teint de porcelaine. Si ses cheveux n’avaient pas été taillés si court, à la tondeuse, ils auraient dévoilé une noirceur douce et éclatante. Son profil correspondait à celui qu’aurait Aline après quelques années de service au sein de la brigade : dynamique, volontaire, engagée et respectée de tous. — Karim ! reprit-elle. Qu’est-ce que tu racontes ? — Toujours dit qu’il avait une grande gueule et qu’il l’ouvrait trop ! s’esclaffa le pompier. Voilà qu’il lui en pousse une deuxième ! Atterrée, Sandra ne put s’empêcher de poser ses yeux droits dans ceux de Karim et elle fut terrifiée d’y voir disparaître la petite once de raison qui y demeurait encore. Envolée comme un flocon planant au-dessus d’un feu de camp. Volatilisée comme la flamme d’une bougie par une bourrasque nocturne. — Karim, reprends-toi ! commanda Sandra avant de tenter une dernière manœuvre. Caporal Arfa ! Caporal Arfa ! C’est votre sergent qui vous parle ! — Zarma ! s’exclama son collègue, toujours plié en deux de rire. L’autre bavard de Riton peut plus se servir de sa bouche et il lui en pousse une deuxième, comme par hasard ! — Oh merde… merde… Au beau milieu du cercle de pompiers anesthésiés voire possédés par la peur, ce qui restait de leur collègue Riton se dandinait et tentait d’attraper des proies qui parvenaient tout juste à reculer de quelques centimètres pour éviter de tomber entre ses griffes. Connu des registres et de l’état civil comme le médecin lieutenant des pompiers de Nice Henri Benedetto, il semblait désireux de prendre soin du prochain patient qui se présenterait à lui. Dépassée par la folie qu’elle lisait dans les yeux rouges de la créature autant que dans les regards traumatisés de ses camarades, Sandra Lin s’effondra. Si la raison ne l’avait pas quittée, sa conscience, elle, refusait d’aller plus loin. Ravie d’avoir fait ce bout de chemin avec toi Sandra ! Merci pour cette promenade champêtre et chaleureuse ! J’ai besoin d’une petite pause, tu permets ? Pipi, bol d’air, casse-croûte… La totale, quoi ! Recharger ses batteries, c’est idéal pour bien repartir. J’espère être revenue d’ici un bon quart d’heure, ça ira ? Rien n’irait plus pour Sandra désormais, sa conscience n’aurait pas l’occasion de mettre fin à sa grève imprévue. Riton le rouge fondait déjà sur elle, prêt à la dépecer. — Arrête ! hurla Aline en décochant un fulgurant coup de pied dans le menton de son collègue mort-vivant qui se rapprochait dangereusement de Sandra. Le monstre recula dans une sorte de pantomime bizarre, sa tête s’agitant furieusement d’avant en arrière. Ce mouvement saccadé rappela à la jeune femme celui de ces chiens automates que l’on place à l’arrière des voitures et qui remuent la tête au gré des mouvements du véhicule. Ici, les soubresauts de cette tête s’amplifiaient à chaque passage, tandis que s’élargissait l’affreuse plaie dans la gorge du pompier. C’est l’enfer ! songea Aline. C’est un cauchemar à se vomir dessus depuis qu’on est arrivés ici mais, là, ça repousse les limites de l’horreur. Il faut en finir ! — Écartez-vous ! ordonna-t-elle en élevant sa hache. Je vais faire ce qu’il faut pour… Un coup de tonnerre retentit et le pompier se volatilisa. Aline demeura immobile, la hache levée prête à frapper, cherchant à le repérer dans son champ de vision. Ses yeux repérèrent enfin au sol tout ce qui restait de Riton : des jambes et une moitié de tronc baignant dans une flaque de sang. Elle ne put s’empêcher de penser un bref instant que le macabre et terrifiant spectacle avait provoqué une forme de colère divine avant de comprendre. On… On lui a tiré dessus ! — Regarde ça, Aline ! s’écria René en pointant un index tremblant vers le ciel. Une forme massive s’extrayait peu à peu des nuages de fumée et descendait vers eux. Un souffle extraordinaire balayait le brouillard étouffant et trois puissants faisceaux lumineux ramenaient la lumière sur l’entrée du parc. De gigantesques hélicoptères militaires qu’Aline et René avaient entendus faisaient leur apparition et leurs rotors brassaient l’air. L’hélicoptère le plus massif continua sa descente, s’apprêtant à atterrir, tandis que les deux autres gravitaient de part et d’autres de la zone, silhouettes fantomatiques dans le ciel couvert. — Voilà les appareils qui faisaient tout ce bruit tout à l’heure ! — Tu réalises ce que ça veut dire, Aline ? — Oui ! Nous sommes sauvés ! Un sourire se dessina sur les lèvres de la jeune femme. Le premier depuis qu’ils combattaient cet incendie infernal où erraient ces créatures innommables, autrefois des hommes et à présent d’horribles dévoreurs de chair humaine. Une plus grande expérience aurait appris à Aline à se méfier des soulagements et des joies trop subits. Les émotions fortes qui nous tombent dessus peuvent s’éloigner avec la même rapidité, parfois en cédant la place à des sentiments contraires. La terreur peut laisser la place à l’extase avant de revenir au grand galop nous frapper en traître. La jeune femme savait pourtant que les violents incendies et les montées de chaleur qui les accompagnent déclenchent des orages dévastateurs. Ce qui vient du ciel dans un moment pareil est rarement bon pour ceux qui se trouvent en-dessous. Des engins militaires… L’armée a dû envoyer une équipe pour observer ce qui se passait dans la montagne. À moins qu’il ne s’agisse d’une patrouille qui passait ici par hasard… Le plus massif des appareils se mit à descendre en direction du dernier héliport intact situé à l’entrée du parc. Les deux autres demeurèrent immobiles quelques secondes avant de se séparer chacun de son côté, souhaitant sûrement couvrir l’ensemble de la propriété. — Je n’avais encore jamais vu d’hélico aussi grand ! s’exclama René. — Moi non plus. Ils doivent être un paquet là-dedans… — Tant mieux ! Tous deux allèrent se placer non loin de leur camion, prêts à reprendre la lutte contre l’incendie dès que les renforts auraient sécurisé le parc. Aussitôt après l’atterrissage de l’hélicoptère, la porte latérale s’ouvrit et une quinzaine de silhouettes sombres en jaillirent et se déployèrent en cercle tout en braquant leurs armes dans chaque direction. Aline regarda sans mot dire l’évolution de cette troupe vêtue de casques, de gilets pare-balles et armée jusqu’aux dents. Un autre homme sortit à son tour de l’appareil et elle comprit instantanément qu’il devait s’agir du chef. Tout d’abord, il portait une tenue similaire avec quelques différences qui indiquaient vraisemblablement un grade supérieur. D’autre part, il était tête nue et le visage qu’aperçut Aline la conforta aussitôt dans l’idée que non seulement cet homme commandait mais qu’il le faisait avec une rigueur sans faille et depuis des années déjà. L’individu avait un de ces visages sans âge qui peut aussi bien convenir à un homme de trente ans aux traits tirés et taillés à la serpe qu’à un quinquagénaire en parfaites santé et condition physique. Son crâne à peine dégarni au niveau des tempes et ses cheveux intégralement blancs et taillés en brosse lui conféraient l’allure d’un vétéran aguerri. Escorté par ses hommes, il se mit à s’avancer à grands pas et d’une démarche toute militaire vers le groupe de pompiers. Ces derniers, médusés, oscillant entre l’espoir et l’incrédulité, le regardaient approcher sans esquisser un signe. Aline crut d’abord qu’il tenait une canne, un sceptre ou une sorte de bâton de commandement avant d’identifier un fusil de précision surmonté d’une lunette tactique. C’était donc lui qui avait appuyé sur la gâchette et neutralisé son collègue Riton avant qu’elle ne le fasse d’un coup de hache. Il ne paraissait nullement ému par son geste, nul doute qu’il en avait vu d’autres. Elle constata que lui aussi portait à la ceinture une arme de poing dans un holster et qu’un fusil mitrailleur fixé par une bandoulière se trouvait dans son dos. Lorsqu’il se fut suffisamment rapproché, Aline put distinguer clairement ses traits et… Son regard n’est pas commun, j’ai dû mal à le soutenir. Il a un air blasé et presque fatigué mais ses yeux sont extrêmement perçants. C’est un curieux mélange, on croirait qu’il est en train de dormir mais qu’il voit tout. J’ai l’impression d’être toute petite et complètement à sa merci. On dirait qu’il a énormément d’expérience mais je ne sais pas si on peut lui faire confiance. Le nouveau venu et ses hommes s’arrêtèrent à deux pas du groupe de pompiers et les observèrent un moment comme s’ils cherchaient à les jauger ou à comprendre quelle peuplade étrange leur faisait face. La raison des soldats du feu avait basculé pour la plupart d’entre eux et ils n’étaient plus que l’ombre d’eux-mêmes. Leurs yeux désespérés se braquaient sur les arrivants. Chacun de leurs regards laissait transparaître tous les efforts de leur esprit pour les informer que le monde fonctionnait de nouveau comme avant, que les morts ne se remettaient pas à marcher pour les dévorer et que la main qui allait se tendre vers eux serait celle d’amis venus à leur rescousse. — Bonjour, mesdames et messieurs ! déclara finalement le militaire d’une voix grave et posée. Vous n’avez plus à vous en faire, nous allons prendre la situation en main. — Merci d’être là… murmura faiblement l’un des pompiers. — C’est notre devoir et notre mission. Dites-moi, combien de ces choses avez-vous rencontrées ? Toujours appuyé contre le camion, René prit la parole. — Nous avons rencontré deux de ces créatures. La première a été prise pour une personne blessée et conduite jusqu’à un de nos véhicules où elle a attaqué un de nos hommes. La seconde se trouve toujours au bout de l’allée, nous l’avons repoussée grâce au jet d’une lance à incendie. En-dehors des pompiers touchés, il y en a certainement d’autres ailleurs dans le parc si l’incendie ne les a pas tuées. L’homme fixa un instant René avec un visage sans émotion. Peut-être était-il surpris par la précision de ce compte-rendu. Si tel était le cas, il n’en laissait strictement rien paraître. — Merci, Monsieur ! finit-il par répondre avant de se tourner vers ses hommes en les balayant du regard. Vous allez neutraliser les pompiers qui ont été mordus puis vous disperser en remontant l’allée centrale et en sécurisant chaque embranchement par groupe de deux. N’oubliez pas que ces créatures sont mortes et qu’il ne doit en rester aucune. Tirez à vue ! — Il y a des collègues près des murs d’enceinte, fit remarquer René — Combien sont-ils, Monsieur ? — Deux groupes de quatre hommes avec chacun un camion équipé d’une citerne. Sans compter les quelques gars qui allument des coupe-feux à l’extérieur de la propriété. — Nos deux autres hélicoptères couvrent la zone, il n’y aura pas de problème. Nous allons demander à vos équipes de stopper leur progression et d’éteindre l’incendie à proximité pendant que nous sécurisons le reste du parc. Le commandant se mit à suivre ses hommes mais René le retint. — Excusez-moi, j’ai autre chose à vous dire. — C’est bon, Monsieur, je n’ai plus de questions et je dois... — Si vous le permettez, j’en aurais deux autres. Aline regarda avec stupéfaction René qui venait de s’avancer de quelques pas et toisait l’homme sans ciller. Qu’est-ce que tu fous, René ? Pourquoi tu t’adresses à lui ? Ce n’est pas notre rôle de poser des questions à ce gars et il doit encore s’occuper de sécuriser le reste de la propriété. Le militaire ne se troubla pas et, sans bouger ni ciller d’un pouce, fixa René avec un petit sourire dont nul n’aurait su dire s’il était aimable ou méprisant. — Je vous écoute, Monsieur. — Première question : qu’est-ce qui se passe ici avec ces morts qui se remettent à marcher ? — Je n’ai ni les compétences ni les autorisations pour vous répondre sur ce point, Monsieur. — Très bien… Alors, je passe à ma seconde question qui relève directement de vos compétences vu l’arme que vous tenez. — Dites-moi… — Avec toute cette fumée, comment est-ce que vous avez bien pu savoir sur qui ou plutôt sur quoi vous tiriez tout à l’heure ? Aline écarquilla les yeux dès que René eut fini de parler, réalisant ce qui aurait pu se produire. Son imagination fit le travail pour elle et substitua son propre corps à ce qu’il restait du malheureux Riton. Elle se vit, étendue dans une bouillie rouge-rousse, le buste et la tête en moins. J’aurais pu me prendre cette balle ? Est-ce que ce gars a vraiment tiré au hasard ? Ne me dis pas que j’avais une chance sur deux de crever ! — Rassurez-vous, Monsieur. Nos yeux ne pouvaient évidemment pas percer cette fumée mais ce n’est pas le cas de la lunette de nos fusils de précision. Elle est équipée d’une vision thermique qui capte les ondes infrarouges dégagées par les cibles. Si nous avons parfaitement identifié sur qui tirer tout à l’heure, c’est parce que les transformés marchent de façon chaotique et dégagent une signature thermique bien particulière, comme si leur cerveau tout entier bouillonnait. Nous n’avons eu qu’à tirer sur le point rouge vif correspondant à la tête. Nous ne confondons pas nos cibles et nous ne les ratons jamais. — Vous êtes au courant de beaucoup de choses… Qui êtes… Sa question se noya dans une série de bips stridents qui provenaient du combiné de radio à l’allure de talkie-walkie que l’homme portait à la ceinture. — Je vous prie de m’excuser, Monsieur, l’interrompit-t-il en décrochant. René se recula et revint près d’Aline. Remarquant son trouble, il lui tapota gentiment la joue en lui adressant un sourire rassurant. Elle leva vers lui des yeux humides, trouva la force de lui rendre son sourire puis remarqua à quel point le visage de son mentor était couvert de sueur. Elle mesura le courage qu’il lui avait fallu pour interpeller ainsi le leader d’une telle force armée. De son côté, le fusil posé sur son épaule, l’homme à la coupe en brosse conversait tout en marchant à la suite de la troupe qu’il commandait. — Affirmatif, nous sommes sur place ! reporta-t-il à son interlocuteur. L’incendie a cramé pas mal d’hectares du parc… La baraque m’avait l’air d’être en miettes… Oui, il y a quelques contaminés dans les parages mais on va les neutraliser vite fait bien fait… L’incendie ? Il n’est pas gênant, les Canadairs le bombardent et les pompiers s’occupent du feu… Quoi ?... Oui, ils sont arrivés avant nous… Comment ? Très bien ! Si c’est ce que vous voulez… Je vous laisse et je coordonne tout ça pour régler le problème… L’homme mit fin à la conversation puis bascula son appareil sur une autre fréquence avant de reprendre la parole : — Aigle noir à Faucons 1 et 2 ! Aigle noir à Faucons 1 et 2 ! Les paramètres de la mission ont changé. On nettoie absolument tout ! L’air serein et doux, il raccrocha calmement sa radio et se tourna vers les pompiers. Aline sentit René se crisper à ses côtés. — Mesdames, Messieurs ! les apostropha l’homme en noir en s’avançant en direction du cercle de véhicules. Les quelques pompiers qui étaient encore capables de tourner la tête le regardèrent tandis que la majeure partie du groupe demeurait dans le même état d’hébétude que tantôt. — Je suis désolé de vous déranger mais je vais encore avoir besoin de vous et de vous tous. Dès à présent, bien que j’en sois navré, vous faites partie de mes cibles ! L’homme laissa tomber son fusil de sniper et, d’un brusque mouvement de hanches, se retrouva avec son autre arme entre les mains. Le fusil au large calibre se mit à aboyer et les pompiers à tomber comme des mouches. L’homme arrosa rapidement le groupe des pompiers situé au centre du cercle de véhicules avant de tourner son tir en direction de René et d’Aline. Celle-ci essaya de crier mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ce fut tout juste si elle vit René s’élancer, plonger et s’abattre sur elle. Tous deux basculèrent jusqu’au sol tandis qu’il l’enlaçait. Elle sentit le corps de son mentor s’agiter de soubresauts en même temps qu’elle l’entendit pousser un cri de douleur et de rage. L’homme en noir, le fusil à la main, contempla un instant son œuvre : corps enchevêtrés et criblés de balles, éclaboussures de sang et impact de balles… — Et voilà… Plus de témoins et un feu qui continue à cramer toutes les preuves. Je ne laisserai personne dire que les Chromatic Crews ont échoué dans leur mission. Maintenant que la Section Noire est là, nous allons ramener de l’ordre dans tout ce merdier. Il prit le temps de contempler le brasier tandis que ses hommes parcouraient le parc. Le vent apportait l’écho des tirs et des rafales. Un sourire satisfait glissa sur ses lèvres, rictus typique des êtres satisfaits devant le travail bien fait. Son regard sans émotion glissa vers le sol et il observa le minuscule ruisseau de sang qui s’était étiré jusqu’à ses bottes noires comme une ultime et muette supplication de ses victimes. Ses yeux remontrèrent jusqu’à la large flaque de sang dans laquelle reposaient la plupart des corps. Les lueurs des flammes y faisaient danser toute une palette de couleurs pourpres. Rouge carmin, écarlate ou bien cerise ; rouge garance ponceau ou vermillon… Le meurtrier se laissa absorber par le spectacle avant que la lueur d’un éclair distordu ne zèbre le ciel et n’annihile une fraction de seconde l’ensemble des nuances. — Un orage à présent… C’est gai…
95
Résumé : Sébastien Braqui est soldat. Sa mission : assurer les convois logistiques. Au volant de son camion, il assiste aux mutations d'un pays et de sa guerre. Homme brisé par les horreurs vécues, il devra subir le rejet de ses compatriotes lorsque sonnera l'heure de la défaite.
C'est sa descente aux enfers et celle de sa famille que décide de raconter un reporter de guerre devenu son frère d'âme après les tragédies traversées « là-bas ».
Un thriller psychologique dur et bouleversant sur les traumatismes des soldats et les sacrifices de leurs familles, les grandes oubliées de la guerre.
« Toutes les morts ne pèsent pas de la même manière sur une conscience. ». Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance, et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman À la quatrième fort énigmatique. Pour avoir déjà lu des ouvrages de cette auteure, pour les plus curieux mes chroniques ici : La Peine du bourreau Les eaux noires Digital Way of Life J’étais curieuse de voir ce que Estelle allait nous proposer avec ce nouvel opus, et je dois dire qu’une nouvelle fois, je n’ai pas été déçue. Nouvel univers, nouveau challenge, et pas des moindres vu le contexte de ce roman. C’est l’histoire d'un soldat racontée par son frère d'armes, reporter de guerre. C'est une histoire bouleversante et tragique à laquelle on ne s’attend pas. Une histoire dont on ressort secoué, ébranlé, dont on se souviendra longtemps, celle de Sébastien Braqui, militaire qui assure les convois logistiques dans un pays dévasté par la guerre. Celle d’un homme broyé par les horreurs qu'il a vécues, celle d’un homme rejeté, bafoué, incompris, autant par la distance des êtres chers, l’absence de communication familiale , que par sa seconde famille, l'armée qui le laisse tomber, lui et ses camarades, alors qu'ils se sont sacrifiés corps et âmes pour cette cause. Alors, comment vivre, ou plutôt survivre après avoir côtoyé d’effroyables horreurs ? Comment digérer ce rejet, cette mise à l’écart, ce manque de reconnaissance, en étant considéré comme un paria sans pensions et reconversions ? Comment ne pas partir à la dérive, se reconstruire avec tant de plaies béantes à cicatriser ? Les premières pages à peine avalées, nous voici plongés, happés, enferrés au cœur d’un récit glaçant, éprouvant, sans concessions aucunes, mené à la façon d’un documentaire qui nous emmène dans l'horreur de la guerre et ses conséquences dévastatrices pour un soldat revenu du chanp de bataille et par ricochet sur sa famille. C’est en alternant habilement entre sa vie privée et celle passée avec ses camarades de régiment tantôt en France, tantôt sur le terrain, que nous allons découvrir sa vie, son passé, ses blessures. De l’immense fierté d’avoir défendu son pays, ses sentiments vont peu à peu se muer en doutes, puis en regrets, colère, pour se transformer progressivement en rancœurs et envie de vengeance envers ceux qui l'ont envoyé au casse-pipe ou qui n'ont pas hésité à l’humilier. Retranché dans un petit appartement miteux, Sébastien va se renfermer sur lui-même, laisser filer les jours, s’éloigner insidieusement de tous, sans chercher à communiquer, même avec son ex-femme et sa fille qu’il aime pourtant par-dessus tout. Il ne dort plus, rumine et ressasse, et se réfugie auprès de sa seule alliée, la boisson, qui muselle tant bien que mal ses démons, le projetant néanmoins dans une spirale infernale des plus inquiétantes. Grâce a une écriture toujours aussi immersive et percutante, incisive et visuelle, l’auteure réussit à nous prendre par la main, à nous faire ressentir de l’empathie pour son personnage aux prises avec ce vortex qui semble se rapprocher irrémédiablement. Impuissants et démunis, nous prenons conscience au fil des pages de la profondeur de ses souffrances, de ce qui le gangrène peu à peu de l’intérieur, et nous assistons horrifiés, au basculement inéluctable qui est en train de s’opérer. Que va-t-il se passer ? Sébastien va-t-il réussir à remonter la pente ? Ses camarades militaires qui ont vécu la même ignominie, qui sont passé par cet enfer, vont-ils réussir à le soutenir ? Sébastien va-t-il retrouver une vie normale, et finir par oublier ? Va-t-il s’appuyer sur l'amitié et la force qui les unissent pour entrevoir le bout du tunnel, ou, est-il déjà trop tard ? Vous le saurez en découvrant ce thriller dur et implacable qui raconte avec brio ce que nos soldats doivent affronter lorsqu'ils partent en mission, mais aussi du parcours du combattant rencontré lors de leur retour à la vie civile. Il parle également des difficultés vécues par les conjoints, de la vie qui doit s’organiser en fonction de l'Armée, mais aussi des non-dits, de la souffrance à être exclus de ce que ressent et doit endurer l'être aimé. Vous l’aurez compris, j’ai beaucoup aimé cet ouvrage qui sort des sentiers battus. Pourtant peu adepte des ouvrages traitant de guerre, celui-ci a fait exception, puisqu’il a su éclairer sous un angle différent le quotidien méconnu d’hommes héroïques revenus brisés après un aller retour pour l’enfer. Alors si vous aimez les romans profonds, de ceux qui ont l’étoffe de vous emmener au cœur de la psyché humaine, qui savent vous remuer les tripes et vous laisser exsangue une fois la dernière page avalée, foncez, vous ne serez pas déçus du voyage  Attention, âmes sensibles s’abstenir  ? scènes difficiles ^^ Ma note :       Pour vous le procurer Pour vous le procurer : Éditions Taurnada Amazon Réseaux sociaux : Twitter Facebook
96
« Dernier message par Apogon le jeu. 24/11/2022 à 17:29 »
La douceur du piment rouge de Laurie Heyme Pour l'acheter : Amazon Librinova Prologue Lorène Quelque part dans le sud de l’Italie
« Je me rappellerai toute ma vie de ce coup de fil ce matin-là. C’était un jour de juillet, chaud, ensoleillé, prometteur.
Je me revois déposer ma brindille à l’école, l’année scolaire allait toucher à sa fin d’ici quelques jours. Je venais de rentrer d’un séjour de trois mois en Norvège pour ma dernière exposition et Ellyn se faisait une joie que je l’emmène.
J’entends encore le babillage de tous ces enfants franchir le portail et s’élancer dans la cour, heureux de retrouver leurs camarades. Je me souviens du va-et-vient de ces parents, venus déposer leur progéniture avant d’aller au travail. Je perçois toujours les sons, les odeurs, la chaleur du soleil sur ma peau, le chant des oiseaux et la légèreté des vêtements que je portais en cette matinée d’été.
C’est fou comme un souvenir n’est parfois pas qu’une simple image. Il peut se composer de tant d’autres choses, de tant de sensations. Des éléments qui séparément, feront leur réapparition plus tard tout au long de votre vie, et qui lorsque vous les apercevrez, vous ramèneront toujours à cet instant-là, celui où tout a basculé.
Je me remémore la sonnerie du téléphone, coincé au fond du sac à main, et ce soupçon d’étonnement en voyant ton prénom s’afficher. Nous avions pour habitude de nous écrire des lettres régulièrement, puis à l’ère moderne, des mails et beaucoup de SMS. En revanche, nous nous appelions uniquement en cas d’évènements importants. Je devais venir quelques semaines plus tard pour les vacances. Tu souhaitais sans doute évoquer le programme des réjouissances.
J’ai décroché sans m’inquiéter, sans penser une seconde à ce que tu allais m’annoncer. C’est ce genre de moment, celui qui précède l’apocalypse dans une vie. L’instant d’avant, tu es heureuse, uniquement préoccupée par des broutilles, disputant ta fille sur le chemin de l’école parce qu’elle ne marche pas assez vite. L’instant d’après, tu t’effondres, parce que la vie est une vraie salope parfois et que c’est ton amie qu’elle a choisie pour exercer son rôle le plus sadique. Entre ces deux moments, quelques millièmes de secondes, un flottement, une bulle de tranquillité sur le point d’exploser.
On ne mesure pas la chance qu’on a. On ne mesure pas que tout peut basculer soudainement et qu’on ne maîtrise rien. On croit qu’on maîtrise, ça nous rassure, même si on se leurre profondément.
Lorsqu’il nous arrive des drames, on en prend conscience quelques jours et puis vite, notre vie se remet au galop et nos vieilles habitudes reprennent le dessus, comme pour mieux guérir, enfouir, oublier.
Et maintenant que tu viens de partir, je revis cette scène dans ma tête comme si c’était hier. Pourtant, quatre années se sont écoulées.
Ma vie ne s’est pas encore remise au galop, je n’y arrive pas. Mon cheval est couché sur le flanc et refuse de se relever. Il paraît que justement, ce n’est pas bon signe un cheval allongé, c’est même inquiétant. Ces jours-ci, je dors debout la plupart du temps comme eux, je suis un zombie. C’est pour ça que j’ai prétexté cette nouvelle mission à l’autre bout du monde, parce que je ne suis pas capable de m’occuper d’Ellyn. J’ai déniché cette porte dérobée et j’ai menti, ce n’est pas la première fois de toute façon. Il faut que je trouve d’urgence un moyen de me remettre en selle, et c’est pour ça que je suis là. »
Lorène soupire et referme le carnet sur cette première page. Elle n’a pas réussi à sortir quoi que ce soit depuis son départ de Paris, il y a trois semaines. Les premiers mots sont difficiles. Comme une sauce trop épicée, ils écorchent sa gorge, ils lui picotent le nez. Comme un piment italien avalé tout rond.
Elle sait qu’elle doit se laisser du temps mais ce besoin pressant d’évacuer subsiste. Elle a surtout peur d’oublier les émotions brutes qui l’habitent et qui, retranscrites sur le papier, n’en seront que plus réelles. Elle a gardé ça enfoui bien trop longtemps, le traînant comme un gros fardeau et il faut s’en délester petit à petit. Le chagrin est trop lourd à porter.
Lorène lui a promis d’écrire son histoire. Des jours qu’elle est sur la route, qu’elle a fui tout ça. Mais ça la rattrape toujours, alors elle n’a pas le choix. Aujourd’hui, elle s’est arrêtée dans cette petite boutique de bord de mer qu’elle avait repérée. Le genre de caverne d’Ali Baba qu’elle affectionne avec des papiers de couleurs de partout, des gommettes, des stickers, des pinceaux, des feutres et des cahiers de notes.
Lorsqu’elle a poussé la porte, une clochette a accompagné son arrivée. Elle a cherché, arpenté, farfouillé et finit par trouver l’objet de sa convoitise. Elle a alors demandé, dans un italien approximatif, un renseignement à la vendeuse plongée dans ses cartons de livraison.
— Ciao, scusami*, dit Lorène en souriant.
— Oui bonjour ! Je peux vous aider ? répond la jeune femme avec un ton jovial.
— Ah ! Vous parlez français, mon accent est donc si mauvais ?!
— Non, ne vous inquiétez pas ! Mais le village est petit, mon petit doigt me dit que vous n’êtes pas d’ici !
— Oui votre petit doigt a raison ! Auriez-vous d’autres quantités pour ce carnet ? Il m’en faudrait plusieurs identiques et je n’en vois plus qu’un en rayon.
— Je vais vérifier en réserve, j’arrive tout de suite.
La jeune femme est revenue quelques instants plus tard, avec cinq exemplaires dans les bras. Lorène les a tous achetés, ainsi que plusieurs stylos-feutres noir, se disant que ça devrait être suffisant.
C’est avec un sac en kraft remplis de carnets dorés ornés d’un immense piment rouge, porte-bonheur chez les Italiens, qu’elle est repartie.
Elle est prête. Il faut juste rassembler les idées, les dates, les évènements, pour raconter.
Raconter l’horreur, la tristesse, le désespoir.
Raconter le courage, l’espoir, la joie. Raconter Giulia.*Excusez-moi.Avant Chapitre 1 Lorène, 1997 « Le cœur humain ne peut contenir qu’une certaine quantité de désespoir. Quand l’éponge est imbibée, la mer peut passer dessus sans y faire entrer une larme de plus. » (Victor Hugo).J’enfile une robe noire pour la première fois, l’occasion ne s’est jamais présentée auparavant. Sa matière soyeuse lui confère un bruit particulier quand je l’enfile par la tête et qu’elle se pose délicatement sur mes épaules. J’ai pris la première qui passait dans ce magasin du centre-ville. Le visage attristé de la gérante m’a tellement gênée lorsque je suis entrée, que je n’ai pas traîné. Elle avait dû voir l’article paru dans le journal local avant-hier. J’ai acheté le modèle qu’elle m’a proposé, sans même chercher à l’essayer. J’ai payé et je suis partie sans demander mon reste. Toutes les personnes que je croise ces derniers jours affichent ce masque, celui de la compassion, teintée d’un soupçon de pitié. Des murmures accompagnent mes rares sorties avec pour seule question : que vais-je devenir ? Je me retourne face au miroir sur pied disposé près de la fenêtre de ma chambre et tente de mettre des mots sur le masque que je porte, mais je ne trouve aucun adjectif qui puisse le qualifier. Je ne vois qu’un manque cruel d’expression, des sentiments anesthésiés. Je décide d’attacher mes longs cheveux en un chignon négligé, après les avoir longuement brossés. Mon visage n’en sera que plus dégagé, visible aux yeux de tous. Ainsi, ils pourront mieux me scruter et tenter d’analyser chaque petit mouvement de cil, chaque clignement d’œil, chaque tressaillement de bouche. J’enfile des ballerines pour accompagner cette robe austère que je ne remettrai sans doute jamais. Je souffle un grand coup, il est l’heure d’y aller. J’ai le cœur qui bat plus vite que jamais. Il va falloir se donner une contenance, quelle qu’elle soit. À pas feutrés, je sors de ma chambre et me glisse en haut des escaliers. Mes chaussures s’enfoncent sans un bruit dans la moquette beige. C’est là que je retrouve à nouveau ces murmures qui me sont devenus si familiers ces dernières heures. Ce sont ceux des grandes sœurs de ma mère, visiblement inquiètes de mon sort. Je les devine installées dans le salon de la maison familiale et décide de m’asseoir sur la dernière marche pour mieux les écouter. — Je suis désolée Suzie, je ne peux pas la prendre avec moi, je vis trop loin d’ici et la déraciner serait une mauvaise idée. Il va falloir qu’elle s’appuie sur les quelques repères qu’il lui reste pour survivre après ça. — Je sais, Madeline, je sais… Il paraît logique que la tâche me revienne… Foutue vie de merde. Il n’y a même pas de testament, on va devoir improviser… — Ils avaient encore toute la vie devant eux… Personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer… — Je sais, c’est terrible… Je vais m’occuper d’elle, c’est mon devoir de le faire. Ces bruissements, toujours les mêmes, sans cesse. Ce flot continu de questions. Cet énorme point d’interrogation qui flotte au-dessus de ma tête. Que peut devenir une jeune fille de 16 ans dont les parents viennent de mourir tragiquement dans un accident de la route ? *** Entourée de mes tantes, je grimpe dans la voiture, mon oncle est au volant. Chacune m’entoure, m’enlace, m’enserre, espérant m’apporter un réconfort certain, réconfort dont je n’ai pas besoin. Le sentiment que mon existence commence vraiment maintenant s’impose à moi sur le chemin qui nous mène à l’église. Je vois défiler ces maisons que je connais depuis toute petite, ces chemins de campagne pour me rendre au collège, ce pont, ces drapeaux, ce ruisseau. Je me revois gambader seule en rentrant de l’école primaire, haute comme trois pommes. Je n’étais pas prévue dans les projets de mes parents. Leur vie de bohème les amenait à être très souvent absents de la maison. Ils m’ont eue par surprise, sans véritable envie de devenir parents. Ils ont fait avec, se disant sans doute que ça ferait bien aux yeux de la société. Malgré mon arrivée, ils n’ont rien changé à leur façon de vivre. Ça a été à moi de m’adapter, de grandir un peu plus vite que prévu, d’être autonome. J’étais un bébé discret, qu’on posait dans un coin sans que je ne bronche. On ne m’entendait jamais, comme si j’avais déjà senti le message passé quand j’étais encore dans le ventre maternel. Je savais qu’il ne fallait pas trop en demander. Je ne sais pas pourquoi ma mère n’a pas avorté à l’époque. Je l’entendais souvent se plaindre quand elle était bloquée à la maison par ma faute. J’étais toujours trop peu, pas assez, la cause, la conséquence, la raison, le frein. J’étais là. Le tracteur que nous suivons ralentit notre itinéraire. Ça me laisse encore un peu de temps pour me plonger dans mes pensées, même si je ne suis pas sûre que ressasser leur absence dans ma vie d’avant soit le moment idéal, surtout sur la route qui mène à leur « au revoir ». Mon oncle peste, fulmine, tente deux ou trois embardées pour le doubler, mais rien n’y fait. Il ne manquerait plus que nous soyons en retard pour les enterrer. Je pose ma tête sur l’épaule de tante Suzie. Son parfum, qu’elle porte depuis bientôt trente ans, embaume mes narines. Quand j’étais petite, chaque fois que je lui faisais des câlins, j’aimais garder cette odeur imprégnée sur mon doudou et mes vêtements. Elle attrape ma main, la serre de toutes ses forces et me dit que ça va aller, que je suis forte et que je vais y arriver. Arriver à quoi ? À faire semblant d’être triste devant les gens ? À fabriquer des larmes pour manifester un brin de chagrin ? C’est tante Suzie qui aurait dû être ma mère, je me suis souvent faite cette réflexion. Elle qui n’a jamais eu la possibilité d’avoir des enfants, m’aurait choyée plus que jamais. Mon père et ma mère, eux, ont fait le strict minimum. Bien m’éduquer, que je sois polie, que j’aie le sens de l’effort mais en terme d’amour, d’échanges et de complicité, ne rien demander. Et surtout, ne pas les empêcher de vivre leur vie. En somme, une relation dénuée de sentiments, mais un contrat aux conditions clairement définies. On se fait à tout dans la vie, alors je m’y suis faite. J’ai construit une carapace autour de moi, dépouillée de sensibilité, d’affection, de compassion, un véritable cœur de pierre. Tout au long de ma vie scolaire, je me suis isolée des autres. Ne rien éprouver, ne pas m’attacher. Rester dans cette solitude qui était ma plus fidèle alliée. À peine une relation d’amitié commençait-elle que j’entrevoyais déjà mille raisons pour qu’elle se termine. Ça me convenait très bien et mes camarades de classe ne cherchaient pas à creuser plus loin. Je me sentais à ma place dans les bibliothèques, au milieu des livres ou encore lors des cours d’arts plastiques. Je passais des heures à dessiner, peindre et découvrir tous ces artistes torturés et incompris. Je me sentais comme eux, mais je n’en avais que faire. Je ne cherchais pas à être comprise, j’étais bien seule. Je pouvais m’occuper de moi sans l’aide de personne, je le faisais déjà depuis longtemps. Mon oncle finit par dépasser le tracteur et file à vive allure jusqu’au parvis de l’église. Il nous dépose juste devant en nous indiquant qu’il va chercher une place plus loin pour se garer. Il va falloir sortir de la voiture et affronter tous ces regards braqués sur moi, tels des projecteurs. C’est le moment de se grimer avec un air éploré. — Ça va aller ma chérie ? me demande tante Suzie, en rangeant une mèche de cheveux derrière mon oreille. — Ça va aller, Tatie, t’inquiète pas. J’ai hâte que cette journée soit terminée… Et toi, ça va aller ? m’enquis-je. — Comme toi, hâte que ce mauvais moment soit derrière nous… Seule tante Madeline pleure déjà à chaudes larmes, se mouchant avec fracas. Je ne réussirai pas à pleurer, c’est sûr. Depuis l’annonce de leurs décès, pas une larme n’a coulé. Chapitre 2 Giulia, 1998 « Je n’ai pas d’endroit préféré. J’ai des personnes préférées, et lorsque je suis avec elles, tout devient mon endroit préféré. » (Auteur inconnu).J’ai proposé à Lorène de déjeuner chez nous ce midi. Mamma* a insisté pour qu’elle vienne goûter les vraies pâtes italiennes, pas ces semblants de spaghettis qu’on nous sert au self du lycée. Les vraies de vraies, avec la sauce maison et une cuisson inimitable. Les pâtes chez les Italiens, c’est sacré. Je l’attends vers le lavoir en bas du chemin de terre menant à la maison, sa tante va venir la déposer. Elle habite à 2 kilomètres, en plein centre du village, entre le photographe et le fleuriste. Lorène y a déposé ses valises à la mort de ses parents. Quand elle est arrivée au lycée, elle ne connaissait personne. Les autres élèves savaient tous plus ou moins qu’elle était orpheline. Certains ont tenté des rapprochements, d’autres s’en sont moqués et quelques idiots ont trouvé le moyen de faire des blagues morbides. Lorène était hermétique à tout, rien ne passait, rien ne transparaissait, rien ne filtrait. Aucune parole ne semblait l’atteindre. Elle a atterri dans ma classe au début de la seconde. Depuis, contre toute attente, nous sommes inséparables. Ce n’était pas gagné de prime abord. Je tentais d’être sympa avec elle, mais à chaque fois, elle me fermait la porte au nez. Un véritable ermite. J’avais d’autres copines, alors j’ai un peu laissé tomber. Et puis, il y a eu le devoir de sciences avec cette prof qui me terrifiait et m’avait dans le collimateur. Elle a désigné les binômes de travail et nous a mises ensemble. Au départ, je l’ai vue d’un mauvais œil. Elle me détestait au point de me coller la nouvelle dont personne ne voulait ! Lorène et moi nous sommes données rendez-vous à la bibliothèque un samedi matin pour travailler sur le projet à rendre. De fil en aiguille, l’atmosphère, tendue les premières minutes, s’est vite allégée. Il nous a pris un fou rire incontrôlable quand elle s’est mise à imiter notre professeur et depuis, nous ne nous sommes plus quittées. C’est ma meilleure amie, ma confidente, je lui dis tout. Elle est capable de prendre les notes du cours tout en écoutant mes péripéties amoureuses, elle est toujours là pour m’aider dans mes lacunes scolaires. Ses classeurs de cours sont remplis de petits mots doux que je lui écris à la dérobée, des « L+G pour toujours ». À chaque fois qu’elle les trouve, elle se moque de moi et de mon côté fleur bleue. Puis ses yeux s’assombrissent et elle me rappelle que malheureusement, rien n’est éternel. Elle paraît froide et insensible, mais je sais que sous la glace se cache un grand cœur. Je gratte tout doucement, jour après jour. Je réussirai à trouver le trésor qui s’y cache. Je sais que le drame qu’elle a vécu est terrible. Même si je râle tout le temps après eux, j’ai la chance d’avoir mes parents avec moi. La famille chez nous, c’est primordial. J’ai trois grands frères, Stefano, Claudio et Gianni. Ils sont tous bien plus grands que moi et déjà partis de la maison, je suis la petite dernière. Ça ne les empêche pas de revenir au bercail très souvent, comme des bateaux qui s’amarrent au port. Je me sens souvent gênée de lui exposer ce tableau familial qu’elle ne connaîtra plus jamais. Je me souviens d’une de nos conversations au tout début de notre rencontre, en évoquant notre avenir professionnel. — Tu sais ce que tu as envie de faire par la suite, toi ? demandé-je. Moi, je sais pas, mes parents me stressent avec ça ! J’ai l’impression de jamais être à la hauteur… — Moi, dès que j’ai mon bac, je me barre d’ici ! — Oh ! Je suis désolée… pardon… je voulais pas… putain ! C’que je peux être conne parfois ! Tu viens de les perdre, et moi j’en remets une couche ! — Mais non arrête, t’inquiète pas, va ! Avec ou sans eux, je me serai tirée d’ici de toute façon ! — Je peux te poser une question, Lorène ? — Je t’écoute… — C’est bizarre mais… on dirait que leur absence te fait rien. Moi, sans mes parents, je suis perdue ! — Ce serait trop long à raconter, j’ai pas envie de rentrer dans les détails … mais disons que ma vie change pas beaucoup en fait. J’ai toujours dû me débrouiller, ils avaient jamais assez de temps pour moi… Mais bon, allez on s’en fout, parlons d’autre chose ! Après cette discussion, nous n’avions plus jamais évoqué le sujet. Elle restait fixée sur son envie de monter à Paris. Elle disait toujours qu’il n’y avait rien pour elle dans ce trou perdu de la Savoie. À part la sœur de sa mère, plus aucune attache ne la retenait ici. Moi, j’étais tourmentée par ce futur qui approchait à grands pas. J’angoissais pour mes résultats scolaires médiocres, j’angoissais pour le choix de mon orientation, j’angoissais parce qu’il fallait réussir et que je doutais d’en avoir les capacités. *** Les yeux dans le vague, les pieds dessinant de grands cercles sur le sol caillouteux, je n’entends même pas le moteur d’une voiture qui approche. — Oh ! Tu rêves, Giulia ?! me demande Lorène en m’attrapant par les épaules. À ce soir Tatie ! Merci de m’avoir déposée ! — Bah mince alors ! Je t’ai même pas vue arriver, tu m’as fait peur !!! — Tu pensais à qui encore ? Au beau Léo ? demande-t-elle en riant. — Oh ! Ça va, je t’ai dit qu’il se passait rien ! De toute façon t’as vu ma tronche, plus calculette que moi, tu meurs ! — Non ! mais t’arrête de te dévaloriser tout le temps ! T’es très belle, il n’a d’yeux que pour toi ! Nous remontons le chemin qui mène à la maison, tout en refaisant déjà le monde. De grands arbres bordent la route tout du long, et un petit ruisseau à l’écoulement discret, accompagne le chant des oiseaux et les cloches des vaches au loin. Ce petit village de 1500 habitants est le berceau de mon enfance. Chaque matin, je prends le car pour me rendre au lycée d’Argonay, situé à une quinzaine de kilomètres. Le soir venu, je suis contente de retrouver le calme des environs. Nos cœurs sont légers, nos estomacs affamés. Avec Lorène, nous savons déjà que nous allons passer un bon moment ensemble. Nous avons prévu de travailler nos cours cet après-midi. Elle veut s’arrêter au bac et pourtant elle devrait continuer, elle en a les compétences, bien plus que moi. C’est une tête en lettres et en philo, mais le monde de l’art l’appelle. Je la trouve bien téméraire de partir seule à Paris, elle va me manquer. Même si elle revient de temps en temps, je ne sais pas ce que je vais faire ici sans elle. Nous pénétrons dans la cuisine, les effluves de tomates fraîches, tout droit sorties du jardin, émanent doucement de la grande marmite en fonte. Ma mère et mon père sont en grande discussion, mélangeant les langues italienne et française dans une douce mélodie. En bruit de fond, le vieux transistor de ma mère crache des bribes de chansons. Quant à mon chien à moitié aveugle, il se met à aboyer dès notre arrivée, comme si une armada de cambrioleurs étaient entrés dans la maison. — Muzio, au panier ! Pronto Lorène, come stai* ? demande Mamma tout en remuant la sauce tomate à l’aide d’une spatule en bois. — Mamma, je t’ai déjà dit de lui parler en français ! — Oh ! Arrête de râler un peu, elle comprend très bien ce que je lui dis, n’est-ce pas Lorène ?! — Sto bene Paola, grazie mille* ! répond Lorène en me faisant un clin d’œil et en me narguant ! Bonjour monsieur Parisi, vous allez-bien ? — Je t’ai déjà dit de m’appeler Alfonso ! rétorque gentiment mon père. — Papa, laisse-la tranquille ! intervené-je. Allez, à table ! Et c’est comme ça que j’ai l’impression de donner à mon amie un bout de famille, autour de ce repas aux couleurs vives et aux saveurs épicées. Sur fond de musique italienne, dans cette cuisine au carrelage ancien, nous partageons des moments légers, insouciants et hors du temps, loin de tout ce que la vie nous réserve par la suite. *Maman
*Bonjour Lorène, comment vas-tu ?
*Je vais bien Paola, merci beaucoup !
97
« Dernier message par Apogon le jeu. 10/11/2022 à 17:36 »
Linko-T1-Es-tu mort, public ? de Frédéric Faurite Pour l'acheter : Amazon Librinova Peu d’archives ont été retrouvées au sujet de ce qu’il convient d’appeler le plus grand scandale télévisuel du XXIème siècle en matière de téléréalité. Dans un souci de clarté et d’exactitude, ce récit comporte quelques morceaux choisis qui permettront au lecteur d’en apprendre davantage tant sur la mécanique macabre de ce jeu que sur l’état d’esprit des différents participants au fil de son évolution. Ces retranscriptions qui peuvent être perçues comme des « bonus télévisuels » ont été classées dans la rubrique intitulée « Le Petit Théâtre du Confessionnal ». L’extrait suivant dans lequel le principal protagoniste en détresse sort brusquement de son rôle pour interpeller le public nous a semblé particulièrement approprié pour débuter cette histoire.LE PETIT THÉÂTRE DU CONFESSIONNAL – PROLOGUE TÉLÉVISUEL Bonjour à tous, c’est Linko ! Voici l’heure d’avouer mes fautes et… Et rien du tout ! Rien, bon sang ! Ce rituel commence à me gonfler... Qu’est-ce que je fais encore là à jouer le jeu comme un abruti ? Occupé à blablater sans même savoir si... Est-ce qu’il y a quelqu’un ? Est-ce que quelqu’un me regarde, au moins ? Je me suis toujours senti mal dans ce Confessionnal mais ce n’est rien à côté de maintenant. Je ne sais même pas si vous pouvez m’entendre et je déteste parler dans le vide. Nous étions déjà comme des prisonniers dans cette maison et, à présent, les murs semblent avoir grandi. Ils ont l’épaisseur du monde entier et impossible de savoir ce qu’il y a derrière. Si quelqu’un m’entend, je supplie que l’on me réponde ou que l’on me fasse un signe. Le jeu continue en attendant car nous ignorons tout de ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C’est comme si nous étions tous morts mais que nous continuions à vivre en ayant perdu le reste du monde. Es-tu mort, public ? 1 LES CRÉATURES DE L’OMBRE 1 Le vacarme. Ce fut comme si une fanfare infernale retentissait dans un égout au cours d’un tremblement de terre. Le tintamarre strident et haché sur fond de musique anxiogène enflait et se rapprochait inexorablement, s’insinuant partout. Ne pouvant échapper au bruit, le seul être vivant qui peuplait ce lieu obscur, ramassé sur lui-même dans une position pratiquement fœtale, n’eut d’autre choix que de reprendre conscience. — Bwââârgh… s’exprima-t-il à sa manière, dans un curieux compromis entre le bâillement et l’éructation. Épuisé, écœuré, engourdi et sale, Colin Roy s’éveilla, chacun de ses sens mis à l’épreuve par le chaos absolu qui l’entourait. Il lui fallut de longues secondes pour décrypter l’ensemble des nuisances qui venaient de l’arracher à son sommeil et l’incommodaient au plus haut point. À sa décharge, la liste était longue car un incident fâcheux s’invite rarement seul : il préfère investir la fête avec quantité de déplaisants camarades. Tout d’abord, cette cacophonie démente. Ensuite, cette pièce sombre qui tournait et s’étirait en tous sens. Puis, cette odeur pestilentielle de nourriture avariée et de gnôle bon marché. Enfin, tout cela s’ajoutait chez le jeune homme à un mal-être physique et moral qui avait survécu à ses dernières heures de sommeil. Le monde est dégueulasse. Telle fut la première pensée vaguement rationnelle qui émergea du cerveau embrumé de Colin. Puis il vomit. Instantanément, il se sentit plus léger et éprouva une bouffée de plaisir offerte par cette infime vague de chaleur sur son tee-shirt. Très vite cependant, le contact devint visqueux et les effluves d’alcool et de biscuits apéritifs mal digérés se répandirent dans la pièce, lançant une odorante proclamation : les chips pimentées et la vodka-pomme ne sont pas compatibles avec tous les estomacs. Ce n’est pas seulement le monde… Je suis dégueulasse, songea alors tristement le garçon. Pendant ce temps, l’insupportable tapage continuait à se faire entendre. D’abord agacé, le jeune homme choisit de prendre son mal en patience avant de réaliser qu’une telle sonnerie pouvait avoir bien des significations, la plupart du temps négatives. Celle qui l’avait arraché à ses rêveries d’ivrogne le concernait peut-être au premier chef. — Un… un incendie… Le feu… murmura-t-il par réflexe, la langue lourde et les lèvres maladroites. Ou bien… C’est que l’invasion a commencé… Cette hypothèse folle qu’il n’avait même pas osé formuler à voix haute l’obligea à s’activer, considérant que l’état d’urgence était déclaré. Drôle de façon de raisonner que celle d’un homme ivre un lendemain de beuverie. En une fraction de seconde, cette pensée venait de passer au rang de priorité et accaparait à présent son attention, au point de lui faire oublier tout le reste. En ce moment précis, Colin Roy aurait été incapable de se souvenir de ce qu’il avait fait la veille ou, pire encore, de prononcer correctement son nom et son prénom. Néanmoins, il essaya de prendre le dessus, de chasser la torpeur et le demi-sommeil qui le maintenaient dans cet état second. Au prix d’un écarquillement maximal des paupières, Colin arriva à déterminer qu’il se trouvait dans son salon, affalé sur le tapis auprès du sofa. La pièce émergeait de l’obscurité par intermittence grâce à la télévision qui jetait des lueurs confuses accompagnées d’un fond sonore des plus singuliers. Il comprit alors que l’imposant cube cathodique rejouait en boucle le menu du DVD qu’il visionnait la veille avant que le sommeil ne s’abatte sur lui, d’où cette étrange mélodie qui se répétait. Cependant, la sonnerie criarde ne provenait pas de l’appareil mais d’un ailleurs indéfinissable, s’interrompant parfois pour repartir de plus belle en répandant ses décibels dans tout l’appartement. S’appuyant sur le canapé, Colin se redressa puis parvint enfin à se hisser sur ses jambes tremblantes alors que le bruit semblait encore s’intensifier. — C’est certain, il se passe quelque chose ! grogna-t-il en s’étirant, dans une succession de claquements de vertèbres. Des images atroces lui vinrent alors à l’esprit. Une série de visions d’outre-tombe. Il voyait confusément une foule de marcheurs titubants et décharnés qui avaient jailli de ses rêves et se trainaient jusqu’à lui. Colin osa tout juste articuler sa phrase, craignant de la voir devenir réalité. — Quelque chose de grave… Qui fait mal et qui mord… Puis, le vacarme suraigu s’interrompit instantanément et le cerveau ainsi que les tympans de Colin lui en furent reconnaissants. Toutefois, le son fut aussitôt remplacé par un autre, beaucoup plus inquiétant : le grincement bien reconnaissable de la porte d’entrée de son appartement. Brusquement, il fut anxieux de voir que ses suppositions alcoolisées paraissaient se concrétiser. On s’est introduit chez moi ! Ils sont dans l’entrée et ils arrivent… Colin fit de son mieux pour se tenir complètement droit et braqua son regard vers le petit sas d’entrée servant aussi de vestibule. Dans l’ombre noire se pressaient de hautes silhouettes qui émettaient des sons imprécis, graves et rauques. Cette vision le pétrifia et il sentit son visage se couvrir d’une froide sueur dont une goutte roula le long de sa tempe, obliqua vers son oreille avant de dévaler le long de son cou. — Triple torsion testiculaire ! Les morts… balbutia-t-il en les regardant s’approcher de lui. Les morts viennent me chercher… Paniqué, Colin recula à travers le salon et vint buter contre son téléviseur qui émettait toujours la même mélopée lancinante, lugubre et parfaitement de circonstance. L’appareil pivota sur son meuble puis s’éteignit lorsque la prise s’arracha. Désormais, plus aucun son ne venait concurrencer ceux des intrus et seuls leurs glapissements résonnaient entre les murs nus de l’appartement. Tout en tentant vainement de reculer le plus loin possible, le jeune homme les regardait avec une hébétude d’alcoolique envahir l’espace sonore et physique de son appartement. — Non ! Ne… N’approchez pas… Laissez-moi ! Je ne comprends pas… Qu’est-ce que ces choses font ici ? Est-ce que je rêve toujours ? Colin se retrouva dos au mur et face à ses responsabilités. Il était seul, fatigué, presque malade et dans un état immonde. Pourtant, il lui fallait affronter ces formes floues et massives qui évoluaient lentement vers lui depuis leur monde de ténèbres. Pas l’ombre d’une chance, pas une lueur d’espoir. On dirait que tout ça est bien réel… Pourquoi est-ce que cette invasion se produit au pire moment imaginable ? Je suis mal en point et fait comme un rat ! Si je ne trouve pas un moyen de fuir, ils vont me réduire en charpie… Sa condition physique actuelle et sa seule apparence le condamnaient par avance au pire des destins mais, malgré l’évidence de la défaite à venir, il ne put s’y résoudre. Cherchant des mains un objet qui puisse lui offrir un moyen de défense, il rencontra une tige métallique. Sans même comprendre précisément qu’il s’agissait de son lampadaire, le jeune homme s’en empara et fit face aux créatures qui se rapprochaient. — Vous ne m’aurez pas aussi facilement ! Un pas de plus et je vous tue ! Façon de parler… Ce n’est pas la pire des menaces pour des zombies… À ces mots, les choses mortes eurent une étrange réaction : sans cesser de s’avancer, elles se mirent à émettre des bruits répétés et sauvages qui martelèrent le cerveau de Colin et vrillèrent atrocement ses tympans. Ma tête ! Qu’ils cessent leur boucan… Qu’ils me dévorent et que ça s’arrête… Je veux du silence ! Entre deux vagues de douleur migraineuse, il crut percevoir une intonation moqueuse dans les borborygmes qui se répercutaient sur les murs tristes et nus de la pièce. Alors, la colère l’envahit. — Ne vous foutez pas de ma gueule, saletés de zombies ! Et, sur cette déclaration d’hostilité, il se rua tant bien que mal sur le plus proche d’entre eux, prêt à lui pulvériser le crâne avec le pied du luminaire. En cet instant, il ne se doutait pas que la menace qui planait sur lui était bien différente de ce qu’il s’imaginait. Bien différente mais infiniment plus pernicieuse. 2 L’appartement que louait Colin n’était qu’un petit T2 obscur, perdu dans un immeuble délabré de Vélizy-Villacoublay, une commune d’Île-de-France au sud-ouest de Paris. L’électricité ne fonctionnait pas dans l’entrée et il fallait progresser avec prudence pour ne pas se prendre les pieds dans les ordures ménagères, les divers objets en bazar et les câbles de manettes de console de jeu qui envahissaient l’intégralité du sol. On retrouvait ici les grands classiques des gens négligés avec, en prime aujourd’hui, quelques flaques de vomi. En bon locataire, Colin s’était montré discret voire effacé depuis son récent emménagement. Toutefois, en dépit de son manque d’envie de se sociabiliser, il était capable de se comporter avec politesse et amabilité. Tous ceux à qui il avait eu affaire dans les diverses démarches administratives pour accéder à cet appartement, c’est-à-dire quelques employés d’une agence immobilière, un concierge et une voisine âgée et à moitié sourde, pouvaient en témoigner. Tous ces braves gens auraient eu bien du mal à imaginer quels visiteurs se présenteraient chez Colin et quelle réception leur réserverait ce dernier. — Ne vous foutez pas de ma gueule, saletés de zombies ! — Je crois que cet imbécile a trop fêté hier soir, constata une voix rauque où demeuraient quelques échos de féminité. — Qu’est-ce qu’il raconte, cet idiot ? aboya une autre voix au timbre nettement plus grave. Colin poussa un hurlement plein de rage tandis que l’arme de fortune filait en direction de sa cible qui l’évita avec facilité, d’un simple pas en arrière. — On dirait qu’il est sérieux ! reprit l’homme aux intonations d’outre-tombe. Je vais lui faire une tête au carré, ça lui remettra peut-être les idées à l’endroit. — Ce ne sera pas la peine, Igor… murmura la troisième silhouette qui n’avait encore prononcé aucun mot. Je suis venu voir Colin personnellement alors c’est la moindre des choses que je m’en occupe moi-même. — Vous êtes sûr ? s’enquit le second mastodonte alors que Colin revenait à la charge. Nous sommes vos gardes du corps et ce type n’a pas l’air de rigoler. Sans prêter la moindre attention à cette remarque, celui qui semblait être le chef se rapprocha du jeune homme qui balançait son arme dans tous les sens, s’essoufflant, jurant, ne touchant personne. — Bonjour, Colin. Cette aimable salutation ne trouva pas preneur chez le garçon qui n’entendait les mots qu’à travers un épais brouillard auditif. La poignée de main que lui tendit l’homme lui fit l’effet d’une déclaration de guerre. — Tu veux y passer en premier ? demanda-t-il en bafouillant chacun des mots prononcés. Parfait ! — Voyons Colin, je ne suis pas là pour vous faire du mal… Hé là ! La silhouette sombre esquiva de justesse le pied de lampadaire et se mit à rire avec bonne humeur. Sans mesurer que cette nouvelle démonstration d’hilarité n’était qu’un surcroit d’agacement pour Colin, l’homme s’autorisa un constat : — Vous avez raison, il est complètement saoul ! Je crois que… La phrase s’interrompit à l’instant où le coude de Colin vint percuter dans un bruit mat le visage de l’individu qui lui faisait face. Celui-ci fut repoussé et recula de quelques pas sans émettre le moindre son. — Prends ça ! triompha le garçon. Tu es trop affreux pour me défier ! — Chef ! s’écria la femme, une note d’inquiétude dans sa voix sourde. — Enfoiré ! On va te massacrer ! s’emporta le dénommé Igor en tendant le poing vers Colin. Alors que la brute allait se jeter à son tour dans la bataille, un bref sifflement l’arrêta instantanément. Toujours sur ses jambes, le chef de la bande se tenait encore face au garçon, dans une position de garde cette fois-ci. — Du calme, vous deux ! intima-t-il à son escorte. J’ai eu le temps d’amortir cette petite attaque avec mon front. Colin se recula pour reprendre son souffle, la barre métallique toujours entre les mains. Il fixait d’un air fou son adversaire qui s’approchait de nouveau. Saleté de cadavre pourri, il en redemande ! — J’avais presque oublié que notre ami avait acquis comme moi quelques notions d’auto-défense dans sa vie mouvementée, poursuivit le chef. Je vais donc devoir opter pour une méthode moins douce, à mon grand regret. — Qu’est-ce que tu baragouines, le zombie ? hurla le jeune homme en bondissant, prêt à en finir. Un fulgurant coup de pied brisa aussitôt cet assaut. Colin le reçut en plein ventre, fut propulsé à travers la pièce et vint s’écraser contre le mur du salon dont le plâtre se fissura. Son dos heurta au passage l’interrupteur et l’ampoule crasseuse du plafonnier jeta sur la pièce la lumière jaunâtre de la vérité. Assommé par le choc, le garçon ne put cependant guère en profiter et ne vit donc pas les trois personnes vêtues de costumes sombres et élégants qui venaient de pénétrer dans son appartement. Le dernier son qu’il perçut fut la voix lasse et agacée de son adversaire : — Décidément, je joue de malchance ! J’ai sali mes Berluti sur son tee-shirt… Le spectacle dont fut privé Colin n’était pas commun, les trois envahisseurs formaient un groupe inattendu et particulier. Les deux plus grands, un homme et une femme, étaient des armoires à glace assez similaires avec des épaules aussi carrées que leurs mâchoires. L’homme portait une coupe en brosse et un bouc poivre et sel. Une longue balafre, probablement causée par une lame, barrait sa joue droite. Son coup d’œil glaçant et déterminé aurait suffi à faire reculer n’importe quel agresseur. De son côté, la femme avait des cheveux roux taillés très courts et, en dehors d’un maquillage discret, l’ensemble de sa physionomie semblait pensée pour le combat. Son regard était bien plus clair que celui de son acolyte mais tout aussi effrayant : l’éclat qui dansait dans ses yeux verts était celui de la violence et de la férocité. — Tout va bien, monsieur ? demanda-t-elle. Vous saignez ! Sans s’émouvoir, le chef, un grand homme élancé aux cheveux châtains gominés et plaqués à l’arrière, sortit de sa poche un fin mouchoir brodé. Il le déploya d’un geste léger tout en accordant un sourire rassurant à sa garde du corps. — Ce n’est rien, Olga, déclara-t-il en se tapotant le front. Ce sont les petites douleurs de ce genre qui nous rappellent que nous sommes vivants. Il demeura un moment silencieux, épongeant le sang de son visage banalement avantageux, le regard rêveur comme s’il méditait ses propres paroles. Le petit groupe prit le temps de contempler l’appartement de Colin, jetant des regards écœurés sur la multitude de détails qui faisaient du lieu un vaste et répugnant capharnaüm. — Ce n’est quand même pas ce simple échange de coups qui a mis un désordre pareil ? s’intrigua Olga. — Non, bien entendu. Il paraît clair que notre ami Colin n’est pas un adepte du rangement ni de la propreté. Je suis curieux d’apprendre ce qui a pu transformer quelqu’un d’aussi prometteur que lui en une épave pareille… Quel accueil en tout cas ! Il a de l’énergie à revendre, c’est très bon signe. Igor s’avança jusqu’à l’endroit où gisait Colin. En chemin, il posa par mégarde le pied sur un objet en plastique qui craqua sous son poids. — Regardez ça ! signala le garde du corps en brandissant la jaquette vide d’un DVD qui trainait par terre. — La Nuit des morts-vivants de Georges Romero, voilà un grand classique ! Olga s’avança et parcourut rapidement la couverture, découvrant un cimetière perdu dans la nuit et illuminé par une lune blafarde. Le titre s’étalait en lettres rouge vif, seule couleur admise ici. — J’ignorais que vous regardiez ce genre de film, boss. — Ah bon ? Je n’ai pas une tête à aimer le cinéma d’épouvante, selon toi ? — Non, non… bafouilla-t-elle. Ce n’est pas ça… — Qu’est-ce qui pourrait bien m’empêcher d’en regarder ? — Rien, bien sûr… répondit la femme avec hésitation et un léger embarras. Seulement… — Seulement quoi ? — J’ai toujours pensé que les films d’horreur convenaient plutôt aux personnes un peu fêlées, comme ce Colin justement. Franchement, aimer voir des monstres s’attaquer à des gens qui doivent survivre, ça ne va pas bien loin. — Moi, j’aime bien les films d’horreur, intervint Igor avec conviction. — C’est ce que je disais, c’est pour les tarés avant tout. — Là, tu vas trop loin, frangine ! Retire tout de suite ce que tu viens de dire ! Le chef n’eut qu’à claquer des doigts pour rétablir le calme entre ses deux gardes avant qu’ils n’aillent plus loin. — Ne vous disputez pas pour si peu ! Ta vision sur le sujet des films d’épouvante est trop réductrice, Olga, mais je ne t’en tiens pas rigueur car elle repose sur un préjugé commun entretenu par ceux qui n’en ont jamais vraiment vu. Raisonner comme tu l’as fait, c’est oublier qu’une œuvre ne sert pas seulement à nous distraire en nous apportant diverses émotions. Elle contient aussi un message ou des idées qui doivent nous faire évoluer ou, tout du moins, réagir. Par exemple, le film dont nous parlons comporte une réflexion sous-jacente sur les conséquences des armes nucléaires dans un contexte de Guerre Froide ainsi qu’une critique des préjugés raciaux dans l’Amérique des années 60. — Vraiment ? s’intrigua Igor. Je l’ai vu mais j’ai sûrement dû oublier ce passage… — Sûrement… Tout ceci pour dire que le fond et la forme d’une œuvre sont intimement liés, ils doivent se répondre et se compléter sans que l’un ne prenne le pas sur l’autre. Preuve en est que les œuvres parfaites, que l’on qualifie communément de chefs-d’œuvre, sont celles qui ont instauré une harmonie entre leur message et les procédés techniques qui le servent. C’est lorsqu’il atteint cette cohérence que l’Artiste impose au monde sa Vérité. — Que c’est beau ce que vous dites, chef ! s’extasia Olga. — Merci ! En tout cas, ce cher Colin a bon goût et je comprends mieux le sens de ses paroles de tantôt. Allez, portez-le dans sa salle de bain ! 3 Flottant de nouveau à la frontière entre l’inconscience et la réalité, Colin sentit qu’on le tirait par les bras sans ménagement à travers son appartement. Sa tête et le haut de son dos écartèrent quelques objets qui jonchaient le sol, divers détritus s’accrochant dans ses cheveux blonds et aux extrémités de sa barbe irrégulière. Je me suis vraiment laissé aller depuis que je suis sorti et que j’ai atterri dans ce bouge. Je dois avoir l’air hirsute. C’est vrai que je ne me suis pas rasé depuis mon emménagement, il y a trois semaines, constata-t-il en soufflant faiblement pour chasser un mouton de poussière qui lui chatouillait les narines. La douleur qu’il éprouvait le ramenait peu à peu à la raison. Les paupières mi-closes, il observait son appartement d’un point de vue inédit et mesurait à quel point le lieu était à son image. Quelle honte… Vivre dans un souk pareil… Boire autant pour oublier… Ce genre d’abattement ne me ressemble pas. Tout m’échappe depuis quelque temps et ça commence à bien faire ! Il faut que je réagisse dès maintenant pour comprendre ce qu’il se passe et arrêter enfin de tout subir. Voyons voir ! Le bruit horrible de tout à l’heure devait probablement être la sonnette d’entrée mais je n’avais encore jamais reçu de visite… Et, en parlant de visite, qu’est-ce que ces trois créatures-là peuvent bien me vouloir ? Alors qu’il tentait d’identifier les gens qui l’entouraient et l’entrainaient, le contact glacé du carrelage de sa minuscule salle de bain acheva de lui faire retrouver ses sens. La lumière fut allumée et la porte en plastique translucide de la cabine de douche ouverte. — Bien ! Igor, Olga, je vous laisse me le réveiller pour de bon, après quoi nous pourrons avoir notre petite conversation. Colin n’avait plus assez d’énergie pour se défendre ni même pour regarder autour de lui et il se laissa faire lorsqu’on le projeta tout habillé sous la douche. Frissonnant au contact des traditionnelles dix secondes d’eau polaire, il se surprit à apprécier, même au travers de ses vêtements, la chaleur du jet d’eau qui trempait tout et chassait peu à peu les cauchemars. Il regarda dégouliner le flot crasseux jusqu’à la bonde avant que cet agréable interlude ne s’interrompe subitement. On le sortit manu militari de la cabine de douche et on lui balança une serviette en pleine figure. — Son odeur est déjà plus supportable, commenta Igor, son grand sourire tout en dents dessinant une ligne presque perpendiculaire au tracé de sa cicatrice. — Drôles de morts-vivants… murmura Colin en observant les trois intrus. — Encore ? s’étonna Olga qui le soutenait. La douche a un peu arrangé son apparence mais son cerveau n’est toujours pas frais… Une nouvelle fois, le chef éclata d’un grand rire joyeux, comme si Colin venait de débiter la meilleure plaisanterie du monde. — Exactement comme je m’y attendais… Mais j’avais prévu que la douche ne suffirait pas pour apaiser un tel lendemain de cuite. Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour ce qui va suivre, mon cher Colin. Sur ces mots, il empoigna le jeune homme à l’arrière du crâne par sa tignasse et lui plongea la tête dans le lavabo. D’abord étonné, Colin se mit à se débattre avec mollesse puis avec une rage de plus en plus désespérée mais la poigne qui le maintenait était de l’acier. Malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à s’extraire de l’eau pour happer ne serait-ce qu’une bouffée d’oxygène et il se sentait partir peu à peu. — Chef ! Vous allez le noyer ! — Encore quelques secondes, Olga. Si j’ai rempli la vasque exprès pendant sa douche, c’est que je ne veux pas perdre mon temps ni parler dans le vide. Faire la proposition de sa vie à un ivrogne, c’est comme pisser dans un violon. L’homme finit par ramener Colin à l’air libre et le laissa s’effondrer contre le carrelage, en travers du tapis de bain. — Espèce de taré ! s’écria le presque noyé en recrachant de l’eau par la bouche autant que par les narines. — Allons, pas de grossièretés entre nous… Je suis navré d’avoir dû employer cette méthode mais j’ai besoin de toute votre attention. Est-ce que vous vous sentez plus lucide à présent ? — Oh que oui ! Dès que je reprends mon souffle, je vous éclate ! L’imposant Igor empoigna aussitôt le col du jeune homme, son immense main distordant le tee-shirt mouillé. Il plongea dans les yeux de Colin un regard noir souligné d’une barre de sourcils distordue par la colère. — Tu sais à qui tu t’adresses, gamin ? Tu oses proférer des menaces ? — Et toi ? Tu sais qui je suis, gros sac ? — Ça, c’est du courage ou de l’inconscience… Pour cette insulte, je vais te casser le bras ! — Du calme, Igor ! Colin ne sait manifestement pas qui nous sommes et je suis justement là pour le lui apprendre. Le colosse relâcha son étreinte et Colin s’affaissa contre le mur carrelé de la salle de bain. Résigné à comprendre ce qu’on attendait de lui, il s’empara de la serviette qu’on lui avait donnée et se frictionna le visage. — Qu’est-ce que vous me voulez à la fin ? Le garçon s’attendait à toutes les formes de réponses mais absolument pas à ce qu’on lui pose une question. Surtout aussi particulière que celle qui allait suivre. — Colin, avez-vous envie de devenir riche et célèbre ? 4 Une fois que les trois inconnus eurent quitté les lieux, Colin tituba jusqu’à ce qui restait de son canapé. Il demeura là, aussi perdu qu’auparavant si ce n’était plus, noyé sous la masse d’interrogations qui jaillissaient dans son esprit encore fatigué. Un cortex cérébral à l’image de l’appartement, en fin de compte : en grand désordre et nécessitant une urgente remise en état. Pourquoi est-ce qu’on viendrait m’apporter sur un plateau la fortune et la gloire ? Surtout à moi... Son interlocuteur était resté très vague sur la question, se bornant à lui intimer de se préparer et d’enfiler des vêtements propres afin de prendre le petit-déjeuner avec lui à l’extérieur. Il finit par s’exécuter, considérant que la meilleure chose à faire était de repartir sur de bonnes bases. Il rechercha dans son désordre une tenue convenable, se prépara un café et l’avala avant de retourner sous la douche, de façon plus orthodoxe cette fois-ci, avec savon, shampooing et sans vêtements. Une fois lavé et globalement séché, il s’empara d’une paire de ciseaux et sacrifia sans regret la triste barbe détrempée qui ornait son visage avant de s’enduire de mousse pour se raser correctement. L’opération achevée, il eut l’impression de redécouvrir son visage. L’homme de Cro-Magnon à l’âge indéfinissable avait cédé la place à un gaillard de vingt-sept ans résolument ancré dans l’ère moderne. Quelques coups de tondeuse venaient de lui faire parcourir en un éclair l’évolution de l’humanité. Pour la première fois depuis une éternité, il se peigna les cheveux. Le reflet que lui renvoya finalement son miroir lui parut acceptable, presque satisfaisant si on faisait exception de la fatigue qui alourdissait ses yeux. Désormais en état de réfléchir, il se demanda un instant s’il avait vraiment bien entendu la question qu’on lui avait posée tout à l’heure et qui résonnait encore dans son esprit de façon obsédante. Colin, avez-vous envie de devenir riche et célèbre ? — La célébrité je m’en cogne, avait-il alors répondu, mais la richesse… — Vous êtes du genre à courir après l’argent ? — J’aimerais simplement pouvoir prendre un boxer le matin sans avoir à me demander s’il est troué ou non. J’ai aussi d’autres projets plus ambitieux qui demandent du fric… — Parfait, parfait ! Alors, nous vous attendrons en bas. Ses habits les plus présentables enfilés, Colin quitta à son tour l’appartement en se promettant d’y remettre de l’ordre à la première occasion. Il verrouilla la porte avec soin, perdant de précieuses secondes à insérer la clé dans une serrure qui tremblait et se déplaçait sans cesse. Lorsqu’il y fut parvenu, il fit volte-face et, avant même de pouvoir s’élancer vers l’escalier, sursauta en constatant qu’une silhouette s’était glissée subrepticement derrière lui. — Qui êtes-vous et que faites-vous là ? lui lança une voix chevrotante. Sur le moment, il crut à une nouvelle menace avant de reconnaître sa voisine de palier, la doyenne de l’immeuble, la vénérable Madame Senex. Celle-ci était vêtue d’une robe de chambre bleue à motif floral. Voûtée comme peut l’être une dame ayant largement fêté ses quatre-vingts printemps, elle s’appuyait sur une canne noire en fibre de carbone et à la poignée béquille torsadée. Ses cheveux impeccablement blancs et symétriquement bouclés ainsi que ses petites lunettes rondes lui conféraient l’apparence archétypale de la grand-mère. Sa parfaite conformité avec tous les clichés en vigueur sur le troisième âge avait quelque chose de presque effrayant. L’être humain adore les portraits stéréotypés mais son œil a souvent du mal à en supporter la vision. — Bonjour, Madame Senex ! parvint à articuler Colin lorsque son cœur retrouva son rythme de croisière. Vous ne me reconnaissez pas ? — C’est bien vous, monsieur Roy ? — Tout à fait ! Vous pouvez m’appeler Colin. — C’est justement vous que je venais voir, Colin. — À quel sujet ? s’enquit-il innocemment, craignant le pire. Après tout ce boucan, elle va me refaire le portrait à coups de canne ! La vieille dame ne répondit pas immédiatement. Elle se borna à le regarder avec insistance au point que le garçon commença à être inquiet et mal à l’aise. Être dévisagé en détail à moins de trente centimètres par un observateur quasiment inconnu, profondément muet et visiblement contrarié est toujours déstabilisant. Nous avons vraiment dû faire un bruit infernal pour que même ma voisine équipée d’un sonotone vienne me demander des comptes. — Vous avez rasé votre barbe, n’est-ce pas ? finit-elle par demander. — On ne peut rien vous cacher. — Eh bien cela vous va mieux ! Je vous trouve beaucoup plus distingué ainsi et cela vous rajeunit de dix ans. — Merci beaucoup. La vieille dame continua un moment à l’observer, manifestement heureuse d’avoir la possibilité de voir un peu plus clair sous la tignasse habituelle de Colin. Qu’est-ce qui est en train de se passer exactement ? se demandait l’intéressé. Elle n’est quand même pas sortie de chez elle pour venir me faire des compliments ? — Il y a un problème ? hasarda-t-il, continuant à jouer la carte de la simplicité et de la candeur. — Vous dites ? — Je vous demandais si tout allait bien ! répéta-t-il plus fort et en prenant soin de bien articuler pour compenser les soucis d’audition de sa voisine. Une ombre soucieuse passa alors dans les grands yeux bleus et cernés de rides de la vieille dame. — Il s’est passé quelque chose d’étrange ce matin ! — Dites-moi tout… — Alors que je retirais mes bigoudis, l’armoire de ma chambre s’est déplacée toute seule. Je l’ai vue de mes yeux ! Colin ne sut trop quoi répondre. Les doléances de la vieille dame étaient plus inattendues que tout ce qu’il aurait pu supposer. Instantanément lui vint en tête la réflexion que se font tous les jeunes gens sains d’esprit lorsqu’ils rencontrent une personne âgée tenant des propos qui sortent de l’ordinaire. Bon sang ! Je n’avais vraiment pas besoin que ma voisine soit victime de démence sénile et fasse une crise d’hallucinations, encore moins dans un moment pareil. Les autres doivent être en train de m’attendre en bas de l’immeuble… Tant pis pour la ponctualité ! Mieux vaut faire bonne figure, c’est encore heureux qu’elle n’ait pas appelé la police pour le tapage de tout à l’heure… — Vous êtes en train de me dire que vous avez vu votre armoire bouger ? s’étonna-t-il en s’efforçant de rester sérieux malgré sa forte envie de rire. — Bouger ! Parfaitement ! Comme je ne suis pas suffisamment forte pour la remettre à sa place, je viens vous chercher en renfort. J’aurais bien volontiers demandé à mes enfants mais ils travaillent tous à l’étranger. Je me suis rappelé que vous étiez jeune et Bertrand, mon fils aîné, m’a recommandé de ne pas hésiter à faire appel à un voisin plutôt que de me faire mal bêtement. Vous accepteriez de me donner ce petit coup de main ? Bien que pressé, le garçon n’oubliait pas sa bonne éducation. On lui avait appris que les personnes âgées n’étaient pas de vagues entités devenues fantomatiques par anticipation ni d’antiques pièces de musée que l’on abandonnait à la poussière et à la solitude dans leurs petits meublés. Elles avaient construit le monde actuel, avec ses bons et ses mauvais côtés, il était donc normal de leur tendre respectueusement la main lorsqu’elles en avaient besoin. Par ailleurs, il n’avait pas eu la chance de connaître ses grands-parents et n’était pas si mécontent que cela de se retrouver avec une grand-mère de substitution à dépanner. Quitte à perdre quelques minutes, il rendrait service à sa voisine. — Bien entendu, vous pouvez compter sur moi. — C’est très gentil à vous, jeune homme ! Suivez-moi. Colin obéit et se retrouva donc à marcher à très petits pas à côté de l’octogénaire qui clopinait en s’appuyant sur sa canne. En chemin, elle continua à le féliciter sur sa décision de se raser la barbe, arguant qu’il n’y avait que les beatniks ou encore les hippies pour porter des cheveux aussi longs. — Finalement, je ne vous imaginais pas si jeune, vous pourriez être mon petit-fils. Le garçon sourit à cette idée tandis que son interlocutrice sortait sa clé et posait une main ridée, veineuse et constellée de taches sur la poignée de sa porte. Lorsqu’elle ouvrit, le jeune homme perçut du premier coup d’œil que l’appartement était aussi archétypal que sa propriétaire. Elle lui fit signe d’entrer et il pénétra dans tout un univers de tapis, de napperons, de meubles vernis à l’ornementation dorée et de fauteuils rembourrés qui devaient être de style Louis XIV ou Louis XV. Des vases, une petite pendule et de nombreux bibelots surmontaient la pièce maîtresse du salon : un large buffet dominé par un gigantesque miroir. Des reproductions de tableaux célèbres, parfois en plusieurs exemplaires, recouvraient les murs. On trouvait entre autres un portrait de Beethoven à l’air sévère, La Liseuse de Fragonard et une copie un peu incertaine du Pèlerinage à l’île de Cythère de Watteau. Un parfum de tisane à la verveine mêlé à des arômes sucrés de sirop contre la toux hantait les lieux. Comment est-elle arrivée à faire entrer autant de meubles et d’objets dans un si petit espace ? Le plus fort, c’est qu’elle est parvenue à rendre tout ce bric-à-brac cohérent : on a l’impression que tous ces objets ont toujours vécu ici et ensemble. — Tiens ? s’intrigua-t-il tout à coup. J’ai cru voir bouger les coussins de votre canapé. — Ce sont mes chats qui s’agitent sous les coussins. Princesse et Figaro sont plutôt joueurs lorsqu’ils ne sont pas occupés à dormir ou à manger. Sans lui laisser le temps de s’attarder davantage sur le salon, la vieille dame le contourna pour emprunter le couloir central. — Le phénomène dont je vous parlais s’est produit dans ma chambre. Venez voir ! — Je vous suis. Il lui emboita le pas – ou, plus précisément et plus cyniquement, lui « boita le pas » –, longeant une petite cuisine et diverses portes entrebâillées donnant sur la salle de bain, les toilettes et un placard pour arriver à la chambre de Madame Senex. Ici encore, on ne pouvait s’empêcher d’admirer la continuité qu’offrait la pièce par rapport au salon : lit en bois verni et massif, table de nuit couverte de photos de famille et de boîtes de médicaments. Une marée montante de boîtes de comprimés, de cachets, de pastilles et de gélules faisait pratiquement disparaître les portraits soigneusement encadrés du mari, des enfants et des petits-enfants de la vieille dame. Dans cette pièce, l’odeur médicamenteuse avait pris racine plus solidement et plus durablement que du lierre sur un muret. — Voilà l’armoire, lui indiqua la vieille dame en tendant sa canne vers le mur qui faisait face au lit. Colin observa le meuble, un mastodonte noir aux allures de cercueil géant qui semblait avoir été taillé dans une même pièce de bois. — Eh bien ? s’intrigua-t-il. Il a l’air normal ce meuble… — Regardez un peu les pieds ! Colin se pencha et s’aperçut que l’immense penderie avait glissé d’une dizaine de centimètres sur le sol, laissant des traces bien nettes sur le parquet ciré. — On dirait en effet qu’elle s’est déplacée… — Exactement ! J’étais encore au lit lorsque j’ai vu l’armoire qui s’agitait et j’ai presque cru qu’elle allait me tomber dessus. Soudainement intéressé par le phénomène, Colin se déplaça sur le côté du meuble afin de regarder ce qu’il y avait derrière, entre le bois et le mur. Aussitôt qu’il constata la tension sur le papier peint ainsi que la forme délicatement courbe qu’avait prise la cloison, il comprit ce qu’il s’était passé. Triple torsion testiculaire ! J’ai bien failli me rendre coupable du meurtre de Madame Senex ! De l’autre côté de cette cloison se trouve mon salon. Quand je me suis ramassé le coup de pied de l’autre sadique et que je suis allé m’écraser contre le mur, le choc a fait bouger le meuble. Visiblement, elle n’a rien entendu de notre combat mais elle a quand même vu son armoire vaciller. Si jamais cette penderie lui était tombée dessus, je ne me le serais pas pardonné… — C’est effectivement très curieux… murmura-t-il, gêné. — Je sais exactement ce qui s’est passé ! déclara-t-elle subitement avec une force et une conviction de jeune femme qui firent sursauter Colin. Le garçon observa sa voisine avec inquiétude, attendant de voir quel verdict allait tomber. — C’est sûrement une petite secousse sismique ! reprit-elle. J’en connais fort bien les effets car j’ai vécu de nombreuses années dans les Pyrénées. Ma famille est originaire d’Accous, dans le Béarn, vous connaissez ? — Ah non, je n’y suis jamais allé… — N’hésitez pas à y passer, alors. Vous pouvez me croire, c’est un endroit charmant. — Je vous crois et je pense aussi que vous avez sûrement raison pour ce qui est de la secousse sismique ! déclara le jeune homme sur le ton admiratif d’un Watson commentant la progression d’une enquête de Sherlock Holmes. Madame Senex se rengorgea avec fierté, s’appuyant d’une main ferme sur le pommeau de sa canne, un sourire triomphal aux lèvres. — Vous avez senti le choc vous aussi, n’est-ce pas jeune homme ? — C’est le moins que l’on puisse dire ! Vous verriez l’état de mon appartement… — Malgré ça, c’est tout de même la première fois que je subis un séisme en région parisienne… déclara pensivement la vieille dame. — Vous voulez que je vous aide à repositionner l’armoire ? proposa le garçon, impatient de changer de sujet de conversation. La vieille dame ravie acquiesça et Colin se pencha avec précaution, pour ne pas se casser le dos, parcourut de la main l’espace entre le bas du meuble et les pieds pour trouver des prises solides puis força un bon coup. Il réussit à ramener l’armoire à sa place au prix d’un effort somme toute raisonnable, compte tenu de la taille du meuble. — Merci beaucoup, jeune homme ! — Je vous en prie, c’est la moindre des choses. — Vous êtes costaud, dites-moi ! Dans son jeune temps, feu mon mari n’aurait pas fait mieux et, pourtant, il était maçon. — Ce n’était rien, je vous assure. Cette armoire est bien moins lourde que je ne le pensais. Madame Senex lui expliqua avec force détails que le meuble ne contenait que du linge de lit, une couette et quelques traversins dont elle détailla les couleurs, les dimensions et la provenance. Colin l’écouta patiemment, avec un sourire poli, sans oser l’interrompre comme si la meilleure manière de laver couettes et édredons – en machine ou à l’eau savonneuse dans une baignoire – était son principal sujet de préoccupation. Je comprends mieux comment ce meuble a pu se déplacer autant suite au choc de tout à l’heure. D’un côté, cette légèreté m’aura permis de le remettre en place facilement mais, de l’autre… Il aurait très bien pu tomber sur Madame Senex en la broyant dessous ou, pire, en la bloquant mais sans la tuer tout de suite… Horrible ! C’est bien la dernière fois que je me bats dans mon appartement… — Voulez-vous une tasse de thé, mon garçon ? — Cela aurait été avec plaisir, Madame, mais des amis à moi m’attendent en bas de l’immeuble. — Dans ce cas, je ne vous retiens pas plus. Merci encore pour votre aide ! — C’est bien normal. — J’espère que vous passerez me rendre visite de nouveau lorsque vous serez moins occupé. — Je vous le promets et je ferai honneur à votre thé à ce moment-là. Sur un dernier sourire, il prit congé de la vieille dame et se retrouva sur le palier. Le contraste entre l’appartement douillettement surchargé de l’octogénaire et la froideur délabrée de la cage d’escalier et des communs lui donna l’impression d’avoir emprunté une sorte de vortex entre deux dimensions. Drôle de journée, quand même ! songea-t-il. Je viens de vivre plus d’événements en quelques heures qu’en trois semaines. Je ne sais pas si je dois être impatient ou anxieux de voir la suite arriver. Il n’était en effet réveillé que depuis une heure mais déjà il avait cru mourir, s’était découvert une grand-mère de substitution et se allait à présent se lancer avec énergie à la poursuite de la richesse et de la célébrité. 5 La descente de l’immeuble fut légèrement vacillante mais il n’y avait déjà plus rien à voir avec le tournis ressenti un peu plus tôt. À présent, il éprouvait une sensation plus naturelle qui lui rappelait qu’il était en vie : la faim. Son estomac réclamait le petit-déjeuner promis tantôt et, bien qu’il ne l’eût jamais admis, il aurait volontiers englouti une bonne dizaine de pains au chocolat tant il avait faim. Devant l’immeuble, l’homme aux cheveux gominés l’attendait, flanqué de ses deux acolytes. Leurs habits élégants détonnaient dans ce quartier où les costumes ne se portent que lors des grandes occasions. De même, leur manière d’être ne correspondait à rien de ce que cette banlieue parisienne pauvre avait l’habitude de connaître. Igor faisait les cent pas sur la chaussée en levant haut les jambes à la manière d’un soldat au cours d’un défilé militaire. De son côté, Olga restait statique mais son visage pivotait en tous sens, observant chacune des façades et des fenêtres qui les entouraient comme si elle craignait d’y déceler un tireur embusqué. Seul leur patron demeurait calme et immobile, les yeux rivés sur l’immeuble de Colin, raison pour laquelle il fut le premier à voir le garçon en sortir. Immédiatement, il claqua des doigts pour avoir l’attention des deux gardes. — Pas trop tôt… commenta Olga. — Ce n’est pas comme si nous avions toute la matinée ! renchérit Igor. Colin aurait pu s’énerver et les envoyer se faire voir l’un et l’autre mais son rapide passage dans l’univers chaleureux et feutré de Madame Senex l’avait adouci. Il choisit de faire profil bas et de présenter ses excuses pour le retard. — Désolé pour l’attente. C’est qu’il y avait beaucoup de travail pour la remise en état… Que ce soit pour moi ou mon appartement… Le chef, nonchalamment assis sur une barrière en fer bordant le trottoir, bondit de son perchoir et détailla Colin de la tête aux pieds. Il esquissa finalement un sourire satisfait en découvrant que la nouvelle apparence du garçon correspondait parfaitement à ses attentes. — Vous avez bien meilleure mine sans cette glorieuse barbe de patriarche, mon cher Colin ! commenta-t-il en lui serrant chaleureusement la main. Ceci étant, on aurait difficilement pu faire pire qu’avant. — Vous étiez sérieux lorsque vous parliez de petit-déjeuner ? — Tout ce qu’il y a de plus sérieux. J’ai pour habitude de régler toutes mes affaires autour d’une table bien garnie. — Alors je connais un petit bistrot pas loin d’ici. — Ce ne sera pas utile, répondit l’homme avec un sourire amusé. Suivez-nous. — C’est parti ! Vous savez que nous avons failli tuer une vieille dame tout à l’heure ? — Vraiment ? Racontez-moi ça… La montre de luxe du patron marquait pratiquement huit heures du matin mais le soleil de ce début d’avril était déjà haut dans le ciel. Le petit groupe se mit à marcher dans la banlieue presque déserte, Colin poursuivant sa narration. Tout était silencieux et tranquille, les quelques passants vaquaient à leurs occupations sans leur accorder autre chose que des regards fatigués et impassibles. Connaissant bien le quartier, le jeune homme ne put s’empêcher de remarquer que le chemin qu’ils suivaient les éloignait des commerces. Le doute s’empara de lui. — Où allons-nous exactement ? — Au terrain de jeu. Justement, se profilait le terrain de basket accolé au petit parc boisé, seule oasis de verdure au milieu des barres bétonnées. — C’est une plaisanterie ? Vous nous avez prévu une dînette dans le bac à sable du jardin d’enfants ? — Vous avez de l’humour, Colin, j’aime beaucoup ! — On me le dit souvent… Expliquez-moi quand même où vous comptez manger parce qu’on ne va pas du tout dans la bonne direction. Pour toute réponse, l’homme sortit de sa poche une petite télécommande et pressa un bouton. Quelques instants après, un bourdonnement se mit à enfler et Colin leva les yeux. — Ne me dites pas que c’est vous qui venez d’envoyer un signal à cet hélicoptère ? interrogea le garçon en fixant et en montrant de l’index un petit cercle argenté qui grossissait à toute allure dans l’azur. — Et qui d’autre ? À moins, bien sûr, que l’un de vos voisins ne possède son propre héliport au sommet de son HLM. Un irrépressible sourire narquois naquit sur les lèvres du jeune homme et un ricanement lui échappa, grave et sourd comme le vrombissement de l’hélicoptère, avant qu’il ne reprenne son sérieux. La misère des gens du coin ne prêtait pas à rire lorsqu’on la côtoyait de près et il doutait que ce fût le cas de cet homme. Il fallait avoir un compte en banque bien garni et des goûts particuliers pour oser lancer ce genre de blagues. — Vous ne manquez pas d’humour, vous non plus ! — De l’humour noir alors : je suis plutôt du genre cynique et sarcastique… Non, en réalité, nous repartons comme nous sommes venus et depuis le terrain d’atterrissage improvisé le plus proche. En effet, l’hélicoptère descendait toujours, visant manifestement le terrain de basket. Ce qui semblait au jeune homme un événement extraordinaire ne paraissait pas du tout impressionner ses trois visiteurs. Qui plus est, la machine volante n’avait rien à voir avec les hélicoptères de police qui survolaient quelquefois le secteur. L’appareil était d’une conception futuriste : la forme élancée de son fuselage ainsi que ses couleurs, du noir au sommet et du blanc sur la partie inférieure de la carlingue, lui conféraient l’allure d’un squale. — Eh bien, ça alors ! s’exclama le garçon lorsqu’il put le distinguer avec précision. — C’est fini, mon cher Colin ! Les petits restaurants pas chers, les déplacements dans les transports en commun, les nuits passées à vous soûler dans votre minuscule T2… Tout ça s’arrête aujourd’hui : il était temps, non ? Le jeune homme demeura bouche bée tandis que le requin métallique se rapprochait majestueusement du sol. Même s’il avait voulu articuler un mot, le vrombissement des rotors aurait instantanément couvert la moindre parole. L’immense main d’Olga l’invita à se courber et à se protéger du souffle qui faisait danser les branches des arbres les plus proches ainsi que les maillons métalliques des filets de basket qui s’agitaient comme si un joueur invisible venait de marquer un panier. Enfin, le bruit diminua et il fut possible de se parler et de s’entendre malgré le mouvement continu des pales des deux hélices. — Je vous souhaite la bienvenue à bord ! s’exclama le chef avec enthousiasme. Igor ouvrit la large porte latérale de l’appareil et Colin découvrit un habitacle spacieux, composé de fauteuils de cuir entourant une élégante table en bois verni. Une agréable odeur de pain grillé et de café frais s’échappait de l’intérieur de l’hélicoptère. Une stewardess blonde s’affairait dans ce qui semblait être une petite kitchenette, ouvrant et refermant des compartiments laissant apparaître un frigidaire, un petit four encastrable et même un bar. L’estomac de Colin gargouilla avec force mais, heureusement pour son égo, personne ne parut s’en rendre compte. Une cuisine dans un hélico ! C’est déjà un concept étonnant mais, le plus ahurissant, c’est que j’y aie accès comme si j’étais une star. — Je vous invite à prendre votre premier petit-déjeuner dans les airs. On y prend goût très vite, vous verrez. Une fois que vous vous serez restauré, nous pourrons alors nous consacrer au projet que j’ai à vous proposer. 6 Tous embarquèrent dans l’hélicoptère. Colin et l’homme aux cheveux gominés s’installèrent sur les places les plus proches de la table, les deux gorilles se placèrent un peu en retrait. — Pilote ! Décollez rapidement avant que notre petit manège n’attire davantage l’attention. L’appareil s’éleva en douceur et, très vite, les tours et les barres d’HLM furent écrasées par l’altitude. Les quelques habitants les plus matinaux qui avaient passé le nez à la fenêtre restèrent un petit moment interdits avant de reprendre le cours de leur vie et de retourner à leurs propres petits déjeuners avant qu’ils ne refroidissent. — Cynthia ! reprit le chef en s’adressant à la jeune femme qui commençait à sortir des assiettes et des couverts. Notre hôte a sûrement très faim, veille à ce qu’il ne manque de rien. Colin, incrédule, se laissait emporter dans les airs et se contentait d’observer ce qui se passait autour de lui. Il admirait l’application de l’hôtesse qui sortait tout le nécessaire pour un excellent breakfast, aérien qui plus est. C’est en voyant les quatre types de pains différents et les soucoupes dans les assiettes que le jeune homme redevint subitement méfiant. Qu’est-ce que je fabrique là-dedans ? Je ne sais même pas comment me comporter dans un cadre pareil. Et puis, qu’est-ce que ces gens-là peuvent bien me vouloir ? Non seulement je ne les connais pas mais en plus je n’aurais normalement aucune chance de pouvoir les rencontrer. Il suffit de voir leur air blasé pour deviner que ce que je suis en train de vivre est une routine pour eux. Nous ne sommes définitivement pas du même monde ! — Vous semblez contrarié, Colin. — Je suis simplement surpris. Vous admettrez qu’il y a de quoi : trois personnes s’introduisent dans mon appartement, me rossent, me noient à moitié puis m’offrent mon baptême de l’air accompagné d’un petit-déjeuner cinq étoiles. — Eh oui ! Vous pensiez être dévoré par des morts et vous voilà nourri par des vivants, les apparences sont souvent trompeuses lorsqu’on a un coup dans le nez, n’est-ce pas ? La jeune femme blonde se pencha vers Colin, son agréable visage illuminé par un sourire joyeux : — Du thé ou du café, monsieur ? — Un thé, s’il vous plaît, répondit-il, décontenancé par tant d’attention et par le fait qu’on l’avait appelé « monsieur », ce qui était bien la première fois. — Je peux vous proposer un Darjeeling ou bien un Hojicha. Venant d’un monde où le thé est cette chose en sachet scellée dans des emballages papier, Colin demeura une fraction de seconde sans réponse. — Quelle est la différence entre les deux ? demanda le garçon, pris au dépourvu et hésitant comme si sa vie dépendait de son choix. — Le Darjeeling est un thé noir qui s’obtient par dessiccation. Le Hojicha est un thé vert issu de la torréfaction des feuilles de thé. — Un vert, merci ! répondit-il, incertain d’avoir réellement compris. Ils se mirent à manger, le chef avec une parcimonie d’habitué et Colin avec la frénésie de celui qui se régale mais s’imagine déjà qu’il ne refera jamais plus un tel festin. Une gêne fugace l’effleura lorsqu’il réalisa qu’il dévorait une portion conséquente de tout ce qu’on lui proposait mais il la balaya en songeant qu’il n’avait pas forcé la main à ses hôtes pour les accompagner. Ils ont voulu inviter un type sans le sou et affamé, qu’ils en assument les conséquences… et les dépenses. Sa faim ne lui avait cependant pas fait perdre de vue qu’il se trouvait en compagnie d’individus dont il ignorait tout et à bord d’un appareil qui fendait le ciel vers une destination inconnue. Aussi, lorsque son estomac se fut quelque peu apaisé, il posa la première des questions qui lui brûlaient les lèvres : — J’aimerais savoir qui je dois remercier pour cet excellent petit-déjeuner. Qui êtes-vous, au juste ? — Je me nomme Artus De Castelnéant. Les sonorités de ce patronyme particulier firent aussitôt réagir Colin sans qu’il puisse déterminer pourquoi. Tiens ? Est-ce qu’il s’agirait par hasard de quelqu’un que je pourrais connaître de près ou de loin ? — C’est étrange… fit remarquer le garçon. Alors que je suis certain de ne vous avoir jamais vu, votre nom ne m’est pas inconnu. Un sourire de satisfaction apparut sur les lèvres d’Artus De Castelnéant qui semblait à la fois rassuré quant à sa renommée et fier qu’elle pût atteindre quelqu’un d’aussi marginal que Colin. — Vous avez pu l’entendre dans bien des occasions car je suis producteur d’émissions de télévision, présentateur aussi à mes heures. — C’est ça ! J’ai certainement déjà dû voir un de vos programmes ou bien entendre des amis parler de vous. Pouvez-vous me donner un exemple d’émission que vous animez ? — Vous devez bien être la seule personne dans ce pays à ne pas pouvoir m’en citer au moins trois d’affilée. C’est peut-être pour cela que vous m’êtes aussi sympathique, d’ailleurs. En voici quelques-unes pour vous rafraîchir la mémoire : « Heureux parcours », « Le Compteur de la terreur » et enfin « Barillet doré », toutes diffusées sur la première chaîne du pays. Colin fouilla quelques instants dans sa mémoire. S’il aimait regarder des films à la télévision, il fuyait comme la peste les autres programmes, estimant qu’il avait assez à faire dans sa propre vie pour ne pas avoir à accorder ne serait-ce qu’une seconde à celle des autres. Toutefois, les titres des émissions du producteur ne lui étaient absolument pas inconnus, il les avait certainement entendus dans une autre vie, dans des phrases prononcées par des amis ou bien des détenus. — Ces trois noms me parlent. Ce sont des émissions dans lesquelles les candidats répondent à des questions pour de l’argent, c’est ça ? — Oui, s’il faut vraiment les résumer en trois mots, c’est le propos. Mais ce genre d’émissions, complètement passé de mode, ne m’intéresse plus désormais. Je souhaite viser plus haut, m’attaquer à du plus gros gibier et c’est là que vous pouvez m’être utile, mon cher Colin. Cependant, avant de vous en dire plus, je souhaiterais que vous nous parliez un peu plus de vous. — Vous semblez déjà en savoir beaucoup sur moi… Colin braqua son regard sur son interlocuteur, droit dans les yeux comme s’il cherchait à y déceler des vérités cachées. C’est vrai qu’il a l’air d’en connaître long à mon sujet, le bougre. Par exemple, comment a-t-il pu avoir si vite mon adresse alors que je viens seulement d’arriver dans cet appartement ? Le producteur soutint son regard avec un certain amusement avant de reprendre la parole, toujours avec le même calme olympien. — En-dehors de mes sources et de mes antennes, j’ai effectivement parcouru un vague dossier mais quelques notes couchées sur du papier ne signifient rien pour moi. Tout ce que j’ai appris de concret, c’est que vous avez eu une jeunesse assez mouvementée, que vous êtes allé en prison un an pour un cambriolage raté et que vous en êtes sorti il y a quelques semaines. J’aimerais savoir ce qui s’est passé avant et pendant cette phase d’enfermement afin de mieux vous cerner. — Je n’ai pas vraiment envie de m’étendre sur le sujet mais je suppose que je n’ai pas le choix, pas vrai ? — Vous avez saisi le principe. C’est la condition sine qua non pour que je vous en révèle davantage sur le but de ma visite et pour que nous fassions affaire ensemble. Allons, dites-nous un peu de quoi votre vie a été faite, je vous prie. — J’espère que vous avez tout votre temps… — Nous aurons au moins celui du voyage. N’ayez pas peur d’entrer dans les détails. Colin fut surpris qu’on lui en demande autant. Raconter une vie dont on n’est pas satisfait revenait selon lui à lancer une lourde pierre dans une mare remplie de vase puante et à voir remonter dans les clapotis des bulles de gaz toutes sortes de parasites et de sangsues. Il faillit refuser tout net mais considéra que c’était une manière comme une autre de payer ce petit-déjeuner pour ne pas avoir l’exaspérante impression de se sentir redevable. Par ailleurs, ce n’était peut-être pas totalement inutile de fouiller dans des étangs boueux, d’autant que l’on n’est jamais à l’abri de voir de l’or émerger de la fange. Alors, Colin fit l’effort de se tourner vers son passé et commença à raconter, d’abord mécaniquement puis en se laissant peu à peu entraîner par le rythme de ses souvenirs.
98
Résumé :
Lalie a 9 ans, un teint de pêche et des joues roses. Elle a aussi deux frères et des chatons, une belle-mère et deux maisons.
C'est une enfant intelligente et vive, une grande sœur attentionnée et une amie fidèle.
C'est la petite fille que chacun aimerait avoir.
D'ailleurs, tout le monde aime Lalie.
Tout le monde doit aimer Lalie.
Il le faut.
C’est une évidence. Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance, et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième fort énigmatique. Pour avoir déjà lu des ouvrages de cette auteure, (pour les plus curieux mes chroniques ici : La cave aux poupées, Les yeux d’Iris) j’étais assez curieuse de voir ce que Magali allait nous réserver avec ce nouvel opus, et je dois dire que je n’ai pas été déçue. Nous faisons ici la connaissance de Eulalie, surnommée Lalie, une petite fille déjà fort intelligente pour bientôt dix ans. Elle a tout pour être heureuse : une vie de princesse, des parents aimants, des amis et de bonnes notes à l'école, Mais le jour où son père décide de quitter ce foyer tant aimé, tous se brise et ses repères volent en éclat. Ainsi, elle doit désormais composer avec deux maisons, une belle maman et deux petits frères du même âge : Charlot, au domicile de sa mère qui a voulu piéger son mari dans le but de retrouver sa vie d’avant, et Malo, issu de son père et de sa maîtresse avec qui il est parti s’installer. Ce changement de vie, malheureusement presque banalisée de nos jours, va engendrer chez cette enfant un vrai séisme, une profonde modification de personnalité qui conduiront à de graves conséquences… tant pour les protagonistes… que pour nous pauvres lecteurs. Dès les premières pages, nous voici plongés, happés, enferrés au cœur d’un récit démoniaque, à l’instar du génialissime film Carry, oppressant, glauque et anxiogène. Je fais ici le choix délibéré de ne pas trop rentrer dans les détails pour vous laisser jauger l’univers et le personnage principal de cette histoire. Ce que je peux vous dire cependant, c’est que Lalie va nous conter peu à peu sa terrifiante histoire. Grâce à une alternance de points de vues fort bien dosés, certains passages vont nous montrer ce qui se trouve dans sa tête, alors que d’autres, plutôt omniscients, vont se concentrer sur son environnement extérieur ; procédé judicieux et fort immersif nous permettant ainsi d’appréhender la situation dans son entièreté. Même chose pour l’emploi du « Je » qui nous projette dans la tête de la petite fille, au plus près de ses pensées, ses ressentis, ses émotions tordues et quelque peu anormales. C’est alors que, glacés et saisis d’effroi, nous assistons anéantis et impuissants, à la transformation inimaginable de cette enfant machiavélique, que l’on peut qualifier de dérangée psychologiquement. Et pour nous transmettre la montée de cette « folie » grandissante, l’auteur utilise tour à tour une plume tantôt directe et incisive, tantôt fluide et percutante. Les chapitres sont bien rythmés, l’écriture demeure précise, très détaillée et rien ne nous est épargné. Nous passons par tout un panel émotionnel ; nos sentiments sont changeants et contradictoires, et nous ne savons plus que penser de Lalie… À ce propos, si cette histoire reste bien ficelée et addictive à souhait, de multiples questions me taraudent : Au fond qui est vraiment Lalie ? Une petite fille simplement en souffrance, ou plus inquiétant une gamine qui rentre de plain-pied dans la psychopathie ? Comment, une petite fille encore bien jeune malgré sa grande maturité, arrive-t-elle a conserver cette apparence lisse, puis à masquer aussi parfaitement ses horribles pensées et actes futurs, ce, sans alerter personne de son entourage ? Comment parvient-elle à berner tout son petit monde, sans qu’aucun d’entre eux ne s’inquiète pour elle, et ne prenne le temps de lui apporter une aide médico psychologique ? Certes, les adultes n’ont pas toutes les clefs, ne peuvent/ne veulent pas voir l’impensable surtout qu’ils sont en prise avec leur propre existence à remettre en ordre… mais, j'aurais aimé un traitement un peu plus poussé sur ces questions. Néanmoins, ce court roman permet d’ouvrir la réflexion sur ce sujet épineux et peu abordé, ce qui est une excellente chose. Vous l’aurez compris, j’ai franchement apprécié cette lecture haute en couleur, presque insoutenable par moments compte tenu du sujet abordé ; âmes sensibles s’abstenir ! Alors si vous aimez les romans coup de poing, de ceux qui vous remuent les entrailles, vous laissant exsangue à la fin de l’histoire.... foncez, vous ne serez pas déçus  Ma note : Ma note :       Pour vous le procurer : Éditions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : Twitter Facebook
99
« Dernier message par Apogon le jeu. 27/10/2022 à 17:03 »
Un goût de cannelle et de chocolat de Magali Chacornac-Rault Pour l'acheter : Amazon Chapitre 1 En ce 17 décembre, Andreas, prend la route. Cela fait presque un an qu’il ne s’est pas accordé de vraies vacances et il est heureux de retrouver son Alsace natale pour les fêtes de Noël, le plus beau moment de l’année. La neige a déjà recouvert son pays d’un voile blanc étincelant de paillettes qu’il est impatient de contempler. Il quitte Paris de bon matin à bord de sa Mégane RS noire et se lance dans les bouchons. Il espère arriver assez tôt, il n’a pas envie de passer sa journée sur la route. Plus il s’éloigne de l’Île-de-France et plus la circulation devient fluide, et il peut enfin profiter des 300 chevaux qu’il a sous le capot. Après plus de trois heures de route où des champs s’alignent à perte de vue, les premiers reliefs des Vosges se dévoilent. Il vient de mettre un pied au pays. Peu à peu, les montagnes se font plus hautes et plus denses, des silhouettes de châteaux en ruine les sur¬plombent et la neige saupoudre les sommets. Appa¬raissent ensuite ces villages aux hautes maisons colo¬rées agrémentées de colombages de bois. Il quitte alors l’autoroute pour les traverser. Ses vacances com¬mencent par un peu de tourisme, un retour aux sources et à ses racines qu’il aime tant. Il passe aux abords de Sélestat puis se dirige vers le nord en traversant plusieurs hameaux tels que Barr et Obernai. Il s’extasie sur l’architecture et les couleurs qui lui mettent du baume au cœur, il est loin de la gri¬saille parisienne. Des cigognes sont encore là, malgré le froid mordant, comme pour parfaire la carte postale. Toutes les maisons sont décorées pour les fêtes. Lorsque, au village suivant, en passant une impo¬sante porte médiévale, il découvre un petit marché de Noël sur la place, il décide de faire une halte. Il gare sa voiture et s’étire avec délice. Le froid le vivifie. Il avait plus que besoin de se dégourdir les jambes. Devant les chalets de bois se pressent quelques badauds, des tou¬ristes et des enfants aux yeux remplis d’étoiles. Lui aussi a les yeux qui pétillent et sa joie déborde lorsque quelques flocons de neige se mettent à virevolter. Il re¬garde ces cristaux cotonneux descendre du ciel en une danse légère pour se poser délicatement sur les toits et sur le sol. Il s’arrête à un premier chalet pour s’acheter de quoi se remplir l’estomac avec un bretzel et un pain d’épices. Tout en dégustant sa collation typiquement alsacienne et en retrouvant les goûts de son enfance, il se balade entre les stands. Il n’a pas encore réalisé ses achats pour Noël, c’est peut-être l’occasion de trouver quelques cadeaux. Après avoir fait un premier tour en flânant et en s’imprégnant de cette ambiance si particulière que nombre de villages en France essaient d’imiter sans jamais y parvenir, il recommence plus concentré sur les étals. Il choisit une miniature de librairie, au bâti carac¬téristique de l’Alsace, qui ravira sa mère et complétera son village de Noël ainsi que des boucles d’oreilles en céramique artisanale pour sa sœur. Comme chaque année, trouver un présent pour son père est plus diffi¬cile. Il opte finalement pour d’appétissants chocolats et choisit en priorité ceux fourrés aux liqueurs régionales. Il sait que son père est gourmand, aussi, même si un ballotin de friandises n’est pas grand-chose, il est certain de lui faire plaisir. Satisfait et reposé, il reprend la route. Rapidement, le chemin le mène en direction des montagnes, les vi¬rages toujours plus serrés se perdent dans les forêts de résineux dont les aiguilles recouvertes de neige étince¬lante semblent se parer d’un manteau de diamant. Plus il s’approche du col et plus la route se couvre de neige mais, ici, cela ne pose pas de problème, les habitants ont appris à dompter cette poudre blanche, que ce soit sur roue, à ski ou en raquettes. La physionomie des ha¬meaux qu’il traverse change, les maisons perdent en couleurs et gagnent en bois, prenant de plus en plus l’aspect de villages de montagne, tout en gardant cette touche alsacienne si particulière. Plus que quelques kilomètres et il sera arrivé. La neige tombe de plus en plus drue d’un ciel de plomb et le vent commence à se lever. Les épicéas et les sapins se balancent paresseusement mais tout le feuillage ondule lorsqu’un courant d’air s’engouffre entre les troncs. Il se croirait face à une mer agitée d’aiguilles vert sombre et d’écume blanche. Son village apparaît enfin, il remonte la rue princi¬pale et s’arrête devant une maison un peu isolée, au style hybride entre le chalet de montagne et la maison alsacienne. Elle tient de la seconde sa couleur jaune paille et ses boiseries foncées, et de la première sa petite taille ainsi que l’escalier, le balcon, la terrasse et les balustrades de bois. Andreas observe avec tendresse la maison de son enfance qui n’a pas changé. La perspective de ces fêtes en famille, tous réunis comme au bon vieux temps, le rend joyeux. Le jeune homme s’extirpe de sa voiture, sans prendre la peine de mettre son manteau, en voyant sa mère s’avancer à sa rencontre, impatiente de le serrer dans ses bras et rassurée de le voir arriver sain et sauf. En quelques enjambées, il la rejoint et l’embrasse af¬fectueusement. Ensemble, ils s’engouffrent dans la petite maison où brûle un bon feu dans la cheminée. Ces quelques secondes passées dehors l’ont frigorifié, aussi, il s’approche de l’âtre pour se réchauffer. Son père est assis à la grande table de bois en train de lire un journal. Andreas l’embrasse en passant. Debout devant le feu, s’enivrant de l’odeur de pin qui brûle, le jeune homme répond aux questions de ses parents. Il trouve toutefois son père trop silencieux, trop sombre et cela l’inquiète. Une fois sa curiosité comblée, Lidy se dirige vers la cuisine pour préparer un goûter conséquent à son fils, qu’elle a décidé de gâter autant que possible durant son séjour. Profitant d’être seul avec son père, Andreas demande : — Je te trouve préoccupé, que se passe-t-il, Papa ? — Kevin ! En plus de passer les fêtes avec nous, il m’a encore demandé de l’argent, j’ai dit que je ne pou¬vais pas, il ne m’a pas cru. Il a insisté, je n’ai pas cédé parce que je ne peux vraiment pas, mais ta mère me fait la tête. Elle n’est pas au courant de la situation… — Je sais… Tu devrais peut-être le lui dire, elle se fera du souci, mais au moins, tout sera plus clair. Et puis il faudrait parler à Elsa, ça ne peut plus durer comme ça, ni pour elle ni pour nous… Je ne suis même pas certain que ma sœur soit heureuse avec Kevin et je ne pense pas qu’elle sache que son petit copain nous demande régulièrement de l’argent, elle est trop fière, elle ne l’accepterait pas ! — Elle a déjà deux boulots pour qu’ils vivent, elle ne peut pas faire plus et, lui, il ne peut soi-disant pas travailler car il faut qu’il reste disponible pour se pré¬senter aux auditions et passer les castings… Tu sais qu’il a refusé un petit rôle de figurant dans une série parce que « si on est catalogués figurants, on le reste » et il souhaite être en tête d’affiche… Lidy revient de la cuisine les bras chargés et gronde son mari : — Tu es encore en train de critiquer Kevin, laisse ce pauvre garçon tranquille, Elsa a 30 ans, elle est suffi-samment grande pour faire ses choix. Elle semble heu¬reuse, alors, même si tu n’apprécies pas son copain, tu fais bonne figure. De toute façon, aucun homme ne sera jamais assez bien pour ta fille. Andreas et son père se regardent, complices, et changent de conversation. Andreas mange de bon cœur le succulent Stollen préparé par sa mère. Elle est ravie par ses compliments et heureuse de lui faire plaisir. Le jeune homme prend enfin le temps de détailler la décoration, très colorée sans être surchargée, de la pièce principale. Les guirlandes scintillent à la lueur des flammes et, à la nuit tombée, les guirlandes lumi¬neuses prendront le relais. Le village d’hiver trône sur le buffet tandis que la crèche est disposée à côté de la cheminée. Le grand sapin est à l’autre bout de la pièce afin qu’il ne prenne pas chaud et qu’il garde le plus longtemps possible ses aiguilles, même si ces dernières sont complètement noyées par des sujets, boules et nœuds de toutes couleurs, pendus aux branches. Dehors, le vent hurle et la neige redouble. Chapitre 2 Amélia observe les éléments qui se déchaînent par la fenêtre et, même si elle est au chaud, elle ne peut réprimer un frisson. Cette nature sauvage lui avait telle¬ment manqué. Ce retour aux sources est un véritable bonheur. Enfant, elle était en communion parfaite avec les éléments, adolescente, elle retrouvait ce lien privilégié ici quelques semaines par an, il a finalement été rompu lorsqu’elle est partie faire ses études de commerce et finance à Londres. Probablement la plus grosse erreur de sa jeune vie. Elle s’est exilée loin de tout ce qu’elle aimait et de tous ceux qui comptaient pour elle, simple¬ment pour avoir un meilleur poste et un salaire plus conséquent, mais cela sans avoir une meilleure vie, bien au contraire. Elle a cédé à son père pour qui la po¬sition sociale est le plus important et elle en paie main¬tenant le prix. Elle s’arrache à la contemplation des flocons qui volent en tous sens dans le vent, elle pourrait les suivre des yeux des heures durant. Il est temps de goûter et elle a une folle envie d’un bon chocolat chaud qui lui rappelle les joies de son enfance. Elle se dirige vers la cuisine, met du lait à chauffer puis casse des carrés de chocolat noir dans la casserole, elle mélange ensuite lentement, jusqu’à ce que le lait prenne une belle cou¬leur marron, puis prépare deux tasses qu’elle remplit du breuvage soyeux et revient au salon. Près de la cheminée, sa grand-mère lit en silence. Elle a l’habitude d’être seule, toutefois, Amélia lui est reconnaissante de ne pas lui poser de questions sur son retour précipité. Elles ont toujours été très proches et Iseline a un sixième sens avec les gens, elle reconnaît ceux qui ont bon cœur et ceux qui souffrent, elle sait aussi quand parler ou quand se taire pour ne pas blesser. — J’ai préparé du chocolat chaud, Grand-mère. — C’est une très bonne idée, ma chérie, ça fait des siècles que je n’en ai pas bu. Elle attrape la tasse que lui tend Amélia, en la remerciant. Elles sirotent leur collation avec du pain d’épices tout en discutant de leur dernière lecture et du prochain pull qu’Iseline tricotera pour les « nécessiteux ». Elle demande conseil à sa petite-fille sur les couleurs à choisir, elle souhaite des tons à la mode mais aussi des teintes qui remontent le moral. Amélia aimerait tant ressembler à sa grand-mère, avoir ce cœur généreux, penser aux autres constam¬ment, passer une vie simple entourée de personnes de confiance. Toutefois, elle sait que les temps et la société sont différents, de plus, elle ne pourrait pas vivre à l’année dans ce lieu reculé, même si elle adore cette maison et la nature sauvage qui l’entoure. Elle a besoin d’exercer une activité, de côtoyer du monde… Bien qu’en ce moment, elle se cache pour essayer de se reconstruire. Des amis, elle n’en a plus, elle ne peut pas compter sur ses parents et a acquis la certitude qu’elle s’est trompée de voie, la finance, ce n’est pas fait pour elle. Elle préférerait être utile, aider les autres, devenir enseignante ou assistante sociale par exemple. Iseline est son seul soutien, son seul réconfort et elle ne l’échangerait contre aucun autre. En voyant les cartons de décorations de Noël, Amélia soupire, elle n’a pas le courage de se lancer dans l’ornementation de la maison ni d’aller couper le sapin, seule. Elle en a pourtant repéré un parfait en se baladant, en plus, il est au pied d’un gigantesque adulte qui lui fait de l’ombre, il n’a que peu de chance de grandir, il finira par dépérir par manque d’eau et de lumière. Noël n’est une fête que si l’on est entouré. À deux, les festivités sont un peu limitées et sa grand-mère n’a plus la condition physique pour arpenter la forêt ou seulement grimper sur une chaise pour accro¬cher des guirlandes. Amélia regrette les grandes réunions de famille de son enfance, la maison pleine de vie, de bruits et de chants. Elle se souvient des bals du nouvel an, comment oublier celui de ses 16 ans ? Elle retourne se poster à la fenêtre, perdue dans ses souvenirs de fillette et d’adolescente tout en finissant son chocolat. Elle range ensuite le goûter puis se met au piano. Elle commence par quelques airs de Noël puis sa tristesse reprend le dessus, elle interprète des mélodies mélancoliques de Bach et Debussy. Jouer du piano lui avait manqué, elle est heureuse de constater qu’elle n’a pas perdu sa dextérité et que sa mémoire ne lui fait pas défaut. Revenir ici, se ressourcer, est la meilleure décision qu’elle ait prise et cela la rassure sur ses capacités à reprendre sa vie en main, à gérer son avenir. Toutefois, elle ne se sent pas encore assez forte pour tenir tête à son père, passer outre ses envies et ses exigences pour mener la vie qu’elle souhaite. Elle sait, cependant, qu’Iseline sera son alliée dans cette difficile épreuve. Sa grand-mère n’a jamais eu peur de tenir tête à qui¬conque, et encore moins à son fils qui, bien qu’il s’en défende, la craint encore comme un petit garçon. Apaisée par la musique, Amélia se fait plus bavarde pour tout le bonheur de sa grand-mère qui s’inquiète de la voir si sombre, si triste, si tourmentée. Elle ne sait comment aider cette enfant qu’elle chérit tant, si ce n’est en étant disponible et à son écoute. Iseline aime¬rait qu’Amélia se confie à elle, mais la jeune fille de 24 ans ne semble pas encore prête pour cela. La dame aux cheveux blancs n’est pas pressée, elle a tout son temps, de bien longues journées, maintenant qu’elle est trop âgée pour se promener dans la neige. Elle espère juste que sa petite-fille s’ouvrira à elle, elle voudrait re¬trouver l’Amélia pleine de vitalité, de joie et de projets, qu’elle connaissait. Lia, comme elle est la seule à la surnommer, n’était pas revenue la voir depuis cinq longues années et elle a beaucoup de mal à la recon¬naître. Elle semble brisée. Chapitre 3 En début de soirée, Elsa et Kevin rejoignent la petite habitation jaune paille, au bout du village. Andreas serre sa grande sœur dans ses bras, ils ont toujours été très unis et la retrouver dans la maison familiale est un plaisir. Il n’y a qu’une ombre au tableau : la présence de Kevin. À peine arrivé, ce dernier fait des remarques désagréables sur tout et sur rien, et cela horripile Andreas qui décide d’avoir une discussion avec sa sœur. Il l’entraîne joyeusement vers la boulangerie, mais, au milieu du trajet, il se fait plus sérieux et demande : — Tu es vraiment heureuse avec Kevin ? Surprise, Elsa ne répond pas et son frère enchaîne : — Parce que, je suis désolé, j’ai beau faire des efforts, je n’y arrive pas, je ne sais pas ce que tu lui trouves, il est désagréable. J’ai toujours imaginé que ton mari deviendrait un ami pour moi, presque un frère, et que ma femme aurait une relation privilégiée avec toi… Et là, ça ne fonctionne pas et ça me peine. Tu as entendu les remarques qu’il a faites sur la décoration du salon et la choucroute que Maman nous a préparée. Elle y a passé des heures, et lui, au lieu de la remercier pour son hospitalité, il est contrarié parce qu’il n’y a pas de foie gras. Il pense vraiment que les parents ont les moyens d’acheter ce genre de produits ? Tu sais que leur situation financière est catastrophique ? — Je sais que vous ne vous appréciez pas, si ça peut te rassurer, c’est réciproque, il ne t’aime pas non plus, il te trouve trop parfait. Il côtoie des gens importants et il essaie de faire croire qu’il évolue dans la même sphère qu’eux, et il oublie qu’avec nous il peut être naturel. — Parce qu’il sait l’être ? Appelle-moi ce jour-là, je veux voir ça ! — Tu es limite méchant, là, Andreas. — Pardon Elsa, je ne voulais pas… Son comporte¬ment avec les parents m’a mis hors de moi. — Je lui dirai de faire attention, soupire la jeune femme. Après un bref silence, Elsa reprend le fil de la conversation : — Tu exagères quand tu dis que la situation finan¬cière des parents est catastrophique, ils s’en sortent, même s’ils ont des revenus très modestes… — Non, Sœurette, je n’exagère pas, mais Maman n’est pas au courant alors tu ne dis rien, d’accord ? — Promis ! Explique-moi. Après un temps d’hésitation, Andreas s’exécute, de toute façon, il en a trop dit alors autant tout déballer : — Quand Papa a eu son accident, qu’un arbre lui est tombé dessus et qu’il a fini en fauteuil roulant, l’entre¬prise de sylviculture ne voulait pas lui verser d’indem¬nité, son patron disait qu’il avait commis une erreur alors que c’était faux. — Oui, je sais ! Il est même allé au tribunal, j’étais plus âgée que toi et j’ai suivi l’affaire… — Tu sais donc que son avocat lui avait certifié qu’il ne pouvait pas perdre et qu’il aurait de belles indemnités ? — Oui, mais finalement il s’est fait écraser par l’en¬treprise et il n’a rien eu ! C’était injuste ! — Et il a dû hypothéquer la maison pour payer les frais de justice… Maman n’a pas pu chercher du travail de suite, il était en pleine dépression, elle avait peur qu’il fasse une bêtise, il a mis du temps à accepter la situation. — Cette période a été difficile pour nous aussi… se souvient tristement Elsa. — Les faibles économies des parents ont été englou¬ties, l’allocation handicap de Papa ne cesse de baisser, comme si, avec le temps, il allait mieux ! Le salaire de Maman n’est pas élevé et, depuis presque deux ans, avec l’inflation, ils ne peuvent plus rembourser la banque sur l’hypothèque… C’est moi qui paie pour que la maison ne soit pas saisie. Ça ne me pose pas de problèmes, j’ai un salaire correct et aucune famille à charge… Maman ne le sait pas, mais tu te doutes ce que ça a coûté à Papa de me demander de l’aide, alors, les remarques de petit bourge de ton mec, ça a du mal à passer ! — Merde, pourquoi il ne m’a rien dit ? — Parce qu’il ne voulait pas t’inquiéter et puis tu as déjà deux boulots pour entretenir le train de vie de Kevin… Tu ne peux pas en faire plus ! Ton jean est rapiécé alors qu’il se pavane dans des habits de marque hors de prix. On remarque tous tes traits tirés et sa mine bronzée. Tu te crèves au boulot alors qu’il parade… Ça aussi, j’ai du mal à l’accepter, c’est pour cela que j’espère qu’il te rend heureuse d’une façon ou d’une autre, Elsa. La jeune femme reste silencieuse, perdue dans ses réflexions. Andreas achète deux baguettes de pain et des mauri¬cettes. Sur le chemin du retour, le jeune homme se remet à taquiner tendrement sa sœur et ils franchissent la porte de la maison familiale dans un fou rire com¬plice pour tout le bonheur de leurs parents. La neige, qui avait presque cessé de tomber durant l’après-midi, redouble. Le repas se passe dans la bonne humeur, Kevin ne desserre pas les dents, il semble bouder. Elsa lui a fait la leçon. Il va se coucher tôt, tandis que la soirée s’éternise. Parents et enfants sont heureux de se retrou¬ver comme avant, ils ont beaucoup à partager et des souvenirs à se remémorer. Au moment de monter se coucher, Andreas prend conscience qu’il a oublié de décharger sa voiture. Dehors, le noir est total, la lune est masquée par les nuages et le vent souffle, il s’engouffre dans le conduit de cheminée en un chant sinistre. Le jeune homme dé¬cide de se débrouiller, pour cette nuit, avec les affaires qu’il a laissées ici. Sa chambre n’a pas changé depuis qu’il a quitté la maison, elle est restée figée dans le temps avec ses posters de Bugatti Veyron et de moteurs W16 et V8 aux murs. Fasciné par les bolides, il a toujours voulu travailler dans l’industrie automobile. Il trouve dans ses tiroirs un tee-shirt et un caleçon qui feront un parfait pyjama et une brosse à dents neuve à la salle de bains, dans la réserve, au même endroit que lorsqu’il était enfant. Il se couche enfin dans son lit, ses pieds dépassent au bout, c’est un meuble ancien, non conçu pour la nouvelle génération si grande. C’est la seule chose qu’il a été ravi de quitter en partant de la maison. Andreas se réveille tôt, l’absence de bruit trouble son repos, lui qui s’est, peu à peu, habitué au ballet incessant des voitures sous ses fenêtres. Il profite qu’une grande partie de la maisonnée soit encore endormie pour occuper l’unique salle de bain. Il prend une douche bien chaude, utilisant le gel douche et le sham¬poing de son père puis se rase comme lui. Il étale une belle couche de mousse blanche sur son visage puis passe un rasoir à main jetable, il ne l’avait plus fait depuis si longtemps qu’il est heureux de ne pas s’être coupé. Tout cela le ramène cinq ans en arrière, avant qu’il parte faire ses études d’ingénieur en région pari¬sienne après deux années difficiles de prépa. Il n’était pas encore vraiment un adulte. Au salon, Lydi s’escrime à s’occuper de la cheminée tandis que Kevin la regarde faire en prenant son petit déjeuner sans que lui vienne l’idée de l’aider. Andreas le fusille du regard puis s’occupe de vider le tiroir de cendres et de ramener de grosses bûches. Il prépare ensuite la flambée et, lorsque le feu est bien parti, il ajoute un gros rondin de bois. Il s’assoit finalement à table et déjeune sans adresser un mot à son beau-frère. Ce dernier rompt le silence le premier : — Andreas, tu pourrais me dépanner de cent euros pour que je fasse un cadeau de Noël à ta sœur, s’il te plaît ? Andreas a envie de l’envoyer balader, cependant, il garde son calme, les fêtes sont importantes, ces mo¬ments en famille trop rares pour être gâchés. Il attrape son portefeuille et en sort deux billets de vingt, et un billet de dix euros. — C’est tout ce que j’ai, je suis désolé, dit-il en tendant l’argent à Kevin. Ce dernier grogne des remerciements incompréhen¬sibles en faisant la moue. Norman arrive peu de temps après et positionne son fauteuil roulant en face de son fils qui vient l’embras¬ser, tandis que Lidy apporte un bol de café bien noir à son mari. La discussion commence par des banalités, le froid et le vent qui a encore forcit, d’autant qu’une tempête accompagnée de fortes chutes de neige est annoncée pour la fin de journée. Andreas écoute avec attention les dires de son père tandis que Kevin commence à critiquer la région et déclare qu’il ne supportera pas de passer deux semaines enfermé ici sans voir la civili¬sation. Norman ne relève pas, tandis qu’Andreas se retient de lui dire de ne pas se gêner pour partir s’il ne se sent pas bien dans cette maison. Elsa se lève la dernière et trouve sa famille en grande conversation, sa mère donne des nouvelles de tous les voisins et de tous leurs anciens camarades de classe, elle s’intègre immédiatement dans le babillage tandis que Kevin reste en retrait. Lorsque le flot de parole se tarit enfin, Kevin accapare l’attention d’Elsa et finit par se plaindre qu’il n’est pas traité à sa juste valeur, qu’on lui fait comprendre qu’il n’est pas le bienvenu. L’ambiance dans le chalet se glace, plus personne n’ose parler. Andreas essaie de relancer une conversation et, comme le sujet en est madame Klein, une adorable dame âgée chez qui Lidy travaille et qui embauchait Andreas pour faire quelques travaux pendant les vacances lorsqu’il vivait encore chez ses parents, Kevin l’accuse de tout faire pour qu’il se sente exclu. Le jeune homme reste sans voix face à cette incrimi¬nation. Il fulmine, se lève et commence à tourner en rond, finalement, il annonce qu’il va faire une petite balade. Dehors, le ciel est bas, presque blanc, le vent souffle fort et les gros flocons tombent drus en tour¬billonnant avant de se poser. Respirer l’air pur le calme un peu, cependant, il est hors de question de partir faire une balade en forêt comme il l’avait projeté. Une évi¬dence lui traverse alors l’esprit. Il rentre prendre ses clefs de voiture et annonce : — Je monte chez madame Klein, s’il y a effecti¬vement une tempête ce soir, le col sera fermé pendant plusieurs jours et il est hors de question que je ne passe pas lui souhaiter de joyeuses fêtes. Ne m’attendez pas pour midi. À ce soir ! Lorsque Andreas se met au volant de sa Mégane, il a un sourire aux lèvres. Il adore Iseline Klein, il la consi¬dère comme sa grand-mère et aime les moments qu’ils passent à bavarder au coin du feu. Au moins, il n’aura plus à supporter Kevin, toutefois, il ne sait pas com¬ment il va pouvoir garder son calme durant quinze jours. Il espère que son beau-frère décidera de partir, mais redoute que sa sœur l’accompagne, ce qui gâche¬rait les fêtes. Il roule au pas, la visibilité est presque nulle et la route se recouvre très vite d’une belle couche de pou¬dreuse. Le chasse-neige est visiblement passé peu de temps avant lui, pourtant, il faudrait presque recom¬mencer. Il a rarement vu une chute de neige aussi conséquente. Plus il monte et s’enfonce dans les bois et plus le vent se fait violent. Heureusement, il est le seul à avoir eu l’idée de prendre sa voiture dans ces conditions. Quelques kilomètres avant le col, des employés de la voirie l’arrêtent et l’invitent à rebrousser chemin, la route n’est déjà plus praticable et cela va aller en empirant. Andreas n’arrive cependant pas à se résigner, il décide de garer sa voiture à l’orée du bois et de faire le reste du chemin à pied, à vol d’oiseau, il n’est vraiment pas loin de son but.
100
« Dernier message par Apogon le jeu. 13/10/2022 à 17:58 »
Les enquêtes de Marie Rose Bailly - Le souffle du diable de Julie JKR Pour l'acheter : Amazon1 « Je sais que je suis mort, mais deux questions ne cessent de me tourmenter. La première, de quelle manière ai-je été tué ? Car il ne fait aucun doute dans mon esprit que mon décès résulte d’un meurtre. Quant à la seconde, j’aimerais découvrir qui en est à l’origine. Qui est celui ou celle qui s’est permis de m’ôter la vie ? Je suis dans un entre-deux entouré par d’autres âmes égarées. Elles me terrifient, et je n’ai aucune idée de comment en sortir. » Une semaine après notre retour à Londres, la voix d’un jeune homme s’est présentée à travers ma perception. Il semblait désorienté, ce que je pouvais tout à fait comprendre, mais il y avait autre chose, comme une sorte d’inquiétude grandissante. Je l’ai laissé parler, il avait l’air d’en avoir besoin, car contrairement à Lizzie Williams, lui était au fait de sa condition. Ce n’était pas toujours vrai d’après ma grand-mère, mais parfois les morts savent qu’ils le sont, et c’était le cas avec lui. En ce qui concernait les raisons de son passage de l’autre côté, il n’en avait aucun souvenir. Il était capable de me dire qui il était, ce qu’il faisait dans la vie, mais la cause de son décès restait un mystère que j’allais devoir résoudre. Dorian a mis ses talents de recherches au service de mon nouvel hôte, et ensemble, nous nous sommes lancés dans cette deuxième enquête qui promettait d’être terrifiante à souhait. David Guillot, vingt-trois ans, résidait à Argenteuil et étudiait l’histoire à la Sorbonne, université parisienne. Ce sont les informations que Dorian a pu confirmer en effectuant ce qu’il faisait de mieux, enquêter, chose que j’apprenais encore à faire. Pour le reste, David a été ma source. Il avait perdu ses parents à l’âge de neuf ans, sa tante s’était alors chargée de l’élever. Il n’avait pas d’autre famille, du moins c’est ce qu’il m’a dit. Il ne s’est pas étendu sur le sujet, et je n’ai pas cherché à le faire non plus. Il venait d’entamer sa deuxième année de master, et depuis quelque temps, il avait envie d’étoffer ses connaissances sur une matière qu’il affectionnait tout particulièrement, les croyances et sciences occultes des civilisations anciennes. J’avoue que ça avait l’air passionnant comme intitulé, mais en même temps l’information provenait d’un mort qui ignorait comment il en était arrivé là. Est-ce que son décès résultait directement de son envie d’apprendre de nouvelles choses ? Où est-ce qu’il s’était simplement retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment ? Pour pouvoir répondre à mes nombreuses interrogations, j’allais devoir obtenir plus de détails, mais avant tout, je devais entrer en contact avec la tante de David pour essayer de glaner quelques indices supplémentaires. J’aurais voulu lui annoncer la terrible nouvelle, mais le corps de David n’avait pas été localisé, et nous ne savions pas où il se trouvait. Et puis à part Dorian, personne ne connaissait mes capacités, alors comment leur expliquer que David était mort ? En revanche, elle pourrait m’en apprendre plus sur son neveu. Aucun signalement de disparition n’avait été émis, soit sa tante ignorait tout, soit elle n’avait tout bonnement pas prévenu les autorités. Il fallait éclaircir ces deux cas de figure si je comptais avancer dans notre enquête. Nous n’aurions aucun mal à la rencontrer, nous étions dans la tranche d’âge de David, nous nous ferions passer pour des amis à lui. Deux jours plus tard, le vingt-huit janvier deux mille dix-huit, je recevais l’appel d’une mère inquiète, qui souhaitait nous engager pour retrouver son fils, dont elle n’avait aucun signe depuis une semaine. Notre notoriété s’était étendue à l’internationale, l’affaire des petites filles de Londres n’était pas restée dans l’enceinte du pays. À présent, Noah Janssens faisait également partie de la liste où le nom de David Guillot se trouvait. Deux disparitions, et deux histoires similaires. Aucune chance que ce soit une coïncidence. 2 – Marie Rose ? David m’a réveillée sur les coups de sept heures du matin, sa voix grésillait dans ma tête. – Je suis là David. – Tu te souviens l’autre jour quand je t’ai dit que je ne me rappelais rien, et bien ce n’est pas tout à fait vrai. Seulement, voilà, je ne sais pas si c’est réellement arrivé. Je comprenais très bien de quoi il parlait, ma première enquête avait été assez bizarre sur le sujet, pour que les paroles de David me troublent. – Qu’est-ce que c’est ? – Je suis drapé dans un tissu blanc et allongé sur quelque chose de dur, comme de la pierre. Je suis transi de froid et j’ai l’impression que je baigne dans un liquide gelé. – Est-ce que c’est toujours le cas ? – Non, là j’ai la sensation d’errer dans un brouillard permanent. Je suis immobile, et la seule chose que je peux faire, c’est communiquer avec toi. La mort, quel étrange phénomène. Il semble différent d’un individu à l’autre ! Vous pouvez être mort et pourtant continuer à évoluer parmi nous, ou alors être coincé à l’endroit exact où vous avez poussé votre dernier soupir. David, lui, était figé dans une sorte de néant sans fin. – Je suis parfaitement conscient que ça ne va pas vous aider à comprendre ce qu’il m’est arrivé, mais ça défile devant mes yeux, sans que je puisse l’arrêter. – Tu veux dire que les images passent en boucle ? – Oui, comme si mon cerveau essayait de me montrer quelque chose, mais je ne parviens pas à mettre le doigt dessus. Est-ce qu’il le pouvait seulement ? Pouvoir se remémorer des choses faisait partie du monde des vivants, les morts étaient-ils capables d’en faire autant ? Je n’en avais aucune idée, mais si l’enquête sur la petite Lizzie m’avait appris une chose, c’était bien que les voix pouvaient nous surprendre bien plus qu’on ne le soupçonnait. – David est-ce que tu vois autre chose sur ces images ? – Non, mais j’entends des sons, comme des voix que je ne connais pas, et qui parlent une langue dont je ne comprends pas le sens. – Pourrais-tu me répéter un mot ou deux ? – C’est un bruit de fond, trop lointain pour qu’il soit clair. – Ça ressemble plus à une conversation, ou à un chant ? – Aucun des deux, on dirait que les voix récitent quelque chose. De plus en plus vite, mais de plus en plus bas aussi. Soudain, une vibration grave et lancinante a envahi ma tête, elle a même fait siffler mes appareils. Elle ne provenait pas de mon environnement immédiat, mais bien de ma perception. Voilà que ça recommençait, mais bien plus fort, et cette fois, je me suis senti mal à l’aise, puis mal tout court. Dorian est apparu la seconde d’après, l’air inquiet, une serviette humide à la main. – Marie Rose ça va ? Que s’est-il passé ? – Comment ça ? – Je t’ai trouvé inconsciente sur le sol du salon. Mais de quoi parlait-il ? – J’ai entendu un bruit sourd, et quand je suis arrivé, tu étais allongée par terre, les yeux révulsés. C’était quoi encore cette histoire ? Je n’avais aucun souvenir d’avoir perdu connaissance. Je parlais avec David, puis j’ai entendu ce bruit et ensuite Dorian était là, à mes côtés. Je n’avais pas eu de trou noir, je me rappelais de tout. – Je ne comprends rien, je suis pourtant certaine que tout va bien. Il est vrai que je me suis sentie un peu mal après mon échange avec David, mais sinon rien d’autre. – Marie Rose, tu n’as plus adressé la parole à David depuis au moins une heure. Qu’est-ce qu’il racontait ? Je venais de discuter d’informations avec lui, il n’y avait pas deux minutes. – Tu plaisantes ? C’est ça ? – Tu es entrée dans le bureau et tu m’as fait part des dernières nouvelles concernant David et de ses dernières paroles. Ensuite, tu m’as dit que tu devais appeler ta mère, et il y a cinq minutes, je t’ai trouvé inanimée. Notre conversation remonte à presque une heure Marie Rose. Une heure. Soixante minutes manquantes. Un laps de temps pendant lequel je n’avais aucune idée de ce que j’avais fait, ni même de ce qu’il s’était passé. J’ai jeté un œil sur ma montre, non pas par manque de confiance en Dorian, mais j’avais besoin de me rassurer. Lorsque j’ai vu qu’elle affichait huit heures dix, mes yeux se sont ouverts en grand, et il a compris immédiatement que je ne me souvenais de rien, et qu’il venait par la même occasion de me faire peur. – Je ne voulais pas t’effrayer, je suis désolé Marie Rose. Dorian n’y était pour rien, ce n’était pas sa faute si mon cerveau avait effacé un bout de ma mémoire. 3 L’épisode de ce matin restait toujours un mystère pour moi. Il occupait toutes mes pensées, même si je m’efforçais de l’occulter. Avec Dorian, nous avions une enquête à mener, et ce genre de contretemps ne devait pas prendre le pas sur nos recherches. Étant donné que nous avions une affaire similaire à celle de David, le temps était quelque chose de précieux, et il était hors de question de le gâcher en problème personnel. Problème dont je n’avais de toute évidence pas la solution pour le moment. La tante de David avait accepté de nous recevoir en fin d’après-midi, elle n’avait pas eu l’air triste ou soupçonneuse, ce qui m’a conforté dans mon idée qu’elle n’était pas au courant que son neveu manquait à l’appel. Je n’ai rien dit au téléphone qui puisse lui suggérer une quelconque information contraire, je préférais être face à elle pour lui apprendre la nouvelle. Installé dans l’avion, Dorian n’arrêtait pas de me jeter des regards inquiets. – Tu as envie de me dire un truc peut-être ? – Non pas vraiment, enfin si, mais je ne sais pas… Voilà qu’il se mettait à bégayer, ça devait être quelque chose de perturbant. Je ne l’avais jamais vu comme ça, pas même lorsque nous avions découvert les cadavres des petites filles dans le musée de l’Horreur. – Dis-moi, tu commences à m’inquiéter. Je l’ai vu hésiter, puis après deux grandes inspirations, il s’est lancé. – Je ne crois pas que ce soit une bonne idée que tu continues d’écouter David. – Ah bon ? Et pourquoi ça ? – Eh bien, parlons de l’épisode de ce matin. Je t’ai déjà vu perdre connaissance, mais cette fois c’était différent. – Comment ça ? – J’ai mis au moins dix minutes à te réveiller, et quand tu as enfin ouvert les yeux, on aurait dit que tu n’étais pas vraiment là. J’ai eu la peur de ma vie. Il était soucieux et attentionné, mais la lueur dans son regard m’indiquait autre chose que je n’arrivais pas à identifier. – Marie Rose, l’enquête débute à peine, qui nous dit que ce genre de crise, je ne sais même pas comment appeler ça… – Moi non plus… – Si ça se reproduit qui nous dit que ce ne sera pas plus grave ? Tu ne te souviens de rien, alors ne me dis pas que j’ai tort de réagir ainsi. Je le comprenais plus qu’il ne l’imaginait, mais je n’allais pas renoncer à aider David et Noah simplement à cause d’une amnésie temporaire. – Ça va me revenir ne t’en fais pas. Tu es bien placé pour savoir que le cerveau est capricieux par moment. – Si tu veux parler de ce qu’il m’est arrivé, je souffrais d’une commotion cérébrale, ce qui n’est pas ton cas. Touchée. – Oui enfin tu m’as comprise. – Oui, mais on dirait qu’à l’inverse, toi, tu ne saisis pas ce que j’essaye de te faire comprendre. – Écoutes Dorian, on va faire un marché, si je dois à nouveau me trouver dans la même situation que ce matin, je te promets de réfléchir à lever le pied. J’espérais sincèrement que ça lui suffirait. – Réfléchir à lever le pied ? Ce qui signifie dans ton langage, je continuerai jusqu’à découvrir le fin mot de l’histoire. Il me connaissait un peu trop bien. Je lui ai pris la main et j’ai déposé ma tête sur son épaule. Il s’est légèrement détendu, et nous n’avons plus évoqué le sujet. Sylvie Hubert vivait dans un petit appartement au dixième étage d’une tour qui en comptait quinze. Les portes de l’ascenseur étaient barrées par une chaîne où pendait une pancarte « En panne » et juste en dessous quelqu’un avait ajouté la mention « comme toujours ». La perspective de devoir gravir des dizaines de marches ne m’enchantait pas plus que Dorian, mais nous n’avions pas le choix. La cage d’escalier en colimaçon donnait l’impression de tourner autour d’un serpent de béton. Très vite, j’en ai eu le tournis, et il nous restait encore six étages à monter. Dorian était passé le premier, et je sentais que pour lui aussi, ça commençait à faire beaucoup. Nous étions certes jeunes et en bonne santé, cela ne nous empêchait pas d’être à bout de souffle. Arrivés sur le palier, la porte de l’appartement de madame Hubert se trouvait face à nous. Nous avons d’abord repris notre respiration, je me suis essuyée le front, et ensemble nous avons frappé. Une femme d’une cinquantaine d’années nous a ouvert. Souriante et accueillante, ce qui a immédiatement confirmé ce que je pensais, elle n’était au courant de rien. – Bonjour, madame Hubert, je suis Marie Rose Bailly et voici Dorian Anderson. Ça semblait si formel, et en même temps c’était le cas, mais elle l’ignorait encore. Elle nous a invités à entrer, nous a escortés jusqu’au petit salon sur la droite, et nous nous sommes installés pendant qu’elle nous servait un verre d’eau bien mérité. – Vous êtes des amis de David ? Il n’est pas très bavard comme garçon. – Oui, c’est exact. Toutes les conversations que j’échangeais avec un membre de la famille des voix que j’entendais commençaient toutes par un mensonge. Petit, mais mensonge tout de même. – Je suis contente qu’il ait des amis, j’étais persuadée que c’était un solitaire. Elle a continué à nous expliquer comment David paraissait secret, et à quel point il était renfermé sur lui-même. – Madame Hubert, est-ce que vous savez où est David actuellement ? Elle a eu l’air surprise par ma question. – Vous êtes ses amis n’est-ce pas ? – Oui. – Mais vous ignorez où il se trouve ? Maintenant, elle semblait carrément méfiante. – Écoutez madame Hubert, on s’inquiète parce que cela fait un moment que nous n’avons pas eu de ses nouvelles, et nous nous disions que vous seriez sans doute en mesure de nous aider. Mon plan de départ avait changé, je n’allais pas lui faire part de sa disparition de but en blanc. Sa méfiance à notre égard venait de choisir à ma place. – Il est parti étudier à l’étranger, un échange, ou quelque chose comme ça, c’est bizarre qu’il ne vous ait rien dit. – On a été pas mal pris avec les cours ces derniers temps. Le deuxième mensonge. La liste allait s’étoffer, c’était une certitude. – Votre ami ne parle pas beaucoup. Elle lança un regard suspect à Dorian. – Il fait également partie d’un échange entre universités, il vient d’Angleterre et son français laisse quelque peu à désirer. En revanche, il comprend très bien ce que nous disons. Ma petite remarque sur son français médiocre a fait sourire Dorian, et la tante de David s’est légèrement détendue. – Vous disiez qu’il est à l’étranger. Est-ce que vous savez où exactement ? – Pas vraiment, nous n’avons pas ce genre de relation. Nous ne discutons pas beaucoup, vous savez. Il est là plus par obligation, que par plaisir. Elle a détourné les yeux, puis elle a continué. – David a perdu ses parents très jeunes, et je suis la seule qui s’est proposée pour l’accueillir. Sa mère était ma sœur après tout, je n’allais pas laisser ce petit garçon livré à lui-même. Il n’a jamais fait le deuil si vous voulez mon avis, et je ne l’en blâme pas, mais il n’a pas non plus réussi à développer de l’attachement pour moi. Debout devant la fenêtre, nous l’avons vu s’essuyer le visage avec la manche de son gilet. J’ai eu de la peine. – Alors, pour tout vous dire, nous sommes plus comme des colocataires, que comme une famille. J’ai appris à vivre avec. Je l’ai laissé reprendre ses esprits. – Je suis désolée si nous avons fait émerger des souvenirs douloureux, il ne nous a jamais dit tout ça. – Ça ne m’étonne pas. J’accumulais les mensonges, mais ils commençaient à faire leur preuve, madame Hubert semblait encline à me croire. – Depuis combien de temps est-il parti ? – Attendez voir que je réfléchisse… je pense que je l’ai noté sur le calendrier. Elle s’est absentée un instant, Dorian a chuchoté. – Tu vas devoir faire diversion. – Pourquoi ? – Elle ne sait rien, nous allons devoir trouver des indices tout seul. – Oui, et qu’est-ce que tu comptes faire ? – Tu vas lui parler, pendant que j’irai fouiller dans sa chambre. Madame Hubert est revenue au moment où Dorian se levait, lui demandant avec son charmant accent, s’il pouvait utiliser ses toilettes. – Il ne se débrouille pas si mal. Quand il voulait quelque chose, il arrivait toujours à se faire comprendre. J’ai suivi les consignes de Dorian, j’ai tenu la conversation jusqu’à ce qu’il réapparaisse, puis nous avons quitté l’appartement sans nous retourner. 4 – Marie Rose, tu m’entends ? Mon corps flotte. –… – C’est glacial, mais c’est visqueux aussi. –… – Marie Rose ? Je ne suis pas sûr, mais je crois que le liquide… c’est du sang.
 Sujets récents
Sujets récents
|

 – jouer le rôle de la cliente si Alban le veut ;
– jouer le rôle de la cliente si Alban le veut ;
 – jouer le rôle de la cliente si Alban le veut ;
– jouer le rôle de la cliente si Alban le veut ;


 Messages récents
Messages récents

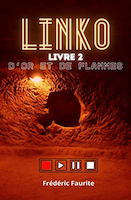

 ? scènes difficiles ^^
? scènes difficiles ^^ 







