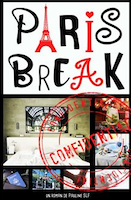81
« Dernier message par Apogon le jeu. 24/02/2022 à 17:50 »
Octave funeste de Valérie HoinardNouvelle fantastique  Pour l'acheter : Amazon Quelques notes de musique me parviennent, lointaines. Elles résonnent dans mon crâne, comme un écho. La tête me tourne, mon estomac me brasse. Je tente de ne pas laisser la bile remonter trop haut, alors que son acidité me brûle déjà la gorge. Je déambule rapidement en titubant, pieds nus, au milieu d’une brume aussi épaisse que glaçante. Elle m’enveloppe de sa froideur cadavérique. Où suis-je ? J’ai des difficultés à respirer. Ma poitrine me fait mal. C’est comme si j’avais reçu un coup de poignard en plein cœur. Que se passe-t-il ? Je m’arrête, puis ferme les paupières. Peut-être que je suis en plein cauchemar ? Oui, ce ne peut être que ça. Je me concentre sur ma respiration et, petit à petit, mon corps se détend. Une drôle de sensation parcourt mes bras en direction de la terre. Je la laisse traverser mes membres, ça me fera un poids en moins à transporter, quelle que soit ma destination. Quand toute pression semble avoir quitté mes veines, je rouvre les yeux. Rien n’a changé. J’ai toujours la bouche pâteuse avec cette atroce migraine qui me broie les tempes. Je me remets en marche. Pas après pas, je déambule dans ce paysage que je ne peux distinguer. Le brouillard. Toujours ce brouillard épais, inquiétant. Le sol change soudain. Je quitte la douceur de l’herbe pour la rugosité du goudron. Ai-je atteint une route ? Cette perspective me réjouit et un léger sourire s’affiche sur mes lèvres asséchées. Depuis quand n’ai-je pas bu ? Cependant, mon rictus s’efface quasi instantanément quand je me heurte à un mur. Je ne peux pas le voir, mais une forte odeur de putréfaction semble sortir de cet endroit. Je change de direction, les mains devant moi. Mes doigts courent sur les briques jusqu’au moment où je sens une poignée métallique et froide. Je me bats contre une brusque nausée, avant d’appuyer sur le mécanisme et de m’échapper. Do Chapitre 1 Une intense lumière m’aveugle. Je place mon bras à hauteur de mon front pour me protéger et plisse les yeux. Un projecteur est pointé sur moi, mais en un instant, il s’éteint. Mon mal-être vient de disparaître avec lui. Finies les douleurs, terminés les maux de tête. Je me redresse. La brume s’est évaporée. Devant moi s’étend une immense prairie verdoyante. Je me sens déstabilisée. La surprise de ce brusque changement passée, j’avance prudemment. Le soleil couchant pare le ciel de couleurs douces et rosées. J’avance au milieu de cette nature majestueuse. Ni pensée, ni souvenir ne me traversent l’esprit. Un sursaut se fait sentir dans ma cage thoracique. Je me raidis et me fige. Qui suis-je ? Quel est mon prénom ? D’où je viens ? L’angoisse me prend à la gorge. Je n’ai aucune réponse à mes interrogations. La pénombre s’installe lentement sur la plaine, et avec elle, le décor idyllique change. Une odeur sucrée de barbe à papa me parvient aux narines. Étonnamment, elle ne me procure aucun plaisir. Des notes de musique, semblables à un murmure, deviennent audibles, puis de plus en plus fortes. Tout se met à tourner. Un mélange de terreur et de stupeur s’empare de mon être. Des rires d’enfants apparaissent. Ils semblent tournoyer tels des fantômes, au milieu d’un épais voile grisâtre qui danse autour de moi en une ronde infernale. Les voix valsent doucement dans les airs, avant d’accélérer leur balai effrayant. Je porte mes mains à ma tête. Je chancelle. La brume se rapproche dangereusement pour m’envelopper de son manteau glacé. De nouvelles nausées secouent mes entrailles. Je ferme les yeux pour oublier et tenter d’apaiser mon corps endolori qui se débat. En vain. Je me sens comme Alice dans le terrier du lapin blanc. Je tombe inexorablement sans jamais toucher le fond. Soudain, tout s’arrête. Je retrouve mon équilibre et mon estomac se calme. Je ne me sens plus comme sur un bateau chahuté en pleine tempête. Un sentiment réconfortant de soulagement m’envahit. Mes muscles se détendent. Est-ce que ce cauchemar a pris fin ? Pleine d’espoir, j’ouvre prudemment un œil, puis l’autre. Saisie par la stupeur, mes yeux s’écarquillent face à tant de couleurs et de majesté. En lieu et place de l’immense plaine verdoyante s’élève un impressionnant chapiteau. Mon regard émerveillé observe les milliers de petites ampoules éparpillées en hauteur. Elles ajoutent un côté féérique à la toile rouge et blanc, vieillie et rayée. Mes yeux pétillants balayent ensuite la piste de terre battue sur laquelle je me trouve. Elle est éclairée par de magnifiques lumières dorées. — C’est toi la nouvelle funambule ? Je sursaute et fais volte-face, surprise par une petite voix fluette et innocente. Personne. Je me retourne. — C’est toi la nouvelle funambule ? Mon cœur manque un battement. Un enfant d’à peine six ans, aux cheveux blonds parfaitement disciplinés, me toise, le regard vide. Je bredouille quelques paroles incompréhensibles, avant que le garçonnet ne me pose la question pour la troisième fois. Je reste silencieuse, toujours sous le choc, mais le scrute longuement. Il porte un petit pull col roulé clair, des collants d’une couleur similaire, ainsi qu’un veston et un pantacourt noirs. Voyant mon air ahuri, il ajoute en grimaçant : — Maman m’a dit que je te trouverai grâce à tes bas rayés et ta robe blanche. Elle s’est trompée, elle est plutôt beige. Surprise par les mots de cet étrange petit garçon, j’observe machinalement mes mains. De jolies mitaines en dentelle les recouvrent. Je baisse mon regard pour découvrir le reste de mon corps. Un corset en bustier me serre la taille et me comprime la poitrine. En dessous, je porte effectivement une jupe bouffante à volants couleur ivoire, ainsi que des collants à bandes horizontales, agrémentés de bottines victoriennes aux lacets blancs. Un léger rictus gêné s’étire sur mes lèvres. Je ne m’étais jamais imaginée dans un pareil accoutrement, qui que je puisse être ! Est-ce que je viens d’ici ? — Alors, tu viens ? Les autres veulent te rencontrer. L’enfant aux vêtements datés des années 1800 m’appelle de l’autre bout du chapiteau. Comment a-t-il fait pour arriver aussi vite là-bas ? Je secoue énergiquement la tête et me frotte les yeux. Lorsque je les rouvre, le petit garçon a disparu. Hébétée, je balaye du regard les lieux plongés dans le silence. Il semble s’être évaporé. Je pose une main sur ma bouche un instant, avant de l’appeler. — Hey ! – j’avance vers les quelques gradins désespérément vides – où es-tu ? Je me penche pour regarder sous un banc. Peut-être qu’il joue à cache-cache ? La stupeur me gagne peu à peu et mon rythme cardiaque s’accélère. — C’est bon, tu m’as eu. Sors de ta cachette maintenant, ce n’est pas drôle ! — Qui êtes-vous ? Je me redresse brutalement et me cogne l’arrière du crâne. Une grimace déforme les traits de mon visage. Je pose mes doigts sur la zone d’impact pour vérifier qu’aucun sang n’en sort, puis je me tourne vers la personne qui vient de me surprendre. Un homme d’environ 1m80 se baisse à côté de moi pour ramasser un petit chapeau haut de forme, semblable à celui qu’il porte, pour me le tendre. Je l’observe, incrédule. Ses longs cheveux noirs lui tombent jusqu’aux épaules. Son costume de dompteur, rouge et noir aux boutons dorés, arbore de profondes griffures à hauteur du torse, ainsi qu’au niveau de l’abdomen. Pourtant, aucune trace de blessure ni de sang n’est visible sur son corps. Mon manque de réaction l’agace, aussi m’incite-t-il, d’un geste ferme, à remettre le chapeau sur ma tête. Je m’exécute prestement. — Que faites-vous ici ? grogne-t-il de sa voix grave. Je déglutis sans qu’aucun mot ne sorte de ma gorge serrée. — Quel est votre nom ? J’hésite quelques secondes avant de finalement répondre fébrilement. — Je ne sais pas. — Comment se fait-il que vous ne connaissiez pas votre identité ? C’est impossible d’oublier cela. Il fronce ses sourcils charnus. — Et vous, comment vous appelez-vous ? Ma question le met visiblement mal à l’aise. Il passe une main sous son chapeau pour recoiffer ses cheveux. — Vous ressemblez à une poupée avec votre peau blanche et lisse. Je vais vous nommer Dolly Doll. J’ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son ne sort. Cet étrange surnom semble m’avoir ôté toute capacité à m’exprimer. Je tente à nouveau de parler. En vain. Je suis figée d’effroi. Pour la première fois depuis le début de notre échange, un large sourire s’étire sur les lèvres de l’homme. — Je te souhaite la bienvenue dans notre troupe, Dolly Doll. Au même moment, le dompteur disparaît dans un nuage de fumée. Ré Chapitre 2 Cette nouvelle disparition me laisse pantoise. Je suis en train de rêver, il ne peut y avoir que cette explication, la seule qui me semble rationnelle. Dolly Doll. Mon nom de scène résonne dans mon esprit. C’est plutôt joli. J’observe le chapiteau à nouveau plongé dans un silence mortuaire. Des accessoires de voltige sont entassés dans un coin à côté de la piste. Un peu plus loin, à moitié dissimulée derrière un morceau de toile, se dresse une immense cage métallique, certainement celle des fauves. Un petit rire d’enfant retentit. Mon regard se tourne vers les gradins. J’ai la drôle de sensation de ne plus être seule. Pourtant, les lieux sont désespérément vides. Une brise glacée frôle mon bras. Elle déclenche un frisson dans le haut de mon dos. L’angoisse me gagne. Il faut que je sorte d’ici. Soudainement prise de panique, je me précipite vers la seule ouverture de la tente, à l’intérieur de laquelle l’atmosphère est à présent devenue irrespirable. J’ai l’impression de suffoquer. Je cours de plus en plus vite pour retrouver l’air libre, comme si ma vie en dépendait. Mon trajet me paraît interminable. Je ne comprends pas. Plus je me rapproche de la sortie, plus celle-ci s’éloigne. J’accélère le pas. Mon cœur cogne contre les parois de ma poitrine. Il semble vouloir en sortir, mais il est prisonnier, tout comme moi. Mes tempes se compriment. Une vive brûlure se fait sentir dans mon crâne. Je place mes mains de chaque côté de ma tête et m’immobilise. La douleur est de plus en plus vive. Je ferme les yeux. Un cri strident sort des profondeurs de ma gorge. Tout se met à tourner autour de moi. Des nausées brassent à nouveau mon estomac. Non, pas ça, pas encore ! Je garde les paupières closes pour ne pas voir le paysage tourner et risquer de m’écrouler. Tout à coup, tout se fige. Je retrouve progressivement mon état normal. Mes muscles se décontractent. Mon corps s’apaise. Je prends une longue inspiration et affronte ce nouveau décor. Une fois de plus, je suis émerveillée par la majesté des lieux. Cependant, celle-ci m’effraie instantanément. Je tourne sur moi-même. Le nombre de pulsations dans mes veines augmente de manière exponentielle. Ma respiration est saccadée. Des centaines, peut-être même des milliers de miroirs m’entourent. Je suis encerclée. Chacun d’eux reflète mon image apeurée. Poussée par la curiosité, je m’approche lentement de l’un d’eux. Ma silhouette, tel un accordéon, s’amincit ou grossit au fil de mes pas peu assurés. Mon visage aussi est victime de cette transformation étrange. Je ne sais même pas à quoi je ressemble physiquement, si ce ne sont mes vêtements fantaisistes. Je n’ai pourtant qu’une seule question en tête : comment sortir d’ici ? Une forme apparaît soudain derrière moi dans le miroir. Mon sang ne fait qu’un tour et je fais volte-face. Personne. Je hausse les sourcils, puis me retourne pour retrouver ma position originelle. La silhouette fantomatique se tient toujours à quelques centimètres de moi. Décontenancée, je lève le menton et scrute l’homme, à travers l’un des miroirs. Il me domine de plus d’une tête, mais n’est pas très massif. Son teint blafard rappelle la peau d’un cadavre. Un grand chapeau noir, baissé jusqu’à l’arête de son nez fin, dissimule ses yeux. Ses lèvres plutôt charnues tirent vers le violacé alors qu’un liquide rougeâtre en sort. Son apparence effrayante me glace les os. Une main quasi squelettique vient se poser sur mon épaule. Je bloque ma respiration. Je sens bientôt sa paume puis ses doigts serrer le haut de mon bras. Je me fige de terreur. Il avance sa bouche près de mon oreille sans que je puisse distinguer la moindre de ses paroles. Je ferme les paupières. Son autre main frôle une de mes hanches. Ce contact malaisant me fait l’effet d’un électrochoc. D’un mouvement brutal, je me libère de cette emprise macabre. Qu’est-ce que c’est que cet endroit ? Je tente de m’enfuir, mais me heurte à une première glace, puis une deuxième. À nouveau, la panique s’empare de mon être. Je dois trouver une issue ! Mes membres supérieurs cognent contre les murs déformants qui me donnent à présent le mal de mer. Je vacille un moment avant de perdre l’équilibre et de m’effondrer sur l’une des parois réfléchissantes. À cet instant, la surface dure et lisse devient visqueuse et perméable. Mon corps s’enfonce progressivement à l’intérieur comme dans des sables mouvants. Je n’ai pas le temps de réagir. Je traverse le miroir en une fraction de seconde. Mi Chapitre 3 Je chute. Les secondes, puis les minutes s’écoulent inexorablement alors que je continue de tomber vers une destination inconnue. Mon corps se meut comme pour ne pas rester immobile. J’ai l’impression de flotter, d’être en apesanteur. Ma crainte s’est évaporée. Ma frayeur a fait place à un sentiment de bien-être et de plénitude. Aucune nausée ne vient briser ce moment d’apaisement. Mon esprit s’évade. Je ne pense à rien, même pas à l’endroit où je vais bientôt atterrir, ou même si je vais m’en sortir. Je ferme les yeux. Je crois que je suis en train de m’endormir. Ma chute cesse brutalement. De puissantes notes florales embaument les lieux où je suis assise. Je sens quelque chose de dur sous mes fesses. Je place mes mains sur la surface lisse. C’est du bois. J’ouvre subitement les paupières, poussée par la curiosité. La vision d’un nouveau miroir face à moi provoque un sursaut dans ma poitrine. Pourtant je m’apaise presque aussitôt. Ce décor me paraît bien plus hospitalier que les autres. Sur la tablette se trouvent un poudrier, du maquillage et divers accessoires de scènes tels que des boas à plumes, un corset et une paire de gants en dentelles. Je me retourne pour observer un peu plus les alentours. Je suis à l’intérieur d’une roulotte très mal rangée, pleine de costumes et de chapeaux multicolores aux formes toutes plus farfelues les unes que les autres. Soudain, je me raidis. Des pas résonnent à l’extérieur en même temps que les voix de plusieurs individus masculins et féminins. Mon regard balaye les lieux à la recherche d’une cachette, mais il n’y a en a aucune. Je suis prise de panique. Ils sont sur le point d’entrer… Je ferme les yeux et me crispe. — Mais que fais-tu ici ? Ça fait une éternité qu’on t’attend ! Je rouvre brusquement les paupières, stupéfaite par ce qu’il se passe. Mes yeux semblent sortir de leurs orbites. Je suis bouche bée, incapable de prononcer le moindre mot. — Laissez-moi passer, je vous prie ! L’homme joue des coudes pour se frayer un chemin parmi la dizaine de personnes amassées devant la sortie, tels des chiens de garde. Ils me barrent le passage, je ne peux rien tenter. Le dompteur que j’ai rencontré sous le chapiteau émerge de la petite foule costumée. Les individus qui ressemblent à des femmes ont revêtu des vêtements qui me rappellent le french cancan et des perruques toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Un détail m’interpelle : nous portons tous les mêmes gants en dentelle. — Enfin ! Tu es là ! Tu te rends compte que ça fait deux jours qu’on te cherche partout ? Je manque de m’écrouler sous le choc. Il se précipite vers moi pour me retenir et m’empêcher de tomber. Deux jours ? Non, il doit se tromper, nous avons eu notre conversation tous les deux depuis seulement quelques minutes ! Des étoiles apparaissent devant mes yeux. Mes jambes ne me portent plus. L’homme au chapeau haut de forme me retient à bout de bras, alors que je m’écroule. La dizaine de regards se braquent sur moi, stupéfaits. Les murmures des quelques spectateurs de mon état résonnent dans ma tête, tels des échos lointains. Peu à peu, ils deviennent de plus en plus clairs. Mon corps retrouve progressivement toute sa substance. Lorsque je suis de retour et prête à continuer mon chemin, le dompteur m’aide à me remettre sur pieds. — Tu sembles étrange ce soir, Dolly Doll. Regarde-toi, tu es toute pâle ! Il saisit un miroir à main et le place devant moi. J’observe mon reflet et me fige de stupeur. Je touche alors mon visage du bout de mes doigts, comme si celui-ci ne m’appartenait pas. Ma peau est aussi blême qu’un cadavre et aussi froide que la porcelaine. Mes cheveux bruns ont été bouclés, ainsi qu’attachés en une coiffure sophistiquée qui ressemble à celle des poupées. En un battement de cils, je me retrouve lourdement maquillée. Mes yeux cernés d’un noir aussi profond que le charbon accentuent la blancheur de mon visage. Mes pommettes saillantes sont couvertes d’un rose bonbon poudreux qui me donne d’autant plus l’air de sortir d’un coffre à jouets. Mes lèvres ont pris la couleur du sang et mon petit chapeau a changé. Je me pince la main pour être certaine de ne pas être endormie. Ce qui vient d’arriver n’est pas possible ! J’en suis parfaitement consciente, mais je n’ai aucune explication rationnelle à donner. — Il est l’heure, m’annonce le dompteur solennellement en m’ouvrant la porte de la roulotte, dans une attitude de véritable gentleman. Les danseurs et danseuses de french cancan se sont évaporés. Je ne comprends rien. Où sont-ils passés ? J’entends des voix en provenance de dehors. Ce sont certainement eux. Incrédule, j’observe le dompteur pendant de longues secondes. Son attitude droite et son élégance m’impressionnent. Il fait alors une sorte de révérence en positionnant son bras au niveau de son ventre et en s’inclinant majestueusement. J’écarquille les yeux, mais me décide finalement à le suivre et rejoindre les autres à l’extérieur.
82
« Dernier message par Apogon le jeu. 10/02/2022 à 17:31 »
Les œillères de l'éléphante de Laurie Heyme Pour l'acheter : Amazon FnacChapitre 1. Etat des lieux.
« Les chances qui se perdent sont les plus grandes malchances. » Pedro Calderon de la Barca.La vie, trois petites lettres de rien du tout. Des moments prometteurs de l’avenir qui basculent dans le passé en une poignée de secondes. Pas le temps de saisir l’instant présent qu’il n’est déjà plus. La vie, qui peut chavirer subitement, comme un navire dans une mer déchaînée. Le calme apparent fait place à l’inévitable tempête. Face aux flots et aux vagues de plus en plus fortes, il est impossible de décider s’il est préférable de résister ou de se laisser engloutir dans les profondeurs. Ma vie, qui n’est qu’un champ de ruines, une embarcation qui tangue déjà et dont la direction du vent ne va pas tarder à changer, pour le meilleur ou pour le pire je ne le sais pas encore. Mon radeau de fortune bricolé et rafistolé prend l’eau de toute part, malgré les apparences. Ma seule certitude, c’est que je n’en peux plus, je suis à bout. Chaque nouveau lever de soleil me confronte à une réalité dont je ne veux plus et dont je suis pourtant incapable de me défaire. Chaque jour est une nouvelle épreuve où il me faut endosser le corps de Louise, prénom que ma mère m’a donné. Quand j’ai cherché à connaître sa signification, j’y ai lu les termes de gloire et de combat. Je ne sais pas si c’est pour ça qu’elle m’a appelé comme ça. Ce que je sais en revanche, c’est que je suis loin de me reconnaitre dans ces mots-là. Je doute d’ailleurs qu’elle ait vraiment réfléchi à ce qu’elle allait écrire sur nos actes de naissance. Je sais que le petit nom de ma sœur a été attrapé au vol dans la salle d’attente de la sage-femme lorsqu’elle était enceinte de quelques mois. Une jolie princesse prénommée Stéphanie y jouait et notre mère, ayant eu d’autres chats à fouetter que de se pencher sur la question, y avait vu là un signe. Le jour où j’avais découvert cette histoire, pour mon livret autobiographique du cours de français, je l’avais trouvée si triste que j’avais préféré ne pas lui demander pourquoi elle m’avait appelé Louise. J’avais brodé une histoire à dormir debout pour mon acrostiche, tout plutôt qu’une vérité difficile à entendre. Je crois que c’est de là qu’est née cette habitude de décrypter les prénoms des personnes que je rencontre, peut-être pour mieux les appréhender et cerner leurs personnalités. Je me suis toujours promis que le jour où je deviendrais mère à mon tour, ce rite de passage serait étudié avec soin et ne serait pas dû au hasard mais plutôt le fruit d’un choix bien élaboré. J’avais déjà feuilleté à la bibliothèque où je travaillais de multiples recueils, « Choisir son prénom, choisir son destin » ou encore « Un prénom, le choix d’une vie ». Mes collègues me trouvaient étrange et me charriaient souvent d’un « Dis-moi comment tu t’appelles je te dirais qui tu es », à chaque fois que j’inscrivais un nouvel abonné. Ma mère s’appelle Marguerite et parler d’elle me déclenche des démangeaisons. Quand j’en ai cherché le sens, j’ai été frappée par les appellations de perle et de pureté. A proprement parlé, elle est loin d’être une perle, du moins avec nous. Toute personne n’étant pas de sa famille proche trouve que c’est une femme charmante, souriante et avenante. Je me souviens parfaitement de la réaction de mes amies quand j’étais adolescente. ¬ « — Ta mère est géniale ! Ta mère est trop cool pas comme la mienne ! Ta mère est super gentille ! » Je souriais, bêtement, acquiesçant face à leurs compliments, même si intérieurement je ressentais un trouble indescriptible. L’envers du décor ne faisait pas écho aux apparences. Je dirais plutôt que je vivais avec une doctrine maternelle qui laissait peu de place à l’ouverture d’esprit et aux effusions d’amour. Je ne dépeins pas d’emblée une relation mère et fille des plus idéales. Et pourtant, chaque dimanche, je vais effectuer mon devoir au brunch familial. Mon père n’est malheureusement plus de ce monde pour assister à ces moments délicieux où elle trouve toujours à redire sur ma coiffure, ma tenue vestimentaire ou encore mon job de bibliothécaire. C’est son passe-temps favori, me rappeler sans cesse à quel point je suis une ratée et à quel point elle sait tout mieux faire que moi. Les encouragements et la prise de confiance en soi n’étaient pas dans ses priorités d’éducation, ce rôle étant plutôt discrètement attribué à mon paternel. « Faites ce que je dis, pas ce que je fais » est un proverbe qui lui va comme un gant. Marguerite rêvait d’être avocate mais mes grands-parents n’ont jamais pu financer ses études. Alors, à défaut de plaider devant les tribunaux, elle jongle avec les appels téléphoniques dans le grand cabinet d’avocat Jackson & Cie du 8ème arrondissement de la capitale depuis bientôt quarante ans. Elle en parle avec tant d’enthousiasme qu’on pourrait penser que c’est elle qui l’a monté de toutes pièces. Son parcours est loin d’être un parfait accomplissement et je doute qu’elle s’épanouisse vraiment dans ce rôle de secrétaire toujours disponible et efficace malgré les années. Cependant, elle tient tout de même à me rafraichir la mémoire au sujet de mes cuisants échecs. Nous n’évoquons jamais les siens, il y aurait pourtant un parallèle à faire. Je n’ai pas besoin qu’on me rappelle les mauvais souvenirs, j’ai une mémoire d’éléphant. Je suis capable de me souvenir des noms de famille des adhérents quand ils viennent rendre leurs livres. Je me rappelle mieux qu’eux-mêmes certains bouquins qu’ils ont lus, histoire de ne pas les emprunter une seconde fois. Cette capacité met de l’eau dans le moulin de mes collaborateurs quand ils ne me taclent pas sur mes lectures mystiques. Je suis un drôle de phénomène, une bête de foire, pas au point de savoir où les ouvrages sont rangés mais presque. Je connais parfois certains emplacements à l’étagère près. A leurs heures perdues, mes consœurs improvisent des quizz littéraires auxquels je me prête volontiers. Avoir une telle capacité à retenir les choses m’émoustille je l’avoue. Je m’attribue peu de qualités mais celle-ci est incontestable alors autant en abuser, ça camoufle un peu le reste. Malheureusement, tout ce que je pense ne sort jamais de ma bouche car ça reste ma mère évidemment et même si mon esprit le hurle très fort je n’ai pas le courage de laisser sortir toutes ces mauvaises pensées. Ça me ferait sans doute le plus grand bien mais je ne suis pas courageuse pour deux sous et je me cache derrière toutes ces croyances qui t’obligent à tout accepter de tes géniteurs. Alors, je reste la petite Louise bien sage qui dit oui à tout sans broncher. Je crois que ça fait partie du bagage « points négatifs dans ma vie ». Cette valise que je traine depuis toute petite pèse une tonne, je n’arrive même plus à la fermer, elle déborde de tous les côtés. Encaisser à chaque fois ces remarques m’enfonce un peu plus. C’est un problème assez omniprésent au quotidien mais que je refuse d’affronter pour le moment, ayant trop peur que les conséquences d’une éventuelle rébellion aggravent encore plus ma situation. J’ai opté pour l’idée de subir jusqu’à la fin de ma vie, même si je dois arriver au paradis en rampant. Dans ce gros balluchon, je rajouterais pour tenir compagnie à ma mère mon cher et tendre compagnon, Ben. Ces deux-là s’entendent à merveille, ce qui devrait m’enchanter. Le beau Ben, un sourire ravageur et des yeux verts sur une peau hâlée qui vous font voyager à Bora Bora en un clignement d’œil. Très franchement, pour être honnête, je ne sais pas ce qu’il me trouve depuis tout ce temps. Cette année, nous fêterons nos sept ans. Je n’aurais jamais pensé que nous arriverions jusque-là. Je crois que j’ai un cruel manque d’assurance et inévitablement, il me vient souvent à l’esprit que ce bellâtre ne peut pas faire sa vie avec un rat des bibliothèques. Cette façon de voir notre relation me pousse à me plier en quatre pour répondre au moindre de ses désirs. Je dis amen à tous ses caprices, ses éclats de colère et ses manies. Je me courbe un peu trop, je vais finir par avoir un lumbago irréversible. Après notre première rencontre, je m’étais précipité à la lettre B afin d’en savoir plus sur lui. Ben était un diminutif de Benjamin, interprété comme fils de la chance. Il ne m’en avait pas fallu plus pour accepter un rencard. Le guide des prénoms était ma boussole et j’avais grandement besoin d’ondes positives dans ma vie. A défaut de trouver un trèfle à quatre feuilles, j’espérais peut-être rafler un compagnon de route pour éclairer mon chemin. Comme chaque matin, mon esprit vagabondait au fur et à mesure qu’il émergeait. Toutes ces réflexions sous ma douche matinale faisaient parties de mon rituel quotidien. Même si je pensais très fort à la planète et au gâchis de toute cette eau qui se déversait sur moi, je me laissais aller à chaque fois dans mes divagations. Elles s’éternisèrent un peu trop longtemps car la sonnerie du téléphone m’en extirpa et, quand je vis le nom qui s’affichait, je sursautai et manquai de glisser dans la baignoire. Il s’agissait de Mme Rambaud, directrice de la bibliothèque Françoise Sagan du 10ème arrondissement de Paris. Il était 8h36 et j’étais officiellement en retard au travail. J’ai oublié de préciser que mon deuxième prénom c’est Françoise, qui signifie libre, mais à priori pas tant que ça. Paris et ces matins tout gris, Paris et les klaxons des taxis. Me voilà habillée comme un as de pique, à peine maquillée et pas coiffée à courir attraper mon bus en tentant d’avaler mon café. Faire deux choses à la fois n’est pas compatible chez moi, je devrais pourtant le savoir ! Dans la précipitation, j’ai mal fermé le thermos qui abritait ma boisson brûlante et je ne pourrais donc m’en prendre qu’à moi-même pour cette auréole de café avec laquelle mon pull moutarde va cohabiter toute la journée. Je fais abstraction de la brûlure au troisième degré qui irradie ma poitrine et m’avance à pied jusqu’à la prochaine station de métro. Malgré ma course folle le bus m’a échappé. J’ai un autre point commun avec les éléphants, je cours comme eux. J’ai une jambe qui marche et une jambe qui trotte. Au collège, mon professeur d’EPS m’avait surnommé affectueusement Pachyderma. J’ai toujours adoré courir pourtant mais les regards amusés des badauds ont vite expédié mes baskets de sport au placard. J’adore mon quartier, ça je le mets dans la valise « points positifs dans ma vie », sachant qu’ils ne sont pas bien nombreux. Ce barda est hélas bien trop léger. Quand nous avons emménagé avec Ben, nous avons eu la chance de trouver ce petit appartement au dernier étage avec une vue imprenable sur Paris. J’ai le vertige mais il était tellement conquis que j’ai cédé, pour lui faire plaisir. Je ne suis donc pas la parisienne qui profite de sa terrasse au petit déjeuner. J’ouvre les fenêtres et je vais arroser les fleurs en fermant les yeux. Ce sont mes pieds qui finissent mouillés la plupart du temps. La seule chose que je peux voir au loin depuis ma fenêtre, sans m’aventurer trop près du bord, c’est la majestueuse Tour Eiffel. Ce monument me procure un effet énergisant et je ne me lasse pas de l’admirer, même après toutes ces années. J’ai parfois l’impression qu’elle me parle dans mes coups de blues et qu’elle s’adresse à moi pour me remonter le moral. « — Allez soit forte Louise, ne te laisse pas abattre. » Je partage un petit secret avec elle, j’adore la prendre quotidiennement en photo. Chaque cliché me permet de découvrir la dame aux mille visages avec un regard nouveau. Cela parait sans doute complètement stupide et ce passe-temps gaspille certainement des milliards de giga dans mon cloud mais je ne peux pas m’en empêcher. Je l’immortalise, inlassablement, parfois le matin au lever du soleil ou bien encore les jours de pluie, parce que même là, elle est grandiose. Je ne sais plus qui a dit qu’il faut apprendre à danser sous la pluie. Ce qui est sûr c’est qu’elle sait le faire la dame de fer, contrairement à moi. En attendant, c’est dans les couloirs du métro que je danse et que je zigzague. J’arrive enfin à Gare de l’est et j’aurais donc, pour être exacte, dix-huit minutes et trente-quatre secondes de retard. Je suis bonne pour une journée sans pause déjeuner avec deux heures supplémentaires pour me faire pardonner. La reine de la culpabilité c’est moi, je pense devoir remercier Marguerite pour ça. Quand je franchis les portes de la bibliothèque Mme Rambaud est là, comme si elle m’attendait, et ses vociférations ne mettent pas longtemps à se faire entendre. « — Louise ! Ce mois-ci ça fait déjà plusieurs retards ! Il va falloir vous ressaisir, sans quoi je ne pourrais pas continuer comme ça ! Je comptais sur vous ce matin pour arriver plus tôt et déménager tous les romans policiers comme nous en avions convenu en réunion. Pouvez-vous me dire quel est l’objet de votre retard aujourd’hui ? Un dinosaure sur les voies ou peut être une invasion d’ovni à l’arrêt de bus ? me hurla-t-elle au visage. — Mme Rambaud, balbutiais-je, je n’ai aucune excuse ce matin … je vous promets que ça ne se reproduira plus, faites-moi confiance ! dis-je penaude et la tête basse. » Je ne pouvais décemment pas lui mentir. Il m’arrivait des évènements tous plus rocambolesques les uns que les autres mais cette fois, je n’avais rien à dire pour ma défense. Je savais que cette histoire allait me miner toute la journée et que j’allais tout faire pour me rattraper, quitte à faire des tas d’heures en plus, et ça Mme Rambaud le savait très bien. Certes, je n’étais pas une championne de la ponctualité mais j’étais très efficace dans mon travail, bien plus que le reste de l’équipe. Mon acariâtre patronne avait surtout bien cerné ma psychologie et savait parfaitement sur quel bouton appuyer pour que je me mette en mode autopunition. Je travaillais dans cette bibliothèque depuis dix ans déjà. Après avoir échoué à mon examen de fin d’année, j’avais mis au placard mes rêves de journaliste et je m’étais réfugiée dans ce job. Amoureuse des livres depuis toute petite, j’avais trouvé dans ce lieu un havre de paix et de silence, obligée de faire taire mes remords et mes regrets. J’aimais la tranquillité de ces rayonnages, les pas feutrés sur la moquette gris souris, et les couvertures de ces milliers d’exemplaires tâchant de couleurs d’immenses meubles blanc. Le personnel en place avait complètement changé après ma venue, avec de multiples départs à la retraite. Je n’avais jamais noué de grandes amitiés avec les nouveaux arrivants et nos rapports restaient strictement professionnels. J’avais surtout décliné les diverses propositions d’apéritifs en sortant du travail. A force d’essuyer des refus, ils ne m’avaient plus invitée du tout. Je préférais rentrer à la maison pour retrouver Ben et je m’octroyais des sorties uniquement lorsqu’il était absent, comme si je m’interdisais de m’amuser sans lui. Parfois, je me sentais vieille avant l’âge, puis je chassais cette pensée, me disant que j’avais de la chance d’avoir un homme dans ma vie de tous les jours, ou presque. La journée s’écoula comme je m’y attendais, je travaillais comme une forcenée, avalant un sandwich en catimini. Le seul réconfort qui maintenait ma motivation à flot était mes retrouvailles du soir avec mon amie d’enfance, Alice. Elle avait besoin d’un coup de pouce au restaurant, son énième extra venait de lui faire faux bon. Je crois plutôt qu’elle était un tantinet trop exigeante et assez insupportable comme employeuse mais ça, je me gardais bien de lui dire. Ça n’avait pas d’importance, j’adorais aller là-bas, j’y joignais l’utile à l’agréable. C’était un moment d’évasion où je n’avais pas le temps de réfléchir et j’en avais besoin, aujourd’hui plus que jamais. La fin de la journée pointa enfin le bout de son nez et j’avais encore une heure de libre devant moi. Je profitais de ce moment de répit pour finir le trajet à pied. Flânant comme j’aimais le faire, mon réflex n’était jamais bien loin, toujours au fond de mon sac. A croire que j’aimais passer en mode camouflage, la tête dans les écrits la journée et derrière un objectif le soir. Je longeais la seine, passant vers ces terrasses à ciel ouvert. C’était l’heure des happy hours et des sorties de bureau. Je voyais tous ces gens qui se retrouvaient, riant aux éclats et se prenant dans les bras. Quand je les observais, une partie de moi les enviait. Ils avaient l’air heureux et insouciants. Je m’imaginais même furtivement, comme dans ces films surréalistes, sauter dans le corps de n’importe lequel d’entre eux pour échanger nos places, pourvu que sa vie soit plus supportable que la mienne. Je me prêtais souvent à imaginer leur quotidien, leur vie amoureuse ou encore leur métier. A les voir ainsi vêtus, ils semblaient tous avoir réussi leur existence et en être les fiers habitants. Pour ma part, j’avais l’impression d’être en dehors de moi-même. Je voyais mon corps vivre, respirer, marcher, agir et j’avais la sensation d’être ce petit fantôme qui flottait et tentait de le réintégrer, en vain. J’étais à côté de mes pompes en permanence mais je savais bien donner le change pour ne rien laisser paraitre. Je traversai la passerelle Simone de Beauvoir et j’en profitai pour immortaliser le métro qui passait au loin, sur le pont de Bercy. Cette vue était magnifique. Paris était une belle ville, pleine de contrastes et d’ambiguïtés. Je franchis les portes de « La croisée des chemins » vers 19 heures. Alice était en extrême concentration sur son tableau de plat du jour. C'est ma meilleure amie, une sœur de cœur, comme je me prête souvent à le dire. C’est même la seule amie qu’il me reste. Nous nous sommes connues sur les bancs de la maternelle. Peu complices au début, j’étais du genre timide et discrète quand elle était déjà exubérante et avec un franc-parler. Il aura fallu que cette terreur de Gabriel vienne m’enquiquiner pendant la récréation pour qu‘elle intervienne et lui fasse une tête au carré. Depuis ce jour, elle a décidé que sa mission de vie était de me protéger et moi, de me laisser tenir la main. Trente ans que ça dure. La légende dit que les amitiés qui durent plus de sept ans, c’est pour la vie. Au vu du chiffre sur le compteur, je crois qu’on est bien parties. Cependant, il faut bien l’avouer, cette amitié n’est pas un long fleuve tranquille car nous sommes rarement d’accord. Nous sommes l’incarnation du yin et du yang, diamétralement opposées tout en étant complémentaires. Alice, c’est le soleil de notre idylle amicale. Je n’ai jamais vu quelqu’un de si positif. Quand elle voit le verre à moitié plein je le vois à moitié vide, sauf quand il s’agit de Margarita, là on tombe souvent d’accord ! Il faut dire que son mental d’acier n’est pas dû au hasard. Plus jeune, un grave accident de voiture avait failli lui coûter la vie. Elle n’était que passagère, mais n’a plus jamais retouché un volant de sa vie jusqu’ici. Elle ne le montre pas, mais la guérison psychologique n’a jamais été complète et son médicament est de faire de chaque nouvelle journée une bulle de perfection et d’hédonisme. Je l’avoue, je suis tout le contraire. Je suis trop souvent négative, pensant toujours au pire quand une situation se produit. Je fais partie de cette catégorie de personne persuadée que rien de bien ne peut lui arriver. Je n’ai jamais de chance et, pour couronner le tout, je suis assez maladroite. Alors, sans cesse, elle est présente, à toujours trouver les bons mots et à tenter de me remonter le moral. Elle essaye de me tirer vers le haut quand les tréfonds m’appellent. Ce soir, elle a du pain sur la planche, il va falloir qu’elle sorte l’artillerie lourde. Demain, une journée douloureuse s’annonce… Demain, nous sommes le 26 avril… Demain, ça fera 18 ans que notre père nous a quittées… La vie, trois petites lettres de rien du tout mais qui peuvent peser une tonne quand le chagrin est trop lourd. Chapitre 2. Jour J. « Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents, dans la mémoire des vivants. » Jean d’Ormesson. Le temps de ce mois d’avril est semblable à mon humeur du moment, changeant. Je passe du rire aux larmes comme le soleil passe à la pluie. Par intermittence, le vent s’emporte et mes idées noires s’installent. De loin, ma belle Tour Eiffel tente de s’adapter à mon moral tumultueux. Voilà qu’il se met à grêler, la météo ne semble pas se tromper pour une fois. Le service d’hier soir était assez chargé. Alice et moi avions couru dans tous les sens. C’était exactement ce qu’il me fallait, ne pas avoir le temps de cogiter ni de réfléchir au lendemain. Occuper mon esprit avec des « Vous prendrez un dessert ? » ou des « Je vous recommande vivement le plat du jour ! ». Nous avions terminé le rangement de la salle autour d’un cocktail secret dont mon amie taisait la recette mais qui noyait allègrement mon accablement. Un taxi nous avait déposé tardivement au pied de nos immeubles respectifs. Je ne crois pas avoir trouvé le chemin de mon lit, car je m’étais réveillée toute habillée sur le canapé. Heureusement que mon amoureux n’était pas là pour me voir dans cet état ! C’était le genre de réveil cliché des lendemains de soirées arrosées. Un filet de bave dégoulinait de ma bouche, restée sans doute ouverte à ronfler toute la nuit. Mon mascara, que je n’avais pas retiré la veille mais joyeusement frotté avec mes mains, me donnait des airs de panda défraichi. Après avoir avalé au moins un litre de café et une aspirine, j’avais trainé au lit avec un livre que j’avais retrouvé dans de vieilles affaires en rangeant l’autre jour, « Les souffrances du jeune Werther. » Ce premier roman de Goethe retraçait l’histoire d’un amour impossible. A l’époque, ces mots m’avaient bouleversée. La fin était malheureusement tragique, je devrais songer à lire des œuvres un peu plus joyeuses. C’était mon jour de repos car samedi j’assurais la permanence, nous la faisions à tour de rôle. Ça tombait à point nommé, je n’étais pas d’humeur à voir du monde aujourd’hui. J’avais un tout autre programme. J’essayais de joindre Stéphanie depuis une heure, sans succès. J’avais pourtant bien pris en compte le décalage horaire. A Paris il était 16h10, en toute logique à New York il était six heures de moins. Mes appels restaient sans réponse et mes messages aussi. Elle ne pouvait pas avoir oublié la date, c’était impossible. Chaque 26 avril nous nous appelions, comme pour prier ensemble à la mémoire de notre père. Enfin, prier est un mot inadéquat, je dirais plutôt se recueillir ensemble. Dieu ou quelques formes de croyance que ce soit ne faisaient pas partie de mon quotidien. Mes mésaventures récurrentes me laissent à penser qu’un mauvais sort m’avait été jeté et qu’aucun Dieu là-dedans ne cherchait à empêcher ça. Ma grande sœur avait eu la riche idée, à la mort de papa, de s’envoler définitivement pour les Etats-Unis. Son agence de voyage et son anglais brillant lui avaient permis de dégoter une opportunité en or dans la grosse pomme. Son poste consistait à s’occuper des voyages à destination de la France et plus précisément de la capitale. Sur un coup de tête, elle avait plié bagages, j’avais alors 16 ans. Nous n’étions pas dans une période très propice à l’entente complice et le décès soudain de Daniel nous avaient toutes deux ébranlées. Daniel, c’est comme ça que s’appelait mon père. L’ironie de tout ça, c’est que cela voudrait dire « jugé par Dieu ». En terme de jugement, cela avait été rapide. Un arbre, une vitesse excessive, un virage glissant et un homme qui nous avait été retiré, en pleine force de l’âge. Depuis, je n’avais revu ma sœur que par des appels en visioconférence. Elle n’avait plus remis les pieds ici depuis tout ce temps et moi, en grande acrophobe que j’étais, je me sentais incapable de monter dans un avion. Lui rendre visite aurait été une aubaine pour découvrir ce pays qui me faisait tant rêver. Mais vu où j’en étais dans ma gestion du vide et des hauteurs, ce n’était pas pour demain. C’était d’ailleurs sur ma liste de procrastination, cette fameuse to-do list que je repoussais jour après jour : aller consulter un hypno-thérapeute pour tenter d’y remédier. Quant à la relation entre ma mère et ma sœur, je restais dubitative. Je crois savoir qu’elles s’appelaient peu, peut-être pour Noël et les anniversaires, comme si elles étaient en froid. J’avais souvent questionné Marguerite mais elle avait toujours balayé d’un revers de la main le sujet, éludant que Stéphanie avait tout simplement du mal à se remettre de la perte paternelle. Il fallait qu’elle change de disque. Cette excuse devenait irrecevable depuis tout ce temps. Il me manquait terriblement à moi aussi. Il subissait également les remarques de sa femme, toujours pleines de reproches. Mais il était d’un caractère foncièrement gentil et docilement, il s’exécutait sans se rebiffer. Je savais de qui je tenais. Ben était parti en déplacement quelques jours. Il m’avait promis qu’il tenterait de rentrer ce soir si son dernier rendez-vous ne s’éternisait pas. Son métier de commercial l’obligeait à être souvent absent. Je lui avais dit plusieurs fois que je n’aimais pas qu’il me laisse seule ce jour-là. Visiblement, il avait oublié, une fois de plus. De surcroit, nous nous étions quittés sur une dispute complètement stupide. Depuis, j’essayais de le rappeler mais il rejetait mon coup de fil à chaque fois et mes supplications restaient lettre morte. Ben était comme ça, une contrariété pour lui qui n’en était pas une pour moi pouvait faire ressortir un homme colérique qui s’emportait facilement. Il pouvait me bouder ainsi pendant des heures et même pendant des jours. Parfois, certaines longues périodes de silence se soldaient par un bouquet de fleurs en rentrant du travail. Et je retrouvais alors celui que j’avais rencontré. La plupart du temps, je l’accorde, c’était peut-être moi qui exagérais. J’étais très maladroite et faisais peu attention aux choses. Vivre avec moi devait être exacerbant. Nous étions ensemble depuis quelques mois lorsque, pour la première fois, j’avais subi les foudres de son mutisme. Il me parlait de ses envies de voyage et des pays qu’il aimerait visiter. « — J’adorerais faire une croisière, c’est un peu ringard mais ça me fait rêver je ne sais pas pourquoi me disait-il songeur … Je m’imaginerais bien partir quelques semaines en mer, m’arrêter au gré des escales et découvrir une ville différente chaque journée. — Ah bon ? Tout seul ?! m’écriais-je un peu trop fort. Je ne suis pas incluse dans ton programme à ce que je vois ! dis-je d’un air adouci mais aussi faussement vexé. — Je parlais à la première personne comme ça Louise !!! Pourquoi faut-il toujours que tu rapportes tout à toi ?! avait-il répondu en se levant subitement du canapé où nous étions paisiblement lovés. — Je plaisantais Ben … dis-je, ne sachant comment me rattraper et surprise face à cette réaction si virulente. — Oui, et bien ton humour laisse à désirer ! Et par la même occasion, tu n’es visiblement pas non plus douée pour le repassage, je m’occuperai moi-même de mes chemises dorénavant m’asséna-t-il d’un ton cinglant, passant du coq à l’âne. Sur ces dernières paroles, il était allé dormir, me laissant bouche ouverte sur le sofa. Après quoi, il ne m’avait plus adressé la parole de toute la semaine. J’avais eu beau pleurer et faire amende honorable, il était resté imperturbable. La boite à méchancetés s’était ouverte, enfouissant le gentleman lover qu’il était sous un tas d’immondices. Puis, le samedi matin, en revenant de son jogging, il m’avait ramené un gros bouquet de roses. Tout était oublié, la boite à gentillesses était à nouveau ouverte. Chaque fois que ce genre de situation arrivait, c’était la fin du monde pour moi. Je n’arrivais pas à me raisonner. Sur le coup, j’étais énervée, me convainquant que cette fois, je ne craquerais pas, puis, je passais vite aux larmes et à l’anxiété, me persuadant que c’était fini et qu’il allait me quitter. Ainsi, je finissais toujours par platement m’excuser pour ce que j’avais pu dire ou faire, même si au fond de moi, je savais que je n’avais rien à me reprocher. Ben, lui, restait muet, un mur de briques triple épaisseur. Rien ne l’atteignait. Et puis, d’un coup, le déclic : du chocolat, un cadeau, une escapade et nous passions à autre chose, sans une once d’explications jusqu’à la fois prochaine. Devant la porte de notre histoire, ces épisodes s’accumulaient les uns sur les autres. Je les enjambais à chaque fois, tentant de les broyer mais hélas, la montagne de déchets commençait à devenir bien trop haute pour être ignorée. Ben était mon ventriloque et j’étais son pantin. Il tirait les ficelles de ma vie bon gré mal gré et chaque fois, je m’exécutais. Notre relation était cyclique, je m’y sentais dominée et surtout ligotée, incapable de bouger et de parler. Je me voyais passive et savais au fond de moi que rien n’était normal dans ce mode de fonctionnement mais je l’aimais, et j’étais persuadée qu’il m’aimait lui aussi malgré cette façade si dure. Je voyais en lui une bouée de sauvetage que j’avais parfois du mal à saisir. Je luttais de toutes mes forces pour m’y accrocher et ne pas sombrer. Je nageais, sans discontinuer, incapable hélas d’atteindre l’autre rive. La sonnerie de Skype me tira de mes sempiternelles interrogations existentielles. « — Enfin Steph !!! J’ai essayé de te joindre je ne sais combien de fois fulminai-je ! Tu n’as pas oublié quel jour nous sommes ! — Non ma belle, mais il n’est que 10h ici ! J’ai des choses qui s’appellent des enfants à déposer à l’école et j’avais une livraison de gâteaux à faire ce matin au plus vite ! » De spécialiste des voyages, ma sœur s’était transformée en professionnelle des cupcakes et gâteaux d’anniversaire en tout genre. Il avait suffi qu’un apollon lui fasse les yeux doux à l’agence de voyages de la cinquième avenue pour qu’elle finisse mariée avec deux beaux chérubins et qu’elle arrête de travailler pour se consacrer à cette si belle famille. Un conte de fée digne de la petite maison dans la prairie. Maintenant que mes neveux, Tim et Jack, étaient plus grands, ma sœur avait décidé de remettre sa vie professionnelle en route. Sans doute en souvenir de ces longs moments passés aux fourneaux avec notre père, elle s’était lancé dans la pâtisserie avec des gâteaux d’exception tous plus incroyables les uns que les autres. Rien que d’y penser, mon estomac faisait la danse de la joie. « — Et tu nous as fait quoi de bon aujourd’hui ? lui demandais je. — Une pièce montée sur le thème d’Alice au pays des merveilles avec une mousse framboise et exotique. Je me suis bien amusée avec les décors ! C’est pour l’anniversaire d’une petite Alice justement. — Tu me mets l’eau à la bouche ! Dommage que tu sois si loin, sans ça toutes ces douceurs passeraient par mon fin palais pour validation, dis-je en salivant. — Heureusement que je cours tous les jours parce qu’avec tout ce que je goûte je vais finir obèse, me répondit elle. — Bon, trêve de plaisanterie, on fait quoi pour papa aujourd’hui ? » Nous n’étions peut-être pas les sœurs les plus soudées du monde, mais nous avions établi un petit rituel chaque année, pour l’anniversaire de son décès. Ces deux mots n’allaient pas du tout ensemble, l’anniversaire était synonyme de fête quand le décès reflétait la tristesse et le chagrin. De longues années s’étaient écoulées mais la douleur restait vive avec un goût amer d’inachevé. Pour tenter de combler le vide qu’il nous avait laissé, j’allais farfouiller dans le grenier de la maison familiale, Stéphanie m’accompagnant seulement à travers l’écran de son smartphone. Maman y avait stocké toutes les affaires de papa, ses papiers, ses vêtements et ses peintures. Elle avait voulu faire un grand tri et se débarrasser de pas mal d’affaires quelques mois après qu’il soit parti mais, je m’y étais opposée, garantissant que je le ferais au fur et à mesure. Elle m’avait alors ordonné de tout monter au grenier, voulant visiblement dépoussiérer la maison des cendres de son défunt mari. J’avais besoin de garder tout ce pèle mêle lui appartenant, comme pour avoir le sentiment qu’il était toujours là, à veiller sur moi. Je me surprenais même parfois à lui parler, les yeux rivés vers le ciel, à lui demander de l’aide ou juste un signe pour me guider. Une fois l’objet de notre convoitise annuelle trouvé, je l’emmenais avec moi ou l’expédiais aux Etats-Unis. A tour de rôle, nous nous appropriions un bout de notre paternel pour nous accompagner jusqu’à l’année suivante. Je finissais toujours à quatre pattes, avec Stéphanie au bout du fil pour me guider dans mes recherches. Notre mère ne comprenait guère cette bizarrerie, elle nous trouvait ridicule. A chaque fois, elle disait « le passé c’est le passé, faire ça ne le fera pas revenir ». Songer que ça nous faisait du bien ne lui venait même pas à l’esprit. Elle était celle qui, parmi nous trois, était vite passée à autre chose. Armée d’un bouclier, elle rejetait en bloc toute émotion et toute nostalgie. J’espérais dans le fond que c’était juste une protection face au chagrin. Je savais que je me leurrai. « — Appelle moi quand tu seras là-bas ! Tu y vas bien ce soir ? me demanda Stéphanie. — Oui, comme d’habitude ! J’aurais même droit au traditionnel ragoût de maman !!! A croire qu’elle ne sait rien cuisiner d’autre… elle sait très bien que je déteste ça… — Alors à tout à l’heure ! éluda-t-elle en raccrochant, sans même prendre la peine de répondre à mes complaintes. » Ce qui contrariait Marguerite par-dessus tout, c’est qu’elle devait garder sa fille à dîner tous les 26 avril et son petit programme s’en trouvait alors chamboulé. Un véritable cœur de pierre, c’était certain. Marguerite avait toujours été un monstre d’organisation. Tout était millimétré et rien ne devait dépasser. Il n’y avait aucune place pour l’imprévu dans sa vie personnelle. Première illusion, car c’était pour mieux s’octroyer des contretemps dans sa vie professionnelle. Papa s’occupait de nous le plus clair de son temps, même si lui travaillait aussi. Elle gérait son emploi du temps afin d’avoir un maximum de liberté pour des réunions de dernières minutes. Comme elle aimait le crier sur les toits, sans elle, le cabinet ne tournerait pas. Tous ces avocats étaient si brouillons, heureusement qu’elle était là pour tout recadrer. Cela avait conditionné notre relation, mère disponible le soir entre 20h et 21h et le dimanche uniquement. J’avais grandi et le champ des possibilités s’était restreint aux repas du dimanche midi. Passer à l’improviste boire un café dépassait l’entendement. J’avais tenté de le faire une fois et cela m’avait servi de leçon. Visiblement, je la dérangeais et elle avait continué son activité sans me prêter la moindre attention. Je m’étais presque fait sermonner, comme quand j’avais douze ans. Je m’étais servi un café que j’avais bu en tête à tête avec moi-même, bouillonnant intérieurement, sans oser crier au scandale. Dans ma tête, je hurlais dans un monologue sans fin. « — Elle est incroyable !!! Elle ne peut pas s’arrêter deux minutes pour s’asseoir avec moi ! De toute façon, je suis bien la dernière de ses priorités, ça a toujours été comme ça ! Mais qu’est-ce que je fiche ici  Moi qui croyais lui faire plaisir ! Si seulement Papa était là … » Cependant, elle connaissait très bien les limites maternelles de cette attitude et n’avait pas eu d’autres choix que d’obtempérer, une fois par an. Et elle me le faisait payer, sournoisement. Capituler était une chose, faire de cette soirée un bon moment en était une autre. Alors que je détestais au plus haut point ce plat, elle me cuisinait inlassablement son ragoût que je me forçais à manger. Je ne m’éternisais guère, et la plupart du temps, à 22h j’étais rentrée. Elle faisait un effort surhumain pour se mettre à table avec moi, le regard jonglant de l’horloge à son assiette. Le dimanche, c’était différent, car c’est elle qui l’avait planifié. Elle aimait se pavaner devant Ben, qui m’accompagnait la plupart du temps. Il adorait ma mère et elle le lui rendait bien. Elle invitait toujours différents amis ou collègues du cabinet. Les apparences, toujours les apparences. Déjà à l’époque, mon père détestait ces repas de représentation mais n’avait pas d’autres choix que de s’y plier. En réalité, il avait le choix. Il aurait pu tout envoyer promener et faire autre chose de sa journée que jouer les maris modèles devant les invités. Surtout qu’elle passait son temps à le fustiger et l’accabler. Je sais qu’il rêvait de s’échapper pour aller pêcher avec mon oncle Phil, son ami de toujours. En général, celui-ci faisait une apparition en fin de journée, une fois la bataille terminée. Après la digestion, je finissais souvent par me reposer dans le grand hamac que mon père affectionnait pour ses longues siestes. Pour faire venir le sommeil, je me prêtais à imaginer un de ces fameux brunchs du dimanche avec les trois hommes de ma vie réunis : Papa, Oncle Phil et Ben. Malheureusement, dès que je me réveillais, le retour à la réalité était ardu. Il en manquait deux sur trois et rien ne pourrait changer ça. En plus du blues du dimanche soir, une chape de plomb s’abattait toujours sur mon moral lors du trajet retour. La relation de mes parents avait toujours été un grand mystère pour moi. J’avais cherché les flammes de leur amour mais n’avait trouvé que quelques braises qui s’éteignaient, lentement. Je voyais mon père tenter de souffler pour que les étincelles reprennent tandis que ma mère jetait de grands seaux d’eau pour tout éteindre. Elle nous éclaboussait au passage, sans se rendre compte qu’elle nous noyait à petits feux. Est-ce que les choses auraient été différentes si Daniel n’avait pas été si docile ? Je lui en veux, parfois. Je lui en veux, tout le temps, car il n’est plus là pour répondre aux milles interrogations qui chaque jour jaillissent dans ma tête. Je ne me doutais pas un seul instant que les réponses allaient venir à moi, tel un pigeon voyageur qui aurait fait cent fois le tour du monde avant d’arriver enfin à bon port, pile au bon moment.
83
Résumé : Jean-Luc Provost, le très médiatique entraîneur de gymnastique français, meurt dans un accident de voiture. La thèse du suicide, à seulement six mois des prochains jeux Olympiques de 2024, est très vite écartée. L'affaire, considérée comme sensible et politique, est confiée au groupe de Lost. Pourquoi vouloir assassiner un homme qui s'apprêtait à devenir un héros national ? Rebecca et son équipe se retrouvent immergées dans un monde où athlètes et familles vivent à la limite de la rupture avec pour unique objectif l'or olympique. Ils sont prêts à tous les sacrifices pour l'obtenir. Jusqu'au jour où le sacrifice demandé devient insurmontable… Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième fort intrigante. J’avais déjà lu et beaucoup apprécié les précédents romans d’Isabelle Villain, ses incontournables polars en compagnie du commandant Rebecca de Lost et son équipe. Je tiens d’ailleurs à préciser qu’Il n'est aucunement nécessaire d'avoir lu les ouvrages précédents pour lire celui-ci. Si vous tenez à vous faire une petite idée de ce qui précède, pour les plus curieux, mes chroniques ici : Peine capitale Blessures invisiblesDécembre 2023. À sept mois des JO de Paris, coup de tonnerre, le coach de l’équipe de gymnastique Jean-Luc Provost perd la vie tragiquement dans un accident de voiture. La thèse du suicide, un temps avancée, est vite écartée au profit d’un assassinat lorsqu’on apprend qu’il s’agit d’un sabotage avéré. Notre groupe de Lost est donc saisi de cette nouvelle affaire, on lui demande de résoudre cette enquête ultra sensible le plus vite possible, sans céder à la pression médiatique et sans faire de vagues. Ces quelques pages avalées, le ton est donné. Tout comme sa femme Rita, les athlètes et leurs familles, une fois la stupéfaction passée, les questions taraudent notre esprit en ébullition. Pourquoi, et surtout qui aurait un intérêt à assassiner cet homme à l’excellente réputation et apparemment estimé de tous ? Pourquoi s’en prendre à celui qui aurait pu devenir le prochain héros national et propulser la France dans l'histoire des Jeux Olympiques ? Sous la plume tantôt fluide et percutante, tantôt acérée et entraînante de l’auteur, nous voici plongés, enferrés, happés au cœur d’une intrigue sombre et douloureuse ayant pour toile de fond l’univers de la gymnastique artistique et de la préparation des athlètes de haut niveau. Dans ce monde où ne priment que l’opiniâtreté, l'acharnement, la persévérance à l'entrainement,, de jeunes athlètes pré-pubères maintenus en quasi huis clos loin de leur famille et de leurs repères sont conditionnés H24 dès leur plus jeune âge pour atteindre la plus haute marche du podium et rapporter la plus belle des médailles. Sous couvert d’excellence, leur enfance, leur adolescence vont être sacrifiées, leur mental et leur physique broyés, dans l’unique objectif de la performance… Malheureusement bien illusoire compte-tenu du nombre d’élus. Pourtant, pour pouvoir être qualifiés, ils seront prêts à tout, même aller jusqu’à l'impensable ! Pour Rebecca et son équipe commence alors une enquête minutieuse pour démêler le vrai du faux ; découvrir qui parmi l’entourage du coach sportif pouvait avoir un mobile, assez de rancœur ou de rancune pour passer à l’acte et l’assassiner. Un milieu opaque, où rien ne filtre ; mutique, ou les non-dits sont légions. Alors, dans ce cercle relativement réduit, qui est le coupable ? Un proche, quelqu’un d’extérieur ? Un collègue, un parent ou un élève ? Pour être honnête, je dois dire que je ne connaissais pas grand chose du milieu ou s’implante ce polar, mais grâce aux connaissances pointues de l’auteure en tant qu’ancienne athlète, et à sa capacité à nous les délivrer, je dois dire qu’il m’a été facile de m’y familiariser sans me perdre, permettant ainsi une excellente immersion. Ainsi, avec beaucoup de justesse, de profondeur et d'empathie, elle a su retranscrire avec brio tout le panel émotionnel et les motivations de ces jeunes Padawans ainsi que de leurs familles dans leur quête de la perfection, ce, en dépit de la mise en danger physique et mentale que cela implique. Médusée, bouleversée, impuissante, je n’ai pu que constater les problématiques liées à ce type de pratiques sportives impitoyables, ou l’humain est poussé au bout de lui-même, non loin du point de rupture. Et une fois lancés dans la spirale de la réussite, ces derniers se retrouvent dans l’impossibilité de faire machine arrière ; le sport étant devenu toute leur vie. L’enquête n’est pas en reste, entre rebondissements et fausses pistes, on se plait à avancer au même rythme que l’équipe pour tenter de découvrir le coupable et son mobile. Grâce à des chapitres courts et bien rythmés, le suspense reste entier tout au long du récit. Une thématique révoltante et inimaginable dont je préfère ne pas parler ici afin de ne pas spoiler ce qui va être abordé avec courage. Par petites touches, des éléments vont être savamment distillés, embrouillant encore mieux le lecteur pour l’emmener vers une fin tout à fait bluffante. Les personnages quant à eux sont bien campés, servant au mieux les besoins du récit. Retrouver Rebecca fut un vrai plaisir et le mélange vie professionnelle et personnelle apporte une profondeur supplémentaire non négligeable. Vous l’aurez compris, j’ai beaucoup aimé ce thriller intense et bien rythmé, la plongée au cœur de cet univers méconnu bien loin des strass et des paillettes, la qualité de l’intrigue et la manière dont elle a été menée. Alors, si vous aimez les romans qui sortent des sentiers battus, de ceux qui vous secouent, vous glacent le sang ou vous révulsent tout en vous faisant réfléchir sur les travers de l’espèce humaine…. foncez, ce livre est fait pour vous ; vous ne serez pas déçus  Ma note : Ma note :       Pour vous le procurer : Éditions Taurnada Amazon Réseaux sociaux : Twitter Facebook
84
« Dernier message par Apogon le jeu. 27/01/2022 à 17:26 »
Les enquêtes de Marie Rose Bailly - Le chant des poupées de Julie JKR Pour acheter : Amazon 1 Avant de vous parler des raisons de ma présence dans cette maison à Londres, laissez-moi commencer par vous raconter mon histoire. Marie Rose Bailly, vingt-deux ans, originaire de l’est de la France. Fraichement diplômée comme enquêtrice privée, me voilà en possession du fameux sésame pour démarrer ma première enquête. Les présentations sont faites. Sommaire, certes, mais concises. En ce qui concerne ma vraie description, elle tiendra en quelques lignes supplémentaires. À la suite d’une histoire de famille qui remonte aux alentours du XVe siècle, et dans laquelle il est question d’une ancêtre brûlée vive sur un bûcher par une bande de fanatiques, je possède une particularité. Elle ne me définit pas à proprement parler, mais elle a déterminé une grande partie de mon avenir. Toutes les femmes Bailly, sont dotées de cette spécificité, une sorte d’héritage familial, qui je l’avoue n’est pas commun. Présentée par les médecins comme une maladie dégénérative des oreilles, ou perte progressive de l’audition, si vous préférez. L’évolution est aléatoire d’un individu à l’autre. Il n’y a pas de règle établie. Ce sera soit lent, soit rapide. Quant à l’âge auquel le sujet sera atteint, là encore le hasard s’invite dans la partie. Pour ma part, neuf ans, a été le point de départ de la dégénérescence, et comme rien n’arrive jamais seul, ce n’est pas l’unique chose qui nous caractérise. « La perception » comme nous aimons l’appeler est un des symptômes majeurs. Notre dossier médical n’en fait pas mention, je vous rassure, ce ne serait pas vu d’un très bon œil. On m’a très vite expliqué les termes du contrat, si je puis dire, et la manière dont les choses allaient se dérouler pour moi à l’avenir. La perte progressive d’un de mes sens allait entrainer l’apparition d’une nouvelle capacité, en quelque sorte. Petit à petit, les voix et sons ambiants s’amenuiseraient, pour laisser place à la voix des morts. Dit de cette manière et surtout à une gamine de neuf ans à l’époque, on peut aisément avoir peur, mais ce n’était pas mon cas. Tout ça faisait partie de mon quotidien. Les femmes Bailly en avaient fait leurs métiers, sous couvert de services funéraires, bien entendu. Elles se chargeaient d’accompagner les familles dans le deuil d’un être cher tout en permettant aux défunts de partir en paix. Détail important à connaître sur la perception, elle n’est qu’auditive. En aucune manière, nous ne sommes capables de voir les morts. Les entendre, leur parler, ça s’arrête là. Ils ne se manifestent que pour délivrer un dernier message à leurs proches, rien de plus. Du moins jusqu’à ce que ma perception se déclare, et que mon expérience se révèle tout à fait différente des autres. Pour faire simple, aucun des morts que j’entends n’est là pour un dernier au revoir. Non. Au contraire. Les miens sont constamment soit en colères, soit tristes, soit complètement perdus. Ils hurlent. Ils pleurent. Ils jurent. Tout le temps. J’ai même droit à des voix étrangères, comme si ma perception avait une portée internationale. Lorsque tout a commencé, les nuits étaient courtes, et les journées à l’école extrêmement longues. Mes camarades me pointaient du doigt, me mettaient de côté, quand ils n’avaient tout simplement pas peur de moi. Une chose qu’il faut bien comprendre, c’est que les voix ne prennent pas rendez-vous, elles débarquent sans crier gare et je dois me débrouiller avec. On n’est pas préparé à ce qui nous arrive et les autres non plus. Dans le silence de la classe, mes hurlements à répétitions et mes crises de larmes ont eu raison du peu d’amis qu’il me restait. L’année scolaire s’est terminée à la maison où ma mère a endossé le rôle d’institutrice. Une solution temporaire, mais qui s’est avérée permanente. Un secret qu’il fallait garder, car les gens ne comprendraient pas, et même si ça avait été le cas, nous n’étions pas prêtes à le divulguer. Les gens ont souvent peur de la différence. Les enfants plus que les autres. Pour découvrir pourquoi ma perception était différente des leurs, elles ont entamé des recherches en remontant sur des dizaines d’années en arrière. Aucune explication n’est venue résoudre mon problème. J’allais devoir vivre avec, un point c’est tout. Chaque fois qu’une voix m’assaillait, je faisais de mon mieux pour en parler à ma mère. Compte rendu détaillé de ce que j’entendais. Quand par chance j’arrivais à obtenir un nom, on se mettait à chercher tout ce qu’il y avait à savoir sur cette personne. On a très vite compris que j’allais devoir faire face à des moments difficiles. Les voix que je percevais provenaient toutes de gens assassinés de manière violente ou cruelle. Dans tous les cas, atroce était le mot. À en croire ce qu’elles me disaient, la vengeance les libèrerait, et c’était à moi, de les aider à résoudre leurs affaires. La police, elle-même, n’avait pas été capable d’y remédier, mais moi, Marie Rose, neuf ans, j’allais y arriver. On marchait sur la tête. Pendant des jours, ma famille s’est attelée à m’apprendre à atténuer ma perception. Deux mots pour décrire cet apprentissage, douloureux et périlleux. Quelques semaines n’ont pas suffi à y arriver. Au bout d’un an, je parvenais seulement à réduire le volume sonore à quelque chose d’acceptable. Ajoutez à cela deux ans de plus et vous obtenez enfin des chuchotements. Ce n’est qu’à l’âge de quinze ans, que j’ai réussi à dompter la bête. Des années de pratique, des centaines de migraines, des séances de pleurs à n’en plus finir, tout ça pour cohabiter avec ma perception. Il a fallu réfléchir à ce que j’allais faire de ma vie, car travailler avec ma famille n’était pas à l’ordre du jour. Le métier d’enquêtrice privée s’est présenté comme une révélation. Je pourrais travailler la plupart du temps seule, c’était exactement ce dont j’avais besoin. Résoudre les affaires en lien avec les voix me permettrait de vivre un minimum en paix. Me voilà donc enquêtrice, les oreilles pleines de voix, des affaires qui se bousculent, et pas la moindre idée de par où commencer. Compartimenter. Prioriser. Mettre de l’ordre dans mes idées. Seulement voilà, tout était nouveau pour moi. Mon métier n’avait été que théorique, et à présent, je devais passer à la pratique en ajoutant ma perception à l’équation. Quel serait le critère à prendre en compte pour faire passer la demande d’une voix avant une autre ? Dix jours de tergiversation pour élaborer un plan d’action qui tienne la route. C’est là que je l’ai entendu pour la toute première fois. Cette voix, si pure, si claire, si triste. Elle m’a frappé comme une évidence. Ma première mission serait de m’occuper de son cas, j’allais me consacrer entièrement et uniquement à elle. Lizzie, cinq ans, anglaise d’après son accent, serait mon occupation principale pour les semaines à venir. Mon excellent niveau d’anglais allait enfin pouvoir me servir pour comprendre ce qu’elle avait à me dire. La perspective de mener ma première enquête me rappelait que si je pouvais entendre cette petite fille, ça signifiait qu’elle était morte. 2 – J’ai un mauvais goût dans la bouche, et ma tête tourne comme quand je vais sur le tourniquet au parc avec papa. J’aime pas ici. Il fait noir et c’est pas chez moi. C’est chez qui ? Je comprends pas pourquoi je suis ici. Il est où papa ? J’ai appelé, mais il a pas répondu. Et elle est où Madeline ? J’ai cherché, mais Madeline est pas là non plus. y a un bruit. Je sais pas c’est quoi. Il est pas loin, mais il est pas là non plus. Quand je parle, c’est comme quand je parle dans le bain et que mes oreilles sont dans l’eau. J’aime pas ça ici. Ça fait peur. Je sais pas quoi faire. Je suis toute seule et il fait noir. J’aime pas quand il fait noir. Ici y a pas la lumière dans la prise comme dans ma chambre. Et y a pas Madeline et y a pas papa. J’aime pas ici. Je veux aller chez moi. Lizzie parle sans s’arrêter. J’essaye de tout noter, mais c’est peine perdue, alors je reste silencieuse et je l’écoute. – Mon nez il est tout mouillé parce que je pleure beaucoup. J’ai pas de mouchoirs, alors ma manche est toute cracra. C’est papa qui dit cracra quand je rentre du jardin. J’aime bien quand il dit ça. Je rigole toujours. Mais là je rigole pas. Je pleure. Et ça coule de mes yeux et ça veut pas s’arrêter. Le bruit est pas loin. J’aime pas le bruit. La voix elle est ici, mais je vois pas la tête. Je connais pas la voix. Elle doit venir. Je veux la voir. Sa voix me brise le cœur. Si je pouvais la serrer dans mes bras pour la réconforter, lui promettre que tout ira bien, je n’hésiterais pas une seconde. Malheureusement, Lizzie est morte et elle ne le sait même pas. Quelle est la meilleure façon d’annoncer à une petite fille de cinq ans qu’elle ne rentrera plus chez elle ? Qu’elle ne reverra plus jamais son papa ? Aucune. Il n’y en a aucune, car rien de tout ce qui est en train de se dérouler n’est normal. Une enfant ne devrait pas mourir un point c’est tout. Je dois trouver le moyen de l’aider à découvrir qui lui a fait ça, c’est bien la seule chose dont je suis sûre pour le moment. Reste à espérer que j’en sois capable. Je commence par lui poser quelques questions simples. – Lizzie, où étais-tu lorsque tu as disparu ? – C’est quoi disparu ? Cinq ans. Ne pas l’oublier. Réfléchir comme une enfant de cet âge. – Lizzie, est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais avant d’être dans le noir ? – Avec papa et Madeline, on faisait des manèges. C’était un début. Maintenant, restait à savoir qui était son père, qui était Madeline et de quels manèges elle parlait. – Est-ce que tu sais où tu habites ? – Dans ma maison avec papa et Madeline. OK. Ce n’était pas gagné, loin de là. Pendant plus d’une heure, j’ai tenté en vain d’obtenir une adresse. Elle a réussi à répondre à quelques-unes de mes questions, et j’ai pu prendre quelques notes de ce que je venais d’apprendre. Tout d’abord, elle était anglaise, l’accent et les bus rouges m’ont mis la puce à l’oreille. Je connaissais son nom, celui de son père et je savais enfin qui était Madeline. Lizzie Williams, cinq ans, fille de Harry Williams. Madeline, poupée qui casse si on la laisse tomber. Ce sont ses propres mots. Minces comme indices pour démarrer une enquête, mais loin d’être inutile. Pour commencer, j’allais concentrer mes recherches sur les disparitions d’enfants en Angleterre. Le périmètre était immense, il allait falloir affiner tout ça rapidement. Pendant que je pianotais sur mon clavier, Lizzie s’était remise à parler. – La voix elle parle de Emily et Megan. Et des autres aussi, mais y a trop de noms. Je peux pas tout retenir. En plus je sais pas qui c’est. D’autres filles disparues ? J’espérais que non, mais mon instinct me prédisait le contraire. Je notais les prénoms. – J’aime pas les poupées dans le noir. Elles sont grandes. Elles font peur avec leurs yeux tout bizarres. J’aime pas leurs grandes têtes. Elles sont assises et elles regardent vers moi. J’aime les poupées. Madeline, je l’aime. Mais pas les poupées avec les yeux mouillés. – Lizzie, parle-moi des poupées. – Je veux plus voir leurs yeux mouillés. – Est-ce qu’elles sont comme Madeline ? Où est-ce que c’est une autre sorte de poupée ? – Elles sont trop grandes et elles font trop peur. Beaucoup trop peur. – Si elles tombent, est-ce qu’elles vont se casser comme Madeline ? – Oh oui. Donc les poupées étaient en porcelaine. Était-ce un détail important ? Aucune idée, mais il ne fallait rien négliger. Restait à découvrir pourquoi elle n’aimait pas ces poupées, et surtout, pourquoi elles lui faisaient si peur ? Je m’apprête à lui poser la question, lorsqu’elle se met à hurler. Son cri est tellement fort qu’il me vrille les tympans. J’essaye par tous les moyens de la calmer, mais rien à faire, elle continue de crier. – Lizzie, qu’est-ce qui se passe ? – Elles parlent. Elles sont tristes. Elles veulent pas être là. Elles ont froid comme moi. Elles disent mon prénom aussi et elles reniflent fort. J’aime pas être là. Je veux mon papa. Dis à mon papa de venir me prendre. Ses derniers mots me rendent triste, mais je dois me concentrer sur le reste. Qui sont ces poupées ? Que lui veulent-elles ? Novice en matière de dialogue avec les morts, certaines choses m’échappent encore. Dois-je prendre au pied de la lettre tout ce qu’elle me dit ? Quelles sont les règles qui régissent l’autre côté ? Je suis certaine que Lizzie ne pourra pas répondre à cette question. Je profite d’une période d’accalmie pour demander conseil à ma grand-mère. Une personne expérimentée sera certainement capable de m’éclairer, et cela même si nos perceptions sont différentes. Parler aux morts, c’est une discipline qu’elle exerce depuis plus longtemps que moi. C’est ma seule solution pour le moment. Ma grand-mère s’est révélée être une source d’information inestimable. Elle m’a notamment expliqué que les morts décrivent les choses telles qu’ils les perçoivent. Si la voix se met à parler d’un corbeau qui chante, cela veut littéralement dire qu’un corbeau chante. Rien de métaphorique pour eux. De notre côté de la réalité, par contre, la signification n’est pas toujours la même. En clair, lorsque Lizzie me dit que des poupées en porcelaine lui parlent, c’est effectivement le cas. À moi, maintenant, de savoir qui sont-elles et ce qu’elles lui veulent. Il me faudra également découvrir qui sont les autres dont parle Lizzie, et si les poupées sont des filles ? Voilà que je commence à m’embrouiller. Je vais laisser le temps me le dire. Tout est une question d’interprétation et de compréhension. Les morts ont quelque chose à me raconter, à moi de découvrir de quoi il s’agit. C’est une première pour nous, alors tout le monde tâtonne, mais je sais que quoiqu’il arrive, je pourrais compter sur ma famille. L’objectif à ne pas perdre de vue, trouver ce qui est arrivé à Lizzie. Son père a le droit de savoir, et je dois l’aider à quitter cet endroit qui lui fait si peur. 3 Internet regorge d’informations, certaines sont utiles pour démarrer une enquête, et d’autres sont clairement à laisser de côté. Le tri est indispensable si l’on veut pouvoir avancer. Tout ce que vous lisez n’est pas à prendre pour argent comptant, la multitude d’informations reste difficile à vérifier. La majorité des articles se basant sur des sources anonymes sont à prendre avec des pincettes, si votre source n’est pas fiable à cent pour cent, et que ce qu’elle avance n’est pas vérifiable, passez votre chemin. Vous me remercierez plus tard. La véracité des témoignages et des faits est primordiale. Il faut être intransigeant là-dessus, sous peine de suivre une mauvaise piste. Mes recherches se concentrent essentiellement la nuit, seul moment de répit, seul moment où Lizzie ne se manifeste pas. Jongler entre ses dialogues décousus, mon investigation compliquée et le manque de sommeil évident, commence à être dur. Le combo parfait pour aller droit dans le mur et la tête la première bien évidemment. Malgré tout, je continuerai à ce rythme effréné aussi longtemps qu’il le faudra, tout simplement parce qu’une petite fille compte sur moi. Durant mes escapades nocturnes sur la toile, un lien vers un blog revenait sans cesse dans les premiers résultats. Le titre Affaires non résolues d’Angleterre m’a poussé à le lire. Articles de qualités, et bien documentés. Écriture professionnelle. Photos et témoignages sérieux. On avait à faire à quelqu’un d’impliqué et de méticuleux dans son travail. D’après sa bio, il était journaliste indépendant, ceci expliquait cela. J’ai passé des heures sur son blog, mais je n’ai rien trouvé sur Lizzie. Je n’avais pas encore fait le tour de tous les articles, je ne devais pas désespérer. Étant donné que je n’avais pas pu me résigner à lui dire qu’elle était morte, je ne pouvais pas déterminer le moment de son décès. La presse et les autorités avaient très bien pu en parler aux informations, mais pour le moment j’avais fait chou blanc. Sauf si c’était une vieille affaire, auquel cas j’aurais du pain sur la planche. L’auteur du blog pourrait peut-être m’aider sur des affaires similaires, bien que je n’aie pas grand-chose à partager avec lui pour le moment. Lizzie avait bien parlé d’autres filles, mais c’était vague. La partie fastidieuse allait débuter, trouver le moyen d’entrer en contact avec cette personne. Son blog était suivi par des milliers d’abonnés, il devait à coup sûr recevoir des centaines de messages par jour. J’allais devoir user d’ingéniosité pour me démarquer, et je dois dire que pour le moment ce n’était pas gagné. L’inonder de messages a été ma première stratégie, mais je me suis vite ravisée. Mauvaise approche pour un premier contact. Le traquer sur les réseaux sociaux a été ma deuxième idée, avec un peu de chance je trouverai une meilleure façon de le joindre. Au moment d’ouvrir un nouvel onglet, une bannière est apparue sous mes yeux. Un message défilait en continu accompagné de la photo d’une petite fille. Le dix-neuf novembre deux mille dix-sept, Lizzie Williams, cinq ans, a disparu. Elle a été vue pour la dernière fois à la fête foraine de Winter Wonderland de Londres. Au moment de sa disparition, elle portait un pantalon noir, des bottines grises, un manteau gris avec une capuche fourrée blanche et un bonnet gris avec un pompon. Caractéristiques physiques : Blonde aux yeux bleus. Elle mesure un mètre cinq. Si vous possédez la moindre information susceptible d’aider la police à la retrouver, composez le numéro qui s’affiche en dessous. La piste que j’attendais depuis des jours venait enfin d’apparaître. Je connaissais désormais sa description complète. Il y avait même un numéro, mais il devait s’agir d’un centre d’appel où ils centralisaient toutes les informations qu’ils recueillaient, donc certainement pas utile pour moi. Je devais absolument trouver le moyen de parler avec ce Dorian, l’auteur du blog. D’après mes notes, Lizzie avait disparu depuis quinze jours. Avait-elle été tuée le jour même ? Ou plus tard ? Restait à le découvrir. Elle était accompagnée de son père à la fête foraine. Où était-il au moment du kidnapping de sa fille ? Que s’était-il passé ? Au lieu d’avancer, de nouvelles interrogations s’ajoutaient aux anciennes. Lizzie avait besoin de moi et moi je tournais en rond. Incapable de dégoter la moindre information sur son blog, j’ai décidé d’éplucher ses réseaux sociaux. Par l’intermédiaire d’un ami à lui, je me trouvais enfin en possession d’une adresse mail personnelle. Je me suis empressée de lui envoyer un message. Baisser les bras ne faisait pas partie des options envisageables. Enquêter nécessitait de la rigueur, de la détermination et un soupçon de chance, je l’avoue, mais c’était avant tout un travail long et fastidieux. La ténacité et la persévérance sont les maîtres mots pour s’engager. Tenir coûte que coûte cette ligne de conduite. Toujours trouver une piste à explorer et à exploiter pour avancer dans son enquête.
85
« Dernier message par Apogon le jeu. 13/01/2022 à 17:34 »
Les chroniques de Zadlande de Emmanuel Hemery : tome 1 La fondation Pour l'acheter : AtramentaPrologue Aurel attendait l’arrivée d’Héléna dans la grande gare de la capitale. Ils ne s’étaient pas vus depuis le jour où, dans cette même gare, ils s’étaient embrassés pour la première fois, avant qu’elle ne parte pour ce séminaire d’agronomie. Il en pinçait pour elle et espérait que ces deux longues semaines ne lui avaient pas fait oublier ce baiser. Aujourd’hui, il lui réservait un accueil savoureux et projetait de l’emmener au restaurant pour une soirée en tête à tête. Malgré la délicatesse et la douceur de leurs échanges SMS quotidiens, Aurel espérait que son amour grandissant était réciproque. En faisait-il trop ou trop peu pour la séduire ? Était-il à la hauteur ? Rien n’était jamais acquis. La remise en question faisait partie de sa nature. Selon lui, le doute pourvoyait aux savoirs, les certitudes entretenaient les croyances et s’y cantonnaient créant parfois les illusions. Aussi valait-il mieux se remettre en question que se mentir à soi-même. Il pensait que toute conviction imposait une limite ou l’échéance de la quête de connaissance ; et s’agissant d’amour, la certitude mettait un terme à la séduction et à ses ravissements. Il ne lui importait donc pas d’avoir la certitude d’être aimé comme le serait tout flagorneur à chaque nouvelle conquête. Ce doute, cette propre remise en question, l’encourageait plutôt à ne jamais cesser de courtiser Héléna, à toujours la couvrir d’attentions délicates et à l’aimer chaque jour plus encore. Aurel était né en 2017, dans la capitale. Fils de Léonard Lerousic, chercheur au centre national de recherche scientifique et de Marianne, artiste réputée et conservatrice de musée. C’était un jeune homme très séduisant, bien bâti ; mais qu’attendrait une jeune femme d’un beau gaillard s’il ne se contentait que de son trait ou d’une contenance particulière pour être apprécié et aimé ? S’il était beau, avec ses longs cheveux blonds, son visage parfait, son allure sportive et décontractée, Aurel ne s’en souciait guère. Car cela n’était pour lui qu’une perception subjective, sans aucune mesure avec le charme qui, tel un parfum, exhalait toutes ses subtilités comme la grâce d’une attention, une pensée tendre ou un geste délicat. Il avait 23 ans, Héléna un de moins. Tous deux étaient encore étudiants. Ils n’avaient pas véritablement de projets d’avenir, se défiant tous les deux de ces lendemains prétendument bien jalonnés qu’offrait une société clairement ébranlée par ses extravagances et ses dénis. C’était du moins l’idée de l’avenir que se faisait cette nouvelle génération née dans les années 2020, consciente et contrainte de s’adapter à un environnement chaotique abandonné par leurs aînés. Rares étaient celles et ceux qui, comme Aurel et Héléna, envisageaient une vie en couple ou fonder une famille. À l’instar de ce monde endiablé, la gare grouillait de gens affairés, pressés ou soucieux. Aurel avait pris de l’avance et observait les horaires d’arrivées s’assurant d’être bien prêt à recevoir sa bien-aimée. Les quais étaient comme toujours encombrés de voyageurs. Les uns courraient, d’autres allaient nonchalamment. Le bruit des roulettes des valises dominait les murmures et les conversations d’autres voyageurs stationnés devant les grands tableaux d’affichage. Mais il y avait dans cette immense gare, une voix étrange qui surpassait ce bourdonnement routinier. Elle raisonnait avec écho dans le hall. Quelques badauds s’étaient regroupés, certains ricanaient. Aurel avait du temps, il s’approcha du groupe. Un homme assez vieux, aussi barbu et blanc qu’il aurait fait un père noël d’exception, clamait d’une voix puissante et intelligible, ce qui semblait être des versets du « nouveau testament ». — Alors je vis que l’Agneau avait ouvert un des sceaux, et j’entendis l’un des quatre animaux qui disait d’une voix de tonnerre : Viens et vois. Je regardai donc, et je vis un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc, et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, pour remporter la victoire… Aurel comprit très vite que l’homme citait un chapitre de l’apocalypse et parlait des quatre chevaliers. Il se crut un moment dans l’un de ces clichés qui font ces films de série B ou les blockbusters au scénario catastrophe simpliste. Il sourit en voyant le vieillard s’agiter et jouer la comédie. –… Et lorsque l’Agneau eut ouvert le second sceau, j’entendis le second animal qui disait : Viens, et vois ! continua le vieillard, brandissant parfois une main tendue vers le ciel… Et il sortit un autre cheval qui était roux ; et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres ; et on lui donna une grande épée. Et quand l’Agneau eut ouvert le troisième sceau, j’entendis le troisième animal, qui disait : Viens et vois ! Et je regardai, et il parut un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j’entendis une voix qui venait du milieu des quatre animaux, et qui disait : La mesure de froment vaudra un denier, et les trois mesures d’orge vaudront un denier ; mais ne gâte point ni l’huile ni le vin… L’attroupement avait dû inquiéter les services de sécurité de la gare. Ces derniers s’approchèrent calmement de l’homme dont le ton et la voix s’intensifiaient au point de faire frémir Aurel et d’autres spectateurs, eux aussi intrigués ou impressionnés par la conviction qu’exprimait ce curieux personnage. Des gens chuchotaient comme pour ne pas déranger le prédicateur insolite. — Et quand l’Agneau eut ouvert le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième animal, qui disait : Viens, et vois ! — Jean-Claude ! intervint l’un des agents de sécurité, vous ne pouvez pas rester là, dit-il en l’invitant à se lever. Le vieil homme ne résista pas, il se releva mais poursuivit son chapitre. — Et je regardais, et je vis paraître un cheval de couleur pâle ; et celui qui était monté dessus se nommait la Mort, et l’Enfer le suivait ; et le pouvoir leur fut donné sur la quatrième partie de la terre, pour faire mourir les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre, acheva-t-il d’une voix forte qui résonnait comme un ultime avertissement, pendant que les officiers l’éloignaient du hall. Aurel resta un moment figé dans la réflexion. Évidemment il ne croyait pas en aucune de ces paroles, mais il ne pouvait s’empêcher de les mettre en corrélation avec ses propres convictions concernant un monde qui selon lui, courrait à sa perte. — Sacré JC, il nous avait habitués à mieux. Je préférai lorsqu’il nous chantait des chansons avec son petit banjo, commenta une personne visiblement habituée des lieux. — On devrait les enfermer ces malades ! entendit Aurel au passage d’un couple suivi d’un agent de la gare qui poussait péniblement un chariot empli de leurs bagages. — Comme si c’était le moment ! On a déjà assez d’assistés, si en plus il faut supporter ces énergumènes et oiseaux de mauvais augure ! renchérit un autre des voyageurs. Aurel se reprit assez vite et oublia cette distraction fortuite. Il était impatient de voir sa petite amie sortir d’une des voitures du train qui venait enfin d’entrer en gare. Finalement il l’aperçut. Elle le cherchait, ce qui lui semblait être une manifestation probable de sentiments réciproques. Les deux jeunes gens se retrouvèrent sur le quai et depuis, ils ne se quittèrent jamais plus. Aurel se souviendra longtemps du début de leur histoire d’amour en 2040 et de ce vieil homme que la morosité ambiante du début de ce siècle avait sûrement dû inspirer. Ce jour où il attendait dans cette gare, il n’était encore qu’un jeune homme à qui on avait promis un bel avenir puisqu’il cumulait à la fois et avec réussite, des études d’architecture et de génie civil. Mais son avenir à lui, c’était elle. Aurel et Héléna s’arrangèrent plus tard pour partager un appartement. Mais ils ne voyaient pas leur avenir se dessiner si simplement. Quant à imaginer dérouler sereinement leur carrière, les événements, les troubles sociaux et politiques leur semblaient ne pas être de bonnes conditions. À cette époque, le dérèglement climatique était une menace majeure, reprise dans toutes les conversations, et dans tous les discours politiques de ces dernières décennies. Aurel repensait parfois aux présages du vieil homme dans la gare, mais sans pour autant lui donner raison, il avait lui aussi un mauvais pressentiment. Héléna et lui vécurent ensemble un peu plus d’une année avant que les événements ne les poussent finalement à renoncer à la capitale et à poursuivre leur idylle à la campagne. Sur les conseils de ses parents, Aurel rejoignit les Près-Monts, une région de montagne au sud-est du pays où vivait son grand-père maternel. Là-bas, le jeune couple pourrait mettre à profit leurs savoirs et trouverait de quoi satisfaire leur envie de vivre plus simplement et bien plus humblement, privilégiant leur amour à une carrière plutôt incertaine vu les conjonctures. Aurel avait été pessimiste, mais les faits et événements qui suivirent lui auront donné raison. On savait déjà depuis plus de vingt ans que le climat avait tendance à se réchauffer, qu’il fallait prendre des résolutions effectives et drastiques pour enrayer le phénomène avant d’atteindre un point de non-retour. Mais malgré les constats et les concordances scientifiques qui affluaient régulièrement, justifiant une source anthropique au phénomène, beaucoup de voix s’élevaient et s’affrontaient quant à l’origine de ce mal. D’aucuns s’appuyaient sur des calculs tout aussi scientifiques pour livrer une version moins pessimiste mentionnant un événement naturel dû aux cycles solaires minimisant de la sorte toute responsabilité humaine. D’autres articulaient leurs arguments en reléguant cette supposée variation climatique à un mensonge, une conspiration contre les populations afin de leur soustraire plus de taxes ou de les obliger à changer de mode de consommation pour une économie soi-disant plus « verte » ou plus « responsable » derrière laquelle se cachait une spéculation véhiculée par de nouveaux lobbys industriels. Malgré les résolutions prises entre les États du monde quant à limiter leurs rejets dans l’atmosphère, peu se pliaient aux recommandations des scientifiques. Des politiques plus subtiles se servaient du prétexte de cette échéance climatique pour contraindre la population à concéder plus d’efforts et contribuer financièrement à leur supposée lutte contre le dérèglement. La duperie politique visait à culpabiliser les plus humbles sans que les véritables pollueurs ne fussent responsabilisés ou appelés à une quote-part financière. Une grogne populaire commençait alors à s’élever sur le continent. Une autre duperie politique issue d’un autre camp, populiste celui-là, s’était nourrie de la colère de la population et dénonçait sans ambiguïté une vaste cabale qui justifierait l’acceptation de migrations venues du sud, évoquant même un complot contre la suprématie de leur Nation. Autrement dit, partout dans le monde, deux camps avaient confisqué le sujet. D’abord les « utilitaristes » qui comparaient la planète à un radeau de naufragés. Selon ceux-là, il fallait impérativement consentir à quelques sacrifices substantiels pour préserver ce dit radeau ; quitte à perdre ou rejeter certains naufragés pour sauver la majorité des autres, ne fût-ce que pour l’intérêt général , ou plus exactement, pour le maintien de la croissance économique malgré la tempête écologique. Le plus souvent ces demandes de sacrifices s’axaient sur le renoncement ou la limitation des droits sociaux, l’augmentation de la durée du travail ou une contribution plus importante. Un effort à fournir que les plus humbles citoyens n’étaient en aucune façon capables de supporter. Cette attitude des « utilitaristes » alimentait expressément le populisme dans les couches sociales plus modestes, si bien que dès le début des années quarante, il n’y avait finalement, que ces deux grands mouvements politiques à se disputer le pouvoir sur fond de tumultes sociaux et d’incohérences politiques. En définitive, le monde plongeait dans un déni total de la situation réelle. Et quand s’abattirent les fléaux les uns après les autres durant cette même décennie, tous, responsables politiques ou simples citoyens, se retranchaient dans ce qu’ils savaient mieux faire : le chacun pour soi ! Le premier fléau fut effectivement le réchauffement climatique. Là encore quelques-uns y voyaient des opportunités économiques comme l’ouverture de nouvelles routes maritimes par le nord, l’exploitation du permafrost, ou la découverte de nouvelles nappes de pétrole. Dans les régions plus au sud, victimes de plus en plus de sécheresses, d’incendies extraordinaires et de famines brutales, les populations devaient migrer au nord, pour en réalité, fuir l’embrasement de leur pays par des guerres dévastatrices. Le nationalisme ambiant qui occupait d’ores et déjà les pouvoirs dans les zones plus tempérées de la planète, leur bloquait les frontières. Les pays riches se refermaient sur eux-mêmes. Mais personne ne sut voir venir la plus grande migration de population. Celle-ci arrivait du nord dès 2042, poussée par des bouleversements météorologiques extraordinaires et de plus en plus fréquents, comme les ouragans, phénomènes totalement inédits dans leurs pays. On avait alors trop longtemps négligé le climatiseur naturel essentiel à la planète que sont les courants maritimes. En effet, les précipitations de plus en plus fréquentes avaient augmenté le débit des fleuves qui rejetaient de plus en plus d’eau douce au nord, ajoutée à celle de la fonte des glaciers et de la banquise des pôles. Une eau douce dont la densité bien différente de celle de l’eau de mer, finit par perturber les courants marins. Et c’est de cette façon que le courant maritime principal remontant des eaux plus tièdes vers le pôle, apportant jusque-là au climat sa douceur estivale et tempérant les hivers, se mit à ralentir jusqu’à ne plus remplir son office de climatiseur. Et contrairement à ce que l’on croyait être un réchauffement climatique global, ce fut en réalité un refroidissement total des parties les plus proches des pôles. C’était donc une ère glaciaire qui s’avançait inexorablement d’année en année sur des terres jusque-là productives, détruisant l’économie de base, l’agriculture, et forçant les populations à rejoindre le sud. Les glaces s’étendaient au nord, les déserts s’emparaient du sud, et le nationalisme explosait au centre. À la fin des années quarante, le climat devenait plus virulent, allant de canicules estivales brutales à des hivers extrêmement froids, en passant par des automnes et printemps plus tumultueux et ravageurs. L’économie mondiale fut anéantie. Ainsi se déclenchait le second fléau : les guerres civiles. Cela aurait pu être un affrontement de populations du nord contre populations du sud, mais c’était un chaos plus dantesque. Une confusion sordide nourrie par un nationalisme exacerbé à tel point qu’on ne distinguait l’ennemi que par sa couleur de peau ou simplement son langage. La banqueroute économique de 2049 aboutissait à l’annihilation de toute forme d’autorité nationale. Seules quelques villes ou métropoles pouvaient encore s’organiser, protégées par des garnisons. Les zones rurales étaient relativement épargnées, mais livrées elles aussi à la famine. Le bétail fut très vite anéanti par les incursions, souvent violentes, des urbains venus chercher les denrées introuvables en ville. Tous les stocks, les centres commerciaux furent pillés. Certains villages et notamment ceux qui se trouvaient en montagne devinrent des forteresses imprenables. Nul ne saurait dire si cette dramatique et meurtrière confusion touchait tous les pays à travers le monde, car les communications, dont le fameux réseau web, étaient coupées. Mais ce qui devinait une évidence pour chacun, c’est que la mort menaçait qui ne trouverait pas suffisamment à se nourrir ou qui croiserait certaines milices lourdement armées. C’est à ce moment qu’intervint le plus terrible des fléaux ; à la fin de l’hiver 2051. Certains nommaient cette pandémie, la « peste blanche ». C’était en réalité le fait d’un champignon qui apparut soudainement. En moins d’une année, il éradiqua plus des deux tiers de la population encore en vie. Les agglomérations subissaient les ravages les plus importants. Les premières victimes furent cependant les personnels soignants et les chercheurs comme le père d’Aurel. Face à cette maladie venue de nulle part et impossible à contenir puisque toutes médecines avaient échoué, des solutions drastiques étaient employées comme la crémation des corps. L’embrasement mal maîtrisé des lieux contaminés occasionnait de terribles incendies. Des quartiers entiers, voire certaines villes dans leur totalité, s’enflammaient, parfois sans aucune résistance. Cette maladie était due à un champignon proche du Candida. Le père d’Aurel avait d’ailleurs étudié l’un de ces dangereux minuscules champignons, le C Auris qui se développait parfois sans qu’on ne puisse le combattre. Mais le développement de la « peste blanche » et sa propagation étaient différents, semblables à un oodinium mais aérien. La victime avait dans un premier temps les bords des paupières qui blanchissaient, puis très vite le champignon s’attaquait à toutes les muqueuses du malade. Et en moins de deux ou trois jours, la personne succombait d’insuffisance respiratoire. Étonnamment, les enfants de moins de cinq ans étaient le plus souvent épargnés. Mais devenus orphelins et isolés pour la plupart, quand ils ne trouvaient pas de secours, leur sort n’en était pas moins fatal. Les nourrissons mourraient dans les bras de leur maman décédée depuis plusieurs jours. D’autres enfants périssaient par les incendies, pour s’être réfugiés sans pouvoir estimer le danger. Personne ne put comprendre ni l’origine, ni la façon dont cette pandémie se propageait puisqu’elle se déclarait spontanément partout sans véritablement de point de départ. On soupçonnait une dispersion rapide des spores du champignon et la seule réponse était d’incendier tout lieu ou personne infesté. L’année suivante, la maladie s’interrompit aussi nette qu’elle apparut, sans que personne ne sût en donner la raison exacte. Mais si elle fut terriblement meurtrière, laissant derrière elle de gigantesques charniers et des villes entièrement consumées, cette pandémie avait mis un terme aux guerres civiles. Le dernier fléau, fut lui tout simplement grotesque. Celui d’une civilisation qui s’évertuait à se reconstruire sur le même modèle que la précédente. Car très rapidement un système féodal s’installa. Des hordes de pillards plus ou moins organisées, s’allouaient certains territoires et dominaient ceux-ci avec la tyrannie qu’il convient d’attribuer à la pathologie évidente de chacun de ces chefs de clans. Véritables psychopathes ou pervers narcissiques, le plus souvent anciens élus ou de formation militaire, certains de ceux-là se nommaient eux-mêmes « Président, Baron, Duc ou Général » en tant que chef et seigneur d’un fief qui leur appartenait. Les populations étaient donc contraintes d’obéir et de se soumettre à ces brigands qui, en échange de leur protection, exigeaient de substantielles compensations alimentaires. Dans le cas où les habitants refusaient, ou ne s’acquittaient pas des exigences de ces seigneurs, ils étaient soit expulsés du territoire ou le plus souvent, purement et simplement lynchés ou tués. Ces tyrans régnaient donc en imposant la peur, mais cela étant, ils étaient le plus souvent confrontés à la concurrence des territoires voisins. Certains cherchaient à étendre leur domaine. Ils combattaient leurs rivaux comme le feraient les gangs mafieux, soit par attentats et petites guérillas frontalières, soit en batailles rangées occasionnant dans les rangs de part et d’autre, de nombreuses pertes et le gaspillage des munitions d’armes à feu de plus en plus rares. La vie d’un brigand au service de ces seigneurs autoproclamés n’était donc pas facile. Quand bien même ils avaient de quoi se nourrir sur le racket des populations ou les butins pris aux adversaires, beaucoup finissaient par déserter. Car en plus des conflits de territoires, ils devaient affronter la résistance d’une population qui semblait progressivement s’organiser et parfois qui les surprenait par des guets-apens. Ainsi certaines provinces étaient abandonnées aux maquisards et les malfrats ne s’y aventuraient que très rarement. Ces territoires épars furent appelés par les chefs de clan « zones autonomes défendues » puis « les Zadlandes ». Leurs fiefs se limitaient donc aux anciennes zones urbaines et alentour, car s’aventurer en ces contrées que la nature pourvoyait en forteresses diverses, ne leur était jamais profitable. Ainsi les régions montagneuses, les hauts plateaux ou les vastes forêts étaient progressivement désertés par les brigands. Chapitre un : Le brochet C’était une journée de début septembre 2055, sombre et lourde. Quelques petites averses s’étaient alternées au matin avant de revenir à une lumière plus souveraine malgré le passage de nuages chargés poussés par un vent capricieux. La surface de l’étang semblait se rebiffer chaque fois aux fantaisies de cette bise et dissipait les reflets d’un ciel ombrageux en myriades d’éclats lumineux comme pour s’en venger avant de reprendre le reflet parfait d’un décor somptueux qui enveloppait cette ancienne tourbière. On pouvait contempler avec ravissement, sur ce seul marécage, quantité de variétés végétales typiques des paysages lacustres. Le plan d’eau s’étendait sur quatre à cinq hectares, alimenté par une petite rivière qui débouchait sur une large bande de roseaux balisant les plus hauts fonds. C’est aussi là qu’avaient lieu les frayères. Au mois de mai, il n’était pas rare d’y voir les carpes s’adonner sans pudeur ni frayeur à des jeux sensuels telle une danse rituelle de la procréation. Cette brousse de roseaux, de joncs et d’osiers était une véritable nurserie. Amphibiens, poissons et gibiers d’eau y trouvaient un abri sûr. De là s’éloigneraient après quelques mois, les plus hardis des alevins et les plus forts têtards qui auraient échappé aux becs de râles, de cingles plongeurs ou de jeunes hérons cendrés. Puis les canes appareilleraient à leur tour traînant en file indienne leurs rejetons, gardant un œil vigilant sur les plus dissipés et scrutant parfois le ciel pour prévenir d’un éventuel piquet d’une buse ou d’un faucon. Canes, foulques et grèbes huppés gagneraient au plus vite les rebords plus encombrés d’arbres arrachés à la berge, de branches à demi immergées mêlées aux ramures de saules cendrés, là où leurs petits trouveraient leur nourriture et une aire de jeu bien protégée. L’étang était ainsi fortifié par toute cette diversité végétale de hauts peupliers, de quelques charmes et plus globalement d’aulnes, formant ainsi un rempart naturel aux tempêtes plus endiablées depuis ces dernières décennies. Aurel appréciait particulièrement ces moments de paix et de solitude, bien loin des tumultes d’une civilisation en détresse après les terribles fléaux. Un climat effroyablement ravageur, des guerres civiles épouvantables et la terrible pandémie avaient bouleversé la planète. Aurel et sa famille avaient été épargnés, vivants depuis de nombreuses années en marge de ce monde qu’il considérait de plus en plus absurde. Ils avaient restauré une petite bâtisse à l’orée d’une forêt et pouvaient vivre de façon autonome. Cette maison était, elle aussi, protégée des tempêtes par une forteresse d’arbres centenaires souvent mis à rudes épreuves. Elle était isolée, adossée aux bois, quasiment invisible, entourée d’un pré et d’un potager qu’ils avaient eu grand peine à aménager au cours de ces quinze dernières années. L’étang n’était qu’à quelques kilomètres de là. Aurel s’y rendait souvent avec une 2CV que feu son grand-père lui avait léguée. Il fallait redescendre un peu plus bas dans la vallée en passant par le col. Seul un tel véhicule pouvait parvenir à franchir de nombreux obstacles comme ces routes déchirées par les crues. Un chemin de terre aux ornières boueuses débouchait sur ce territoire plein de vie. Comme si ce lieu avait été protégé par une bulle de bonheur figée là par le hasard ou une divine bénédiction. Dès qu’on le pénétrait, tous les fracas, les affres, les abominations, le souvenir de la barbarie de ce monde, s’évanouissaient. La nature venait là gagner cette bataille, ou du moins, avait-elle pris d’assaut l’esprit d’Aurel qui lui était infiniment reconnaissant de lui fournir chaque fois de quoi subsister et nourrir sa petite famille. Autour du plan d’eau, quelques rares berges vertes, telles des plages de gazon, offraient aux chevreuils une herbe plus tendre qu’ils venaient brouter régulièrement la nuit. C’était sur l’une de ces aires dégagées qu’Aurel avait installé son ponton et une petite cabane de bois assez large pour lui permettre une couchette et de quoi ranger son matériel de pêche. L’ancienne tourbière, dont l’exploitation avait dû cesser depuis plus de deux siècles, avait pu garder de belles profondeurs allant jusqu’à quatre ou cinq mètres de fond. Là se trouvaient les plus belles prises. Une forêt de nénuphars y avait pris place, offrant aux plus gros carnassiers une cache idéale ou un poste d’affût. Arrivé assez tôt ce matin, Aurel s’était contenté de quelques gardons, brèmes ou rotengles, pour le plaisir. Il relâchait le plus souvent ses prises après avoir pris le soin de ne pas trop les blesser en leur retirant son hameçon. Il eut aussi le plaisir de combattre une grosse tanche qu’il avait pu suivre alors qu’elle fouinait par trois mètres de fond, faisant remonter des micro-bulles chaque fois qu’elle remuait la vase ou frôlait l’une des nombreuses plantes aquatiques qui tapissaient le fond. Pour le coup, il prit le temps d’adapter une canne, sonder la profondeur, préparer un hameçon muni d’un beau lombric qu’il déposa sur cette trajectoire qu’elle révéla malgré elle. Elle mordit au piège en très peu de temps. L’animal se débattit avec force et réjouit le pêcheur aguerri. En près de dix minutes, il put fatiguer le poisson et le déposer dans sa large épuisette. « Belle prise , beau combat » se dit-il en la remettant délicatement à l’eau. Et vint le moment qu’il attendait. En fin d’après-midi, le vent était tombé, il faisait lourd, le soleil déclinait. Les insectes qui tombaient ou s’échouaient sur la surface ouvraient ainsi le bal quotidien de gobages en tout genre. L’heure était au repas pour tous. Mais Aurel avait son idée bien précise, une cible qu’il avait déjà souvent manquée. Un brochet qui devait être énorme. Il scruta la surface et attendit. Il prépara une canne plus longue et plus solide, fit un premier jet sans appât pour tester le leste et le parcours. Puis il ramena le tout lentement. À l’aide d’un chiffon enduit de suif, il graissa le fil avant qu’il ne s’enroule sur le moulinet. Calmement il choisit un hameçon double, l’œil toujours aux aguets sur la surface de l’étang. Pour le monstre qu’il convoitait, il lui préféra un beau rotengle pour appât. Il enfila délicatement une fine tresse métallique à l’aide d’une longue aiguille, le long de la dorsale du vif, s’assurant de ne pas le blesser. Seules les deux hampes de l’hameçon apparaissaient telle une couronne sur la tête du poisson. La tresse métallique était discrète. Aurel avait enfilé plusieurs petits bouchons libres et en fixa un autre à une distance d’un mètre cinquante du vif. Il déposa l’ensemble dans l’eau. Le vif était vigoureux cherchant naturellement à gagner le fond ou filer vers la première plante pour s’y abriter. « Ne le fatiguons pas tout de suite » se dit Aurel en le déposant dans un bac pour qu’il s’y repose. Maintenant, il fallait attendre, mais ce ne fut pas long. À une quarantaine de mètres de sa position, entre le bosquet d’aulnes et la masse de nénuphars, il aperçut plusieurs ablettes qui sautaient hors de l’eau comme pour échapper à un prédateur. « Une chasse , enfin ! Espérons que ce ne soit pas une perche ou un autre petit carnassier ! ». Mais le remous en surface qui suivit la panique des ablettes attesta d’un assaillant de bonne taille. Aurel sentit son cœur battre. Il fallait être lucide et bien analyser le parcours possible de la cible. Après cette attaque, s’il avait pu se repaître d’une petite ablette, le brochet devrait avoir rebroussé chemin et revenir vers les nénuphars. Aurel lança avec délicatesse son appât pile à l’endroit de l’attaque. Le fil flotta parfaitement sur la surface, prenant la forme d’un ressort étiré sur toute la distance. Graissé de la sorte, il ne pouvait couler et resterait bien visible, permettant la maîtrise de sa distance et de sa tension. Au bout de la ligne torsadée, le vif allait et venait, virulent, hésitant à se diriger vers les branches immergées de la berge droite ou la forêt de nénuphar à gauche. Il se dirigea vers les branches ce qui permit à Aurel de le ramener facilement en position. Le temps allait virer à l’orage, des nuages s’étaient regroupés en masse au lointain et formaient déjà d’énormes cumulonimbus avec une base ténébreuse et confuse qui s’étalait en assombrissant le paysage. Quelques rafales commencèrent à secouer les peupliers mais rien ne sembla troubler le repas des poissons dont les sauts et remous divers redoublèrent au détriment des insectes naufragés. Un vol de colverts choisit alors la bande de roseaux pour y trouver abri comme s’ils savaient que le temps allait tourner à la tempête. Plus d’une demi-heure avait passé et le rotengle ne semblait absolument pas faiblir. Aurel le ramenait chaque fois qu’il tentait de trouver refuge quand tout à coup le bouchon principal, qui jusque-là frémissait au moindre mouvement du vif, s’immobilisa quelques secondes. Soudain il plongea et disparut sous la surface, le fil quant à lui, se tendit progressivement. D’évidence ce n’était pas le rotengle qui avait eu la force de plonger si vite et si fort. L’attaque avait eu lieu. Aurel sentit son cœur battre plus fort. C’était le moment le plus crucial. Il sembla d’emblée que le prédateur avait saisi sa proie et l’avait emmenée, mais Aurel savait qu’il ne fallait pas ferrer tout de suite, juste laisser filer la bête, alors il libéra son fil pour qu’aucune résistance ne puisse l’alerter du piège. Comme prévu, le bouchon principal remonta et s’immobilisa un instant. C’était le moment cette fois de tendre progressivement le fil en rembobinant tout doucement jusqu’à sentir, depuis le scion de la canne, les variations de tensions. Celle-ci frémit légèrement, comme si le tueur avait lâché sa prise. Mais Aurel savait qu’avec la taille de ce vif, le brochet devait l’avoir attrapé par le flanc puis s’était arrêté pour l’engamer la tête la première, avant de reprendre son chemin. Le bouchon plongea à nouveau c’était le moment de ferrer. Aurel abaissa sa canne en maintenant le fil toujours sous légère tension. Puis d’un grand geste ample, il le tira en arrière. La courbe du fil et son élasticité pouvaient amortir l’effet, il fallait être sûr que le ferrage soit net. Il n’y avait plus de doute, le carnassier réagit violemment et fila immédiatement vers les nénuphars. Aurel desserra légèrement le frein du moulinet et celui-ci se mit à geindre. Il ne fallait surtout pas qu’il aille se fourrer dans cet amoncellement de tiges, la ligne pourrait s’y empêtrer, au risque de perdre un contact direct avec sa prise. Déjà quelques jeunes pousses flottaient à la surface attestant que le fil avait ceinturé la forêt de nénuphars et cisaillé quelques tiges périphériques. Heureusement, le brochet rebroussa chemin et prit la direction de la berge encombrée. Soulagé, Aurel récupéra quelques mètres de fil, mais le poisson était puissant et lui reprit de la longueur. Le frein du moulinet hurla de plus bel. C’était un bruit à la fois effarent et jouissif. La canne se courbait, allait et venait, amortissant les variations de tensions. Le brochet s’approchait bientôt des branchages et là aussi, il fallait éviter qu’il aille s’emmêler aux rameaux immergés. Aurel dut ralentir sa progression et progressivement resserrer le frein au risque de casser le fil. L’animal redoubla d’effort, il devait sentir sa tentative vouée à l’échec. Soudain la canne se redressa et le fil retrouva sa forme hélicoïdale sur la surface. Aurel s’aperçut que le bouchon n’était toujours pas remonté. Un instant il pensa que tout était terminé, le fil avait peut-être été brisé en amont du bouchon. Mais la spirale bougea encore et revint vers lui, décrivant un arc de cercle. Le brochet avait choisi de revenir à rebours, en direction d’Aurel, se libérant ainsi de toute tension afin de pouvoir se dégager du piège. Immédiatement Aurel rembobina récupérant tout le fil jusqu’à retrouver le contact, et de nouveau le combat reprit. La bête tenta un retour vers les nénuphars, mais cette fois elle avait perdu beaucoup trop de distance. Aurel en était conscient, le plus gros était fait. Maintenant, il fallait fatiguer la bête et la contraindre. Il desserra légèrement le frein du moulinet pour éviter les à-coups trop brutaux, puis le resserra progressivement chaque fois qu’il sentait une plus faible résistance. Il piqua lentement la canne vers l’eau en moulinant puis la retira lentement vers lui. Petit à petit, il put ainsi attirer le poisson vers la berge. Quand le brochet redoublait d’effort, il le laissait repartir et reprendre quelques mètres, quitte à le suivre en longeant la berge, puis Aurel recommençait, plusieurs fois, mètre après mètre. Parfois il pouvait apercevoir l’animal effleurer la surface de l’eau. Des reflets jaunâtres confirmaient définitivement la présence d’un brochet. Celui-là devait être énorme. La bataille avait déjà duré presque une heure. Aurel sentait lui aussi la fatigue dans les bras et le dos. L’animal tenta encore plusieurs plongées, mais chaque fois qu’il revenait vers la surface, Aurel lui reprenait quelques centimètres. Cette prise devait être exceptionnelle, il fallait bientôt mettre un terme à la lutte. Le poisson allait et venait de droite à gauche et se fatiguait à chaque tentative de fuite. Aurel put revenir sur ponton. Il le voyait désormais, se débattant, secouant son énorme gueule, essayant de pincer la tresse métallique pour la briser. Il put dorénavant lui maintenir la tête hors de l’eau, pour le priver d’oxygène. Mais le monstre ne renonça pas, il se secoua encore aussi bravement qu’il lui resta de la force. Tout l’avant de son corps fouetta furieusement l’eau qui gicla tapageusement. On n’entendit plus que le bruit de cet ultime engagement entre le pécheur et le brochet, comme si autour d’eux, tout s’était arrêté en un silence pesant. Aucun piaillement d’oiseau, ni gobage intempestif, ni même le frémissement des feuilles d’un tremble, toute la nature sembla s’être figée comme le seraient des badauds, témoins pantois d’un événement hors normes. « L’épuisette ne sera pas assez grande », se dit Aurel, il lui faudrait une gaffe. Il en avait une, fabriquée en bois de houx, longue et ferme, une pointe solide qu’il suffisait de glisser derrière l’ouïe afin d’extraire l’animal de l’eau. En principe, une telle action paraissait évidente, mais maintenir d’une main le monstre encore combatif et de l’autre ajuster l’ergot de la gaffe derrière son ouïe, puis coordonner une même traction pour sortir une pièce de prêt de vingt livres et plus d’un mètre de long sur le ponton était loin d’être commode. Ce fut le dernier effort, enfin Aurel put tirer l’animal sur le gazon, déposer sa canne et admirer la bête. C’était là sa plus belle prise depuis bien longtemps. Chapitre deux : Rescapé Héléna sera fière de lui, pensait Aurel encore sous l’effet de l’adrénaline. Il enroula le brochet dans une large bande de papier, ouvrit le coffre arrière de la 2CV et le déposa à la place de la roue de secours sous la tôle. Puis il entreposa son matériel et ses cannes derrière la banquette. Le soir commençait à tomber et l’orage devait bientôt éclater. Il fallait partir assez vite avant que la tempête ne se déclenche et ainsi éviter les branches projetées sur la route. Pour démarrer, puisque la batterie de la voiture était trop vieille, il utilisa la bonne veille méthode de la manivelle. Il mit le contact, passa devant le véhicule, et introduit la manivelle à l’endroit prévu. Il fit deux ou trois tours assez lents pour pomper un peu de carburant et puis d’un coup plus fougueux, en un seul quart de tour, le moteur se mit à ronronner. Les premiers mètres du chemin furent comme souvent chaotiques, la voiture tanguait. Aurel adorait être ainsi ballotté, s’agrippant au volant pour choisir les meilleurs passages et éviter les ornières trop profondes. Il avait toute confiance en sa vieille auto malgré ses nombreux grincements et couinements qui, comme le bruit typique de son moteur, contribuaient au charme de cette voiture. Quelques grosses gouttes commençaient à exploser sur le pare-brise, mais Aurel n’utilisa l’essuie-glace qu’avec parcimonie pour ne pas trop tirer l’énergie de l’alternateur. Il finit même son parcours tous phares éteints, connaissant parfaitement les quelque six cents mètres du chemin caillouteux qui menaient à la maison. Il ne faisait pas encore nuit mais une lumière inhabituelle éclairait depuis l’arrière du dernier bosquet. Cela semblait provenir des phares d’une automobile. Ce ne pouvait être autrement, car la maison n’avait pas d’électricité depuis bien longtemps. Qui pouvait leur rendre visite ? Un véhicule, du genre tout terrain, était garé dans la cour et éclairait la lisière du bois. Il ne connaissait personne possédant encore un tel véhicule. L’inquiétude l’envahit. Il coupa le moteur de la 2CV et finit le trajet en roue libre pour arriver le plus discrètement. Puis il aperçut un homme sortir de la maison renversant ce qui semblait être de l’essence d’un bidon en métal. Aurel était assez grand et très athlétique, il lui faudrait peu de temps pour maîtriser ce petit blanc-bec dont l’intention évidente était de mettre le feu à la maison. Il pensa immédiatement à sa femme et à sa fille Marine. Où étaient-elles ? S’étaient-elles réfugiées dans les bois ? Dans la maison ? Blessées ou pire encore ? L’urgence était donc d’arrêter l’individu avant que le pire ne se produise. Il se saisit de sa manivelle et s’empressa d’atteindre le malfaiteur. Mais soudain il fut saisi par-derrière et tenaillé par deux énormes bras le privant de tout mouvement. L’homme qui l’avait surpris devait être d’une force et d’une taille incroyable car Aurel avait été décollé du sol. Il tentait vainement d’agiter sa manivelle, mais il ne pouvait atteindre son assaillant. L’autre le serrait si fort qu’on put entendre l’une de ses cotes craquer sous la pression. Aurel hurla. — Mais que faites-vous là ? Laissez-nous tranquille, il n’y a rien à voler ici. Arrêtez je vous le demande… La pression était si forte qu’Aurel en perdit son souffle. — Sinon quoi ? dit l’homme malingre en ricanant, le bidon à la main, s’approchant de lui l’air goguenard. L’homme avait des marques sur le visage. Des griffures récentes qui devaient probablement signifier qu’Héléna ou Marine avaient dû être agressées et s’être défendues. — On ne vous a rien fait ! Laissez-nous ! brailla Aurel en tapant avec ses talons les jambes du colosse qui ne bronchait toujours pas. Un autre homme sortit du véhicule une arme à la main. Il semblait pareil au premier tout aussi chétif. — Retourne surveiller les pétasses Revil, lui ordonna le géant. Aurel tourna alors la tête vers le véhicule. La porte avait été ouverte, il pouvait entendre les cris de Marine qui à l’arrière, les mains contre la vitre, appelait au secours. Il vit le visage désespéré et affolé d’une gamine de treize ans réalisant la peine et l’impuissance de son père qui se débattait vainement. Puis il aperçut à côté d’elle, la chevelure d’Héléna, immobile, assise, probablement inconsciente. Marine hurlait et tentait désespérément de briser la vitre arrière avec ses petits poings. La rage, la peur, la haine envahirent Aurel et il redoubla d’effort pour se dégager, mais l’homme au bidon d’essence s’approcha, sortit un revolver en le pointant sur Aurel. — Non ! lui ordonna le colosse. Nous avons bien du mal à trouver des munitions, on ne peut se permettre de les gâcher ! — Très bien ! On va improviser ! lui répondit l’autre avec un fort accent de l’est. — Oui mais presse-toi, il me fatigue ! Aurel reçu un premier coup du bidon sur la tempe, d’une violence inouïe qui lui fit perdre un moment conscience. Mais il se redressa les yeux à demi ouverts. Les avant-bras du géant lui comprimaient toujours autant la poitrine. Tout ce qu’il pouvait voir de son adversaire était cette poigne énorme et un étrange tatouage en forme de roue à la base du pouce gauche. — Alors c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? Achève-moi ça ! ordonna le colosse. L’autre s’y reprit une nouvelle fois, pivotant le bidon métallique pour frapper avec l’angle. Aurel s’effondra une fois relâché. Un bruit sourd lui saturait les tympans, il ne pouvait plus bouger. Il ressentit sa chute comme un épouvantable et long affaissement de tout son corps avant d’échouer mollement sur l’herbe mouillée. Il put sentir de la boue lui rentrer dans la bouche. L’orage commençait à gronder, les éclairs frappaient à proximité mais lui semblèrent un tonnerre lointain, il entendait à peine les voix des deux hommes. — Il a son compte ! — Oui, j’ai entendu un joli craquement ! Il a son compte. Rentrons ! ordonna le géant. Une lumière éclaira soudainement la cour, et malgré ses yeux mis clos, il distingua nettement l’arrière du véhicule et le visage de Marine totalement effrayée. Elle hurlait, mais il n’entendait aucun son. La lumière s’amplifia, jaune, animée et si vive qu’elle souligna plus encore l’expression de terreur sur le visage de sa fille. La vision se fixa. Aurel crut que le temps s’était soudainement arrêté, malgré la soudaine averse de grêle. Il sentait le goût de son propre sang dans la bouche, puis le ruissellement gelé de la glace fondue dans ses cheveux. L’image de Marine effarée ne le quittait pas. Elle était toujours là, le regard terrifié, les mains sur la vitre arrière du véhicule, figée telle une photographie. Puis progressivement la vision s’enfonça dans le noir et le silence. Une légère lueur filtrait à travers ses paupières. Aurel croyait rêver, mais il ne semblait pas en mesure de remuer. Pourtant, il avait très froid. Il mit un temps à ouvrir les yeux. Mais un seul lui permit de voir qu’il faisait jour. La pluie ne cessait de battre le sol. Quelque chose de mou au goût ferreux encombrait son palais. Il chercha à recracher ces caillots de sang mais ne pouvait à peine ouvrir la bouche, sa mâchoire lui faisant un mal horrible. Il souffla pour évacuer cet amas visqueux mêlé à de la terre. Quand il essaya de se lever, une douleur vive dans la nuque ne lui permit aucun mouvement. Le souvenir et l’image de Marine lui revinrent instantanément à l’esprit. Il gémit en regardant le ciel, allongé sur le dos. La pluie lui rinçait le visage et se fondait à ses larmes. Il lui fallut endurer encore la douleur quand il tenta de regarder du côté de la maison. Le toit était effondré et avait emporté le premier étage. Ce n’était plus qu’un amas de bois noircis par le feu, quelques fumerolles s’échappaient encore de certaines poutres. Les pointes des pignons avaient elles aussi disparu. Les briques s’étaient mélangées à la cendre et aux restes calcinés. Tout avait été anéanti, les meubles, les souvenirs… On ne lui avait pas seulement enlevé ce qu’il avait de plus précieux sur ce monde, mais détruit aussi tout ce qu’il avait pu construire. Trempé depuis de longues heures, transi de froid, il avait envie de mourir, de se laisser là, comme au bord d’un abîme sans fond qu’un seul saut lui permettrait d’oublier à jamais cette souffrance insupportable. Il se sentait si faible que chaque respiration lui semblait être un effort. Il se retourna du côté de la 2CV, à quelques pas de lui. Elle aussi avait été incendiée, mais elle tenait encore sur son châssis. Les pneus n’avaient pas été touchés par les flammes, seul l’habitacle avait été détruit. Assiégé par tant de désolations, lui restait-il au moins l’envie de se battre, de survivre ? Ne serait-ce que pour se sortir de là, de tout faire pour retrouver ces ordures et libérer sa douce Héléna et sa jeune Marine. Il ne devait pas se laisser agoniser ainsi. Mais il se sentait si faible et cette douleur aux cervicales lui interdisait toujours le moindre mouvement. Il palpa son visage, put sentir un énorme œdème qui lui couvrait depuis l’arcade gauche jusqu’au menton. Il supposa qu’il avait aussi la mandibule cassée. Il pouvait sentir ses jambes, ses bras, ses mains, les bouger, mais impossible de porter sa tête sans cette horrible douleur. Pas de paralysie ! pensa-t-il presque rassuré. Il estima alors qu’il avait dû être inconscient plus de quarante-huit heures, vu les restes de la maison et le peu de fumée qui s’en échappait encore. Mais s’il ne trouvait pas rapidement le moyen de se bouger et de se mettre à l’abri, l’hypothermie pourrait l’achever. La 2CV serait le plus proche refuge, au sec sous le châssis. Encore fallait-il pouvoir bouger sans risquer le pire avec les cervicales en mauvais état. De là où il se tenait, il put attraper quelques branches au sol, qu’il brisa en plusieurs morceaux de moins de dix centimètres. Il les choisit relativement solides mais assez souples. Puis il défit sa ceinture et se la glissa sous la nuque. Un à un, il disposa les brins de bois les uns à côté des autres sur la large lanière de cuir. Il en fit un premier tour autour de son cou. Avant d’en refaire un second, il disposa à nouveau quelques-unes de ces attelles de fortune et ainsi de suite selon leur taille ou leur épaisseur. Les plus longues et les plus solides lui remontaient depuis le niveau des omoplates jusqu’à l’arrière de son crâne. Enfin il boucla le tout fermement mais sans trop serrer. Cette minerve de fortune sera-t-elle efficace ? Il le saurait assez vite. Il pouvait se dire qu’avec un peu d’effort, il lui suffirait de compter « un deux et trois » puis hop, se relever tranquillement. Mais ce n’était pas aussi simple. En plus des douleurs, il y avait aussi cette nausée. Chaque mouvement lui donnait l’impression de perdre à nouveau connaissance. Il lui fallait être patient, respirer lentement et profondément. La côte fêlée ne gênait pas sa respiration. Aurel souffla donc et inspira ainsi pendant plusieurs minutes. Il y a du mieux ! se dit-il, mais se redresser était encore risqué. Alors il roula sur le côté, la minerve improvisée lui maintenait la tête comme prévu. La douleur était toujours vive mais l’effort lui sembla plus facile. Maintenant, l’idée serait d’atteindre la 2CV et de se glisser au sec, sous le châssis. Ce qu’il fit pas à pas, ou plutôt roulade après roulade, alternée de haltes sur le dos, pour souffler de nouveau. La minerve, bien que très désagréable démontra son efficacité. Avec beaucoup plus d’aisance qu’il ne le crut, il parvint enfin à s’étendre à l’abri de la pluie froide, la tête entre les deux roues arrière. Il y avait là bien assez de place, au moins de quoi lever les coudes ou s’agripper au pot d’échappement. À nouveau, il tenta de décoller sa tête du sol. C’était beaucoup mieux, mais toujours insuffisant pour espérer se redresser totalement. Le temps de souffler encore et avec de la patience, il dominerait bientôt cette douleur. Peut-être s’était-il endormi, ou avait-il à nouveau perdu connaissance ; Car quand il se réveilla, il faisait nuit. La pluie avait cessé. Le vent avait tourné au nord, entraînant vers lui l’odeur de la suie et du charbon mouillé, ravivant ainsi brutalement la flagrance du drame. La nausée et son abattement lui imposaient encore l’immobilité et le repos. Il s’assoupit parfois quelques minutes, parfois une à deux heures. C’était à chaque réveil, un retour à la terrible réalité. Chaque fois, l’image de Marine derrière la vitre arrière du véhicule s’imposait à son esprit. Il se savait anéanti mais devait réagir et puiser dans ses dernières ressources, si tant est qu’il lui en restât. Le jour se leva alors qu’il gambergeait encore, ne sachant plus trop s’il songeait, rêvait ou réfléchissait, car tout s’entremêlait. Il accueillit cette lumière matinale comme un salut. L’air plus chaud et ses vêtements beaucoup moins humides lui fournirent plus d’entrain. Il s’agrippa au châssis et décolla son torse du sol. « Très bien » se dit-il, il pourrait peut-être bientôt se relever, mais encore fallait-il en trouver la force. Pour cela il devait donc se nourrir. Pas loin de là, il aperçut un bouquet d’oxalis et put en arracher une poignée. Cette plante devrait lui apporter un minimum de vitamines. Mais il ne pouvait en aucun cas les mastiquer. Il malaxa les feuilles entre les mains, en fit quelques boulettes qu’il put introduire dans sa bouche. L’acidité et le jus de la plante lui procurèrent un grand plaisir et l’envie de renaître. Mais il ne pouvait se contenter que de cela. Il observa les alentours mais rien de comestible sinon que ce « pain de coucou » qu’il prit bien le temps d’avaler. Puis il réalisa soudain, qu’il y avait près de dix kilos d’une bonne viande juste dessus de son nez. Là, derrière cette tôle, se trouvait le brochet. Avec un peu de chance, il n’avait pas dû être brûlé. Pour l’atteindre, il lui fallait se glisser d’à peine un mètre vers l’arrière de la 2CV, ce qu’il réussit aisément. Maintenant, ouvrir le coffre était facile. Il put y attraper un chiffon, celui qu’il utilise généralement pour essuyer l’humus gluant dont les brèmes ou les tanches sont couvertes. Malgré la puanteur de ce chiffon, il se l’enroula autour du cou pour renforcer sa minerve. Plonger son bras à l’intérieur du coffre et soulever la plaque du fond, devenait plus délicat. Pour cela, il devait se tenir assis et donc se redresser. En s’agrippant au pare-chocs de la voiture, il pourrait décoller son torse à la force des bras. Sa tête était suffisamment soutenue. Il respira profondément, calculant chacun des gestes qui le conduirait à la position idéale puis, après ces quelques secondes de concentration, il s’élança et se retrouva assis. La douleur aux cervicales avait été aiguë mais très brève. Il ressentait plutôt des douleurs aux côtes, de part et d’autre de son abdomen qui l’obligèrent à immobiliser au mieux son torse. Il put enfin ouvrir le coffre et atteindre le brochet. Les fauteuils de la voiture n’étaient plus qu’une carcasse de ferraille et de ressorts qui pendouillaient. La pluie avait sûrement dû limiter la puissance de l’incendie, sa bourriche était à peine fondue. Sous la plaque de métal, le papier qui emballait le poisson avait été séché et légèrement roussi, la chaleur avait dû être assez forte à cet endroit, mais heureusement pas suffisante pour atteindre le réservoir de carburant situé juste en dessous. Une grimace apparut sur le visage tuméfié d’Aurel, c’était tout simplement un sourire. Car en retirant les restes de papiers, le poisson avait été cuit. Il saisit le tout et le déposa sur ses cuisses et sortit un couteau de sa bourriche. Il referma le coffre, ramena ses jambes en tailleur en y maintenant son précieux repas et fit lentement une rotation en s’appuyant sur les bras. Progressivement et patiemment, il put alors s’adosser à la voiture. Comme pour l’oxalis, toujours dans l’impossibilité de mastiquer quoique ce soit, il glissa dans sa bouche entrouverte de petits morceaux de chair avec la lame du couteau. Cette fois le soleil le réchauffait ; bien maintenu et adossé, il pouvait ressentir la force le regagner. Lentement il put se rassasier et malgré les douleurs persistantes aux flancs, il se laissa glisser dans un sommeil plus serein. Quels sorts étranges lui réservait cette vie, songea-t-il. S’il n’avait pas été accaparé par ce combat avec le brochet, il serait rentré plus tôt et peut-être aurait-il pu sauver sa femme et sa fille. Mais peut-être en aurait-il été aussi autrement. Ces hommes étaient armés, il aurait bien pu s’en défendre mais lui n’avait pas d’arme. Les marques laissées sur le visage de l’un d’eux prouvaient qu’Héléna n’avait sûrement pas dû se laisser faire. Mais que voulaient-ils alors ? S’ils avaient voulu tuer, elles seraient mortes. Il n’y avait rien à prendre de valeur dans cette maison, aucun véritable butin, rien ! Sinon qu’ils avaient enlevé Héléna et Marine. Mais pourquoi ? Cette seule question l’envahit de rage même s’il s’efforçait à classer toutes explications possibles en de simples conjectures pour éviter de dramatiser et ne pas imaginer le pire. Peu importe cet effort et sa lucidité, il ne pouvait contenir toutes ces horribles images qui lui traversaient l’esprit. À nouveau il se sentit totalement impuissant et démuni et les larmes inondèrent son visage sans qu’il ne sorte aucun son, aucun gémissement. Il venait pourtant de gagner une première bataille contre le mauvais sort, il avait pu manger et peut-être évité la mort. Il pensa alors à cette réussite, il lui fallait rester positif. Ses réflexes de survie ne seraient pas vains. Il récupérerait, il guérirait, et il les retrouverait toutes les deux. Il n’aurait aucun autre but que de sauver son enfant et sa femme, quoi qu’il en soit, quoi qu’il lui en coûte. Il n’abandonnera donc pas. Marine l’avait vu tomber, elles avaient assisté à son lynchage. Quelle souffrance horrible pour une gamine, elle qui devait maintenant le croire mort. Chapitre trois : Gédéon Une nuit de plus avait passé, cette fois sans averses ni froid. Aurel avait entrecoupé chaque phase de sommeil par une petite collation de ce fameux brochet. Il se sentait déjà mieux mais encore bien incapable de pouvoir se relever et de chercher une aide quelconque. Il savait que régulièrement son ami Gédéon passait les voir au moins une fois par semaine. C’était leur façon à eux de veiller les uns sur les autres. Miri était un village particulièrement très étendu. Il y avait bien quelques bâtiments concentrés autour de la place, comme l’ancienne école ou la mairie, mais sa population était disséminée aux alentours. Comme ils habitaient tous assez éloignés, reclus pour la plupart en forêt, hors des grands accès, les voisins se rendaient couramment visite, soit par courtoisie, soit pour échanger des provisions. C’était une forme de bienveillance collective qui se dessinait naturellement entre eux comme par instinct. Gédéon était un vieux paysan, il vivait avec sa fille Solange dans sa ferme à trois kilomètres de là. Il était veuf depuis bien avant la crise, son épouse avait été emportée par le cancer. Solange était un peu plus âgée qu’Aurel, elle était interne de médecine avant « l’apocalypse » comme disait son père. Aurel reconnut tout de suite le moteur pétaradant de la 4L F6 de Gédéon sur le chemin et se réjouit enfin d’un secours. Il entendit les freins couiner, le grincement du frein à main, une porte claquer et les pas du paysan qui accourrait devant les restes de la maison. — Boudiou de boudiou ! Qué malheur ! s’écria le grand-père en se frictionnant les quelques longs cheveux blancs qu’il lui restait autour de la nuque. Il s’agitait et s’était rapproché de l’entrée de la maison. Mais il tournait le dos à Aurel qu’il n’avait pas vu assis derrière la 2CV. — Aurel ! Héléna ! cria le vieux bonhomme désespéré. Aurel ne sut sortir aucun son qui put lui être perceptible, sachant que Gédéon était légèrement dur de la feuille. Alors il frappa son poing contre le coffre de la voiture. Gédéon se retourna et accourut. — Houla ! Mon pauv’ fieu ! Quelle catastrophe, mais quelle catastrophe ! Qu’est-il donc arrivé ? — eu a arler ! tenta Aurel — Houla boudiou ! Dans quel état on t’a mis mon ptit gars ! Héléna ? Marine ? — enle’ées ! Attaqués… trois honnes ! soupira Aurel. — Je ne peux pas t’aider tout seul, mon fieu, je vais chercher du monde et on t’emmène à la maison. Je reviens tout de suite ! Moins d’une demi-heure plus tard les pétards de la 4L annonçaient l’arrivée des renforts. Gédéon avait amené les frères Turpin d’une des fermes voisines. Les deux gros costauds avaient avec eux un brancard et des couvertures. Il y avait assez de place dans la 4L fourgonnette pour y allonger le blessé. L’un des frères Turpin avait glissé un tas de couverture et de chiffons sous le brancard pour amortir les vibrations et les chocs possibles de la route chaotique et resta auprès d’Aurel pour le maintenir et lui éviter de ballotter. L’autre frère était assis à l’avant et Gédéon s’efforçait de rouler le plus souplement possible, évitant les nombreux nids-de-poule et autres achoppements d’une route fortement endommagée. Aurel fut pris d’émotion, des larmes s’échappaient de son œil encore ouvert, il tenta aussi de sourire comme pour exprimer sa satisfaction. — Ça va aller Aurel ! On va bien s’occuper de toi ! lui assura l’un des frères. Aurel était touché, ces gens avaient accouru, lâchant probablement leurs occupations pour parer à l’urgence. L’esprit de solidarité naturelle les avait propulsés instinctivement au secours d’un des leurs. Aurel ne pouvait ignorer cette disposition humaine car rien ne les y obligeait depuis que le pays avait sombré dans le chaos. Dès la chute des gouvernements, la dispersion des forces de l’ordre, le règne du chacun pour soi avait pris le dessus. Si des hordes de pillards rançonnaient celles et ceux qui, comme Aurel, Gédéon et beaucoup d’autres, avaient trouvé les moyens de survivre de façon autonome, les attaques dans la région étaient plus rares. La menace de brigandage et les affres d’une météo souvent ravageuse avaient poussé les survivants à l’entraide. Aurel souriait en regardant le plafond de la fourgonnette, il saluait quelque part ce que la nature humaine avait de plus précieux et que longtemps on avait renié. Comme la plante qui après l’incendie jaillissait des cendres pour renaître encore, l’humain retrouvait son instinct véritable au milieu de tout ce chaos. Il y avait toujours cru ainsi que son grand-père anarchiste lui avait enseigné. « Aucune autorité ne peut obliger à ce que déjà la véritable nature humaine nourrit et impose d’elle-même », disait-il, quand il répondait au jeune Aurel pour ce que signifiait la solidarité. « L’homme, un loup pour l’homme » objectait le jeune adolescent comme on lui avait appris au collège. Mais selon son grand-père, cette maxime était un mythe, un leurre idéologique totalement faux. Et pour qui connaît le mode et le fonctionnement social des loups, c’était ajouter à l’ignorance et à l’idée reçue, une véritable injure à ce noble animal. On avait fait des hommes des concurrents, des batailleurs, des tricheurs, des peureux et des égoïstes, ce qui ne ressemble pas aux loups. Qui plus est, selon lui, les humains avaient été progressivement dénaturés et vidés de leurs sens primordiaux de survie en collectivité, pour les remplacer par ce qui s’appela le « devoir ». Après des siècles de soumissions et d’obéissances, là aussi convertis en termes de « civisme » , après avoir châtié dans un bain de sang toutes éclosions de sociétés autonomes exemptes d’autorité, le monde s’était finalement fait à l’idée que l’ordre devait s’imposer par la seule autorité. Son grand-père ajoutait : « Si tu trouves dans la nature un oiseau assez idiot pour s’arracher les plumes dans le but de s’interdire de voler, dis-toi que c’est ce que l’humain est devenu aujourd’hui ! ». Ainsi le réflexe naturel de solidarité avait été neutralisé par une forme d’automutilation. À cette époque, Aurel ne saisissait pas toujours les analogies de son grand-père mais pouvait comprendre pourquoi ce vieil homme s’était lui-même retranché dans une vie de plus en plus autarcique et pourquoi il se disait souvent « malade de ce monde ». Aurel y voyait plutôt une forme de réticence aux progrès en tout genre, très classique chez les personnes de son âge. Mais il respectait l’homme et savait avoir eu la chance de connaître ce qui aujourd’hui lui paraissait être de la pure sagesse, puisque tous les événements dramatiques qui suivirent confirmèrent hélas ce que son aïeul entrevoyait. Sa 2CV, une relique souvent raillée à l’époque moderne des voitures hybrides ou électriques, incarnait dès lors l’esprit de son grand-père. Elle était aujourd’hui, comme cette 4L, parmi les seuls et rares véhicules à pouvoir encore être utilisés. Le souvenir de son grand-père, la présence et la réactivité de ses voisins lui furent comme un baume soulageant son terrible chagrin. Serein, il se laissa bercer par les vibrations de la voiture et ferma les yeux, conscient qu’il lui faudra prendre le temps de se refaire, avant d’entreprendre des recherches et secourir sa famille. Il se savait maintenant en sécurité.
86
« Dernier message par Apogon le jeu. 30/12/2021 à 18:00 »
Mon parcours de bypassée de Nisa Pour l'acheter : Amazon BookelisLes batailles qui comptent ne sont pas celles qui sont visibles. Ce sont les luttes à l’intérieur de vous-même – les batailles invisibles et inévitables pour chacun d’entre nous – qui importent.
Jesse Owens Quelques repères Concernant le livre Plusieurs sigles et termes médicaux parsèment le parcours et entrent vite dans le vocabulaire des patients. Ceux principalement utilisés dans ce témoignage sont expliqués une première fois en bas de page ou entre parenthèses. Ils se retrouvent également dans le glossaire présent à la fin de l’ouvrage et sont signalés par un astérisque afin que vous puissiez les identifier facilement. Les références indiquées dans les notes sont regroupées juste après si vous souhaitez approfondir le sujet. * Étant donné qu’il s’agit d’un témoignage, les personnes dont je parle sont réelles. J’ai donc modifié leurs noms ou prénoms pour respecter leur anonymat. Pour le personnel médical récurrent, il m’est arrivé de rencontrer plusieurs intervenants avec le même métier. Par exemple, la psychologue avec qui j’ai eu une consultation n’a pas été la même que lors de l’ETP (Éducation Thérapeutique du Patient). Pour plus de lisibilité et parce que ça n’a au final aucune incidence (les discours étant les mêmes et la bienveillance toujours présente), j’ai choisi de baptiser Paulette ces deux professionnelles, faire comme s’il n’y avait eu qu’un intervenant. Pour aider à la mémorisation du rôle de chacun, j’ai utilisé des prénoms ou noms dont la première lettre rappelle la fonction. Je vous les liste ici si vous avez besoin de vous y reporter pendant la lecture. Chirurgien : Dr Champollion Diététicienne : Domitille Enseignant en Activité Physique Adaptée : Anthony Infirmière à domicile : Isabelle Infirmière à l’hôpital : Ingrid Kinésithérapeute de ville : Kim Kinésithérapeute à l’hôpital : Kader Médecin généraliste : Dre *1 Grimaud Médecin nutritionniste : Dr Nicholson Ostéopathe : Olga Psychologue : Paulette Secrétaire du chirurgien : Sakina * Je mentionne de nombreuses fois un groupe dans ce livre. Il s’agit d’une communauté sur Facebook, gérée par l’association de patients de mon du Centre De l’Obésité (CDO). Les échanges nourris et les encouragements reçus m’ont été d’un soutien précieux tout au long de mon parcours. Je parle également à plusieurs reprises d’un ouvrage découvert lors de la rédaction de ce témoignage : Le charme discret de l’intestin – tout sur un organe mal aimé... de Giulia Enders. Il m’a appris beaucoup de choses et je ne peux que vous en conseiller la lecture si ce n’est pas déjà fait. * Pour rédiger ce livre, j’ai longuement hésité entre un journal chronologique ou un récit classé par thématique. J’ai finalement opté pour un mix des deux. La première partie de ce témoignage se déroule de façon linéaire. On y découvre mes évolutions et prises de conscience au fur et à mesure. Je souhaitais vraiment que vous m’accompagniez dans toutes les étapes. Puis je me focalise sur un thème par chapitre, comme un bilan de chaque aspect important. Cette solution m’a semblé plus pertinente, car elle correspond mieux à mon cheminement et permet au lecteur concerné de retrouver plus facilement certains passages s’il désire s’y référer à nouveau lors de son avancement dans le parcours. Ne soyez donc pas étonnés si je reviens parfois en arrière dans certains chapitres. Bonne lecture ! Concernant l’obésité et l’opération J’ai bénéficié d’un bypass gastrique en octobre 2019, et cette chirurgie, qui souffre de beaucoup d’idées reçues, m’a transformée. Avant de vous raconter mon histoire, il me semble nécessaire de vous communiquer quelques éléments de contexte, utiles pour la suite. Le premier point important à prendre en considération avant de débuter votre lecture est que ce récit est mon témoignage de patiente. Il s’agit uniquement de mon expérience et de mon ressenti. Je ne suis pas une professionnelle de santé et j’interprète forcément les paroles des médecins en fonction de mon histoire et mes connaissances. Tout ce qui est dit dans ce livre n’engage que moi. De même, si je m’appuie parfois sur ce que j’ai pu voir ou entendre d’autres opérés, je ne relate ici que mon vécu : mon intervention (un bypass gastrique en Y), mes complications, mon apparence, mon mental, etc. En aucun cas, je ne parle au nom de tous les obèses. S’agissant plus spécifiquement du choix de la technique, il ne se fait qu’en fin de parcours, on m’a donc mentionné la sleeve à quelques occasions. Pourtant, je n’en parle pas dans ce témoignage. Tout simplement parce que je savais, au plus profond de moi, dès le premier rendez-vous avec le chirurgien, que je souhaitais un bypass et que c’était l’opération qui me correspondait le plus, par rapport à mes antécédents. Il m’apparaît aussi primordial de préciser que lorsque j’évoque la maladie et les difficultés importantes à maigrir, cela concerne l’obésité, soit un Indice de Masse Corporelle (IMC) supérieur ou égal à 30. Et plus particulièrement l’obésité morbide (IMC de plus de 40), qui est plus susceptible d’entraîner des problèmes de santé. Si vous avez un IMC inférieur, que vous avez pris deux kilos après la tartiflette, la raclette et la fondue des vacances de Noël, la situation est complètement différente. On ne peut pas comparer l’incomparable : perdre quelques kilos qu’on juge de trop n’a rien à voir avec s’en délester de plusieurs dizaines. Cependant, quel que soit votre cas, je pense que certaines astuces et bonnes habitudes que j’ai acquises pendant mon parcours peuvent être utiles à tout un chacun et pas seulement à la population en situation d’obésité. Bien entendu, comme toute pathologie, ses effets sont variables d’une personne à l’autre et peuvent évoluer dans le temps. Pour prendre un exemple assez parlant non lié à la morphologie, mon fils et moi sommes asthmatiques. Lui a une forme grave, avec un retentissement quotidien sur sa vie. Vu la fréquence et l’intensité de ses crises, il ne peut pas sortir de la maison sans son médicament d’urgence. Tandis que si j’oublie ma Ventoline, j’ai 99 % de chances que tout se passe bien (et c’était déjà le cas avant qu’on me prescrive un traitement de fond). Pourtant, c’est moi l’obèse. Et si je parle de maladie, ce n’est pas péjoratif (j’aurais peut-être mal pris ce terme à l’époque où ma santé n’était pas impactée, car oui, on peut être gros et aller très bien), je pense que vous le comprendrez à la lecture de ce témoignage. J’espère ne blesser personne, je sais que le sujet est très délicat, mais s’agissant de mes ressentis et de mon expérience, ils seront forcément différents de ceux d’un autre. * Dans ce récit retraçant mon parcours, de la décision aux neuf mois postopératoires, je ne vais pas exprimer mon poids en kilos, car il ne sera pas parlant. Si je vous dis 100 kilos et que vous faites 1m90, ça ne vous semblera pas gros. Par contre, si vous faites 1m45, tout de suite, vous allez visualiser une silhouette bien différente. Je vais donc uniquement utiliser l’IMC*. Cet indice, validé par l’Organisation mondiale de la Santé, permet de mesurer la corpulence d’une personne en divisant le poids en kilos par le carré de la taille en mètres. Par exemple, pour quelqu’un de 104 kilos et de 1m50 : 104/(1,5 x 1,5) = 46,22. Vous trouverez de multiples sites Internet qui feront les calculs pour vous. L’IMC se classifie ainsi : – moins de 18,5 : Insuffisance pondérale (maigreur) – de 18,5 à 25 : Corpulence normale – de 25 à 30 : Surpoids – de 30 à 35 : Obésité modérée – de 35 à 40 : Obésité sévère – plus de 40 : Obésité morbide ou massive Lors de la pesée à mon premier rendez-vous, mon IMC était de 46. Pour vous aider à m’imaginer, voilà ce que ce chiffre représente avec plusieurs tailles (données approximatives qui dépendent de différents paramètres comme l’ossature ou la musculature) : – 1m50 : 104 kilos – 1m60 : 118 kilos – 1m70 : 133 kilos – 1m80 : 149 kilos – 1m90 : 166 kilos De plus, je parle toujours de ma perte depuis le jour où j’ai franchi les portes du CDO*, car je considère que c’est là que mon parcours a débuté. Alors que de nombreux opérés se basent sur la date de leur chirurgie. * La chirurgie bariatrique n’est pas destinée à n’importe qui. Il ne s’agit pas d’une opération pour perdre quelques kilos superflus. Remettons les choses dans leur contexte. Si le taux d’obésité augmente (IMC* supérieur à 30), celui de l’obésité morbide (ou encore dite massive avec un IMC de plus de 40) est relativement stable et concerne environ 1 % de la population *2. Pour envisager cette chirurgie, il faut : – Un IMC au-dessus de 40 (obésité morbide). Les patients présentant une obésité sévère (IMC entre 35 et 40) sont également éligibles s’ils souffrent d’une ou plusieurs maladies associées comme le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, une stéatose du foie, l’apnée du sommeil, une insuffisance respiratoire... – Être en échec lors des précédentes tentatives d’amaigrissement. La chirurgie est toujours le dernier recours quand rien d’autre n’a réussi ; ce n’est jamais une décision anodine ou de facilité comme on peut parfois le croire de prime abord (même chez certains futurs opérés). – Un consentement éclairé : il est impératif que les enjeux soient bien compris par le patient. En effet, cette chirurgie modifie le système digestif en réduisant drastiquement la taille de l’estomac (et le bypass va jusqu’à dériver une partie de l’intestin). Elle implique des changements conséquents concernant les habitudes de vie (notamment alimentaires) et le suivi médical est très rigoureux. Il existe plusieurs contre-indications. Certaines sont temporaires, d’autres irrémédiables. J’en liste quelques-unes à titre d’exemple, mais seul votre CDO* peut vous renseigner par rapport à votre situation personnelle. Dans les définitives, nous pouvons citer : – présenter une maladie endocrinienne ; – quand le risque que fait courir la chirurgie est plus important que le bénéfice qu’elle peut apporter ; – certaines pathologies graves qui rendent toute anesthésie impraticable (cela semble évident, mais ça va mieux en le disant) ; – si le suivi est impossible (en raison du lieu de vie par exemple), l’opération sera trop risquée ; – le bypass entraînant une malabsorption *3 de certains médicaments, si ceux-ci sont indispensables, cette chirurgie précise ne pourra pas être proposée. Les temporaires concernent essentiellement deux situations. Tout d’abord la dépression sévère. Il faut déjà se faire aider, car cette maladie altère les capacités de jugement et le consentement ne pourra pas être éclairé. De plus, il est compliqué de suivre un traitement médical et d’observer une prise en charge correcte en souffrant de cette pathologie (j’en sais quelque chose, je suis passée par là il y a plus de dix ans). La difficulté à se maîtriser rend également ardue la phase postopératoire et ses « contraintes » (je ne mets pas des guillemets au hasard, vous comprendrez pourquoi au fil de la lecture). En outre, il y a la crainte que la dépression, après un apaisement grâce à l’intervention et la perte de poids, revienne plus forte et conduise à certains actes désespérés. Le risque est accru après chirurgie : on estime qu’il y a quatre fois plus de suicides chez les opérés que dans le reste de la population. Attention avec ce chiffre, car les obèses sont plus fragiles, même avant l’intervention. Cette dernière pourra régler certains problèmes, mais n’effacera jamais certains traumatismes (qui ont pu provoquer une prise de poids) comme de la maltraitance ou de l’inceste. De plus, l’image modifiée de son corps, ne pas se reconnaître, ne pas maigrir autant qu’attendu, ou bien perdre sans avoir anticipé les excès de peau difficiles à assumer, peuvent aussi entraîner une dépression. Une fois la maladie soignée, la chirurgie peut être envisagée. Si vous êtes concerné par des troubles des conduites alimentaires, il ne faut surtout pas le cacher de peur qu’on vous refuse l’opération. Au contraire, il est nécessaire d’en parler à l’équipe médicale qui vous aidera à surmonter ce problème pour que l’intervention ne soit pas un échec. Il faut savoir qu’il existe également des facteurs de risque comme l’âge, un IMC* supérieur à 50, le tabagisme, qui, s’ils n’empêchent pas forcément la chirurgie, doivent être pris en compte pour votre sécurité. Dans tous les cas, mentir ne pourrait que vous desservir et vous exposerait à des complications pouvant être évitées. Une honnêteté totale avec l’équipe médicale qui vous assiste dans le parcours est indispensable afin de ne pas vous mettre en danger et d’obtenir le meilleur résultat possible à long terme. Au pire, si l’opération est vraiment incompatible avec vos antécédents, on ne vous abandonnera pas. Vous serez pris en charge autrement. À noter que si vous pensez ne pas rentrer dans les clous, rien ne vous empêche de consulter (vous verrez que j’ai douté moi aussi !), chaque patient est étudié au cas par cas et vous serez accompagné, même si ce n’est pas chirurgicalement. Toute opération bariatrique fait l’objet d’une entente préalable auprès de la Sécurité sociale et vous pouvez être amené à rencontrer l’un de leurs médecins. Ce n’est ni inquiétant ni anormal. N’ayant pas été convoquée, je n’y reviendrai pas dans ce témoignage. * L’intervention tend à plusieurs buts, voici les principaux : – Celui auquel tout le monde pense immédiatement : la perte de poids. – Le plus important tient en la disparition ou la baisse des comorbidités. Il est par exemple possible de passer d’injections quotidiennes d’insuline à quelques comprimés pour le diabète. Ou encore de récupérer une tension artérielle dans les normes ! Bien sûr, le résultat n’est pas garanti, mais quasiment tous les opérés ont un réel gain sur les maladies associées à l’obésité. – La diminution des risques de développer d’autres pathologies comme certains cancers (tels ceux du sein, colon, utérus, prostate, rein...). Elle serait d’un tiers selon l’étude SOS *4 ! C’est énorme. Je vous parlerai de cette étude lors du premier rendez-vous avec le chirurgien. – L’amélioration de la qualité de vie des patients. – La normalisation de la fertilité si le poids était la cause de problèmes dans ce domaine. – En évitant certains décès liés notamment aux cancers et accidents cardio-vasculaires, la mortalité serait réduite de 40 % ! Un chiffre qui donne le tournis. La perte moyenne est de 70 % de l’excès de poids, en conséquence, on ne devient généralement pas mince après ce type d’intervention. C’est une moyenne, ce qui signifie que certains maigrissent plus... tandis que d’autres moins. L’IMC* moyen après la chirurgie est de 30... soit le tout début d’une obésité modérée. Exit l’image du top model donc. On considère qu’à dix ans, les opérés se seront allégés en moyenne des 2/3 de leur poids excédentaire. Je crois que ces chiffres sont essentiels à connaître dès le début. Personne ne peut vous garantir une perte de tant ou tant de kilos. Il est possible de maigrir beaucoup, comme très peu. Mettre une attente trop élevée sur l’intervention risque d’entraîner une déception (ou une frustration) importante et des dommages psychologiques non négligeables. La décision J’ai mis des années à me décider, car rien qu’en entendant les mots « chirurgie bariatrique », je suis pétrie de peur. Peur des risques liés à l’opération en premier lieu. Pourtant, les chiffres sont plutôt rassurants. Peu de décès : 8 à 14 pour 10 000 interventions. Malgré tout, je peux faire partie de ces exceptions. Et puis, il y a les complications... Occlusion *5, fistule, phlébite *6 , infections, malaises, hernie, problèmes digestifs... On ne parle que de cela, partout. La peur de la douleur est loin derrière, mais bien présente. Il paraît que ça fait très mal, non seulement dans les jours qui suivent, mais aussi pendant très longtemps en cas de dumping syndrome *7 . Et s’il faut se faire retendre la peau car elle n’a pas suivi le rythme accéléré de la perte, on repart sur de nouvelles souffrances de cicatrisation, des années plus tard. Une autre peur, qui peut sembler étonnante, celle de changer. Physiquement (même si mon corps est perfectible, c’est le mien, je ne connais que l’obésité) et mentalement. Certains témoignages parlent d’impossibilité de se reconnaître, de rejet de ce corps modifié, mais également de divorces, d’amitiés mises à mal. La dernière peur qui me taraude est celle des contraintes et frustrations après l’opération. Elles seront présentes à vie. Il n’y aura pas de relâchement envisageable. Suis-je prête à ces sacrifices ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? En fait, il reste une crainte que j’ose à peine m’avouer. Il y a longtemps, quand je m’étais renseignée, j’avais lu qu’il pouvait y avoir des fuites anales. À même pas trente ans, ça avait suffi à me convaincre que non, non, non ! Hors de question de perdre (potentiellement, certes) le contrôle total de mon sphincter. De mes souvenirs (car je ne retrouve rien de ce type lorsque je dévore tout ce que je trouve sur le sujet avant le premier rendez-vous), c’était expliqué par la malabsorption* des graisses qui lubrifiaient les intestins et les selles glissaient ainsi presque toutes seules dans le colon. Le fait de ne plus en entendre parler me rassure. Au contraire, il est plutôt fait état d’une constipation suite à l’opération du fait de la diminution de nourriture et de fibres ingérées. Ma dignité a une nette préférence pour ce dernier effet secondaire. * Ma généraliste, la Dre Grimaud, évoque cette chirurgie depuis cinq ans, depuis qu’elle a repris le cabinet médical où je suis suivie. C’est la première à m’avoir informée que l’obésité est une maladie, qu’il existe des équipes spécialisées, en milieu hospitalier, et que l’intervention est à envisager dans mon cas, au vu de mon IMC* élevé et de tous mes échecs précédents pour maigrir durablement. Mais j’ai peur, si peur que je refuse d’en parler. Comme je l’ai dit plus haut, j’appréhende les risques opératoires bien sûr. Mais je suis aussi terrorisée à l’idée que ça rate, que je ne perde pas, ou que je reprenne. Si le dernier espoir ne fonctionne pas, que me restera-t-il ? Et puis... j’ai honte. Honte de ne pas réussir sans aide. Ce n’est quand même pas si compliqué ! 99 % de la population n’est pas obèse morbide. Si je le suis, c’est parce que je ne bouge pas assez, que j’écoute trop mes douleurs. Et puis, même si je mange sain, je mange trop ! Et la semaine dernière, je me suis offert une glace, alors que j’aurais pu m’en passer. Si je fais plus d’efforts, que j’arrête les féculents, que je fais deux heures de sport par jour, je vais y arriver. Seule, sans aide. Alors je perds quelques kilos. J’en reprends quasiment le double. Comme d’habitude. C’est mon éternel schéma depuis près de vingt-cinq ans, depuis que j’ai consulté pour la première fois lorsque j’étais encore à l’école. Ce fameux effet yoyo. La Dre Grimaud me reparle de la chirurgie annuellement, juste pour connaître la progression de ma réflexion, me rappeler qu’elle sera là le jour où je serai prête. J’ai conscience de la chance que j’ai d’avoir une généraliste en or, la savoir derrière moi m’a aidée tout le long de mon cheminement. Tendre la main au lieu de culpabiliser, c’était indubitablement la bonne méthode à appliquer avec moi, même si ça m’aura pris du temps. Se décider est très difficile. Cela impose de se regarder en face et d’être prêt à s’engager à vie, car il est compliqué, voire impossible, de revenir en arrière. Il est donc normal que cette résolution mûrisse, souvent très longtemps. D’autant qu’une opération qui va changer le métabolisme et impacter le reste de la vie n’est jamais à prendre à la légère. Parce que oui, après des années à refuser d’en entendre parler, je suis enfin prête à envisager cette possibilité. Ma santé est affectée et c’est ce qui me conduit à sauter le pas. Mes risques cardio-vasculaires sont importants, l’angoisse de mourir ne me quitte plus. En préparant ce livre, j’apprends que les obèses ont quatre fois plus d’hypertension artérielle que le reste de la population en raison d’hormones et de molécules émises par les cellules adipeuses. Je suis loin d’être une exception. D’autres problèmes se rajoutent et me conduisent à consulter une néphrologue. Mon poids revient comme facteur aggravant, encore et toujours. Et ce dernier souci me fait en plus douter que je sois éligible à l’opération. Sur le site du CDO* que j’ai fini par examiner en long, en large et en travers, il est précisé qu’il ne faut pas avoir de pathologie liée à la thyroïde ou aux glandes surrénales. Avec mon nodule surrénalien, je suis convaincue d’être rejetée de cette opération. La Dre Grimaud use de toute sa persuasion et j’accepte d’y aller quand même. Au pire, ils me prendront en charge et m’aideront autrement. Mais à ce stade, enfin disposée à entrer dans ce parcours, ça serait une nouvelle difficile à encaisser. Je ne suis pas sûre d’en être capable, mais ai-je encore le choix ? * Hormis les problèmes de santé, plus le temps passe, plus je suis lourde, fatiguée, dans l’incapacité d’accomplir certaines choses, notamment avec les enfants. Être obèse implique de m’adapter en permanence. De m’interroger avant de faire quoi que ce soit : « Cette chaise va-t-elle supporter mon poids ? », « Est-ce que je tiens sur ce trottoir ? ». De devoir me garer plus loin, car la place de parking est trop étroite et que je ne pourrai pas m’extirper de mon automobile. De pleurer en sortant des courses lorsque je découvre qu’une voiture est collée à la mienne et qu’il m’est impossible de m’y glisser. Car, obèse depuis l’enfance, je n’ai jamais eu le loisir de me faufiler. D’avancer régulièrement l’heure du réveil, car il m’est de plus en plus compliqué de m’habiller. Le pompon revient aux chaussettes qui sont ma croix journalière. De demander de l’aide aux collègues pour accéder aux archives, car je passe à peine une cuisse entre les rayonnages. De prendre des antidouleurs quand je reçois des invités pour réussir à gérer le ménage, la préparation du repas et la visite sans m’écrouler. Même s’il n’est pas reconnu en tant que tel, je ressens mon poids comme un réel handicap, qui me rend la vie difficile au quotidien. Et tout autour de moi me le rappelle constamment. Heureusement, j’ai un travail administratif et je n’ai pas à m’inquiéter à ce sujet, contrairement à d’autres obèses qui peuvent avoir du mal à trouver ou garder leur boulot s’il y a contact avec le public ou beaucoup de manutentions par exemple. Leur apparence ne rassure pas les employeurs potentiels (ce qui est discriminatoire, mais comment le prouver ?), ou les douleurs deviennent invalidantes et rendent certaines tâches difficilement réalisables. * Mon obésité est devenue un fardeau. Un fardeau physique, car se mouvoir avec plusieurs dizaines de kilos en trop, c’est plus difficile, plus fatigant. Je ne compte plus le nombre de malaises que j’ai fait en jardinant ou en passant simplement le balai. Avec les années, j’ai appris à décomposer toutes mes tâches pour éviter de m’épuiser et d’en arriver à cette extrémité. Cinq minutes par-ci, par-là. Me garer plus près. Échapper aux escaliers autant que possible... Il faut bouger pour aller mieux, mais ça m’est tellement difficile... C’est le serpent qui se mord la queue. C’est venu en même temps que la trentaine. Avant, je faisais partie de ces grosses qui clament qu’elles vivent normalement et qui revendiquent presque fièrement leurs kilos. Le fardeau est aussi psychologique. Personnellement, je pense le supporter relativement bien par rapport aux témoignages divers que j’ai pu entendre. Malgré cette acceptation de mon corps, il m’est impossible de me voir en photo. Si je ne suis pas complexée, je ne supporte pas l’image renvoyée par l’appareil. Elle est tellement éloignée de la façon dont je me visualise qu’il m’est intolérable d’y être confrontée. Dans le quotidien, chaque rappel de mon apparence hors-norme est autant de coups de griffes que je reçois. Ça ne fait pas très mal à chaque fois, mais ça égratigne. Je me révèle entièrement couverte de ces cicatrices mentales. Les regards, le mobilier inadapté, les réflexions, les brimades lorsque j’étais petite... À tout cela s’ajoute la culpabilité, fidèle d’entre les fidèles depuis ma tendre enfance et les insultes de cours de récré. On m’a tellement martelé que si je suis grosse c’est de ma faute que je l’ai toujours cru. Il y a ceux qui essaient de me faire cracher le morceau : « Non, mais avoue, je ne le répéterai pas. Tu te gaves de paquets de chips quand il n’y a personne, hein ? » Il y a les médecins qui soupirent devant mon poids, nécessitant de parfois changer de matériel. Une chronique de Baptiste Beaulieu *8 pour France Inter est visible sur Internet à ce sujet et m’a beaucoup touchée. Il y a les regards jetés dans mon chariot. Vu que je suis grosse, on peut juger ce que je mange ! Alors que je fais les courses familiales, ce n’est donc pas forcément pour moi. Ce n’est pas parce que je suis au régime permanent que mes enfants doivent l’être également. Encore une fois, mon premier réflexe est de me justifier bien que je n’aie pas à le faire. Il y a ceux qui se moquent dans la rue (souvent des groupes d’adolescents). Il y a les comparaisons aux autres, la honte de ne pas réussir à faire autant et aussi bien que mes amis et collègues quand ils se racontent leurs week-ends. Impossible pour moi en fractionnant mes tâches domestiques et parentales d’avoir la même efficacité qu’eux sur tous les fronts. Avec les années, j’essaie de me blinder, de me cacher derrière une façade, celle de la fille qui s’en fiche, qui assume et est bien dans ses baskets. J’ai tant souffert petite, que sans cette carapace, le quotidien me serait intolérable. L’obésité morbide abîme le corps et le psychisme. Je ne connais personne qui s’inflige de telles douleurs morales et physiques volontairement, quoi que les bien-pensants en disent. * Maintenant que je suis prête à rencontrer le chirurgien, je n’aborde pas cette opération en me fixant un poids ou un IMC* à atteindre. Sans doute, car j’ai une amie qui a perdu peu par rapport à ce qu’elle espérait, et que ce qu’elle a ressenti comme un échec a été très douloureux pour elle. Ça l’est du reste encore malgré les années passées. J’ai pleinement conscience que je ne pourrais me délester que d’une vingtaine de kilos. Voire moins. Qui seront toujours ça de gagné. C’est mon état d’esprit. J’aimerais juste casser cette spirale infernale qui me pousse à grossir invariablement. Si je stabilise à un IMC de 38 par exemple, je m’en satisferai. Je rêve de ne plus focaliser sur mon poids, de ne plus craindre le yoyo, de ne plus devoir être dans une restriction perpétuelle et culpabilisante. Si je souffre des répercussions de mon poids, je n’ai pas de problème particulier avec l’acceptation de mon corps, il me convient tel qu’il est et je crois que ça facilite cette absence d’objectifs. Oui, même si j’ai du mal à me voir en photo car je ne me reconnais pas. Très franchement, je me fous complètement de l’aspect esthétique tandis que c’est la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu’on parle chirurgie. C’est vraiment ma santé que je souhaite améliorer, ne plus craindre de mourir et de laisser mes enfants, ne plus me détériorer (je constate que je perds de l’autonomie à une allure qui me terrifie). Si possible, gagner en qualité de vie, notamment au niveau de la mobilité. Au fond de moi, un doux rêve : pouvoir rentrer dans un gilet et ainsi faire du canoë ou du Laser Game. Voire glisser mon corps dans un kart, même si la vitesse me fiche la trouille. J’ai tellement envie de partager des activités avec mes ados que je suis prête à combattre mes peurs. Ça serait la cerise sur le gâteau comme on dit. Pas une seconde, je n’imagine atteindre un IMC* normal. Le premier rendez-vous Le cœur battant, je suis les indications sur les panneaux de l’hôpital. Ma main tremble lorsque j’appuie sur le bouton de l’ascenseur qui me rapproche du chirurgien, de ce rendez-vous qui va potentiellement changer ma vie. Les portes s’ouvrent sur un nouveau couloir, je prends à droite et vais m’annoncer à l’accueil. La secrétaire, Sakina m’apprend son badge, me remet un petit fascicule qui décrit les quatre interventions actuellement pratiquées, puis m’invite à patienter. Quand je pénètre dans la salle d’attente, les larmes me montent aux yeux. Ici, les fauteuils sont adaptés aux obèses. Je n’en avais jamais vu, je ne savais même pas que ce type de mobilier existait. Ils sont environ deux fois plus larges que la normale, je n’ai pas à rester debout ou à déborder de mon siège en culpabilisant de prendre trop de place. Je m’installe, confortablement, avec la sensation que je vais trouver dans cet endroit de la bienveillance. Enfin. En attendant le Dr Champollion, je lis et relis mon petit fascicule, stressée. Un dessin illustre chaque intervention pour une meilleure visualisation. En plus du bypass qui sera mon opération (même si je l’ignore à cet instant) et dont il est question dans ce livre, il y a la gastroplastie par anneau ajustable, la sleeve gastrectomy et le duodenal-switch. N’ayant pas eu ces techniques, je n’en parlerai pas plus. Ce document explique que la chirurgie bariatrique, si elle n’est pas miraculeuse, est la solution la plus efficace sur dix ans. * Tout commence par une réunion de groupe, très interactive. Nous sommes trois. Trois femmes (comme 80 % des opérés) à nous jeter dans l’inconnu, à espérer beaucoup de ce premier rendez-vous. Le Dr Champollion, aidé de diapositives projetées au mur, nous apprend toutes les données essentielles à connaître avant de se lancer. Les différentes techniques chirurgicales, les attendus, les complications possibles, les études (notamment une suédoise, nommée SOS [Swedish Obese Subjects], menée sur une quinzaine d’années avec un échantillon de plusieurs milliers d’obèses). C’est très didactique, il ne se contente pas de dérouler sa présentation. Non, il commence toujours par nous interroger. Il veut savoir quelle est notre compréhension à ce stade, si nous avons de fausses idées sur ce type d’intervention, si des rumeurs nous inquiètent, si nous nous souvenons de nos cours de biologie concernant la digestion, si nous réalisons l’intérêt de couper un bout d’intestin dans le cadre du bypass... La discussion est très enrichissante et ainsi, nous sommes vraiment actrices de cette première réunion. Il n’y a pas de jugements, ni entre nous ni de la part du médecin. Le fait d’être en groupe permet d’avoir des réponses à des questions que nous n’aurions peut-être pas osé poser ou auxquelles nous n’avions pas (encore) pensé. Revenons plus en détail sur tout ce que le Dr Champollion nous explique. Nous débutons par les études et j’apprends avec stupeur qu’il est prouvé que, sur dix ans, le combo alimentation + sport + suivi psychologique échoue généralement chez les obèses. Bien sûr, comme pour tout, il n’y a pas de règle absolue. Il peut marcher avec certaines personnes, et rien que pour ça, ça vaut la peine d’essayer avant d’envisager l’opération, mais dans la plupart des cas, le seul effet obtenu est le célèbre yoyo. Nous n’avons pas quelques kilos à perdre liés à des excès, mais bien une maladie qui fait que notre métabolisme utilise très peu de calories pour fonctionner. Découvrir ça, diagrammes à l’appui sur le mur face à moi, est comme un tsunami. Si je ne parviens pas à maigrir, ce n’est pas de ma faute. Ce n’est pas ma faute... alors qu’on m’a rabâché le contraire toute ma vie. Oralement, mais aussi avec le regard, comme celui de parfaits inconnus me jugeant si j’ose manger une glace ou une gaufre en public. Pourtant, même si ça fait du bien à entendre, ma culpabilité, ancrée si profondément en moi, ne s’envole pas d’un coup de baguette magique. C’est « juste » le début d’un long travail. La même étude nous montre que l’intervention fonctionne vraiment ! Il faut toutefois savoir que près de la moitié des patients grossissent à nouveau, habituellement après quelques années. Il s’agit en général d’une reprise modérée, mais à surveiller, seuls 3 % retournent à la case départ. Le chirurgien nous répète que l’opération n’est pas une baguette magique, mais une béquille. Elle nous aidera, mais ne fera pas tout pour nous. Le Dr Champollion insiste sur l’hygiène de vie à avoir après une intervention. On nous offre une chance, à nous de la saisir. Il cite l’exemple d’un de ses patients qui ingurgitait de la raclette une dizaine de fois dans la journée. Évidemment qu’il reprend du poids ! Par contre, en s’impliquant dans le suivi et en tenant compte des conseils et recommandations du CDO*, il y a de bonnes raisons d’espérer. En ayant la confirmation qu’il s’agit d’une maladie, que je n’en suis pas responsable (même si les obèses mangent en général trop, car ils ont perdu la sensation de satiété), je me libère d’une crainte que je ne pensais pas avoir, celle de faire payer aux autres mon problème. Une opération revient cher à la Sécurité sociale : passage au bloc, hospitalisation et arrêt de travail chiffrent vite. Hors de question d’être (encore plus) un poids pour la société à cause de mon manque de volonté. Sauf que si la chirurgie est prise en charge, c’est bien qu’il y a une raison. D’abord, l’obésité morbide est une pathologie reconnue, mais aussi les frais liés à l’intervention sont amortis par la diminution ou la suppression des traitements des comorbidités. Sans parler des maladies évitées qui auraient eu un coût par ailleurs. Cette idée m’apaise. Encore une petite part de culpabilité qui s’envole. *1 Abréviation de Docteure. J’ai beaucoup hésité à employer le masculin « neutre » pour docteur dans cet ouvrage, selon les recommandations de l’Académie française. Cependant, même elle reconnaît qu’elle intègre dans son dictionnaire les mots entrés naturellement dans l’usage. C’est donc à nous de faire évoluer les choses, individuellement. J’ai conscience qu’écrire « ma médecin », « à la Dre Grimaud » peut décontenancer au début. J’ai vécu cela avec le terme « autrice », historiquement le bon, mais interdit longtemps par nos chers académiciens. Il est réutilisé dans le milieu littéraire depuis quelques années, grâce à l’engagement de plusieurs d’entre elles. Et à force de le voir, je suis passée naturellement de « auteure » à « autrice » dans mes retours de lecture. Une conférence sur le sexisme, proposée par mon employeur et animée par Alexia Anglade, fondatrice de Lumières s’il vous plaît, a achevé de me convaincre : ce qui n’est pas dit n’existe pas, et ne pas féminiser précisément cette profession alors que les autres le sont n’est pas sans incidence. La France progresse doucement, le féminin docteure est par exemple mentionné dans le guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions de 1999 (qui aurait besoin d’une remise à jour). Dre en abréviation de Docteure est du reste la norme dans des pays comme la Suisse et le Canada.
*2 Sur les conseils de mon nutritionniste, j’ai suivi le MOOC (Massive Open Online Course qui signifie cours ouvert en ligne et massif) gratuit « Chirurgie de l’obésité », proposé par univ-toulouse sur la plateforme FUN (France Université Numérique). Dans la vidéo « L’IMC comme indicateur d’excès de poids », le Professeur Patrick Ritz donne ce chiffre en se basant sur les études ObEpi (enquêtes nationales françaises au sujet de l’épidémiologie de l’obésité).
*3 Habituellement d’origine pathologique, ce trouble est recherché dans le bypass avec la dérivation d’une partie de l’intestin. Cette action entrave le processus normal d’absorption des nutriments (ainsi que de certains médicaments) à travers la paroi de l’intestin, notamment des glucides (sucres) et des lipides (graisses). Cependant, cette malabsorption occasionnant des carences*, il est nécessaire de prendre des compléments vitaminiques à vie.
*4 Swedish Obese Subjects. Il s’agit de la principale étude dans le domaine de l’obésité. Réalisée en Suède, elle a suivi environ 4 000 patients obèses répartis en deux groupes (traitement chirurgical ou prise en charge médicale) pendant dix ans.
*5 Il s’agit d’un blocage (partiel ou total) de l’intestin, entraînant un arrêt des selles et des gaz.
*6 La phlébite, appelée également thrombose veineuse, consiste en la formation d’un caillot sanguin à l’intérieur d’une veine, pouvant être associée à une inflammation. Elle intervient majoritairement dans les membres inférieurs.
*7 Le dumping est une complication fréquente du bypass. Il s’agit d’un malaise général qui survient après un repas contenant des aliments souvent riches en sucres rapides. Ces aliments arrivent brutalement dans l’intestin grêle, peu digérés. La concentration importante des molécules des glucides simples attire une quantité équivalente de fluide, ce qui rend l’intestin hypertendu. Des douleurs et crampes apparaissent, pouvant déclencher des réactions hormonales et nerveuses (palpitations, bouffées de chaleur, faiblesse…).
*8 Baptiste Beaulieu est médecin généraliste, écrivain et militant. Vous pouvez retrouver son intervention ici ou en tapant « Obèse ou XXL ? La chronique de Baptiste Beaulieu », le nom de cette vidéo, dans la barre de recherche de YouTube ou de votre navigateur Internet.
87
« Dernier message par Apogon le dim. 26/12/2021 à 21:40 »
L'anatidaephobie, comme son nom l'indique (enfin... presque) est la peur d'être observé par des canards  Peut être la peur des regards en coin coin
88
« Dernier message par marie08 le sam. 25/12/2021 à 13:01 »
Pour avoir lu d’autres romans de Fateah Issaad, je savais à l’avance que je ne serais pas déçue avec Un petit tout au Paradis. Et comme pressenti, j’ai retrouvé une plume fluide et surtout l’humour de Fat, un humour avec grand H qui fait du bien au coeur. Ce roman est un véritable conte spirituel et philosophique qui donne matière à réflexion. Cela m’a d’autant plus touché que ce roman entre dans mes convictions. Néanmoins, il m’arrive de douter, je ne le cache pas, mais après on se dit pourquoi pas ? Et si c’était vrai ? Fat je te remercie de nous faire partager ce petit « voyage » raconté avec ta verve et ton Humour. Futurs lecteurs, si j’ai un conseil à vous donner, ne passez pas à côté de ce merveilleux conte, il pourrait peut-être vous ouvrir les yeux et répondre à certaines de vos questions. https://www.amazon.fr/Petit-Tout-Au-Paradis/dp/B09L4K6QFW/ref=sr_1_1?crid=18BUF30ISA9G7&keywords=un+petit+tout+au+paradis&qid=1640433599&s=books&sprefix=un+petit+tout%2Cstripbooks%2C220&sr=1-1
89
« Dernier message par Apogon le jeu. 16/12/2021 à 17:17 »
Paris Break de Pauline SLF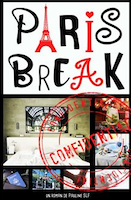 Liens d'achat : Amazon FnacÇa faisait une éternité que je n’avais pas pris le train. Je devais me rendre à une formation à Paris, pendant trois jours. D’habitude, je n’allais jamais à ce genre de chose. Au fil des années, j’étais devenue adepte des programmes en ligne, du « e-learning » ou « non-présentiel », comme on dit. C’était beaucoup plus simple, par rapport aux enfants. S’absenter trois jours pleins de la maison, à cheval sur un week-end, quand on a des enfants en bas âges et un mari qui aurait bien du mal à se pointer à la crèche ou à la garderie avant l’heure de fermeture, ça m’avait toujours semblé être une situation… à éviter. Alors, qu’est-ce qui avait changé ? Tout d’abord, les enfants ont grandi. Plus besoin d’aller les chercher, ils rentrent seuls. Plus besoin de les aider à faire leurs devoirs, ils gèrent. Plus besoin de les emmener à leurs activités, ils y vont à vélo. Plus besoin d’organiser des après-midis de jeux avec les parents des copains-copines, maintenant nos « bouts de choux » s’envoient des textos pour fixer leurs lieux et heures de rendez-vous eux-mêmes. En fait, à présent, ils avaient juste besoin qu’on leur prépare à manger midi et soir. Et ça, mon mari gérait comme un roi. Donc, l’idée de disparaître pendant trois jours n’avait plus du tout l’air d’un projet égoïste et culpabilisant, d’une sorte d’abandon du domicile familial, laissant mon conjoint seul aux manettes d’un vaisseau infernal que nous avions l’habitude de conduire à deux, dans un partage parfait des différentes tâches… même si, franchement, je ne me serais pas gênée pour le faire si j’en avais ressenti le besoin. En fait, après quinze ans de vie commune, je crois que c’était tout simplement la première fois que j’en ressentais le besoin. Une fois en quinze ans, ce n’est pas si mal, quand on y pense. C’est bien la preuve que je suis heureuse, même si je n’en ai pas toujours conscience. Du moins, à ce moment-là, je n’en avais pas réellement conscience. Donc voilà, les enfants avaient bien grandi et n’avaient plus autant besoin de moi en tant que co-responsable logistique du foyer. Mais ce n’était pas tout. Oh non. L’autonomie croissante des enfants n’était que le petit plus qui m’avait confortée dans cette démarche de formation. À vrai dire, leur père et moi traversions une période difficile, depuis près de deux ans. Un grand classique dans tous les couples qui durent, je sais. Mais nous peinions à surmonter nos problèmes. On n’arrivait même plus à trouver le courage de faire des efforts. J’en avais eu la preuve pendant nos vacances d’été. Comme tous les ans, nous étions partis trois semaines en vadrouille avec les enfants. Nous aimions alterner les visites culturelles, les activités sportives et les moments de farniente, tout en découvrant de nouveaux pays, de nouvelles régions. Comme tous les ans, nous étions revenus ravis de nos vacances. Mais sur le chemin du retour, alors que nos trois pré-ados dormaient à l’arrière, j’avais fait un constat assez sinistre. Nous roulions depuis des heures, en conduisant chacun notre tour. Et nous ne nous étions pas adressé la parole depuis notre départ, le matin-même. J’avais alors réalisé que durant ces trois semaines de vacances, à chaque fois que nous nous étions retrouvés seuls, nous n’avions jamais décroché un mot. Ni lui, ni moi. En présence des enfants, nous devions très certainement avoir l’air d’un couple normal, car nous nous efforcions de ne rien laisser paraître. On était des parents au top. On jouait notre rôle à merveille. La machine était bien rodée. Mais le soir venu, dans notre lit, on bouquinait en silence, ou pianotait sur nos téléphones, jusqu’à ce que chacun éteigne sa lampe de chevet, de façon plus ou moins décalée dans le temps. On avait même perdu l’habitude de se dire simplement « bonne nuit » dès que l’autre éteignait sa lampe. Bref. Pas un mot pendant trois semaines. Pas un contact. Pas une caresse. Je ne me souvenais pas vraiment de notre dernier gros câlin. Je me rendais compte qu’on ne s’embrassait même plus. Pas même un petit bisou machinal le matin. Rien. Et ça ne me manquait pas. Une fois rentrés chez nous, dans notre duplex avignonnais, j’avais profité des quelques jours qui nous restaient avant de reprendre le boulot pour faire un bilan de la situation, de mon point de vue à moi. J’étais assise dans la salle à manger, occupée à commander les courses sur l’application de notre supermarché de quartier, accompagnée d’une chaleureuse tasse de thé vert. J’observais mon mari pendant qu’il cuisinait, son bassin collé à l’îlot central, sa tête penchée vers sa cagette de légumes frais, son regard figé sur la planche à découper, totalement absorbé par cette aubergine qu’il taillait en fines lamelles. Je l’observais, en silence, pendant de longues minutes. Je ne ressentais pas d’envie, pas de désir, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais je ne ressentais pas de choses négatives pour autant. En fait, je ne ressentais plus rien. Je n’avais pas envie de lui parler, pas envie de l’embrasser, pas envie d’être avec lui. Mais je n’éprouvais pas non plus l’envie irrésistible de lui hurler dessus, le couvrir de reproches, lui envoyer ses lamelles d’aubergine à la figure et lui demander de partir. Sa présence ne suscitait plus rien chez moi, mais elle ne m’indisposait pas pour autant. J’avais donc bien du mal à savoir ce que je voulais, ou ce qui serait le mieux pour nous deux. J’étais complètement paumée. Et le pire, c’était qu’à force de ne plus se parler, à part pour des banalités, je n’arrivais même plus à me motiver pour me lancer avec lui dans une conversation pourtant bien nécessaire. Visiblement, lui non plus. C’est ce qu’on appelle un cercle vicieux, non ? Et pourtant, j’étais là. La veille de notre reprise du travail, alors que nos enfants avaient encore quelques jours de vacances avant la rentrée scolaire, j’avais pris l’initiative de jeter un œil à mes mails professionnels, histoire de ne pas y passer deux heures le lendemain matin et de trier d’ores et déjà le « urgent » du « peut attendre ». Parmi la centaine de mails à traiter, j’étais alors tombée sur une proposition de formation à Paris, dont la première session de l’année avait lieu quelques jours plus tard. Mon premier réflexe fut de supprimer le message, sans même l’avoir lu. Après avoir fait le tour des mails, je traînai quelques instants sur mon réseau social préféré. J’étais abonnée à un compte qui publiait des proverbes et citations tous les jours. En faisant défiler la page d’accueil du bout de mon index, je tombai sur la dernière publication de ce compte. C’était une phrase en anglais dont la traduction littérale voulait dire « J’ai juste besoin de m’éloigner pour me souvenir pourquoi je reste. ». Et là, en une fraction de seconde, un feu d’artifice éclata dans ma petite tête. Partir, n’était-ce effectivement pas la meilleure façon de comprendre pourquoi on reste ? J’avais immédiatement pensé au mail que j’avais supprimé. Celui sur la proposition de formation en présentiel. Trois jours à Paris, toute seule, dans un contexte professionnel, n’était-ce pas exactement ce qu’il me fallait ? N’était-ce pas une façon toute simple de faire le point ? De savoir si mon mari, avec qui je vivais depuis près de quinze ans, allait me manquer ? Et réciproquement, mon absence serait-elle pour lui la confirmation que ma présence ne comptait plus du tout, et qu’il était temps de s’interroger sérieusement sur l’avenir de notre couple ? Ou serait-ce au contraire le déclic dont il avait besoin pour se rendre compte que non, il n’envisageait pas une seule seconde de vivre sans moi ? J’avais immédiatement récupéré le mail dans la corbeille et l’avais ouvert pour le lire avec attention. Dans ma profession, nous avions une obligation de formation annuelle, les logiciels sur lesquels nous travaillions étant en constante évolution. Les trois jours de stage à Paris concernaient l’apprentissage d’une nouvelle fonction sur un logiciel que j’utilisais très peu. Dans un autre contexte, je ne me serais jamais inscrite. Mais là, j’avais juste besoin d’un prétexte. Un prétexte bien crédible pour m’accorder trois jours de réflexion en solitaire, loin du foyer familial et de mes enfants qui, soyons honnêtes, étaient sans le vouloir une merveilleuse diversion permettant à leurs parents d’éviter de se retrouver face à leurs problèmes une bonne fois pour toutes. Trois jours rien qu’à moi, pour faire le point, pour me poser les bonnes questions, tout en satisfaisant ma conscience professionnelle et mon obligation de formation annuelle. En plus, je serais revenue quatre jours avant la rentrée scolaire, ce qui me laisserait le temps de m’occuper des derniers petits préparatifs, s’il en restait. C’était décidé. J’allais le faire. Le lendemain matin, avant-dernier lundi du mois d’août, dès mon arrivée au boulot, j’avais envoyé un mail à mon chef pour lui demander de m’inscrire à cette formation. Très surpris, il s’était pointé illico dans mon bureau, me demandant si j’étais certaine de vouloir partir trois jours alors que je revenais tout juste de vacances, tout ça pour suivre une formation qui ne présentait pas un immense intérêt pour ma carrière. Eh bien oui, c’était ce que je voulais. Le long soupir qu’il avait poussé me laissait entendre que j’étais en train de passer pour une cinglée, doublée d’une enquiquineuse. Bah tant pis. J’avais su me montrer à peu près convaincante, et avais conclu les négociations par ce qui s’avérait être un énorme mensonge, à savoir que j’avais toujours rêvé de faire cette formation car je souhaitais vraiment développer mes compétences en matière d’animation vidéo. Mon chef m’avait lancé un regard étrange. En même temps, tout était étrange dans ce que je venais de dire. Depuis dix ans que je bossais pour cette boîte, il me connaissait bien. Et là, rien ne me ressemblait. Mais il n’avait aucune raison valable de me refuser cette formation. Alors il avait accepté, après m’avoir gentiment rappelé que dès mon retour, on attendait mes propositions d’illustrations pour les affiches du festival de jazz du printemps prochain. Victoire. Dans l’heure suivante, j’avais reçu la confirmation de l’organisme chargé du stage, ainsi qu’un mail de la secrétaire de direction me donnant les références de réservation pour mes billets de train et mes deux nuits d’hôtel, le tout aux frais de la boîte. Impeccable. Le soir-même, j’avais profité du dîner pour annoncer officiellement mon projet. Entre deux débats opposant mes filles à mon fils à propos des dernières séries télé disponibles sur notre service de vidéos à la demande favori, j’avais pris mon courage à deux mains et m’étais lancée. Voilà. C’était une grande première, mais Maman allait partir jeudi matin de très bonne heure, et reviendrait samedi soir. Pourquoi donc ? Parce que Maman avait l’opportunité de suivre une formation très intéressante qui serait du meilleur effet sur son C.V si un jour elle décidait d’évoluer professionnellement, ou si elle voulait carrément changer de boîte. Où partait Maman ? À Paris, pendant trois jours. Comment partait Maman ? En train. Où allait dormir Maman ? Dans un petit hôtel. Comme je me l’étais imaginé, mes trois pré-ados s’étaient contentés d’un « ok » et avaient immédiatement repris leur conversation télévisuelle. Mon mari, lui, m’avait regardée droit dans les yeux de façon franche et intense, pour la première fois depuis deux ans. Il m’avait interrogée sur le programme de la formation, et j’avais avancé exactement les mêmes arguments qu’avec mon chef. Après quelques échanges sur les conséquences logistiques de mon absence et le passage en revue des petites choses qu’il aurait à manager seul pour la première fois depuis la naissance de nos aînées, il avait imité ses enfants en concluant la conversation d’un « ok » qui suintait l’indifférence. En réalité, il n’était pas si indifférent. Au moment du coucher, quand nous nous étions retrouvés seuls dans notre chambre, au lieu du traditionnel silence, il m’avait posé quelques questions anodines sur mon séjour parisien de dernière minute. Et j’en avais assez vite conclu qu’il croyait moyennement à mon histoire de formation qui sortait de nulle part. Mine de rien, il était la personne qui me connaissait le mieux au monde. Vu l’état de notre couple, il s’était peut-être imaginé que j’allais rejoindre un amant, ou une amie à qui je confirais mon mal-être et qui me pousserait à demander le divorce. J’aurais pu le laisser cogiter, le laisser dans le flou, s’imaginer des trucs, en espérant que ça le pousse lui aussi à faire le point. Mais non. Je détestais qu’on me soupçonne, et lui avais donc montré les preuves que toute cette histoire était vraie : la confirmation d’inscription venant de l’organisme de formation, mes billets de train aller-retour et ma réservation d’hôtel. N’ayant plus aucune raison de me questionner, il s’était alors tourné dos à moi et avait éteint sa lampe de chevet, sans me souhaiter bonne nuit. J’avais attendu quelques secondes, me disant que c’était peut-être l’occasion de discuter avec franchise. J’avais hésité à lui dire clairement que je partais à Paris pour faire le point sur nous, histoire de provoquer chez lui une sorte d’électrochoc, une quelconque réaction. Alors qu’il me tournait le dos et cherchait le sommeil, je lui avais lancé un très pacifique « Peut-être que ça serait bien qu’on parle, non ? » auquel il m’avait vaguement répondu « Bah tu veux qu’on parle de quoi à cette heure-ci ? », preuve qu’il ne ressentait ni ne voyait la nécessité d’avoir une conversation de couple face à la dégradation progressive et inéluctable de nos rapports. À croire que ça ne l’inquiétait pas, ne le perturbait pas, ne le rendait pas malheureux. À ce moment-là, j’avais eu la certitude que cette escapade de trois jours nous ferait le plus grand bien. Mais trois jours, était-ce vraiment suffisant pour prendre tout le recul dont nous avions besoin ? Pas sûr. Le mercredi soir, après le dîner, j’étais montée dans ma chambre pour préparer mes bagages, pendant que mes enfants et mon mari jouaient ensemble à un jeu vidéo auquel je perdais tout le temps. J’emportais tout d’abord le bagage à main professionnel contenant mon ordinateur portable équipé de tous mes logiciels de boulot, et ma tablette graphique dernier cri. Dans la petite valise à roulette assortie sur laquelle le bagage à main se fixait de manière très astucieuse, j’avais mis trois tenues estivales qui me permettraient d’avoir le choix et de m’adapter à la météo qui s’annonçait encore très chaude, mais qui pouvait très bien changer en cours de route. Ça me permettrait aussi de m’adapter à la température de la salle de formation, car rien ne stipulait que celle-ci serait climatisée. J’avais pris du classique, décontracté et léger. Une paire de sandales de rechange, des sous-vêtements, ma trousse de toilette, de quoi m’attacher les cheveux, ma petite trousse à maquillage, et un bouquin que j’avais commencé pendant les vacances et que je peinais à finir. Pendant que je bouclais ma valise, mon mari entra dans la chambre pour prendre son chargeur de portable dans sa table de chevet. Je levai les yeux vers lui, pour voir si j’arrivais à capter son regard. Encore une fois, je pensais que peut-être, le fait de me voir préparer mes bagages provoquerait quelque chose chez lui. Une réaction, une émotion… quelque chose. Mais rien. Toujours rien. J’avais envie de lui dire un truc du genre « Tu as vu ? Tu as vu ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de préparer ma valise ! Je suis en train de me barrer ! Tu le vois, ça ? Tu le vois  ». Mais bien évidemment, rien ne sortit de ma bouche. Il avait quitté la pièce sans un mot, sans un regard. À ce moment-là, je n’avais plus eu qu’une seule envie : mettre mon pyjama, me coucher, et m’endormir le plus vite possible pour que le matin arrive. J’étais allée embrasser mes enfants avant de filer sous la couette, leur rappelant que je comptais sur eux pour bien se comporter pendant mon absence, histoire qu’à mon retour je ne retrouve pas un mari épuisé qui me supplierait de ne plus jamais le laisser trois jours seuls avec nos pré-ados. J’avais même poussé le vice jusqu’à leur dire que mon absence était une merveilleuse occasion pour eux de passer des moments privilégiés avec leur père et qu’il fallait en profiter. En réalité, mon mari était déjà un père formidable qui prenait le temps d’avoir des petits moments de complicité avec chacun de nos enfants, et ce depuis leur naissance. Donc, ma remarque était carrément déplacée et superflue. Mais tant pis. Sur le coup, ça m’avait donné l’impression de dire quelque chose de bien. Je m’étais couchée seule, fatiguée de ma journée de travail mais surexcitée à l’idée de partir seule à Paris, avec la musique du jeu vidéo sur lequel ma petite famille continuait de s’éclater à l’étage du dessous, en guise de berceuse. Voilà. Allez, bonne nuit tout le monde. Nous étions donc jeudi matin. Je m’étais levée à 6H15, avais fait le moins de bruit possible en me préparant, et quittai l’appartement en ayant une drôle de sensation. Quelque chose d’assez inexplicable. Nous vivions à vingt minutes à pied de la gare d’Avignon-TGV. Pendant que je marchais dans les rues désertes, et que ma valise à roulettes semblait faire le même bruit qu’un avion au décollage tant la ville était silencieuse, j’essayais d’identifier cette sensation. C’était comme si, au fond de moi, quelque chose me disait qu’un mécanisme s’était déclenché, et que rien ne pourrait l’arrêter. Comme si ces trois jours loin de mon foyer allaient me transformer, et que je reviendrais samedi soir en n’étant plus vraiment la même personne. Je pensai à mon couple, à mon mari, à notre histoire qui avait pourtant si bien commencé. On s’était rencontrés à l’anniversaire d’une de mes copines de promo. À l’époque, j’étais en troisième année d’études, et lui en plein master 2 de biochimie et biologie moléculaire. Il était ami avec le frère de cette fameuse copine. Lorsque l’on me l’avait présenté, ce soir-là, je l’avais trouvé sympa, et mignon, mais sans plus. J’étais venue avant tout pour m’amuser et danser avec mes copines, pas pour me faire draguer. Mais j’avais quand même discuté avec lui, et nous avions échangé nos numéros de portable, sans grande conviction. On s’était revus une semaine plus tard, autour d’un verre en terrasse, avec le prétexte de devoir rejoindre ma copine et son frère pour voir un film au ciné. On avait discuté de tout un tas de choses. Mais ce qui nous avait rapprochés, au point de ne pas voir l’heure passer et de louper la séance, c’était de découvrir que nous avions pour point commun de sortir chacun d’une relation sérieuse qui s’était mal terminée. Comme moi, il avait vécu avec quelqu’un pendant plusieurs mois avant de retourner en colocation. Comme moi, il était à l’origine de la rupture. Comme moi, il avait énormément souffert de mettre fin à une relation qui avait duré plusieurs années et gérait mal le poids de la culpabilité. Comme moi, il venait de faire une croix sur un avenir amoureux qu’il pensait tout écrit, et devait à présent accepter l’idée que le chemin serait différent. Comme moi, il avait tellement aimé cette personne qu’il avait peur de ne plus jamais tomber amoureux avec la même intensité. On avait les mêmes craintes, les mêmes doutes. On se comprenait, lui et moi. Et quelque chose de fort était né de ça. On avait commencé à sortir ensemble, et on était très vite tombés amoureux. C’était grisant de constater que contrairement à ce qu’on s’était imaginé, nous vivions une histoire encore plus forte, encore plus belle, encore plus intense que n’importe quelle autre relation d’avant. Très vite, il m’avait proposé de vivre avec lui. Et notre cohabitation était une totale réussite. Tout me convenait. Moi qui ne croyait pas au concept d’âmes-sœurs, je devais avouer que ça y ressemblait beaucoup. On s’était mariés quelques mois après la fin de mes études. Un petit mariage civil tout simple, à notre image, entourés de nos amis et de la famille proche. On voulait des enfants rapidement. On ne voulait pas attendre. Au contraire. On voulait commencer par ça, et profiter de la vie après, avec eux. Je l’ignorais au moment de dire oui, mais je m’étais mariée enceinte de trois semaines. Les années qui suivirent furent parfaites. Vraiment parfaites. Nous avions chacun un boulot stable et épanouissant, nous vivions dans un superbe appartement, les enfants se portaient bien, nous avions des amis formidables que l’on voyait régulièrement, nous partions en vacances plusieurs fois par an. La grande force de notre couple, c’était notre compatibilité. On s’entendait à merveille, et avions tellement de points communs. Les sujets de discorde étaient rares, même très rares. On ne se disputait quasiment jamais. Et pourtant, on s’était éloignés, progressivement, au point de cordialement s’ignorer depuis deux ans. Qu’est-ce qui s’était passé ? La routine ? Les enfants ? Peut-être. Pourtant, je l’aimais, notre routine. J’aimais notre vie de famille, notre quotidien. Je n’imaginais pas ma vie autrement. Oui, les enfants sont chronophages. Mais j’avais toujours eu l’impression qu’au contraire, nos enfants nous avaient encore rapprochés davantage. Avec eux, nous étions bien plus qu’un couple d’adultes amoureux. Nous étions une paire de parents. Un duo de choc capable de faire face à n’importe quelle situation. C’était comme ça que je nous voyais. Etions-nous moins beaux, moins désirables qu’avant ? Sans doute. Mais je nous estimais encore jeunes et séduisants. En tout cas, moi, quand je me regardais dans le miroir, je ne me faisais pas horreur du tout. Je n’avais plus vingt ans, certes. Mais j’estimais être encore jolie. Et lui aussi, je le trouvais beau. Peut-être même encore plus beau que quinze ans plus tôt, car son visage gagnait en caractère. Etais-je devenue inintéressante ? Ennuyeuse ? Aucune idée. J’avais la prétention de penser que non. Et en même temps, étais-je vraiment la mieux placée pour répondre à cette question ? Peut-être que, sans m’en rendre compte, j’étais devenue fade, et terne. Je cogitais tellement que je ne vis pas le trajet passer. Nous y étions. Les horloges de la gare indiquaient 7H15, et je me trouvais sur le quai avec ma valise à roulettes à attendre le T.G.V qui me mènerait de la cité des papes à la capitale en deux heures et trente minutes. Il n’y avait pas grand monde autour de moi. Normal, à cette heure-ci, fin août, quand pas mal de gens sont encore en vacances, ou encore dans leur lit. On voyait déjà que ça allait être une belle journée. Le soleil était de la partie. Tout était si calme, si désert. À tel point que le jingle de la S.N.C.F et la voix dans le micro nous demandant de nous éloigner de la bordure du quai me firent sursauter. L’arrivée du train étant imminente, je jetai un œil à mes billets et découvris avec satisfaction que j’allais voyager en première classe. Sympa, le chef. En même temps, étant une experte du télétravail et des formations à distance, on ne pouvait pas dire que je lui avais coûté cher en transports et en hôtel depuis mon embauche. J’étais toute contente. Je n’avais pas pris le train depuis des années, alors que j’adorais ça. Et je ressentais encore quelque chose d’indescriptible. Mais pas comme la sensation que j’avais pendant que je marchais vers la gare. Là, en voyant le train qui arrivait au loin, c’était plutôt quelque chose qui me donnait l’impression qu’en fait, j’aurais dû m’autoriser ce genre d’escapade depuis bien longtemps. J’étais seule, avec ma valise, sur un quai de gare, comme quand j’étais étudiante. Un bond de presque vingt ans en arrière. C’était plus fort que moi, je ne pouvais pas m’empêcher d’être heureuse, comme jamais depuis de nombreux mois. Le train arriva. Apparemment, tout le monde se rendait à Paris, car personne n’en descendit. Une fois à bord, je fus surprise de voir qu’il n’était pas aussi vide que le quai. Les gens n’étaient donc pas tous en vacances ou au fond de leur lit. Toutes ces personnes s’étaient même levées bien plus tôt que moi, les pauvres. Depuis l’entrée du wagon, je constatai que toutes les places individuelles étaient occupées. J’étais donc forcément dans un carré de quatre personnes, à moins que quelqu’un ait piqué ma place. Je jetai encore une fois un œil à mon billet pour me remémorer mon numéro de siège, et avançai à l’intérieur du wagon. Une fois devant ma place, je m’apprêtai à prendre ma sacoche contenant mon ordinateur et ma tablette pour pouvoir travailler le temps du trajet. Mais finalement, non. Je n’avais pas envie de travailler, j’aurais mes soirées en solo à l’hôtel pour pondre ces fameuses illustrations de jazz. J’avais envie d’écouter de la musique. Je posai donc ma valise et ma sacoche quelques mètres plus loin dans un espace à bagages, ne gardai que mon sac à main et allai m’asseoir. Dans le carré de quatre places où j’étais censée m’installer, une seule était occupée. Il s’agissait d’un homme grisonnant et corpulent, assis côté fenêtre, en train de lire un magazine de sports mécaniques. Normalement, je devais m’asseoir en face de lui. Mais nous aurions passé tout le trajet à faire en sorte que nos jambes ne se touchent pas, et ça aurait été très pénible. Les autres places du carré étant inoccupées, je décidai donc de m’installer dans sa diagonale, côté couloir. Quand je fus assise, il leva les yeux vers moi et fit un petit mouvement de tête en guise de salutation, sans prononcer un mot. Je répondis avec un petit « bonjour » tout juste audible pour ne pas perturber le calme qui régnait dans le wagon. Pendant que je prenais mes écouteurs pour les brancher sur mon téléphone, l’homme regarda vite fait la table qui se trouvait entre lui et moi afin de s’assurer que ses affaires n’empiétaient pas sur mon espace. Sa pile de magazines débordait légèrement sur le côté couloir. Alors qu’il s’apprêtait à les déplacer vers lui, je lui fis un signe de la main accompagné d’une petite moue bienveillante pour lui faire comprendre que ses magazines ne me gênaient pas du tout, et qu’il n’était pas nécessaire de les déplacer. Encore une fois, il me fit un signe de la tête en guise de remerciement, sans prononcer un mot, puis replongea dans sa lecture. Je mis les écouteurs dans mes oreilles, lançai ma playlist, et me réjouis à l’idée de passer deux heures et demi dans un siège de première classe, à écouter mes chansons préférées tout en contemplant le paysage. Un moment tout simple, qui avait pourtant quelque chose de magique, tant ça me changeait de mon quotidien. J’adorais cette ambiance, ce wagon tout calme et silencieux, peuplé de personnes qui ne se connaissaient pas et ne se reverrais plus jamais. J’avais toujours été un peu fascinée par tous ces gens que l’on croise un jour dans le train, dans le métro, au restaurant, au cinéma… Toutes ces personnes à côté de qui on passe tout au long de sa vie sans jamais vraiment se rencontrer, avec qui on a comme seul point commun le fait d’avoir été au même endroit, au même moment. Voilà. J’étais confortablement assise, ma musique dans les oreilles, heureuse d’avoir pris l’initiative de passer trois jours seule, loin de la maison, et espérant que cette escapade allait m’apporter au moins un début de réponse à toutes les questions que je me posais. Puisque je regardais en direction de la fenêtre, mes yeux se posaient machinalement et à de nombreuses reprises sur mon voisin de voyage. Le magazine qu’il lisait était en anglais. Je compris alors que son mutisme à mon égard ne venait pas forcément d’une envie de respecter le silence du wagon, mais tout simplement du fait qu’il ne parlait peut-être pas un mot de français. Il ne prêtait pas du tout attention à moi, plongé dans sa lecture. Du coup, sans pouvoir m’en empêcher, je l’observais. Et la raison était simple : depuis que nos regards s’étaient croisés, j’avais la certitude de l’avoir déjà vu quelque part. Et en même temps, il me semblait étranger. Ou alors, peut-être qu’il me rappelait simplement quelqu’un ? Je lui donnais une cinquantaine d’années. Il avait des cheveux poivre et sel coupés courts, et un teint très mat. Des yeux noirs, un large front, les rides d’un quinquagénaire, et d’épaisses joues qui allaient avec son surpoids. Rasé de près, une dentition d’une blancheur dont j’étais follement jalouse, il avait un regard très doux, mais fatigué. Il respirait la gentillesse. Pourtant, sa corpulence en faisait le genre de gars qu’on imaginait bien faire des ravages dans une mêlée de rugby, ou sur un ring de boxe. Il portait une chemise à manches courtes très classique, à fines rayures verticales. En regardant à côté de moi vers le sol, j’apercevais une paire de baskets noires d’une marque connue et le bas d’un jean bleu. Alors qu’il tournait sa page, il leva brièvement les yeux vers moi, se sentant probablement observé. Nos regards se croisèrent encore, le temps d’un instant, et cela suffit à me conforter dans l’idée qu’il ne m’était pas totalement étranger. Je réalisai qu’il allait peut-être falloir que j’arrête de l’observer, sinon il risquerait de s’imaginer des trucs. C’était pénible. Je me trouvais partagée entre la certitude de croiser cet homme pour la première fois de ma vie, et la sensation de le connaître depuis longtemps. Alors qui était-il ? Nos regards se croisèrent une nouvelle fois quelques minutes plus tard quand il voulut quitter sa place pour se rendre au wagon-restaurant. Il se déplaça d’abord tout doucement sur le siège situé en face de moi tout en veillant à ne pas me marcher sur les pieds. Par réflexe, je repliai immédiatement mes jambes sous mon siège. - Merci, marmonna-t-il d’une voix grave. Je lui souris. Il se leva en s’aidant des montants des sièges, pour être certain de ne pas perdre l’équilibre. Je le vis se déplier douloureusement, ce qui laissait supposer qu’il était assis depuis longtemps et avait dû monter dans le train au tout début du trajet, sur la Côte d’Azur. Alors que mon regard s’était déjà redirigé vers la fenêtre, l’homme, debout à côté de moi, tapota sur mon épaule du bout de son index. J’ôtai un écouteur pour être sûre de l’entendre. - Pardon. Mon français… difficile, dit-il en grimaçant avec un accent américain très reconnaissable. Je vais… café. Vous voulez ? Café ? Grâce à mon travail, j’avais un bon niveau d’anglais et pouvais soutenir une conversation sans difficulté. Je lui répondis donc dans sa langue maternelle, ce qui le fit immédiatement sourire. - Non merci. J’ai déjà ce qu’il me faut, déclarai-je gentiment en lui montrant la gourde de thé qui dépassait de mon sac à main. Mais c’est très gentil de votre part. - Ok. Il quitta le wagon. Je remis mon écouteur et réallongeai mes jambes en attendant qu’il revienne. Un quinquagénaire Américain, seul, dans un train reliant Toulon à Paris. Tout en écoutant ma playlist, je continuais de chercher pourquoi j’avais la sensation de le connaître. Mais rien ne me venait à l’esprit. J’avais eu l’occasion de travailler avec des Américains à plusieurs reprises, mais pas avec ce type-là. J’en étais sûre. Ça ne venait pas du boulot. Quelques minutes plus tard, je vis dans le reflet de la porte vitrée du fond du wagon que la porte opposée située derrière moi venait de s’ouvrir et que l’homme regagnait notre carré, son café à la main. Plus loin dans le wagon, je vis alors un couple de trentenaires chuchoter discrètement tout en dévisageant l’Américain. Bon. Je n’étais visiblement pas la seule à cogiter. Ça ne faisait plus aucun doute : ce type était connu. Mais pour quelle raison ? Lorsqu’il arriva à ma hauteur, je repliai mes jambes pour le laisser s’installer, sans lever les yeux vers lui. Quand il fut assis, je vis qu’il tendait quelque chose dans ma direction. - Tenez, c’est pour accompagner le thé. Il venait de s’exprimer en anglais, et me tendait un sachet de noix et graines. Par politesse, je retirai une nouvelle fois mes écouteurs et saisis le sachet en le remerciant, alors que j’avais encore mon petit déjeuner sur l’estomac, et donc pas du tout faim. - Vous avez l’air de bien parler anglais, ajouta-t-il, alors si ça ne vous dérange pas, je crois que je ne vais plus faire d’efforts. Le français, c’est beaucoup trop compliqué. - Je confirme. Même pour un Français pure-souche, le français est compliqué. Il ouvrit un sachet de noix et graines identique à celui qu’il m’avait rapporté du wagon-restaurant, et leva son gobelet de café en ma direction, comme pour porter un toast. Je m’empressai donc d’attraper ma gourde de thé pour l’imiter. Nous trinquâmes discrètement. Je me sentis obligée de l’accompagner dans cette petite pause grignotage, et ouvris donc mon sachet après avoir avalé une gorgée de thé. Il mastiqua quelques noix en soupirant, puis déglutit avec un air désespéré. Il faisait presque peine à voir. - D’habitude je craque pour les cacahuètes au chocolat, mais pour des raisons évidentes, il faut que je m’habitue à calmer mes envies de sucre avec ce genre de choses. Ce n’est pas facile. - Je suis de tout cœur avec vous, répondis-je entre deux noix. J’ai traîné un surpoids pendant des années, je pensais que je ne m’en sortirais jamais. Et un beau jour, j’ai réussi à franchir le cap d’arrêter le sucre. J’ai perdu mes kilos en quelques mois et je ne les ai jamais repris. Au début c’est difficile. Mais le sucre, c’est une drogue. Et comme toutes les drogues, le sevrage doit se faire en douceur, et avec beaucoup de volonté. Vous devez vous accrocher. - C’est exactement ce que me dit mon médecin. J’essaye de diminuer ma consommation de sucre, mais je crois que je pars de très loin. - Il faut commencer par des choses simples et concrètes. Par exemple, moi, le premier truc que j’ai fait, c’est arrêter de manger des desserts le midi et le soir. Je me rassasie avec le plat principal, et je m’arrête là. - Vraiment ? Pas de dessert ? Non, c’est trop dur. Et c’est trop triste. - Au début, oui, confirmai-je avec empathie. C’est même carrément horrible. Si vous avez vraiment du mal à vous passer de dessert, l’astuce c’est de vous autoriser un carré de chocolat noir avec le café. C’est d’ailleurs pour ça que dans les restaurants, quand vous commandez un café, on vous le sert presque toujours avec un petit carré de chocolat, ou quelque chose dans le genre. C’est pour vous apporter la petite touche de sucre qui fait du bien au moral. Mais quand on a beaucoup de poids à perdre, arrêter les sucres rapides ajoutés, c’est vraiment la clé. C’est pour votre santé, tout ça. C’est très important, si vous voulez vivre longtemps. Donc voilà, à partir de maintenant, plus de desserts. Juste un café, ou un thé, avec le petit carré de chocolat noir. Et pas de sucre dans le café, évidemment. - J’ai du mal à croire que vous ayez été en surpoids. Vous avez l’air mince. - Aujourd’hui, oui. Mais croyez-moi, je n’ai pas toujours été comme ça. Accrochez-vous. C’est dur, mais ça vaut vraiment le coup. - Ok. Et après le sevrage du sucre, quelle est la prochaine étape ? - Le sport, évidemment. Mais là c’est pareil, ne vous en faites pas toute une montagne. Les gens s’imaginent que pour garder la ligne, il faut faire des heures et des heures de sport par semaine. C’est faux. Il suffit d’avoir une activité régulière, avec une intensité qui vous correspond. Et encore une fois, tout est une question de motivation. Il y a bien des choses qui doivent vous motiver, non ? - La tête déconfite de mon médecin devant mes analyses de sang, ou quand je monte sur la balance, ça fait tellement mal à voir que ça pourrait être une très bonne motivation. C’est moi qui suis aux portes de l’obésité, et c’est à lui que ça a l’air de faire le plus de peine. Au fur et à mesure qu’il me parlait avec sa voix grave si apaisante, j’observais cette bouille carrée toute douce et me sentais plus que jamais convaincue que je me trouvais assise face à une star Américaine. Ou une ancienne star Américaine ? Je crevais d’envie de lui poser la question frontalement, mais si jamais je me trompais, j’aurais l’air ridicule et le reste du voyage me semblerait bien long. En tout cas, il était vraiment adorable. C’était dingue, cette douceur qui émanait d’un tel colosse. - Sérieusement, continua-t-il, je me demande parfois comment j’ai pu en arriver là. Et en même temps, la réponse est évidente. J’ai arrêté de fumer il y a dix ans et j’ai compensé avec la nourriture. Je mange n’importe comment, j’ai arrêté le sport il y a des années, je suis souvent invité à des soirées où l’alcool coule à flots et j’ai du mal à résister… Mon surpoids me déprime, et quand je suis déprimé, j’ai envie de manger. - Eh bien c’est un schéma très classique, tout ça. Et le fait d’en être conscient, c’est déjà un excellent point. Donc voilà. Le hasard de la vie a fait que je me suis assise en face de vous aujourd’hui, et que j’ai réussi à me sortir d’une situation dans laquelle vous vous sentez coincé. C’est un signe ! C’est le signe qu’aujourd’hui, ça y est, vous êtes résolu à vous débarrasser de votre surpoids, parce que vous avez rencontré une fille qui l’a fait, et que si elle en a été capable, vous en êtes capable. En montant dans ce train, vous ne saviez pas que votre vie allait changer. Alors voilà, c’est fait. À partir de maintenant, vous êtes le gars qui ne prend plus de dessert, qui ne boit plus d’alcool, et qui fait quelques minutes de sport tous les jours. Tout ça grâce à un voyage en train. La vie est quand même surprenante. Il se mit à rire. Et j’eus immédiatement un flash. Le flash que j’attendais depuis que je m’étais assise en face de lui.
90
« Dernier message par Apogon le jeu. 02/12/2021 à 16:37 »
Je contrôle la situation de Maritza Jaillet Lien d'achat : Bookelis AmazonTW (avertissement) :
Dans cet ouvrage sera évoqué : la grossophobie, la perte de poids, troubles alimentaires, anorexie, le rapport à son corps, la dépression, le harcèlement, l’anxiété, les crises d’angoisse.Cette œuvre est fictive, et même si elle est inspirée librement de faits réels, toute ressemblance serait fortuite. Certains éléments sont, pour des raisons évidentes, différents. 1 « Six semaines avant mon anniversaire, Noël. » Je ne suis pas égoïste, alors je vais plutôt indiquer la fête des cadeaux et pour l’étalage de mes états d’âme, inscrire dans ce carnet la date du 13 novembre 2021. Arf, maudit stylo ! Il n’a pas résisté à la pression. C’est la première fois que j’entame un journal, si on excepte celui que j’ai entrepris à mon septième anniversaire. Et celui que j’ai démarré pendant ma période d’ado rebelle. Ah oui, qui a fini brûlé avec mes cahiers dans un magnifique feu de joie. Depuis le temps, y a prescription ! Par quoi je commence ? Mes résolutions de l’année 2022 ? Bien trop tôt, et puis, comme tous les ans, je ne les suivrai pas. La liste des cadeaux ? Pourquoi pas, cela me changera du tableau Excel à actualiser chaque fois que j’aurai déniché la perle rare pour faire plaisir à un proche. Toutefois, dans l’émission que j’ai vue hier soir – c’était soit ce truc soit me replonger dans une lecture pas très excitante –, le but de l’écriture est de graver sur un support le changement qu’on souhaite opérer sur soi. Écrire pour aider à la réalisation d’un objectif. Dans mon cas, de changer. Un besoin de renouveau. La raison a déjà été avancée par ma famille, mes amis et mon médecin traitant comme étant la crise de la trentaine. Je n’ai pas encore trente ans. Enfin, si, bientôt, dans six semaines. Et si on prend en compte le développement du fœtus… Ma migraine va repartir à ce rythme ! Où j’en suis ? J’ai eu le malheur d’être expulsée de l’utérus de ma mère le 25 décembre au matin. De son côté, elle me répète année après année que c’est merveilleux, son plus beau cadeau, sa fierté… Du mien, c’est plutôt une déception enfermée dans une boucle temporelle qui revient au même point, chaque année. Prisonnière d’un cercle vicieux qui ne cessera qu’à ma mort. Oui, ce n’est pas très joyeux et visiblement des pensées noires me hantent encore… Bref. Mon père est, quant à lui, ravi depuis le premier jour de ce hasard calendaire puisqu’il peut assouvir en grand sa passion pour la pâtisserie : faire trois gâteaux au lieu d’un. Un pour mon anniversaire, un pour Noël et un pour ceux qui ont encore un petit creux ou qui n’aiment pas les deux premiers. C’est un pâtissier à la retraite qui a toujours le coup de main pour ruiner vos derniers efforts sportifs avant les fêtes. Ma mère travaille cependant, son boulot est tellement épuisant et compliqué que j’en bâille, rien qu’en me demandant comment elle peut faire la même chose depuis quarante ans. Néanmoins, elle arrive à poser des congés pour son « meilleur jour de l’année ». Est-ce que quelqu’un me demanderait mon avis ? Tant pis. Quant au reste de ma famille, cela demeure somme toute classique. On dit souvent que l’aîné est un terrain d’essai et que le cru s’améliore année après année. Affirmation démontrée. J’ai une cadette, Bérénice qui a deux ans de moins et qui est une comédienne mondialement connue et reconnue. Elle a réussi. Faut-il que je précise que sa vie à elle est parfaite ? Comme le souhaitaient mes parents dans leurs rêves les plus fous, elle s’est mariée à un beau jeune homme – mannequin pour des défilés de mode et des publicités –, a eu deux enfants sublimes qui parlent déjà trois langues, et voyage dans le monde entier. Elle vit entre Osaka et Seattle, se pose parfois à Londres ou Berlin quand elle ne succombe pas au charme de Vienne. Je l’envie, je la jalouse, mais cette remarque, je dois la garder pour moi. Finalement, je les étale mes états d’âme sur ce papier ivoire. Pour finir, il y a la dernière, Éléonore, encore à l’université. Enfant chérie et choyée par mes parents, elle habite à Grenade, en Espagne pour ses études d’interprétariat. De temps à autre, elle est aussi influenceuse sur les réseaux sociaux. Impeccable jusqu’au bout des ongles, elle n’a jamais eu de problèmes de peau ou de poids. Elle peut s’enfiler un pot de nocciolata en live sur Instagram sans en mettre sur son rouge à lèvres et garder ses dents blanches en toute circonstance. Mon cadre familial posé, je dois m’attaquer au cercle amical. Ce sera vite réglé. La plupart de mes amis ont coupé les ponts avec moi au moment de mon entrée en fac ou quand j’ai décidé de les trier sur Facebook . J’en avais assez de faire le premier pas à chaque fois et d’être là, à chaque fois qu’ils en avaient besoin alors que je pouvais aller me brosser dès que j’essayais de les joindre. Il me reste une amie, que je me risque à appeler « ma meilleure amie », Kate, qui vit à Los Angeles depuis deux ans et que je vois beaucoup moins qu’avant. J’ai un meilleur pote, Timothé, dit Tim. Toutes ces lignes devraient être suffisantes. Dans le doute, je relis les notes que j’ai prises la veille sur un brouillon qui traîne sur le meuble télé. À l’arrache, j’ai écrit « Soi, Famille, Amis, Amours et Travail. » Pour ma part, les informations me concernant sont déjà assez étalées. Pas besoin de rajouter de confiture. Je déteste mon prénom, Uranie, et mon visage sans être vilain reste quelconque. Mes cheveux bruns se raidissent une heure après le brushing de la coiffeuse et certaines mèches mi-longues dissimulent mes yeux dont l’iris change en fonction de la lumière. Sur mon passeport c’est indiqué yeux noisette, mais parfois, ils tirent plus sur le cacao. Passons à l’étape suivante. La famille, les amis, c’est déjà fait. Les amours seront encore plus rapides dans la mesure où je suis célibataire. Bon, cela ne veut pas dire que je ne pense pas à un homme en ce moment précis, seulement, ce n’est pas réciproque. Du moins, plus maintenant. Et puisqu’il a annoncé ses fiançailles récemment, je peux le supprimer de mon esprit. Cependant, pas de mon compte Facebook. Si mon subconscient le veut bien et arrête de m’envoyer des images de lui à poil, dansant sur une musique stupide dès que je ferme mes paupières. Garder autant de souvenirs de son ex c’est se laisser plomber par les angoisses, et dérangeant, non ? Pour ma santé mentale ? Pour mon cœur d’artichaut ? Je dois l’oublier. Cependant, le prochain cercle concerne la carrière. Et « lui » se rapporte au travail. Il s’appelle Thomas, c’est le maire de la ville qui ne remplit pas forcément tous mes critères – quelle idée d’en avoir autant ! –, mais qui est adorable au quotidien. C’est un ami du lycée avec qui je m’entends bien et on est sortis ensemble un bon moment. Mon cœur en palpite encore. Je pourrais écrire sur lui pendant des heures… Or, mon téléphone me rappelle que je devrais déjà être partie depuis dix minutes. J’ai un petit creux et il reste un dernier carré de chocolat subsistant seul dans son emballage. Pince tes bourrelets Uranie, pince tes bourrelets et ne cède pas à la tentation ! Je n’y résiste pas malgré l’important petit-déjeuner que j’ai avalé vingt minutes auparavant. Un petit écart signifie vingt squats supplémentaires. N’empêche que cette énergie délivrée par ce petit plaisir est nécessaire. Un véritable un coup de fouet avant de descendre à pied les quatre étages me séparant du parking souterrain de la résidence. J’entends partout que les escaliers c’est bon pour les fessiers seulement, j’attends toujours de voir le résultat. Légende urbaine. Je croise la gardienne qui a déjà commencé le nettoyage des marches, et j’évite le plus possible de faire des traces avec mes chaussures. Sa tâche est assez difficile, pas besoin que j’en rajoute. À peine installée dans ma voiture, le bip de la porte du garage entre deux doigts, ma mère essaye de me joindre. Évidemment, mon kit mains libres s’est enroulé autour de mon trousseau de clés au fond de mon sac… Appel manqué, à une seconde près ! Intérieurement, je rage. Elle laisse un message, que je ne prends pas le temps d’écouter, et je lui téléphone illico. — Oui ? Maman ? — Uranie ? Je t’appelais pour organiser le repas de Noël et… Je n’entends pas la fin de sa phrase à cause des couinements de cette porte métallique des années quatre-vingt. Heureusement que le syndicat a dit qu’il s’en chargerait. — Uranie ? poursuit-elle. Tu préfères un déjeuner léger pour le 24 ou on mange comme d’habitude ? Sachant que le « comme d’habitude » chez mes parents signifie pour quinze personnes et le « léger » l’extrême inverse, soit juste une salade verte, j’hésite… — Tu peux faire entre les deux ? Un plat normal avec tous les groupes de nutriments qu’il faut… — Va pour la salade verte alors. Je me demande encore pourquoi ma mère sollicite mon avis si finalement, elle a déjà choisi. C’est ainsi. Elle ne changera jamais. Je m’apprête à raccrocher, ne prononçant plus aucun mot, mais elle n’a pas terminé. — Et tu as réfléchi à ton cadeau ? Trente ans, ça se fête ! Je te rappelle qu’à ton âge… — Tu étais mariée, tu avais déjà tes premiers enfants et reçu deux promotions au boulot, je sais Mam. Je te laisse, je m’engage sur l’autoroute. Je lui raccroche au nez. Comportement un peu brutal, je l’admets. De toute façon, elle ne m’en voudra pas et j’ai besoin d’être concentrée pour me faufiler dans la chenille , pile devant une voiture, qui n’avance pas aussi vite que les autres dans les bouchons. Technique d’observation imparable. Une fois insérée dans cette queue qui durerait d’après mon application GPS une bonne vingtaine de minutes, je peux allumer la radio et me tenir au courant du monde. Même si, à bien y réfléchir, on entend toujours des actualités similaires jour après jour : des politiciens véreux, des journalistes cherchant à redorer leur profession, des invités qui ont du mal à cacher au micro leur ennui, la guerre aux quatre coins du monde et le changement climatique. Vivement qu’il soit huit heures et trois minutes pour obtenir un peu de douceur auditive. À l’exception des klaxons enclenchés par ceux qui n’ont toujours pas compris que leur action n’aiderait pas la file à avancer, je suis sereine, je respire et me prépare psychologiquement à une nouvelle journée de travail à la Médiathèque. Réunions, archivages, plannings, courriers… Je reçois un SMS de mon ami et maire Thomas, qui m’annonce l’annulation de notre déjeuner ensemble. Il a trop d’affaires à régler. Dommage, mais je comprends et lui renvoie un petit message de soutien. C’est alors que je vois une berline noire foncer à vive allure dans le rétroviseur. Le conducteur croit être plus malin que tout le monde en passant par la bande d’arrêt d’urgence et ainsi grappiller des places dans la file. — Encore un sans-gêne, beuillon va ! m’écrié-je alors que ma réaction ne sert pas à grand-chose puisqu’il ne m’entendra pas. Je déteste les gens qui agissent de la sorte. Sans être à cheval sur les règles du bien-vivre en société, quelqu’un qui cherche par tous les moyens à nous la mettre à l’envers, je lui attribue tous les honneurs de l’idiot. En revanche, je dois reconnaître qu’en l’absence de flics ou de caméras, l’énergumène arrivera à l’heure quand moi, je vais devoir m’excuser auprès de la directrice. L’A450 est toujours bouchée, elle le sait, toutefois, elle est aussi informée qu’il suffit de partir avant sept heures et demie pour faire les trente bornes en vingt minutes et pas en une heure. Mea culpa pour aujourd’hui ! J’ai essayé une fois. Cependant, c’est déprimant d’arriver au boulot la première, de devoir allumer toutes les lumières, de saluer les agents d’entretien terminant leur travail et d’avoir un demi-café dans la machine qui met du temps à démarrer. Non, plus jamais. Mon téléphone sonne. Sans grande surprise, Stéphanie, ma supérieure, m’appelle. — Salut ! Êtes-vous bientôt là ? J’ai un avocat qui a pris rendez-vous pour des recherches et j’aurais aimé que vous l’aidiez. J’entends très bien, au ton qu’elle emploie, qu’un refus de ma part serait mal venu. Or, je suis bloquée. — Je suis encore dans les embouteillages, j’en ai bien pour une demi-heure. Aurélie peut, peut-être s’en charger ? Évidemment qu’Aurélie peut s’en charger, ai-je besoin de le préciser ? C’est une stagiaire, qui connaît les moindres recoins de la médiathèque, à force d’accepter toutes les basses besognes. Pourtant, elle rêve de responsabilités. — Je vais voir avec elle. Bonne route ! La moquerie qui accompagne cet encouragement ne m’atteint pas. Mon téléphone vibre. Bon sang, ils se sont donné le mot ? Un SMS de mon père qui râle du fait que j’ai « choisi » de manger léger le 24 au midi et parce que je ne veux rien de spécial pour mon anniversaire le lendemain. Comme tous les ans, je n’ai aucune idée. Même si je vais avoir trente ans, cela ne changera pas le fait que le jour durant lequel je suis censée profiter à fond de la vie soit le jour de la remise des cadeaux de la famille. Comme si j’y peux quelque chose ! Puisque la circulation reprend, le portable retrouve sa place dans le sac. Un jeu stupide passe à la radio. Le journaliste prend un prénom au hasard dans son dictionnaire et le premier auditeur qui appelle remporte la somme de cinq cents euros. Je trouve cela absurde, surtout parce que je ne pourrais jamais gagner. Oui, je suis mauvaise joueuse seulement… Est-ce que mon prénom est au moins dans un dictionnaire ? Pas sûre. Quand mes parents m’ont affublé d’« Uranie », les sages-femmes ont dû hésiter à l’inscrire. Ma mère adore les personnages dans les pièces de théâtre, tandis que mon paternel voue un culte à l’astronomie. Devinez lequel a gagné ? En même temps, être prénommée Uranus n’aurait pas été cool à l’école. Toutefois, certaines planètes ou satellites ont des appellations vraiment transcendantes. Je me serais bien vue en Jupiter ou Io. — Et aujourd’hui ce sera Gaspard. Est-ce qu’un Gaspard peut joindre notre standard ? Gaspard. C’est le chat de ma voisine. Peut-être que si je les appelle en miaulant ? Ahah, je me marre toute seule. Reprends-toi Uranie ! Ça ne marchera jamais ! Dommage. Enfin, j’arrive sur le parking réservé aux personnels et m’aperçois avec stupeur qu’un véhicule est garé à ma place. Ok, mon nom n’est pas clairement indiqué avec un écriteau comme celui de Monsieur le maire et ses élus. Or, l’emplacement du milieu à côté de ce petit banc en bois face à la porte de la médiathèque, c’est la mienne. Cinq ans que je me gare dessus, tous les matins, et chacun sait que cette place, c’est pour ma titine. Je furète à droite, à gauche, rageant dans le vent. Mes mains serrent le volant au point que mes ongles blanchissent. Il faut bien que je reconnaisse, au bout de trente secondes d’agacement, que personne ne bougera cette berline noire de marque allemande qui ressemble d’ailleurs à celle appartenant au beuillon sur l’autoroute. Celui qui se croit plus malin que les autres. Je me retiens d’agir par instinct. S’énerver ne résout pas le problème. Je sers le service public et en tant qu’assistante de direction, je me dois de donner l’exemple et je ne vais certainement pas prendre la place réservée aux personnes souffrant d’un handicap. Ce sera le parking gratuit à cinquante mètres. L’air de rien l’écart de ce matin peut encore s’annuler avec les pas supplémentaires. Maudite montre compteuse de calories que j’ai encore oublié de charger ! Avant de franchir le seuil de l’établissement, je me permets de faire un détour par cette Golf assez quelconque. Pas de châssis sport ni de jantes m’as-tu-vu, pas de vitres teintées, une plaque avec les deux chiffres du département, pas de siège auto à l’arrière et aucun objet de valeur visible depuis l’extérieur. Étrange. Tout est à sa place, aucun mouchoir qui traîne ni ticket de caisse ou encore une bouteille d’eau compressée, coincée derrière un siège. Elle appartient donc soit à ma mère, peu probable, soit à une personne célibataire et maniaque, qui a décidé de gâcher ma journée. Troisième option : un véhicule de location ? Je regarde l’heure sur mon téléphone : je suis vraiment à la bourre. Accélérant mon allure, je me dépêche de poser mes affaires, de filer aux toilettes pour être tranquille pour la matinée, et de récupérer le courrier destiné à la direction que je dois trier. Mon corps s’essouffle vite, un point de côté ne va pas tarder à apparaître. Mince. En plus, je ne vois ni Stéphanie ni Aurélie. L’une est sûrement à une réunion organisée à la dernière minute, tandis que l’autre doit gérer le premier usager de la journée. Maintenant que je suis assise avec ces lettres à décacheter, je peux discrètement ouvrir le premier tiroir de mon bureau et m’enfiler un arlequin. Le grignotage c’est mal, mais sentir ce goût de banane qui descend dans ma gorge est plus excitant qu’un biscuit aux avoines ou même des graines. Biscuits que Stéphanie pose à l’instant sous mon nez. — Encore en retard ! Zut. Moins de cinq secondes pour réagir. — Bonjour, Stéphanie ! Comment allez-vous aujourd’hui ? Elle remonte sa paire de grosses lunettes avec son index et hausse les épaules comme si je suis un cas désespéré. — Bon, souffle-t-elle en constatant le bonbon collé à ma joue. Y a quoi dans le courrier ? Le courrier. Vite. Je n’ai ouvert que cinq enveloppes et lu en diagonale deux d’entre elles. — Gérard confirme la réunion pour le plan Neige de cet hiver, on a une excuse de Monsieur Dorier pour les livres empruntés qu’il n’a pas rendus à temps et encore une demande de permis de construire qui doit aller au service urbanisme. — Les gens n’ont toujours pas compris que ce n’était pas la mairie ici. Enfin, vous devriez manger ça plutôt que de vous goinfrer de bonbons. Ce n’est pas très bon pour la ligne et je vous rappelle que vous êtes la première personne qu’ils voient. Elle n’a pas tort. J’en ai pris compte dans mes résolutions de l’année dernière, et des autres avant également, de perdre dix kilos avant mes trente ans seulement, je n’ai pas tenu quinze jours. Pourtant, je me suis fixé ce petit objectif dans l’espoir de l’atteindre, mais mon envie de sucre est plus forte que tout. — Sinon, y a une nouvelle salle de sport qui a ouverte rue François Darcieux à la place du taudis abandonné, déclare-t-elle en sortant de sa poche un flyer qui semble être passé par la case machine à laver. Je la remercie pour cette délicate attention signifiant qu’à ses yeux je suis définitivement obèse. Sur ce point, le corps médical lui donnerait sûrement raison. Je peux enfin souffler la voyant repartir dans sa tour d’ivoire, un bureau vitré situé en mezzanine. De là-haut, elle doit avoir un point d’observation magnifique sur la rangée livres fiction et le rayon adolescent. Je n’ai jamais eu l’occasion d’aller dans son bureau depuis les travaux. À vrai dire, en ai-je vraiment envie ? Je branche le téléphone et à peine deux secondes plus tard, je suis tenue de traiter ma première affaire de la journée. Les minutes passent, l’ennui s’installe vite et j’ai ce maudit flyer presque en charpies devant mes yeux. Par curiosité, je cherche sur le web et découvre un site aux couleurs chatoyantes. Rien à voir avec l’image que je m’en faisais. Les derniers sur lesquels je suis tombée ressemblent soit à un descriptif pour un hôpital psychiatrique soit à une salle de torture où toutes les couleurs sont permises avec des spots, faisant fuir les épileptiques. Un petit regard sur les entraîneurs et je m’empresse de sortir mon téléphone pour appeler mon meilleur ami. À cette heure-ci, il doit être en pause. Il commence à quatre heures cette semaine. — Tim ? Désolée de te déranger pendant ton breakfast italien, mais ça te dirait de venir tester une salle de sport avec moi, ce soir ? — Sans façon, je vais être crevé et ma mère voudra que je me couche tôt ! Ah ! Timothé ou le Tanguy comme je l’appelle. Vivant encore chez ses parents, à qui il n’a toujours pas avoué pourquoi il ne ramène jamais de petites copines, et toujours peu motivé quand il s’agit de se bouger. Il continue de converser, mais je n’ai pas dit mon dernier mot. — Tu comprends qu’en ce moment j’ai d’autres projets et… — Ils offrent une séance gratuite avec un coach qui compte plus de tablettes de chocolat que mon tiroir peut en contenir. — Mouais, se lamente-t-il dans le combiné. — Tu ne veux quand même pas que j’y aille seule ? — Ce n’est pas parce que ton meilleur ami est gay qu’il va t’accompagner juste pour persister dans ce cliché dé… — Il possède un master nutrition-sciences des aliments. J’imagine l’expression de son visage au moment où je ne l’entends plus respirer. — Va pour 18 h 30, tu m’envoies l’adresse par SMS ? — Qu’est-ce qu’il y a à 18 h 30 ? Cette voix suave me fait sursauter. Il m’espionne comme toujours et mon cœur manque un battement. Ma transpiration augmente. Il ne peut pas s’en empêcher, mais cela signifie sûrement qu’il ne peut pas se passer de moi, ou alors qu’il a un rendez-vous avec Stéphanie et qu’il vient de voir mon écran… Sur lequel se dessine une sublime salle de sport colorée répondant au doux nom de « Magenta ». — Bonjour, Monsieur le maire, expédié-je avant de raccrocher avec Tim. 2 — Uranie, appelle-moi Thomas je t’en prie. Tu disais donc 18 h 30 ? — Avec Tim on prévoit d’aller se bouger un peu et on découvrira du coup la nouvelle salle qui vient d’ouvrir à deux rues d’ici. — Je vais m’y rendre également. Une collègue m’en a parlé et j’ai un ami qui doit reprendre sa vie en main. On se voit là-bas ? Bigre. Manquait plus que ça. Allez, réagis ! Mon ex va me découvrir dégoulinante de sueur et souffrir au premier exercice venu. Je peux au moins soigner mon apparence. Tout s’accélère dans mon cerveau. Je dois absolument, pendant ma pause déjeuner, filer dans les magasins et trouver une tenue de sport qui ne soit pas trouée ou délavée. J’ai besoin d’être un minimum présentable si je le vois, surtout s’il n’est pas seul. Et puis zut, je n’ai pas à me prendre la tête, est-ce qu’il se malaxe les synapses, lui ? Sans être un mannequin ou un coach du Magenta, il ne se rue pas sur les pâtisseries d’en face ou des bonbons dissimulés dans un tiroir. Thomas est très grand, au point qu’il pourrait servir de repère pour les mètres Carrez. Ce châtain aux yeux bleus rend folles la plupart des femmes depuis le jardin d’enfants. Notre histoire aurait pu être magnifique, malheureusement je suis idiote. Et une idiote fait des conneries ! Le passé, c’est le passé. Il repart avant même que je lui réponde, mais il connaît déjà ma décision. Je me remets au travail. Stéphanie a organisé un après-midi jeux-vidéos éducatifs dans deux semaines et, pour l’instant, aucun enfant n’est inscrit. La publicité doit être renforcée sur les réseaux sociaux et je vais demander à Aurélie de poster une affiche sur l’une de nos nombreuses baies vitrées. Une tâche à accomplir. Je vérifie aussi l’agenda numérique de Thomas, en ligne sur le site de la mairie. Il n’y a pas de raison que je ne l’espionne pas comme il le fait. Qu’indique l’emploi du temps de Monsieur le maire ? Il a divers rendez-vous, entre la ville, la métropole, le prolongement de la ligne de métro, les rencontres avec les particuliers, les sorties pour se montrer proche de la population… Le temps défile. Des livres arrivent sur un chariot et passent devant moi. La stagiaire a visiblement terminé son rendez-vous puisqu’elle s’occupe du retour des bouquins. — Ah salut ! Je ne t’ai pas vue ce matin, raille-t-elle avec un grand sourire. Tu ne manges pas, aujourd’hui ? Je regarde mon téléphone et effectivement, je devrais être en pause depuis au moins cinq minutes. Elle me raconte son début de journée, je dois avouer que je ne suis pas très attentive. J’ai la tête ailleurs. Entre le travail, mon anniversaire, une amie qui désire me voir juste parce que je lui sers de bouche-trou… Cela ne m’empêche pas de l’admirer. Elle est jeune, brune, mais elle se teint souvent en blonde, des dents aussi blanches qu’en sortant d’un détartrage et un rouge à lèvres sublime. Comment fait-elle pour ne pas s’en mettre partout ? Je me le demande. Elle me souhaite un bon appétit et je m’apprête à quitter mon bureau quand je vois qu’elle range le meilleur roman de Jane Austen, à mon sens, Orgueil et Préjugés. — Attends ! J’adore ce livre, je vais le lire après manger et le replacer. — Ok pas de problème ! Tant que tu le rentres dans le fichier ! Pourquoi cet ouvrage ? Je ne sais pas. Parfois, j’ai des envies sans vraiment comprendre. Je ne lui propose pas de manger avec moi, elle a toujours son sandwich thon-crudités qu’elle déguste dans la petite cafétéria au rez-de-chaussée, seule avec son casque sur les oreilles. En sortant, je me précipite vers le foodtruck de la place de la poste pour ne pas avoir à faire la queue. Le timing est très important. À midi quinze vous en avez pour dix minutes à tout casser. À midi vingt et une, vous avez une file de dix mètres qui va jusqu’à la Banque populaire près de l’arrêt de bus, trente mètres plus loin. Avec l’habitude, tout se rationalise et le temps de travail reste efficace ! Je me dépêche, j’avale ce hot-dog bien trop salé à mon goût et mes frites en quelques minutes, avant de foncer dans un magasin de sport. Situation ironique quand j’y pense. Mes fringues sentent la friture et mon apparence évoquera aux vendeurs ma visite récente d’un fast-food. Alors que dans les faits, pas vraiment. Une seule heure pour manger, même en centre-ville, c’est rapide. En revenant vers la médiathèque, je m’aperçois que « ma » place est de nouveau libre. Super ! Cependant, j’ai la flemme de bouger ma voiture, maintenant. Je ne suis pas du signe astrologique Balance néanmoins, je peux parfois être contradictoire envers moi-même. Vivement ce soir que je me défoule un peu. « 18 h 25. Je suis toujours en avance, car à l’heure ce n’est plus l’heure. » Non, ça c’est nul. Je barre cette phrase de mon carnet. Ce n’est pas ainsi que je vais franchir le seuil de la trentaine. « 18 h 26. J’attends Tanguy, toujours en retard. » Bon, dans les faits, il ne l’est pas vraiment. Je suis juste impatiente. Et très motivée. Je le vois courir depuis l’arrêt de bus. Il a aussi eu le temps de se changer, de se laver. Finalement, lequel de nous deux possède la plus grande motivation ? Il sent encore le gel douche et s’agite comme un enfant devant les attractions de Disneyland. Il tique pourtant sur ma tenue. — Pourquoi t’as acheté de nouvelles fringues ? Je croyais que tu étais contre les achats compulsifs non nécessaires à ta survie ? — Thomas va passer ! — Et ? insiste-t-il avec son regard inquisiteur. Tu es encore sur lui ? Uranie, tu vas fêter tes trente ans et tu cours après ton amour de lycée, qui a duré quoi une… — Arrête, c’est bon. Oui et puis, toi, tu as tourné facilement la page Axel évidemment, tu ne viens pas t’amuser ici… On se fait la tête une seconde avant de rire stupidement. Le gérant nous accueille enfin. — Première séance ? — Affirmatif, répond Tim rapidement, sans me laisser le temps d’ouvrir la bouche. — Vous aviez réservé un coach ou c’est juste pour tester ? Il nous interroge, mais il a le planning de ses employés sous le nez. À croire qu’il nous prend pour des imbéciles. Ou alors il veut vérifier. — On a opté pour Laurent. Il a l’air super, non ? — En effet, c’est bien ça ! Vous avez les vestiaires hommes à votre gauche et ceux des femmes sur la droite, bonne séance ! Je dois arrêter de juger les gens trop vite, seulement j’ai du mal à ne pas cocher mes cases préétablies dans mon cerveau. Par exemple, dans le vestiaire, je reconnais tout de suite la bavarde, celle qui vient juste pour discuter avec sa copine et qui n’a pas la moindre envie de chauffer d’autres muscles. Elle souffre déjà des zygomatiques, ses baskets sont comme neuves et elle n’utilise sa bouteille d’eau que pour hydrater de nouveau sa bouche. La rousse aux cheveux magnifiquement bouclés a visiblement passé plus de temps devant son miroir à se coiffer qu’elle n’en dépensera sur un tapis de course ; sûrement une fille qui cherche à se rapprocher physiquement d’un coach. Quant à celle qui s’est enfermée à double tour dans une cabine, et qui supplie sa mère de ne pas sortir, est certainement une pauvre jeune adolescente en obésité morbide qui a peur du regard des autres et des insultes grossophobes. À juste titre. — Allez les filles ! À Magenta on bouge son gras ! hurle la rousse avant de mettre son débardeur « coach » en place avec son prénom. Une espionne dans les vestiaires. Évidemment, j’aurais dû me méfier. Leur slogan me paraît déplacé, mais je vais éviter de me faire remarquer en lançant un scandale. Elle fait sortir de la cabine une adolescente qui, en réalité est loin d’être obèse et me salue avant de partir. Je suis une vraie buse. En même temps, j’aurais pu tracer tout droit vers les salles de cours collectifs. Or, ma curiosité m’a poussé à aller fouiner. Heureusement, nous n’avons pas choisi Audrey, mais Laurent. Laurent ou le stéréotype du coach sportif qui se nourrit tous les matins avec son muesli de flocons d’avoine, d’amandes, de fruits et d’un jus vert à l’aloe vera épinard… Berk ! sans oublier les œufs crus dans le shaker avec de la poudre. Potentiellement flexitarien ou végétarien qui mange du tofu à chaque repas. Je tiendrai presque les paris. Il est brun aux yeux noirs, abonné aux carrés. Carré d’épaule, carré de mâchoire et carrés de chocolat sur tout le corps. Tout ce qu’aime Tim sans oser le clamer. — Hé ! me chuchote-t-il. Mate-moi ce fessier ! — T’as déjà oublié qu’en plus d’être beau, il a fait des études ? — Je craque d’avance. Je vais transpirer pour lui et l’inviter à boire un verre. Samedi, ça me paraît bien. On a prévu un film seulement, je sais qu’il ne répond plus de rien. Dire qu’au lycée la timidité l’envahissait et il bégayait dès qu’il ouvrait la bouche ! Au moins, lui a changé ! Bon sang ! Il ne manque plus que la playlist d’Ariana Grande pour que je fuie cet endroit. Heureusement – ou malheureusement –, pour moi, pas de musique pour le moment. Laurent se présente et nous demande ce que l’on recherche. Performance, perte de poids, défi personnel… J’ai presque envie de répondre tout, mais c’est surtout le désir de me reprendre en main qui m’a amené ici. En tout cas, il devra commencer doucement, ma dernière séance de gym s’étant terminée au bout de cinq minutes à cause de douleurs insupportables. Mon meilleur ami déclare qu’il vise la performance et me désigne avec son index. Qu’est-ce qu’il cherche à faire comprendre, exactement ? Je sens que je regrette de l’avoir pris en accompagnateur… Le coach nous montre les machines – de tortures – sur lesquelles on va travailler et en moins d’une minute, on démarre les échauffements. J’ai presque envie de lever la main et de demander plus d’explications sur les appareils pour que cela entame sur le temps alloué. Un peu comme à l’école. J’admets qu’en plus des douleurs aux bras, j’ai un manque profond de motivation à cet instant. Voilà que Laurent allume des enceintes… la musique Thank U Next de la diva préférée de Tim. Je peux quitter ce monde en restant persuadée que je juge correctement les gens. Vingt d’joux ! L’EPS me paraît si loin ! Je râlais quand Madame Poulet – oui elle se nomme vraiment ainsi –, nous demandait de faire le tour du lac puis trente pompes, mais en fait c’était un ange comparé à ce démon qui ne transpire même pas. Il ne peut pas être humain. Laurent est un extraterrestre, c’est sûr ! À bout de souffle, je m’écarte un peu et les laisse faire connaissance. Tim est tellement à fond qu’il demande à courir sur un tapis ! Lui ? Sur un tapis ! Notre amie Kate n’en reviendra pas quand je l’appellerai ! Ou mieux, je devrais le filmer ! En parlant d’elle, je vais lui écrire un petit message sur Messenger. Avec le décalage horaire, je ne sais jamais si c’est le matin ou le soir pour elle, mais au moins, elle aura la possibilité de le voir. Je lance la caméra et filme le plus discrètement possible mon meilleur ami qui s’attaque à des haltères après dix minutes de footing. À moins que ce soient les haltères qui se frottent à lui, j’hésite. Kate va pester quand elle va savoir qu’elle a loupé un tel épisode ! Tiens, les deux bavardes que j’ai étiquetées comme telles conversent sur leurs conquêtes respectives. Elles parlent tellement fort que c’est comme si je fais partie de leurs causeries. Je n’aime pas les gens qui se vantent, encore moins quand l’une d’elles crache sur son ex-petit ami trop étouffant. Simple question de point de vue. Un homme qui envoie deux messages par jour, je trouve cela mignon et touchant. Ces inconnues n’ont définitivement pas les mêmes valeurs que moi. Leurs anecdotes demeurent amusantes et divertissantes, cependant, moins que Tim s’entraînant à la corde à sauter. Je me moque, seulement je reste bien assise sur un pouf à le regarder. Le coach essaye bien de me motiver à reprendre les exercices, change la musique et se dit prêt à m’écouter, comme si j’avais besoin d’un autre psy. Toutefois, je n’ai pas envie. Ou plutôt, je n’ai plus l’envie. Je sens déjà la sueur, mon legging me colle et mes cuisses me grattent. C’est définitif, je suis allergique au sport. Je traîne sur Facebook en désespoir de cause quand mon meilleur ami fait un détour vers moi, entre deux tortures. — Je crois que j’ai un crush ! Génial et prévisible. Tim a donc le béguin pour Laurent. J’espère pour lui que ce sera réciproque, c’est souvent trop beau pour être vrai. Et puis, avec un tel corps, mon meilleur ami sera fréquemment jaloux, voudra vérifier son téléphone chaque seconde et inspecter le moindre de ses faits et gestes envers les clientes potentielles. Sortir avec un coach sportif est une très mauvaise idée. Pire que de ressortir avec son ex ? Faut que je réfléchisse. Et que j’arrête de juger. En attendant, Thomas doit passer et je ne l’ai toujours pas croisé. Un petit regard vers l’un des nombreux cours collectifs me confirme qu’il ne s’est pas converti au Yoga ni à la danse. Les autres salles disposent des vitres occultantes. Quelle frustration pour la commère que je suis ! Je pousse délicatement les portes et constate qu’il ne participe pas au Tai-chi, ni à la gymnastique. Bon sang ! L’attente me paraît interminable. Je me demande bien ce qu’il fait, mais je me vois mal lui envoyer un SMS en mode « Coucou t’es où ? je t’attends ! », ce serait inapproprié. Et puis je sens la transpiration. Mon carnet ! « Penser à prendre du déodorant doublé d’un anti-transpirant. » En même temps, vais-je retourner dans cette salle de sport ? — Hey, salut ! Je crois que j’ai renversé le pouf par terre en me levant comme une brute. — Salut Thomas ! Est-ce que ça va ? — Oui seulement mon ami n’est pas encore arrivé, il a du mal à se garer. — Ah ! nous on est venus en bus, on s’est un peu douté que ça allait être galère dans cette rue avec les travaux et… Stop. Je vais partir dans une discussion sans intérêt. Je dois me ressaisir. Qu’est-ce que tu fais ma grande ? Au bûcher les banalités, passons les préliminaires et… ! — Et sinon, poursuis-je tout en finesse, tu commences sur quelle machine ? — Après mes échauffements, je vais faire un peu de renforcement musculaire, puis de la muscu au niveau des épaules je suis trop mou et je finirai par du cardio. J’étais dans une salle à Bron avant, mais d’ici avec mon emploi du temps serré, c’était trop speed. — Je t’accompagne si tu veux. Je ne contrôle plus ma bouche. Faites-moi taire ! Me voilà à quatre pattes sur le lino à faire des burpees, une espèce de chenille des squats et de l’escalade sans bouger d’un tapis de sol. J’en peux plus. Comment mes muscles font pour ne pas déjà craquer ? D’ailleurs, c’est craquable ? Après tout, on peut bien se les claquer… J’abandonne avec un sourire, prétextant une envie de boire un coup. D’un côté, ce n’est pas un mensonge, j’ai vraiment soif. D’un autre, une minute de plus et je m’étale sans ne plus pouvoir me relever, jamais. Je fais un signe vers Tim, seulement il est bien trop occupé pour faire attention à moi. Mince. J’ai les jambes qui flageolent, des points noirs qui apparaissent devant mes yeux. C’est sûr, je fais une crise d’hypoglycémie. Et dire que j’ai oublié de remettre des bonbons dans ma poche de sac à main. Premier objectif : trouver les vestiaires. Manger. Me doucher. Attendre mon meilleur ami dehors. Il ne reste plus qu’un petit quart d’heure de séance gratuite. Je dois me dépêcher sous peine de m’allonger un peu n’importe comment sur ce lino. Autant éviter la honte… Je n’ai pas envie de faire un malaise devant tout ce monde, trop humiliant. Tout aussi dégradant que de tomber à la renverse sur une plaque de verglas. Ne pas parler de verglas, je vais me porter la poisse et les températures vont chuter cette nuit juste pour m’embêter. Bon allez, vestiaire droite, douches… — Oh ! Je crois que je viens de foncer dans quelque chose d’humide et chaud. Dans quelle situation tu t’es encore fourrée ? Je lève à peine la tête et me rends compte, malgré moi, que je me suis trompée de vestiaire. Quelle buse ! Si à l’entrée c’est à droite, cela signifie à gauche en quittant la salle principale, et donc j’ai foncé dans… Double buse ! — Pardon, avoué-je au milieu d’une horde de mâles dont une partie seulement est habillée. L’autre moitié demeure dénudée, dont celui qui sort visiblement de sa douche et qui me fixe d’un regard méprisant. Dommage, il a de beaux yeux noirs. C’est comme si un corbeau me guettait dans l’attente de mes mouvements. Je l’observe en quelques secondes me forçant à garder la tête haute. Grand, peut-être un mètre quatre-vingt-dix un peu plus que Thomas, je dirais. Ce n’est pas un apollon loin de là, mais je ne refuse pas les petites poignées d’amour. Est-ce vraiment le moment de songer à en faire son quatre heures ? Après tout, toute l’assemblée reste stoïque… Or, j’ai l’impression qu’il est énervé. Ses yeux plissés, la tension instantanée de ses… muscles. Il me demande de sortir en haussant le ton. Comme si je l’ai fait exprès ! Tout le monde peut se tromper ! En entrant dans le vestiaire – le bon une fois n’est pas coutume –, je me fais de nouveau reprendre à l’ordre par le gérant. Message reçu. Un peu sainte ni touche ici. Je n’ai rien vu, du moins rien de punissable. En quittant la salle, je m’excuse une nouvelle fois au comptoir même si j’aurais bien voulu m’attarder avec l’intéressé. Thomas apparaît et se dirige vers le distributeur. Barre protéinée, boisson énergisante ? Je lui fais signe et constate qu’il opte pour des biscuits secs. — Tu pars déjà ? — Oui, avec Tim on a fini notre séance d’essai. — Ok. Tu reviendras ? me demande-t-il en affichant un grand sourire. — Oui ! Non ! — C’est cool ! Tu vas voir ça va t’occuper, te changer, tu auras une autre vision de toi-même dans quelques semaines. Semaines. Si j’avais une baguette magique, je me transformerais là tout de suite et je… ne pas dire du mal d’autrui ! Il me faudrait le corps d’Aurélie, avec la poitrine magnifique de Kate, le visage de ma starlette de sœur et le cerveau de mon père. Ah j’oubliais, les jambes de la benjamine ! Voilà, c’est possible ? Je ferme les yeux, les rouvre, rien n’a changé. Tim vient de prendre une douche, il dégouline de partout, mais est pressé de sortir pour me raconter tout ce qu’il s’est dit entre lui et Larou. Oui, il a déjà un surnom assez proche d’un autre chanteur favori de mon meilleur ami. Je laisse Thomas repartir dans la salle collective sans même lui demander si son ami est finalement arrivé. Triple buse, je suis ! Entre deux arrêts, Tanguy me propose un restaurant pour éviter de se retrouver en tête à tête avec ses parents. Je refuse. Mon prochain défi va être de perdre du poids avant Noël, avant mon trentième anniversaire et je pourrai être fière de moi. C’est vrai, je n’aurai pas à reporter une énième fois cette résolution pour 2022.
 Sujets récents
Sujets récents
|





 Messages récents
Messages récents
 Moi qui croyais lui faire plaisir ! Si seulement Papa était là … »
Moi qui croyais lui faire plaisir ! Si seulement Papa était là … »