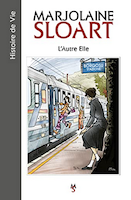Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
61
« Dernier message par Apogon le mar. 09/08/2022 à 13:07 »
62
« Dernier message par marie08 le mar. 09/08/2022 à 09:50 »
Pour avoir lu presque tous les romans de Anne-Marie Bougret, (un seul manque à ma liste) dont le prequel de ce thriller : L’invitation, que j’ai adoré, j’étais certaine de ne pas être déçue. C’est donc avec un grand plaisir que j’ai retrouvé la plume fluide et dynamique de cette auteure. Avec ce thriller, Anne-Marie nous entraîne dans un road-trip haletant à travers les USA. Le couple Stephen et leur fille Stessie mènent une vie sans histoire, jusqu’au jour où Stephen, le mari est assassiné. Dès lors, Vanessa, sa femme, et sa petite fille sont entraînées dans une course poursuite jalonnée de cadavres. Intrigues, complots et meurtres sont au programme de ce roman dont les rebondissements sont aussi nombreux que surprenants. Arrivera-t-elle à se sauver avec sa fille ? Vous ne le saurez qu’en lisant cet excellent roman que je vous recommande vivement. Merci Anne-Marie pour m’avoir fait haleter. Et bravo pour ce roman. https://www.amazon.fr/Dossier-explosif-Mme-Anne-Marie-Bougret/dp/B0B4HRSXH6/ref=sr_1_1?crid=25GBTGX1UCKDY&keywords=un+dossier+explosif&qid=1660031260&sprefix=un+dossier%2Caps%2C959&sr=8-1
63
« Dernier message par marie08 le mar. 09/08/2022 à 09:44 »
Avec ce roman, je découvre la plume de Mélodie Miller. Une plume fluide, tendre et franche. L’histoire se situe entre la romance et le feel-good, avec une palette de personnages haut en couleurs. Et tous sont attachants, chacun à sa manière. Nous faisons connaissance avec Manon, une jeune femme de 28 ans, célibataire, dont la meilleure amie se nomme Claire. Elle traîne derrière elle un passé familial douloureux qu’elle nous dévoilera au fil des pages. Obligée de partir à Ibiza pour son travail, elle va devoir cohabiter avec trois personnes, Arturo, le fils du patron, Mattéo, un latin lover dans toute sa splendeur, et Jeanne, une graphiste. Trois êtres totalement différent les uns des autres, dont nous apprendrons peu à peu leurs secrets. L’auteure nous fait également voyager entre la superbe villa et les différents lieux d’Ibiza. C’est un véritable dépaysement. En un mot, si vous voulez oublier votre quotidien et prendre un bol d’air et de soleil, libérez la licorne qui est en vous et partez avec elle pour Ibiza. C’est vraiment un roman que je recommande. Merci Mélodie Miller pour m’avoir fait passer un merveilleux moment. https://www.amazon.fr/nest-jamais-trop-lib%C3%A9rer-licornes/dp/B0B2TY7H8T/ref=sr_1_1?crid=14EFPIWU49HNF&keywords=il+n%27est+jamais+trop+tard+pour+lib%C3%A9rer+les+licornes&qid=1660031053&sprefix=il+n%27est+jamais+%2Caps%2C878&sr=8-1
64
« Dernier message par Antalmos le lun. 08/08/2022 à 20:24 »
John Stephen, architecte new-yorkais, mène une vie sans histoires avec sa femme, Vanessa, et leur fille Stessie, jusqu'au jour où il découvre que son associé, Brandon, lui cache des choses. Est-ce pour cette raison que John est retrouvé peu après mort, assassiné ? Comprenant que sa vie aussi est menacée, Vanessa se lance avec sa fille dans une course poursuite, à travers les États-Unis, sur une route jalonnée de cadavres et de rencontres. Mais à qui peut-elle vraiment faire confiance ?
Un dossier explosif, dont le titre à lui tout seul annonce déjà la couleur, fait partie de ces romans que j'ai dévorés très vite, tant par la qualité d'écriture, fluide et maîtrisée de l'autrice, que par la densité d'événements et de rebondissements qui se succèdent et qui donnent envie de tourner les pages au plus vite pour connaître la suite. Car Anne-Marie Bougret a fait le choix d'aller droit à l'essentiel, sans lourdeurs. Les événements s'enchaînent à une telle vitesse qu'il devient dés lors difficile de lâcher le livre.
En résumé, je recommande ce roman avec lequel j'ai passé un très bon moment de lecture et qui réunit tous les ingrédients du genre avec son lot de trahisons, magouilles, meurtres et d'actions, et qui m'a donné très envie de découvrir le prequel de ce livre : L'invitation.
65
Résumé :
Meghan Grayford, une jeune journaliste passionnée par l'exploration de lieux abandonnés, a localisé un vieux manoir dans la forêt de Brocéliande : ses occupants semblent avoir fui précipitamment…
En se faufilant dans cette bâtisse isolée, Meghan ignore encore que son histoire n'est pas peuplée de magie et de fées, mais d'horreur et de sang…
La nuit, quand tout est calme, le Manoir Brocélia se réveille…
La nuit, quand tout est calme, les atrocités de son passé reprennent vie…
La curiosité est un vilain défaut… Meghan aurait mieux fait de s'en souvenir…
Un thriller aussi terrifiant que captivant, dans la lignée des investigations paranormales d'Alan Lambin. Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance, et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième fort énigmatique. Jeune journaliste travaillant pour Insolite, journal spécialisé dans les phénomènes paranormaux, Meghan Grayford doit écrire à tout prix un article accrocheur pour contenter son patron pointilleux et souvent intransigeant ; elle décide alors de se mettre en quête d'un scoop destiné à le satisfaire. Se souvenant d’un vieux manoir situé dans la forêt de Brocéliande qu’elle avait visité il y a quelques temps en grande passionnée d’Urbex (l'exploration de lieux abandonnés ), Meghan décide sur un coup de tête de jeter son dévolu sur cette étrange bâtisse. Accompagnés de cette pétillante journaliste au tempérament curieux et plutôt casse-cou, nous allons pénétrer dans ces lieux forts mystérieux et mener l’enquête à ses côtés. Ces quelques lignes posées, le ton est donné ; les questions affolent notre esprit cartésien. Vu le côté inquiétant, est-il vraiment souhaitable d’entrer dans cette demeure, d’y glisser un orteil intrusif, de déranger ses nombreux occupants pour déterrer leurs histoires ? C’est mal connaître Meghan. Toujours en quête de sensationnel, se targuant d’être une habituée de ces environnements peu communs, elle ne va pas réfléchir bien longtemps, et va balayer le danger d’un revers de main. Mais une fois sur place, comme pour confirmer nos ressentis, les choses ne se passent pas comme prévu. Très vite, Meghan s'aperçoit que les derniers résidants de la bâtisse semblent l'avoir quittée de manière précipitée. Pourquoi ? Que s’est-il passé ? Quelles sont les raisons qui les ont poussés à partir ? Quels secrets peuvent bien cacher ces anciens habitants ? Le roman à peine entamé, nous voici entraînés, plongés, absorbés au cœur d’une histoire perturbante et glaçante, où vont se mêler vieilles légendes et activités paranormales. En effet, Brocélia semble dissimuler en son cœur des meurtres, suicides et autres joyeusetés. Des manifestations inquiétantes vont se succéder ; de surprenantes apparitions vont se produire, mais la journaliste malgré le danger omniprésent, va vouloir persister dans son entreprise. Aidée d'Alan Lambin, un spécialiste des phénomènes étranges rencontré dans certains opus précédents, elle n’aura de cesse de découvrir le passé mystérieux de ce manoir, quitte à se mettre en danger, à prendre de multiples risques, autant pour elle que pour ses amis Pour autant, Meghan est loin de se douter de toutes les atrocités qu'elle va rencontrer. Ne dit-on pas que la curiosité est un vilain défaut ? La jeune femme va malheureusement l'apprendre à ses dépens… Toutefois, malgré une intrigue rondement menée et une histoire captivante, quelques écueils ont gêné la fluidité de ma lecture. En effet, j’ai été par moments déroutée par le comportement de notre personnage principal, qui, là où le plus raisonnable des mortels aurait temporisé, voire déguerpi vu la multitude d’éléments surnaturels qui se succèdent, Meghan, elle, n’a pas pris la poudre d’escampette, s’est au contraire obstinée dans ses investigations, rendant son comportement parfois inconcevable, ou plus simplement tiré par les cheveux. De plus, j’ai eu la curieuse sensation que l’épilogue était incroyablement long si on le compare au rythme soutenu insufflé durant le reste du récit. Même ressenti concernant la dernière partie pourtant essentielle afin de clôturer définitivement l'enquête ; elle arrive un peu tard, engendrant une impression de lenteur, et gâchant malencontreusement l’homogénéité du roman. Chose d’autant plus dommageable que la plume de l’auteur est agréable, tantôt visuelle et précise, tantôt nerveuse, et addictive ; les pages se tournent à toute allure. Tout comme notre protagoniste, malgré la peur qui s'instille au fil de la lecture, révélant nos frayeurs les plus primaires, nous voulons savoir, comprendre quelles souffrances intérieures animent cette bâtisse. Et donc, que cache Brocélia et ses habitants? Je ne vous en dirai pas plus, à vous d’être curieux, et de venir comme moi pousser la porte de cette demeure ^^ Vous l’aurez compris, malgré les quelques bémols sus-cités, j’ai particulièrement apprécié cette histoire pleine de rebondissements inattendus. Une seule envie maintenant : après la découverte de ce super auteur, se plonger dans ses autres ouvrages dès que possible  Alors, si vous aimez les maisons hantées, le surnaturel et les sensations fortes où l'horreur côtoie le fantastique, ce roman est fait pour vous ; dépaysement et frissons garantis  Ma note : Ma note :      
Pour vous le procurer : Éditions Taurnada Amazon Réseaux sociaux : Twitter Facebook
66
« Dernier message par Apogon le jeu. 04/08/2022 à 17:42 »
L'Autre Elle de Marjolaine Sloart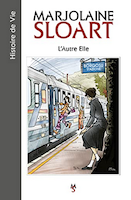 Pour l'acheter : AmazonChapitre 1 Il y a certains amours dans la vie qui bouleversent la tête, les sens, l’esprit et le cœur ; il y en a parmi tous un seul qui ne trouble pas, qui pénètre, et celui-là ne meurt qu’avec l’être dans lequel il a pris racine.Alfred de Musset La journée s’annonçait belle, Clara s’était levée, comme d’habitude, aux aurores. Le café fumant trônait sur la gazinière. Le pain frais sur la table, tout semblait prêt pour que ses trois hommes puissent prendre le petit-déjeuner. Son mari n’allait pas tarder. Avant de quitter la maison, elle irait réveiller ses deux garçons, Mattéo et Gianni. Elle devait se dépêcher, les clients de l’épicerie avaient leur habitude et elle aimait quand tout était rangé avant leur venue. Elle ordonnait la nourriture et toutes les viennoiseries dans les rayons ainsi que les produits laitiers, les légumes seraient livrés à une heure plus avancée. Tout ce qui attendait derrière la devanture de son magasin nécessitait d’être mis en place pour 7 h. Son premier fidèle client s’appelait Alberto, c’était l’employé communal de Borgosu, un village de 1500 habitants se situant à l’intérieur des terres, en Sicile, c’était un vieux garçon, gentil et serviable. Tous les matins, il passait en coup de vent acheter une baguette, ensuite arrivait Mme Di Lila, mariée, sans enfant, elle raffolait des croissants fourrés aux amandes, tout comme son mari. Puis entrait Mlle Sofia, la secrétaire du notaire au coin de la rue, elle n’était pas fiancée, toujours en quête de son âme sœur, elle commandait trois pains au chocolat, trois croissants et une madeleine. Les clients détenaient leurs habitudes et elle, les siennes. Elle s’y était accoutumée depuis plus de vingt ans qu’elle tenait son épicerie. Elle incarnait une personne discrète, de bonne écoute, les paroles étaient entendues, mais ne ressortaient pas de son magasin. Clara était appréciée pour cette qualité inestimable. Tous les jours se déroulait le même rituel, tout nécessitait la perfection afin de ne pas endurer les remontrances de son époux. Il faut reconnaître qu’il n’était pas commode. Claudio demeurait rustre et autoritaire avec elle. Elle le subissait depuis de nombreuses années. Lorsqu’elle l’avait rencontré il y a une vingtaine d’années, il semblait charmant et prévenant, pourtant à peine lui avait-il mis la bague au doigt que les problèmes débutèrent. Cela se passait dans les années soixante-dix, ils habitaient dans la campagne à une demi-heure de Catane, à cette époque-là, les femmes étaient soumises et les hommes commandaient, cela paraissait normal. Au fil du temps, le caractère bien trempé de son mari l’avait muselée. Elle finit par en avoir peur et elle le craignit. Devant les gens, il semblait gentil, mais une fois le dos tourné, il devenait despote. Il ne lui restait plus de famille, ses parents, à leur mort, lui avaient légué la seule épicerie du bourg qu’elle reprit sans se poser de questions. Cela représentait son refuge et elle y passait la plupart de son temps. Souvent, Clara fuyait la maison prétextant quelques affaires à régler, des comptes à faire, des étagères à organiser. Son mari la laissait s’y rendre, pour autant qu’il n’en subisse aucune conséquence. Il n’avait jamais brandi la main sur elle, mais ses paroles aiguisées lui léguaient de béantes blessures, devenues des cicatrices. Petit à petit, son travail de dévalorisation avait fait son chemin et elle se sentait de plus en plus comme une moins que rien. Deux garçons naquirent de cette union, Mattéo, dix-neuf ans et Gianni, seize. Élevés par leur grand-mère paternelle tandis que Clara s’occupait de son commerce. Ceci expliquait pourquoi ils ne la considéraient pas plus que cela, surtout Mattéo son aîné. Avec Gianni, elle semblait plus proche, peut-être parce qu’il lui ressemblait. À la maison, Mattéo avait à peu près la même attitude que son père. En y regardant de plus près, elle était la bonne à tout faire et elle acceptait la situation sans broncher bien que cela ne la rendait pas heureuse. Dans ce village rural où il fallait travailler dur pour s’en sortir, les états d’âme n’avaient que peu de place. Seul le travail comptait, rapporter de l’argent chez soi pour montrer aux autres que l’on savait faire mieux qu’eux. Cette mentalité était bien ancrée et Clara poursuivait sa vie sans trop de réflexions, tout cela lui semblait normal. Dans son ignorance, elle supposait que c’était partout ainsi. Ses journées étaient interminables, entre l’épicerie qui l’accaparait du matin au soir, les repas, le ménage et les lessives, elle n’avait jamais une seconde pour elle. Elle travaillait d’arrache-pied et le dimanche après-midi elle soufflait, seul moment pendant lequel son mari et ses garçons s’absentaient pour aller au village d’à côté voir des matchs de football pendant la saison chaude ou traîner au bar de Borgosu en hiver. Elle profitait durant ces quelques heures de répit pour rencontrer quelques amies et manger une glace ou boire un café. Les rares sorties de Borgosu se résumaient à quelques concerts donnés à gauche à droite dans la région. Son époux était membre de la fanfare locale et une à deux fois par année, ils partaient en excursion afin qu’il se produise avec son groupe musical. Ses enfants suivaient les traces de leur père au même degré que bien des jeunes des villages aux alentours. Mattéo jouait du trombone tandis que Gianni sonnait de la trompette comme son papa et était de surcroît très doué. Mis à part ces quelques sorties éphémères, ils ne quittaient jamais leur région, les vacances, c’était pour les autres, ainsi, l’épicerie restait ouverte presque toute l’année sauf les jours fériés, ce qui revenait à dire que Clara ne fermait celle-ci qu’une dizaine de jours par an. Les veilles de fête, elle engageait toujours une aide, pour satisfaire rapidement tous les clients, il fallait être efficace. En principe, elle placardait un encart sur sa vitrine et elle n’avait jamais de problème à trouver une personne dévouée pour l’épauler. Le travail était répétitif, son employée passait la majeure partie de ses journées à servir les antipastis, deux cents grammes de jambon cuit par ci, trois cents grammes de jambon de parme par-là, de la salade russe, des poivrons farcis, etc., c’était une occupation qui laissait peu de temps à la conversation. Il fallait contenter tout le monde et il n’était pas rare qu’une queue s’installe sur le trottoir. Pendant ce temps, les discussions allaient bon train. Ces moments festifs, les gens les appréciaient. Afin de ne froisser personne, elle donnait la possibilité à chacun de venir œuvrer avec elle, mais en définitive elle engageait toujours la même personne, une femme d’une cinquantaine d’années, elle l’avait formée et depuis elle maîtrisait la machine à trancheuse, ce qui était important durant ces périodes de forte affluence. Malheureusement, Simona ne pourrait être là cette année. Tombée d’un escabeau alors qu’elle tentait de décrocher un rideau, elle s’était cassé le bras. Bien entendu, Clara connaissait tous les habitants et quand une tête nouvelle se présentait, elle aimait savoir d’où elle arrivait. C’était le mois de mars et elle venait de coller une affiche pour engager un extra en prévision des fêtes de Pâques. Il ne s’était pas passé une demi-journée lorsqu’elle entendit le grelot de la porte tandis qu’elle était installée derrière son comptoir. Elle leva le nez du catalogue qu’elle consultait et elle se trouva en face d’une personne étrangère. La femme qu’elle dévisageait devait avoir une trentaine d’années. Habillée d’un pantalon ocre avec des pattes d’éléphant, elle portait un chemisier jaune sur lequel des motifs de fleurs blanches étaient peints, ses cheveux coiffés en chignon, un foulard les égayait. Sur son long cou pendait un collier avec des perles en bois. Un agréable parfum l’entourait. Clara la trouva sublime. — Bonjour, je peux vous aider ? — J’ai vu votre pancarte, vous cherchez une vendeuse ? — Oui c’est bien cela. Elle lui tendit la main. — Je m’appelle Antonietta Mazzari, mais c’est Nietta pour les intimes, j’ai 31 ans, je suis la nièce du professeur Angelo. J’arrive de Milan. Je suis là pour quelques mois afin de m’occuper de mon vieil oncle, vous n’êtes certainement pas sans savoir que depuis son AVC, il a besoin de soutien. — Oui, j’en ai eu ouï-dire par sa voisine. D’emblée, Nietta lui plut, elle l’estima totalement décalée par rapport aux gens d’ici. Son modernisme étant frappant, Nietta l’époustoufla ! Malgré elle, elle ne pouvait que se comparer aux autres, elle portait une longue jupe plissée, un chemisier blanc, ses cheveux relevés en chignon lui donnaient un air austère et ses sandales n’avaient rien de sexy. Ce n’était pas ainsi qu’elle pouvait se mettre en valeur, elle devait bien le reconnaître. — J’ai déjà travaillé comme vendeuse dans un gros magasin au rayon alimentaire à Milan, je pourrais vous être d’une grande utilité si vous m’engagez. — Vous tombez alors à pic, Simona, qui normalement me fournit un coup de main durant les fêtes, s’est cassé le bras, j’ai donc besoin d’une personne qui maîtrise la trancheuse, pourriez-vous faire un essai ? — Oui, volontiers, quand voulez-vous que je commence ? — Demain, si cela va pour vous ? — Parfait, à quelle heure, dois-je être présente ? — Dix heures, je vous expliquerai ce que j’attends de vous et nous ferons le point en fin de journée. — Bien, à demain. Nietta s’était montrée d’emblée efficace, elle avait tout de suite constaté qu’elle maîtrisait parfaitement ce travail, son expérience allait lui être utile. C’était une bénédiction que de l’avoir au magasin. Les clients l’appréciaient, elle apportait de la fraîcheur et de l’originalité ce qui ne déplaisait pas à certains, en particulier à la gent masculine. Lorsque Clara rentra à la maison, son mari Claudio n’hésita pas à critiquer son choix. Sa chère mère étant passée dans la journée acheter des antipastis, elle n’avait pas manqué de s’épancher auprès de lui. Quelle vipère celle-là, pensa-t-elle ! — C’est qui cette nouvelle vendeuse ? — Elle s’appelle Nietta, c’est la nièce du professeur Angelo. — Et elle sort d’où ? — Elle arrive de Milan. — Ah ! Ceci explique cela. — Que veux-tu dire ? — Ben sa manière de s’habiller et son côté aguicheur. — Tant qu’elle effectue son travail et que les clients en sont contents, je ne vois pas le problème. — Certes, tu ne penses jamais à rien. Comme d’habitude, aucun esprit d’analyse et l’on observe le résultat ! Ça y est, ça allait recommencer. Elle n’avait aucune envie de partir dans ce genre de discussion, elle y mit fin, en prétextant qu’elle devait se rendre à la buanderie étendre du linge. Clara supportait de moins en moins cette manière de la dénigrer. Elle était certaine que sa belle-mère y était pour quelque chose. Elle ne pouvait s’empêcher de la critiquer. C’était toujours pareil, chaque fois qu’elle prenait une initiative, elle avait droit à des réflexions blessantes, ce n’était pas qu’elle s’y habituait, mais elle faisait avec. Nietta paraissait pourtant ravissante et pimpante, tout l’opposé de cette femme amère. Néanmoins son fils buvait ses paroles et ne voulait en aucun cas la contrarier, tout ce que sa mère disait était des propos d’une « Madone » et pour avoir la paix, Clara adoptait le parti de se taire afin de ne pas envenimer les rapports tendus entre elle et son mari. Alors, elle restait silencieuse la plupart du temps, elle subissait son existence. Étant sous le joug de son époux, son esprit d’analyse concernant bien des aspects de sa vie s’amenuisait de plus en plus. Il en était de même quand l’heure d’aller se coucher arrivait. Il utilisait son corps sans se préoccuper de ses envies, l’acte fort heureusement, ne durait pas. Il accomplissait sa petite affaire, se retournait et s’endormait en deux minutes la laissant à la limite des larmes. Elle se levait et elle faisait un détour par la salle de bains avant de se faire un lait chaud. Clara avait de la peine à comprendre que certaines filles parlaient de l’amour comme étant le Graal. Dans son épicerie, elle vendait des périodiques. Aux heures creuses, elle les dévorait. À ce qu’elle lisait, elle vivait dans une époque où les femmes revendiquaient des droits, elles étaient en pleine libération sexuelle. Clara réalisait que, dans son village, ils résidaient encore à des années-lumière de ce qui se déroulait dans les grandes agglomérations. Tout ce qu’elle apprenait lui semblait tellement lointain de ce qu’elle expérimentait avec son mari qu’elle peinait à croire ce qui se disait dans les magazines, elle pensait que les journalistes inventaient des histoires pour les vendre… Chapitre 2 Plusieurs mois s’écoulèrent depuis qu’elle avait engagé Nietta, son énergie, sa jeunesse et sa vision du monde l’avaient tout bonnement rendue indispensable. Afin de l’aider à s’intégrer, Clara la présenta à quelques amies du village. Toutes la trouvaient tellement exotique. Elle avait une dizaine d’années de moins que Clara, pourtant quand elle l’entendait parler de sa vie à Milan, elle donnait l’impression d’avoir mille ans. Un dimanche, alors que toutes ses copines se réunissaient pour manger une glace, Eleonora, la femme du boucher la questionna. — Nietta, comment cela se fait-il que tu ne sois pas encore mariée ? Si tu penses que je suis indiscrète, tu n’es pas obligée de me répondre. — Eh bien, j’ai eu un fiancé, Marco, mais je n’étais pas convaincue. Je l’ai rencontré sur les bancs de l’école et nous sommes restés ensemble pendant dix ans et puis je me suis lassée. Il était adorable, mais j’avais envie d’autre chose. Personne n’a compris mon choix, mais sincèrement, j’attendais autre chose de la vie. Nietta, une fois lancée, semblait difficile à arrêter. — Voyez-vous, je l’aimais comme un frère, il n’y avait plus de grand frisson quand j’étais avec lui, plus de papillons dans le ventre, tout était devenu d’une platitude… Je m’en suis rendu compte lorsque j’ai rencontré Luca. Lorsqu’elle énonça son nom, tout son être s’illumina. — Raconte, où l’as-tu connu ? — Au travail. Il était responsable des achats. Au début, je n’y ai pas prêté attention, mais lui m’a tout de suite remarquée. Chaque fois qu’il passait dans mon rayon, il me faisait un compliment. À certains moments, sur ma façon de m’habiller, d’autres fois, sur ma coiffure, mon maquillage, etc. Il avait toujours une parole gentille. De temps en temps, il m’apportait un cadeau, une rose, un chocolat. Il tissait sa toile comme une araignée et mes collègues ont bien tenté de m’avertir, pourtant je n’ai rien vu venir. — Et alors, que s’est-il passé ? Sandra s’impatienta tandis qu’elle pourléchait sa glace. — Je me suis laissé séduire. Il m’a invitée à boire un café et j’ai fini par accepter et là il m’a servi son baratin. Un expert en la matière. J’ai bu ses paroles. Je le trouvais tellement différent de Marco. C’est sûr, il savait y faire. Ce n’est que plus tard que j’ai réalisé qu’il utilisait sa technique bien rodée auprès de toutes les femmes qui l’intéressait. Leur curiosité était à son comble. — Et… — Et, il est advenu ce qui devait arriver. J’ai quitté Marco pour Luca. Notre relation a duré cinq mois. J’étais sur un petit nuage, de l’aube au crépuscule. Luca m’a appris à aimer, il m’a enseigné « l’Amour », il m’a fait découvrir toutes les zones érogènes de mon corps. Avec lui, le sexe ressemblait à un feu d’artifice et je ne m’en privais pas. Et puis, il y a eu une autre femme, une nouvelle employée qui travaillait au rayon des chaussures… Et comme nous n’étions pas sur le même étage, je n’ai rien vu ni su. C’est seulement quand il a souhaité rompre que je suis redescendue sur terre. Son doux visage s’assombrit, des larmes au coin de ses yeux leur firent réaliser qu’elle avait toujours cette histoire sur le cœur. Cela ne dura que l’espace d’un instant éphémère et elle sourit en se tamponnant les paupières. — Je ne regrette rien, juste un peu Luca, mais je vous rassure, on guérit vite lorsqu’on est trahie, ceci chassant cela. Sur le moment, j’étais anéantie tant la douleur était vive, le fait de travailler au même endroit et l’idée de le croiser au bras de l’autre greluche m’insupportaient. Elle soupira. — Je n’avais pas d’alternative. Rester digne et prendre sur moi étaient tout ce que j’avais à faire. Je me disais que tôt ou tard, la fille en question expérimenterait un chaos identique et bien que cela ne me réjouissait guère, je ressentais un peu de réconfort en imaginant cela et puis, j’avais des amies très convaincantes pour m’aider à démolir pièce après pièce ce que représentait Luca à mes yeux. Soit j’alimentais mon chagrin soit je le fuyais et j’ai décidé que pour ma propre survie, le mieux était de l’occulter. Je me suis mise en quête d’un nouveau loisir, une collègue cherchait une partenaire pour un garçon de son cours de Salsa, elle m’a proposé d’essayer et heureusement, j’y ai pris tout de suite goût. Clara l’interrogea. — De quoi s’agit-il ? — La salsa, signifie littéralement « Sauce » en espagnol, elle recoupe plus l’idée d’une danse apportant de la saveur, de la joie et de la force à la vie. Honnêtement, cela m’a libéré l’esprit. Mon partenaire était un excellent cavalier et j’ai appris les pas de salsa grâce à lui. Cela a été un bon début afin de m’éloigner des sentiments que j’éprouvais pour Luca. J’ai commencé par me rendre une fois par semaine au studio et puis deux et pour finir j’y allais même le week-end. Nietta prit Clara par la main et lui montra quelques mouvements de danse en la faisant virevolter dans la pièce. Toutes les femmes présentes se mirent à rire de bon cœur. — Mes chères amies, il se fait tard, il est presque 18 h, je dois partir. Nous continuerons cette discussion, n’est-ce pas Nietta ? — Mais bien entendu. Clara embrassa ses amies et se dépêcha de rentrer. Borgosu était une petite bourgade, y demeurait un peu plus de deux mille personnes. Dans sa rue principale, le quidam trouvait tous les commerces nécessaires pour y subsister. Une boulangerie tenue par Pépé, un commerce d’électricité, une bijouterie, une boucherie, un poissonnier : lui, venait exclusivement les fins de semaine pour vendre sa pêche, un cordonnier, une papeterie, un magasin de journaux qui faisait office de librairie, une banque, une pharmacie, une droguerie, un fleuriste, une mercerie avec quelques habits à la mode du coin (donc pas d’actualité), une boutique de vêtements pour hommes, une quincaillerie, un glacier, un bar, un restaurant et au bout de l’allée, l’épicerie de Clara. Il y avait de quoi satisfaire tout le monde. Dans les rues adjacentes, on trouvait un mécanicien, la Poste, un carreleur, un lavoir. Les habitants disposaient quasiment de tout sous la main et ils n’avaient pas besoin de se rendre en ville. On pouvait aussi dénicher un médecin qui comme le curé était au courant de bien des choses inavouables. Résider dans une si petite communauté comportait des avantages, les gens se sentaient moins isolés, d’une certaine manière, chacun se montrait concerné par le malheur des autres. Tout le monde connaissait tout le monde et le dimanche la population se retrouvait la plupart du temps à l’église. Il restait plutôt difficile de vivre caché ou d’avoir des secrets, car tout se répandait et les nouvelles, bonnes comme mauvaises, étaient révélées à la vitesse du vent. Clara habitait à la sortie du village, elle mettait une dizaine de minutes pour rentrer chez elle depuis son épicerie. Elle avait l’habitude de marcher et de faire le trajet plusieurs fois par semaine. À midi, la plupart du temps, elle se rendait chez sa belle-mère qui concoctait le déjeuner pour toute sa famille. Cela l’arrangeait bien, car elle était libérée d’une corvée supplémentaire et cela faisait l’affaire de son mari qui trouvait que sa maman préparait mieux à manger qu’elle. Sa belle-mère habitait proche du magasin, c’était également pour cela qu’elle passait tous les jours chercher des vivres. Clara était obligée de lui faire la conversation à chaque fois, bien que cela ne l’enchantait guère. Claudio, quant à lui, disposait de sa menuiserie en dessous de leur maison. Il prenait, par conséquent, sa Fiat 500 et chargeait Mattéo qui travaillait avec lui, pour se rendre chez sa mère. Gianni arrivait un peu plus tard par le bus scolaire, sa grand-mère lui gardait toujours son repas au chaud. Clara remontait tranquillement la rue et elle ne manquait pas de saluer les personnes qu’elle rencontrait. Elle devait faire attention où elle posait ses pieds, car lorsqu’il pleuvait, c’était souvent de manière diluvienne. Le trottoir en pâtissait et quelques trous de-ci de-là rendaient celui-ci dangereux. Elle s’irrita, il faudra qu’elle en parle au maire pour voir s’il ne pouvait pas au moins boucher ces cavités. Elle se demandait pourquoi la Municipalité ne faisait rien, qu’attendait-elle, qu’une personne se torde la cheville ? Elle en était là de ses réflexions tandis qu’elle arrivait enfin chez elle.
67
« Dernier message par Apogon le jeu. 21/07/2022 à 18:09 »
Des colts et du Beethoven de Elsa Errack Pour l'acheter : Amazon FnacDes Colts et du Beethoven
(Et il paraît que la musique adoucit les mœurs…)PARTIE I LA TRAQUE I Un fracas terrible le réveilla en sursaut. Il était déjà trop tard. Un homme venait de défoncer la porte, malgré le lit qu’il avait eu la précaution de mettre en travers la veille pour la protéger. Comment ? D’un coup de carabine ? Il n’eut pas le temps d’avoir de réponse. C’est à peine s’il put distinguer un chapeau gris crasseux avançant vers lui qu’il ressentait déjà une terrible douleur, l’autre lui vidait consciencieusement le barillet de son Colt 44 en pleine poitrine. Il lui semblait que cela durait, durait. Et pas moyen de saisir son arme, et cela le tourmentait terriblement : comment se faisait-il que lui, si rapide, si précis, n’ait rien pu faire ? Il s’en voulait à un tel point que l’idée de la mort, sa propre mort pourtant si proche, ne le hantait même pas et cela aussi l’étonnait et il était surpris également qu’il puisse réfléchir à tout cela. Quand il ouvrit les yeux après avoir réussi à sommeiller quelques heures entrecoupées de nombreux réveils et peuplées de cauchemars comme celui qui venait de le réveiller, une faible lueur pénétrait dans la chambre miteuse par l’unique fenêtre aux vitres sales. La main gauche déjà sur son Colt, il jeta un bref regard sur la porte : elle était heureusement intacte. Presque chaque nuit ce même cauchemar revenait depuis bientôt trois mois maintenant, Victor étant constamment sur ses gardes, de jour comme de nuit, traqué, les nerfs à vif, toujours à la merci de la balle qui mettrait fin à ses jours. Il se leva du vieux fauteuil bancal où il avait passé la nuit puis se dirigea avec précaution vers la fenêtre. Il jeta un coup d’œil prudent sur la rue poussiéreuse. Un jour glauque pointait peu à peu. La tempête qui sévissait la veille s’était calmée, il ne soufflait plus qu’un vent encore assez furieux. La rue était déserte. Il entreprit une toilette sommaire - ce qui le contraria car habituellement il prenait un bain quotidien quand il était en ville- versant dans une cuvette à la propreté douteuse le peu d’eau qu’il y avait dans le broc ébréché, le tout étant posé sur une table si frêle qu’elle donnait l’impression de vouloir s’effondrer à tout moment sous ce poids pourtant ridicule. Il prit toutefois le temps de se raser parfaitement, utilisant pour cela son propre miroir et son savon à barbe, étant donné que la chambre n’offrait pas ce genre de confort. Avec son lit rempli de punaises que Victor avait dédaigné autant par dégoût que par la nécessité d’être toujours sur le qui-vive, la pièce présentait un spectacle désolant. Le plancher était noir de crasse tout comme les murs et le fauteuil où il avait passé la nuit devait dater de l’époque de Thomas Jefferson. « Et dire que Domir est mort ! » La terrible nouvelle qu’il avait apprise un mois plus tôt et qui l’avait effondré lui revint douloureusement à l’esprit. « C’était stupide de ma part mais, il me semblait que jamais cela n’arriverait. » Puis il peigna soigneusement son abondante chevelure brune, se disant machinalement qu’il ferait bien de se rendre chez le barbier pour une bonne coupe. Il s’habilla le plus élégamment possible malgré une chemise blanche des plus froissées, n’ayant pas été repassée depuis longtemps. C’est là qu’un des boutons de son gilet lui resta dans les doigts… Ce qui n’aurait dû être qu’un détail des plus futiles au vu de sa situation provoqua un trouble chez lui. Comment, lui, toujours vêtu de façon impeccable, devoir porter un gilet auquel il manquait un bouton ? Et après ? Ce seraient des manches élimées ? Une cravate qui s’effiloche ? Des chaussures trouées ? Lui apparut aussitôt l’image de ce pauvre hère, qu’il avait croisé dans la rue la veille au soir juste avant d’arriver dans cette misérable auberge des abords de Wichita, à qui il manquait la moitié des dents et qui exhibait ses haillons tout en réclamant quelques cents. Ce n’est pas qu’il ait vécu auparavant dans le luxe - la parenthèse dorée de Denver mis à part- mais il n’avait jamais manqué de rien étant enfant et ce jusqu’à l’âge de dix-sept ans et depuis peu encore, il connaissait une grande aisance. Il s’aperçut aussi que sa boite à pâte dentifrice Sheffield était quasiment vide et tout en la laissant sur la table, il se dit, sarcastique, que vu ce qui l’attendait, cela ferait toujours quelques onces de moins à transporter. Dans la salle de l’auberge qui offrait un décor tout à fait en accord avec la chambre et où régnait une lourde odeur de graillon, officiait un gros homme chauve à la mine réjouie. Quand Victor entra, quatre jeunes hommes, dont aucun ne devait avoir plus de dix-huit ans, des cowboys à la tenue fruste, en sortaient justement. L’aubergiste voyant le visage de Victor aux traits tirés par la fatigue, lui demanda, sur un ton ironique, s’il avait passé une bonne nuit. Celui-ci ne daigna pas répondre et s’assit devant l’une des tables branlantes et poisseuses. Bien que le vent se soit calmé depuis la veille, on avait toujours l’impression qu’il allait emporter le bâtiment de bois vacillant, l’air poussiéreux s’infiltrant à travers les planches disjointes. Victor réussit à obtenir un œuf frit et un café épouvantable. Il n’osait presque pas toucher au morceau de gâteau rassis que l’aubergiste avait apporté en assurant jovialement que sa femme l’avait fait seulement la veille. Victor fut surpris de découvrir qu’il avait cependant bon goût. Et soudain, subrepticement, lui revinrent en mémoire Denver, le Brown Palace Hotel, Octavie, douces images ressurgies d’un temps qui lui semblait déjà lointain -alors que tout cela datait seulement de quatre ans. Il fut étonné que de tels souvenirs émergent de son esprit car il ne repensait pas souvent à cette époque. Mais ce n’était vraiment pas le moment de se remémorer cela. Il s’empressa de chasser ces pensées, il lui fallait concentrer toute son attention sur ce qu’il avait à faire. Il alla seller son cheval, son adorée Terpsichore, une jument anglo-arabe de douze ans à la robe alezane. Il lui dit quelques mots en français -il n’y avait presque plus qu’avec ses chevaux qu’il parlait le français ces derniers mois : « Tu vas être un peu plus chargée que d’habitude mais enfin, cela ne fera pas un poids très lourd » puis il alla flatter une dernière fois l’encolure de Boniface, son ancien cheval de bât. Il était obligé de le laisser, et cela pour diverses raisons. Tout d’abord, parce que lorsqu’il était arrivé la veille au soir, il avait joué de malchance : l’aubergiste l’avait reconnu immédiatement et il avait bien fallu négocier pour ne pas être livré au shérif. Victor n’ayant plus assez d’argent, le cheval avait servi de monnaie d’échange. Boniface n’était plus de la première jeunesse mais il était encore solide et bien entretenu. Ensuite, il fallait bien avouer que Victor n’avait plus grand-chose à lui faire porter depuis cette épouvantable histoire qui lui était arrivée un mois auparavant à l’hôtel (un hôtel digne de ce nom car à l’époque il pouvait encore se le payer) de North Platte. Enfin, il devrait, encore plus que d’habitude, faire montre de rapidité, et si Terpsichore volait au-dessus du sol, ce n’était pas le cas de ce pauvre vieux Boniface qui allait le ralentir au risque de lui faire perdre la liberté et donc la vie car la corde l’attendait en cas d’arrestation. Il sortit dans la rue qui commençait lentement à s’animer. C’était une belle matinée de septembre, hormis le vent qui soufflait encore assez fort. Terpsichore montrait des signes de nervosité, ressentant l’inquiétude de son maître. Victor traversa la ville de Wichita, cette ancienne « cowtown » qui comptait désormais plus de dix mille habitants, au quotidien plus calme qu’à l’époque où elle était une tête de ligne pour le transport du bétail au début des années 1870. En ces temps-là des hordes de cowboys l’investissaient régulièrement lorsqu’ils conduisaient les troupeaux de vaches jusqu’à la gare. Après un rude voyage de plus de deux mois, l’arrivée en ville donnait lieu à une explosion de joie par trop bruyante et exubérante au goût des honnêtes citoyens désirant mener une vie tranquille. C’est ainsi que s’était forgée la mauvaise réputation de Wichita et encore plus celle de Delano, la ville de l’autre côté de l’Arkansas où se trouvaient quantité de saloons, tripots et maisons closes qui étaient pris d’assaut par tous les marchands de bétail, conducteurs de troupeaux et cowboys. Victor emprunta les rues les moins fréquentées, le chapeau baissé sur les yeux, prenant une allure calme et dégagée mais étant dans la crainte permanente d’être reconnu. Il arriva dans le quartier résidentiel de College Hill où vivaient les habitants les plus fortunés de la ville. Il s’avança jusqu’aux abords d’une immense villa construite sur une éminence artificielle, une réplique d’un des palais vénitiens de Palladio, la villa Foscari, dont les somptueuses colonnes ioniques de pierre blanche de Pucisca dominaient un grand bassin où évoluaient des cygnes noirs. Un magnifique jardin entourait la maison, agrémenté de statues représentant divers personnages de la mythologie grecque, il y avait même un Cerbère dans un coin, tellement criant de vérité qu’il semblait que, de ses trois gueules allaient sortir de furieux aboiements et qui, invariablement, faisait sursauter les invités qui le découvraient subitement au détour d’une allée. Victor s’arrêta à une centaine de yards de la villa et descendit de cheval. Il attacha Terpsichore à l’une des branches à moitié cassée, qui pendait au sol, d’un énorme chêne et se plaça en embuscade derrière l’arbre. Il vérifia ensuite à nouveau minutieusement son arme -il avait pris un de ses Schofield- puis il tenta de s’immobiliser, le revolver dans la main gauche, prêt à faire feu. Alors qu’il était toujours si sûr de lui et maître de ses nerfs, cette fois il ne parvenait pas à évacuer une forte tension qui avait envahi tout son corps. Il n’avait pas eu le temps de bien inspecter les lieux, de se préparer et il n’aimait pas ça. Il n’était jamais allé auparavant dans ce quartier de Wichita et c’est seulement la veille, avant de s’installer dans cette pauvre auberge qu’il était passé pour observer la maison, mais très rapidement et il faisait déjà nuit. C’est donc presque contre son gré qu’il finit par sortir une flasque de whisky d’un de ses sacs de selle et qu’il en but quelques gorgées bien qu’il se fût donné pour règle de ne jamais boire une goutte d’alcool avant de se mettre au « travail ». Radomir le lui avait dit cent fois : « Le whisky et le tir, ça ne fait pas bon ménage, parce que, à part troubler la vue et faire trembler la main… » Victor se disait qu’il lui fallait à tout prix réussir, réussir à éliminer le commanditaire de ces tueurs lancés les uns après les autres à ses trousses. Il avait supprimé le premier à Grand Island au Nebraska, le second sur la route de Kearney et lorsqu’il avait découvert qu’un troisième l’avait pris en chasse, il avait compris qu’il ne le laisserait jamais en paix où qu’il se trouve. Après le désastreux épisode de North Platte, il était parvenu à se débarrasser du troisième tueur, mais il savait trop bien qu’il en avait à nouveau deux autres à ses basques -il espérait d’ailleurs qu’ils ne surgiraient pas à l’instant. Pour avoir une chance de s’en sortir vivant, Victor savait qu’il devait d’abord en finir avec l’homme qui s’acharnait après lui et qui ne cesserait de lui envoyer ses mercenaires qu’une fois mort. « Et dire que je n’en serai pas là, que tout cela ne serait pas arrivé si je n’avais pas eu la faiblesse, la bêtise... La bêtise ? L’idiotie oui -et là Victor ne trouvait jamais de mot assez fort pour se blâmer- d’accepter ce contrat proposé par ce crétin d’Albert Cooler, ce traître, cet imbécile, cette chiffe molle, ce pleurnicheur… » Victor s’arrêta là, mais il n’avait pas pu s’empêcher, encore une fois, de se reprocher amèrement de s’être laissé embarquer dans cette stupide affaire qui avait complètement bouleversé le cours de sa vie et l’avait mis en constant péril de mort. S’invectivant, s’injuriant même, il ne cessait de se demander ce qu’il lui était passé par la tête, ce soir de mai dernier. « Et tout ça pour 545 misérables dollars ! » Lui qui ne se déplaçait jamais pour moins de cinq mille ! Il finit par se ressaisir, se répétant à nouveau qu’il ne pouvait pas savoir que cela tournerait aussi mal, puis desserra les mâchoires, ferma les yeux et expira lentement pour se forcer à retrouver le calme. Dix heures dix. Exactement. Dans un élégant cabriolet à quatre roues mené par un vieux cocher noir vêtu d’une livrée écarlate, Blake Hole sortait de la villa pour se rendre à sa quotidienne séance de spiritisme. Victor arma le chien de son revolver. Mais pour comprendre pourquoi Victor Brennan s’apprête à tuer Blake Hole en cette matinée de septembre 1876, il nous faut revenir quatre ans en arrière, lorsque John Cooler, modeste ingénieur de Chicago venu s’installer à Wichita travaillait d’arrache-pied afin de créer sa Cooler Refrigerator Company. II - P’pa, tu viens manger, il est presque 22h… En plus Margarita nous a fait sa tarte à la rhubarbe… - Viens, viens voir ! ça y est, j’y suis, regarde un peu, je vais t’expliquer le fonctionnement. C’est bien parce qu’il aimait à ce point son père et éprouvait pour lui une grande admiration, sachant aussi combien ses recherches étaient fondamentales à ses yeux qu’Albert se pencha sur les plans qui jonchaient la table de travail plutôt que d’aller déguster une part du délicieux gâteau dont l’odeur suave agaçait encore plus son appétit. L’adolescent tenta de se concentrer afin d’essayer de comprendre les explications. - Tu vois, en fait c’est tout bête, mais… personne encore n’y avait pensé. Voilà : là, en haut des wagons, il y aura les caissons contenant la glace, ainsi l’air refroidi s’écoulera vers le bas. Il n’y aura plus qu’à bien emballer la viande, et … le tour est joué ! Elle pourra être transportée sans dommage pendant plusieurs jours. Et maintenant que je le tiens, mon wagon frigorifique, il va falloir monter cette affaire… Tu vas voir, dans quelques mois, des wagons de la Cooler Refrigerator Company sillonneront les Etats-Unis d’Ouest en Est ! De Wichita à Chicago et peut-être même jusqu’à New York ! Et nous gagnerons des millions ! - Ah ! C’est formidable p’pa ! Je l’ai toujours dit, tu as des idées géniales ! Et maintenant, tu viens manger ? John Cooler en avait passé un temps pour le mettre au point, ce wagon frigorifique ! Cela faisait des mois et des mois qu’il y travaillait. Mais attention, c’était un wagon réfrigérant fiable, performant, pas une de ces glacières sur roues -les premières tentatives avaient eu lieu vers 1851- qu’on ne pouvait utiliser qu’en hiver et dans lesquelles la viande en contact avec la glace s’abimait, prenant un mauvais goût et se décolorant, ni ces wagons où les carcasses étaient suspendues au-dessus d’un mélange de sel et de glace que l’on avait rapidement cessé d’utiliser car ils provoquaient des déraillements tant leur charge oscillait dans les virages. La mise au point de ce wagon frigorifique n’était toutefois qu’un élément de la vaste entreprise que John Cooler se promettait de mettre en œuvre. Depuis quatre ans, John ne vivait plus que pour cela, c’était devenu une obsession : aussitôt éveillé il se mettait à y réfléchir, n’hésitant pas à retourner à sa table de travail en pleine nuit, multipliant calculs, plans, schémas, prévoyant le montant des capitaux à investir (c’était là où le bât blessait le plus) et également les bénéfices qu’il escomptait prodigieux. Son exaltation lui faisait perdre le sommeil et il en oubliait également parfois de manger. Néanmoins, jamais il ne cessa de s’occuper de son fils, Albert, pour qui il avait une tendre affection. Il l’associa à tous les stades de la réalisation de son grand projet. L’idée de John Cooler était simple mais elle pouvait rapporter gros si elle aboutissait : il s’agissait de contrôler toute la filière de la viande, de l’achat de bétail à son abattage et à sa transformation sur place, à l’Ouest, jusqu’au transport et à la livraison de viande au détail dans les villes de la côte Est. De la vache sur pied au steak fraîchement livré ! Car jusque-là, les vaches, les fameuses « longhorns », parcouraient un épuisant trajet, parfois de plus de mille cinq cents miles, en troupeaux de deux à trois milles têtes, des ranchs du Texas où elles étaient élevées aux cowtowns du Kansas et c’est ensuite entassées dans des wagons à bestiaux, pendant plusieurs jours (sans eau ni nourriture le plus souvent) qu’elles étaient acheminées dans les villes de l’Est où se trouvaient abattoirs et usines de transformation de la viande. Il n’était guère étonnant que dans ces conditions nombre de bêtes meurent en route et que les autres arrivent dans un état pitoyable, amaigries ou malades et qu’ainsi la viande ne soit pas de la meilleure qualité. Le système inventé par John Cooler permettrait donc un bien meilleur rendement avec la disparition de tous les intermédiaires. Tout le monde y serait gagnant, de l’éleveur qui gagnerait plus, au consommateur qui paierait moins. Mais pour que cela fonctionne, il fallait pouvoir transporter la viande sur des milliers de miles, pendant des jours sans que celle-ci s’abime, donc il était indispensable de disposer d’un wagon réfrigérant qui garantisse vraiment sa qualité et sa fraîcheur. - Ah si ta mère était encore avec nous, elle serait bien épatée de voir que j’ai réussi, elle qui pensait toujours que je n’arriverais à rien… Avec Gladys, son épouse, John n’avait pas eu de chance. Le mariage avait tourné court. Gladys avait quitté son mari pour partir avec le meilleur ami de celui-ci- c’est d’un commun certes, mais c’est toujours affreusement vexant et navrant- et était allée s’installer avec lui en Californie. Elle avait cependant attendu d’accoucher car elle ne désirait pas s’embarrasser de l’enfant qu’elle attendait et c’est bien volontiers qu’elle l’avait laissé à son mari. Elle envoyait toutefois une lettre chaque année pour les vœux. Albert n’avait donc jamais connu sa mère. Son père et lui avaient quitté Chicago pour s’installer à Wichita en 1872 au moment même où le chemin de fer arrivait. L’Atchinson Topeka and Santa Fe Railroad permit alors de relier la ville à la côte Est en faisant également d’elle une « tête de ligne » pour le bétail1. Si sa femme avait encore vécu avec lui, elle n’aurait pas manqué de s’écrier que son mari était fou, que tout cela les mènerait directement à la ruine et elle aurait enjoint John de retourner aussitôt à Chicago dans son petit bureau d’ingénieur où il travaillait pour Mr Baker. Mais John était plein d’allant et avait une foi inébranlable en son projet. Aussitôt le brevet de son wagon frigorifique déposé, il se lança dans l’aventure, qui promettait d’être risquée et pleine d’obstacles à surmonter, l’absence quasi-totale de fonds n’en étant pas le moindre. Il réussit à convaincre quelques personnes qui n’avaient pas froid aux yeux de s’associer à lui pour donner naissance à la Cooler Refrigerator Company et se lança corps et âme dans la réalisation de son entreprise y consacrant tout son temps et toute son énergie. Cela lui demanda un travail acharné, il se démena pour tenter de convaincre quelques éleveurs de lui vendre leurs bêtes, fit de nombreux allers-retours au Texas, mais un seul d’entre eux accepta. Il persuada ensuite son vieil ami George Walter de lui fabriquer dix wagons frigorifiques dans son usine de Chicago. Il réussit, avec ses trois associés qui étaient tout aussi désargentés que lui, à réunir les capitaux en multipliant les prêts, s’endettant jusqu’au cou. Et enfin, après avoir fait construire un abattoir à Wichita et s’être associé à un détaillant de Boston qui revendrait ses produits, il parvint à obtenir de l’Atchinson Topeka and Santa Fe Railroad de faire rouler ses wagons réfrigérés, ce qui fut des plus difficiles, la compagnie de chemin de fer craignant de perdre ses juteux bénéfices liés au transport de bétail sur pied. Pendant tous ces longs mois de lutte, le père et le fils furent inséparables. John emmenait Albert partout, dans les ranchs au Texas, à Chicago dans l’usine de George Walter, dans les nombreuses banques qu’il avait sollicitées... Albert, même s’il n’en saisissait pas tous les enjeux, s’était enthousiasmé pour cette affaire et surtout il ne pensait pas un seul instant que son père pût échouer. Et c’est ainsi que La Cooler Refrigerator Company vit le jour, au début de l’année 1874, le six janvier, jour de l’anniversaire d’Albert qui venait d’avoir dix-huit ans. Le premier convoi de wagons frigorifiques emplis de carcasses de viande partit de Wichita le 15 février 1874 et arriva sans encombre à Boston une semaine après. Les premiers profits furent engloutis dans 1 L’aboutissement du sentier sur lequel étaient conduites les longhorns du Texas au Kansas se déplaçant au fur et à mesure de l’avancée de la construction des chemins de fer. les remboursements des emprunts mais tout avait l’air de se passer admirablement bien. C’était sans compter l’éternelle histoire du pot de terre contre le pot de fer. Et le pot de fer en l’occurrence fut le puissant Julius Hole. Celui-ci, associé à son frère Blake, était à la tête d’un véritable empire financier dont le commerce de la viande n’était qu’une affaire parmi bien d’autres. Les richissimes frères s’étaient partagé le pays, Julius œuvrait à l’Ouest, Blake régnait sur l’Est. Julius prenait part à tout ce qui concernait le développement de l’Ouest : lignes de chemins de fer, ventes de terres aux colons, exploitation de mines et donc aussi commerce du bétail. Julius, qui n’était pas marié, se plaisait à changer souvent de lieu de résidence, suivant l’avancée des lignes de chemin de fer, mais en 1871, il eut un coup de foudre pour Wichita (sans doute pas pour le site qui n’a rien de rare.) Il se fit bâtir une demeure magnifique sur le modèle d’une villa du Palladio car il était un grand admirateur de la civilisation italienne de la Renaissance. Le vieux père Hole, resté à Boston, n’avait jamais compris pourquoi Julius s’était entiché de ce coin perdu à la réputation épouvantable. Pour lui, ces régions de l’Ouest ne faisaient pas partie du monde civilisé et Wichita n’était synonyme que de violence, débauche et crimes. Julius Hole avait suivi avec grand intérêt le projet de John Cooler, il avait missionné une équipe qui était chargée d’espionner tous ses faits et gestes et qui les lui communiquait au fur et à mesure de l’avancée de l’opération. Pour rien au monde il n’y aurait mis un cent, car il voulait d’abord s’assurer que tout cela pourrait fonctionner et ensuite il était hors de question pour lui d’être l’associé d’un petit ingénieur de rien du tout et de participer à une entreprise d’une taille méprisable. S’il obtenait la preuve que le système était efficace, Julius Hole n’aurait plus qu’à récupérer l’idée de John Cooler. Ce qui ne lui fut pas très difficile, car il avait l’habitude des affaires et donc des coups retors. Il envoya ses sbires chez George Walter qui se laissa convaincre sans trop de peine de fabriquer des wagons frigorifiques pour Hole étant donné qu’on lui laissait entrevoir de substantiels bénéfices. George Walter se persuada lui-même, pour balayer ses scrupules, qu’après tout, cela ne se faisait pas contre John, que c’était le progrès, qu’il fallait vivre avec son temps et puis, malgré le brevet, tout un chacun pouvait bien, en observant un peu comment fonctionnait le système de réfrigération, fabriquer ces wagons, alors pourquoi refuser une offre aussi intéressante ? Il accepta donc et, pour son plus grand malheur, commit la grave erreur d’accepter de travailler avec les gens à la solde de Julius. Ils s’empressèrent de voler les plans et les wagons furent construits dans une des usines des Hole, à Boston. John Cooler, fort de son brevet, tenta bien une action en justice mais à part y perdre beaucoup d’argent, il n’arriva à rien, les Hole ayant à leur disposition une armée de brillants avocats ainsi que de sérieuses relations dans les milieux politiques. La Hole Refrigerator Line vit ainsi rapidement le jour et très vite ce furent près de cinq cents wagons réfrigérés qui circulèrent à travers le pays, non seulement sur la ligne de l’Atchinson Topeka and Santa Fe Railroad mais aussi sur d’autres lignes du pays. Des contrats furent passés avec de nombreux éleveurs et les Hole avaient déjà à leur disposition tout un réseau de grossistes et de détaillants pour revendre la viande sur la Côte Est. Ils proposèrent des prix alléchants pour tout le monde et la Hole Refrigerator Line devint ainsi incontournable sur le marché de la viande bovine de l’époque. Quant à John Cooler, un malheur n’arrivant jamais seul, l’unique éleveur qui le fournissait mourut subitement et ses fils qui avaient repris le ranch firent affaire avec Julius Hole. Bref, en quelques mois seulement, la Cooler Refrigerator Company fut coulée, John fut ruiné, tout comme ses associés, et il se trouva dans l’incapacité de payer ses très lourdes dettes et de verser la paye de ses employés. Ce fut Julius Hole qui lui racheta ses quelques wagons frigorifiques… Avant de mettre fin à ses jours, John Cooler avait longuement hésité, non pas à exécuter son sinistre projet, car pour cela sa décision était irrévocable, mais à laisser une lettre à son fils bien aimé. Le matin même de sa mort, quelques heures avant de se jeter sous le dix heures quarante qui partait pour Chicago et qui comportait d’ailleurs plusieurs wagons de la Hole Refrigerator Line, John s’enferma dans son bureau. Il commença par quelques phrases solennelles, puis pris d’une grande lassitude, il finit par déchirer et brûler son brouillon. Il espérait qu’Albert surmonterait ces moments pénibles et irait vivre en Californie avec sa mère. Il jeta alors quelques mots sur une feuille qu’il introduisit dans une enveloppe adressée à sa femme qui vivait à San Francisco. Albert fut totalement effondré par le décès de son père. Quand il l’apprit, une demi-heure seulement après le drame, il pensa ne jamais pouvoir y survivre. Pendant plus d’une semaine, plongé dans une affliction extrême, c’est à peine s’il put s’alimenter (ce qui était signe chez lui d’un profond désespoir), il ne quitta pas la chambre et beaucoup craignirent qu’il ne se laissât mourir. Puis peu à peu, malgré son immense détresse, il se remit à faire machinalement les gestes du quotidien et revint tout doucement à la vie. Dans le même temps naissait dans son esprit l’obsession qui allait le hanter pendant de longs mois: faire disparaître de cette terre Julius Hole qu’il tenait pour seul responsable de la mort de son père. Il s’en fit la promesse et c’est ce qui lui permit de trouver la force de continuer à vivre. Quant à Gladys, lorsqu’elle reçut la lettre de John avec seulement cette phrase : « Tu avais raison » elle s’interrogea longuement, se demandant de quoi il pouvait bien parler. Puis elle fut prévenue du décès de son ex-mari. Elle en éprouva du chagrin car elle avait toujours gardé une certaine affection pour John, même si très rapidement après leur mariage elle l’avait trouvé trop sérieux, trop sage, trop triste enfin bref, trop terne et qu’elle était très vite tombée amoureuse de Jim qui était tout l’inverse de John. Elle fut par contre étonnée elle-même de s’inquiéter du sort d’Albert, dont elle ne s’était pourtant jamais préoccupée pendant toutes ces années. Elle demanda à son frère et à sa belle-sœur, installés à Wichita depuis peu de veiller sur son fils, ce qu’ils firent avec bienveillance, même s’ils avaient toujours pensé que John était un fou exalté et que son fils prenait le même chemin que lui. Ils proposèrent à leur neveu de l’héberger mais celui-ci refusa, préférant rester seul dans la demeure paternelle, qu’il réussit à garder grâce à une hypothèque. III - Mais Bon Dieu, ça fait deux ans que tu me répètes la même chanson ! Arrête ! Soit tu le fais vraiment soit tu cesses d’en parler ! s’écria Frank excédé. - Je le ferai, je te dis, je le ferai, je le ferai ! Tiens, regarde, j’ai acheté ça hier. Et Albert souleva sa veste pour montrer un Colt 1849 Pocket glissé sous sa ceinture. - Tu es fou d’avoir apporté ça ici. Tu sais ce que tu risques ? Albert Cooler referma sa veste et haussa ostensiblement les épaules. Il avait déjà beaucoup bu mais il commanda un autre whisky. Il savait bien qu’au « White horse », le saloon où Frank et lui se trouvaient, comme dans tous les autres lieux de distraction de Delano, cette banlieue autrefois très agitée de Wichita, le port d’une arme était interdit et qu’on se devait de la laisser à l’entrée sous peine de se faire sonner les cloches par le shérif. - C’est pas parce que Paul Honor te connaît depuis des années et qu’il serait indulgent avec toi que ça ne te vaudrait pas une nuit en taule, un truc comme ça ! Pour toute réponse, Albert se mit à pleurer, abondamment. Son vieil ami Frank, qui devait se rendre à sa partie de poker -il était devenu joueur professionnel- s’impatienta mais il ne voulait pas laisser Albert seul dans cet état. C’était son ami d’enfance et son seul véritable ami d’ailleurs. Il assista une fois encore à la même scène, à laquelle il assistait plusieurs fois par semaine depuis plus de deux ans, depuis ce jour de 1874 où le père d’Albert avait mis fin à ses jours : Albert se lamentait sur son sort, sur celui de son père John Cooler, ruiné par Julius Hole, puis se mettait à traiter le patron de la Hole Refrigerator Line de tous les noms, pour au final promettre de le tuer de ses propres mains. Mais ce soir, ce qui était nouveau, c’est qu’Albert était armé et cela inquiétait Frank qui se demandait quel usage il pourrait faire de cette arme car à défaut de tuer Julius Hole il était possible qu’il tente de la retourner contre lui. Soudain Albert s’effondra sur la table -Frank eut juste le temps de reculer le verre de whisky à moitié plein pour éviter qu’il ne le renverse- et c’est à peine si Frank l’entendit murmurer : « Je le ferai, je le ferai… Il va crever ce salaud de Julius. » Ses propos se faisaient de plus en plus confus. Puis après un court silence, s’étant un peu redressé, il pleurnicha, dans un soupir de désespoir et levant douloureusement les yeux sur Frank : « J’sais pas me servir de ce truc, tu te rends compte, Nom de Dieu, j’sais pas, j’y arriverai jamais ! » Et il retomba sur la table. Frank avait vraiment de la peine pour lui. Il avait bien conseillé à de nombreuses reprises à Albert de vendre la vieille maison de son père, de liquider l’abattoir qui fonctionnait au ralenti -il n’en sortait plus que quelques carcasses de viande par mois qui lui assurait un maigre revenu- de partir s’installer dans une autre ville, pourquoi pas en Californie aller rejoindre sa mère, en tout cas de refaire sa vie, ou plutôt de la faire car il avait seulement vingt ans, mais Albert s’acharnait, voulait à tout prix venger son père, et en même temps, était incapable d’agir. A ce moment-là, Peter Drabek, un grand blond à l’air dégingandé, entra dans le saloon et fit signe à Frank. « Qu’est-ce que tu fiches, on t’a attendu, mais comme tu ne venais pas, je leur ai dit de trouver d’autres partenaires. Comme ce n’est pas ton habitude, j’étais inquiet, qu’est-ce qui se passe ? » Et il jeta un regard sur Albert, qu’il avait croisé une ou deux fois, il connaissait vaguement son histoire. Albert se releva un peu, avec difficulté, fit un bref signe de tête pour saluer le nouveau venu, puis aussitôt, repartit dans ses borborygmes. Frank se mit en devoir de résumer l’affaire pour Peter. Il se trouvait que Peter était du genre à s’occuper des affaires des autres et à aimer trouver une solution pour chaque problème. - Ah, je vois, fit Peter, je pense que j’ai ce qu’il vous faut. - Ce qu’il faut à Albert, pas à moi, attention, je n’ai rien à voir avec ça, moi, précisa Frank d’un ton irrité. Et puis, qu’est-ce que ça veut dire « ce qu’il faut ? » - Eh bien, vous ne voyez pas… Si on veut tuer quelqu’un… - Chut, moins fort ! lui intima Franck, les sourcils froncés par l’agacement. - Ouais, bon, continua Peter à voix basse, je disais que si on veut… mais qu’on est pas en mesure de le faire soi-même… Eh bien, faut trouver un gars qui le fera à votre place… C’est un type sûr, je le connais bien, quand on était gosses, on habitait le même quartier à Omaha, au Nebraska. C’est mon père qui lui donnait ses cours de piano, il est très doué d’ailleurs, un vrai virtuose. - Quoi ! Un pianiste ? Mais qu’est-ce que tu veux qu’on foute d’un pianiste ? C’est pas vrai, t’es encore plus bourré que ce pauvre Albert ! tempêta Frank qui commençait en à avoir assez de cette discussion sans queue ni tête. - Mais non, il est pas pianiste, il a changé d’instrument, si tu vois ce que je veux dire, et c’est un véritable as de la gâchette. Frank secoua la tête, il désapprouvait totalement la proposition, mais Albert, qui avait fini par comprendre, tiré peu à peu de sa torpeur alcoolique par les propos de Peter, s’exclama : - Un tueur, c’est ça, c’est un tueur ? - C’est ça, gueule-le encore plus fort pendant que tu y es ! En plus, avec ce que tu as sur toi, c’est vraiment le moment de te faire remarquer, gronda Frank. - Mais oui, Nom de Dieu, j’y avais pas pensé, c’est ça qu’il me faut, et se tournant vers Peter, trouve-le moi tout de suite, je veux que Julius soit descendu dès demain. - Pas si vite, je pense savoir où le trouver, mais il me faudra quelques jours. Et puis il va falloir du fric, parce que Vic, il ne fait pas dans les œuvres de bienfaisance. Par contre, tu peux être sûr que ce sera du travail bien fait. - Ouais, pour le fric, ça ira, j’en trouverai, va le chercher, il est où, en ville ? - T’as quasiment plus un cent et tu es prêt à… Frank bouillait. Tiens, je préfère partir, mais avant, comme tu es mon ami, je tiens quand même à te dire que tu te conduis comme un imbécile et encore une fois, je te conseille de tout vendre et de partir d’ici. Je sais que tu ne m’écouteras pas mais au moins j’aurais la conscience tranquille car je t’aurais prévenu. Frank quitta vivement la table et sortit du saloon. Peter reprit alors, en chuchotant. - Donne-moi trois jours, je te trouve Vic et je te le ramène. On peut se retrouver chez toi, jeudi soir, vers onze heures, c’est OK ? - C’est bon, je vous attendrai. Jeudi, onze heures. - T’habites où ? - Douglas Avenue, n°16. Le jour dit, à onze heures précises, Peter, accompagné d’un homme grand et mince très élégamment vêtu, jaquette et chapeau noirs, gilet vert jade à discrets motifs floraux et cravate de soie de couleur taupe, se trouvait devant le 16, Douglas Avenue. Il frappa à la porte mais personne ne venait. La maison avait l’air inhabité, il n’y avait aucune lumière aux fenêtres. Il était visible qu’elle tombait peu à peu en décrépitude. Ils attendirent un instant, puis ils aperçurent Albert surgir au coin de la maison et leur faire signe de le suivre. Les cheveux en bataille, la tenue négligée, il avait l’air encore plus désorienté que l’autre fois au saloon. Il les fit entrer par la porte de l’office dont il était le seul à faire usage désormais puisque les domestiques engagés par John Cooler autrefois avaient tous été renvoyés, même Margarita, la cuisinière mexicaine qu’Albert aimait tant, autant pour la douceur de son caractère que celle de ses gâteaux. Albert ne passait plus que par-là, ayant délaissée l’entrée principale. Il s’était replié sur deux pièces seulement: la cuisine et sa chambre, laissant le reste de la demeure vivre sa lente déchéance sans lui. Ils ne virent pas grand-chose de la cuisine car elle était plongée en grande partie dans l’obscurité, seule la lampe à pétrole posée sur la table émettait une faible lumière. Les présentations furent rapides et on en vint tout de suite aux termes du contrat. Ils s’assirent autour d’une table qui était, étonnamment dans cette demeure à l’abandon, d’une propreté irréprochable. Albert sortit fébrilement une vieille bouteille de rhum dont l’étiquette avait disparu et trois verres dont l’un était un peu ébréché. « Je suis désolé, je n’ai que ça », bredouilla-t-il. Sa nervosité était palpable. Albert commença à remplir les verres. A peine le sien fut-il empli à moitié que Victor fit un geste pour arrêter la main d’Albert. Quant à Peter, il but aussitôt le sien et tout en déclarant que le rhum était fameux fit signe qu’il en accepterait bien un deuxième. - Je ne suis pas fortuné, comme vous pouvez le voir, dit Albert en s’adressant à Victor avec un sourire forcé, tout en faisant un geste de la main pour désigner la pièce, mais je peux vous payer… je vous propose… 545 $ et 50 cents. Victor resta impassible, but une gorgée de rhum, reposa son verre, et enfin d’un ton glacial annonça : - Ce n’est pas mon habitude de travailler pour un salaire de conducteur de troupeau. - N’exagères pas, Vic, je t’ai expliqué la situation, et puis, 545 $, c’est quand même pas mal, plaida Peter. C’est pas le salaire d’un conducteur de bétail, ah ça non ! Eh, ça fait plus de trois mois de salaire du shérif de Delano, ajouta-t-il en riant pour tenter de détendre l’atmosphère. Cependant la remarque n’arracha aucun sourire à Victor ni à Albert qui commençait à paniquer. - C’est tout ce que j’ai. C’est vraiment tout ce que j’ai pu réunir. Je peux… je peux aussi… vous donner ça, et il montra l’arme qu’il avait acquise. - Allez, Vic, s’il te plait, je t’ai raconté son histoire, tu comprends bien, surtout toi, avec ce que tu as vécu, ce qui est arrivé à ton père… - S’il vous plait, acceptez, j’en peux plus, si vous le faites pas, j’irai, tant pis, avec ça, et il montrait son revolver, je sais pas m’en servir mais tant pis, j’irai et puis, je sais pas… Il continua, les yeux dans le vague, comme se parlant à lui-même. A travers sa logorrhée, on pouvait discerner « vengeance, pourri de Julius, qu’il aille au diable, j’en mourrai et à de très nombreuses reprises « mon pauvre père », puis la voix se perdit dans un murmure inaudible. Victor et Peter attendirent calmement, sans montrer aucune impatience qu’il ait terminé. - Tu vois, Vic, c’est comme qui dirait pour réparer une injustice. Et puis aussi pour qu’Al ait à nouveau l’âme en paix. De toutes façons, pour toi, c’est rien, tu vas faire ça en deux temps trois mouvements, t’es un as dans ta partie, c’est bien connu, t’es un des meilleurs de tout l’Ouest. » Victor ne laissa paraître aucune émotion sous le flot des « compliments » adressés par Peter Drabek, mais celui-ci savait qu’il avait touché une corde sensible chez lui. En effet Victor était content de lui, fier de ce qu’il était devenu. Depuis l’âge de douze ans, suite aux effroyables instants qu’il avait vécus, il s’était promis de savoir manier une arme de façon à devenir l’un des plus redoutés tireurs de tout l’Ouest et il y était parvenu. Après un apprentissage avec un maître en la matière, il avait fait ses preuves en tant que détective de la fameuse agence Pinkerton puis… alors qu’il n’avait pas encore vingt ans, il était passé du côté de ceux qu’il pourchassait. Cela était advenu un peu par hasard. L’occasion de gagner une somme considérable s’était présentée à lui à un moment où il avait vraiment besoin d’argent et il s’était fait, il est vrai de façon bien inconséquente, tueur professionnel. Pour une seule et unique fois s’était-il promis sur l’instant. Une seule et unique fois… Néanmoins c’était maintenant depuis près de quatre ans qu’il « exerçait » cette activité. Sans que cela trouble apparemment sa conscience, du moins jusqu’à présent… tant l’homme s’accoutume à toutes les situations qui ne tardent pas alors à lui apparaître ordinaires. Au moment où il se trouvait dans la cuisine d’Albert Cooler, il n’avait eu encore aucun problème avec la justice, ayant toujours réussi à exécuter ses contrats sans que son nom soit révélé : aucune affiche ne mettait sa tête à prix, aucun shérif n’était à sa poursuite. La loi implacable selon laquelle, dans son cas, on se retrouve forcément un jour ou l’autre face à plus rapide, plus précis ou alors simplement plus malin que soi ne devait pas être inconnue de Victor, mais, soit jeunesse, soit vanité, il n’y pensait pas trop, ou peut-être, ne voulait pas trop y penser. Après un moment de silence, Victor reprit la parole de la même voix neutre : - Bon, j’accepte, mais il faudra me payer d’avance, car Julius Hole, c’est du gros gibier, dès qu’il sera abattu, ce sera le branle-bas de combat, il faudra que je quitte immédiatement la ville et même le Kansas. IV Pour Julius Hole, l’Ouest avait été un exutoire lui permettant de fuir une famille oppressante. Il avait souffert durant son enfance et sa jeunesse, pris dans les carcans d’une éducation stricte, subissant les dures exigences d’un père calviniste et d’une mère plus austère encore que son mari. Dès l’âge de vingt et un ans il s’était installé à l’Ouest et depuis il menait la vie qu’il avait rêvée. Son père avait voulu l’envoyer à Harvard mais Julius n’y était pas resté longtemps, ce qu’il voulait, c’était suivre son frère Blake, de deux ans son aîné, qui s’était lancé avec succès dans les affaires. Les deux frères s’étaient toujours bien entendu même s’ils n’avaient pas du tout le même caractère, Julius étant exubérant et expansif, alors que Blake était plus sombre et renfermé. Ils s’associèrent et si Blake avait bien réussi dans ses premières entreprises, il fallait avouer que Julius le surpassait de beaucoup, le génie des affaires l’habitait. Tous le disaient : « Il a ça dans le sang, dès que Julius s’occupe d’une affaire, on est sûr que l’or va couler à flot ». On le surnomma rapidement le Midas de l’Ouest. Julius Hole était prudent, n’engageant jamais de capitaux de façon hasardeuse, par exemple, dans les années 1850 il avait spéculé sur des compagnies minières mais uniquement après avoir eu l’assurance que les filons exploités par celles-ci étaient abondants, car trop souvent ces derniers étaient superficiels et menaient à des faillites retentissantes. Il n’hésitait pas aussi à user de procédés malhonnêtes : ainsi, avant la création de la Hole Refrigerator Line, pour augmenter le poids des vaches amaigries par les longs trajets en train, il ordonnait qu’on les assoiffe pendant le voyage puis qu’on les fasse boire tant et plus le jour de la vente. Il avait aussi été à l’origine d’un bureau de publicité mensongère pour que les compagnies de chemin de fer dans lesquelles il avait investi vendent facilement les terres, que le gouvernement fédéral leur avait octroyées, à de naïfs pionniers. Pour attirer ceux-ci, il leur promettait dans de beaux prospectus que la fortune était à portée de main et n’hésitait pas à inventer de brillantes métropoles là où il n’y avait encore que trois cabanes de bois. Et bien sûr, il n’avait aucun scrupule à s’emparer des idées des autres comme il l’avait fait avec John Cooler. Flairant toujours les bons coups, il avait dernièrement jeté son dévolu sur le fil de fer barbelé, qui se vendait seulement 20 dollars les cent livres en 1874 mais 80 dollars en 1876, ayant bien compris que le prix n’allait cesser de croître, les fermiers étant résolus à protéger leurs cultures des ravages causés par les troupeaux itinérants. Julius Hole prétendait être accaparé par ses affaires qui ne lui laissaient pas une minute de libre selon lui, pour systématiquement éviter les réunions familiales qui se tenaient à Boston, la ville natale de son père. A cinquante-deux ans, Julius n’était toujours pas marié et il y avait bien longtemps que l’on avait cessé de lui faire des remarques là-dessus, ses parents s’étant résignés. Sa débauche n’avait fait que croître au fil des années et maintenant dans sa somptueuse maison de Wichita ses maîtresses se succédaient, chacune parvenant à se maintenir, dans le meilleur des cas, cinq à six mois. Il y organisait de titanesques orgies, arrosées des meilleurs vins français. Son vieux père serait mort d’une attaque s’il avait eu connaissance des mœurs dépravées de son fils. Quant à sa mère, elle se doutait que la vie de Julius n’était pas d’une pureté angélique mais faisait mine de ne rien soupçonner et d’ailleurs ce qu’elle imaginait ne pouvait rester que bien en-deçà de la réalité. En outre Julius adorait aller s’encanailler dans les quartiers mal famés de Delano, toutefois toujours accompagné de deux ou trois colosses qui étaient chargés de sa protection. Il y fréquentait tout particulièrement le Red Orchard, un lupanar réputé. La maison était tenue par Mme Gessler, une suissesse pas commode qui ne tolérait aucun désordre. Chez Mme Gessler, c’était la légion romaine, tout était d’une propreté irréprochable et tout son petit monde lui obéissait au doigt et à l’œil, mais sans heurts, c’était une autorité ferme qui s’exerçait en douceur. Les clients étaient toujours très satisfaits et nul ne s’était jamais plaint du Red Orchard. Quand Julius Hole s’y rendait, la patronne lui réservait deux ou trois très jeunes filles, connaissant bien les goûts du fortuné débauché. La vie des plus rangées de son frère Blake : marié à l’âge de vingt-deux ans avec la fille aînée d’une famille de la grande bourgeoisie de Boston dont il avait eu deux enfants et pour laquelle il faisait preuve d’une fidélité irréprochable depuis trente-deux ans, formait donc un éclatant contraste avec la licencieuse existence de Julius. Et pourtant Blake, depuis sa prime jeunesse, n’était pas dénué de bizarreries. Loin de là. Mais il les cultivait en secret. Gavé de lectures ésotériques, il avait par exemple lu et relu le Zohar et les œuvres d’Aboulafia, Blake étant persuadé que les réalités du monde n’en étaient pas et que tout n’était que signes, chiffres, mystères à dévoiler. Il suivait les enseignements de plusieurs maîtres spirituels et lui-même se pensait capable de décrypter le sens caché de l’univers. Il était notamment convaincu de l’existence du royaume souterrain mythique d’Agartha, pensant que le but de l’Humanité était d’y accéder et d’y trouver le bonheur éternel. Et il était sûr que lui, Blake Hole, avait un rôle décisif à jouer dans tout cela, il attendait son moment, qui ne tarderait pas à venir selon lui. Il « savait » que cela arriverait. Il avait financé au moins deux expéditions de pseudo-savants en Inde pour retrouver ce monde idéal qui permettrait d’accéder à des connaissances et à des pouvoirs surnaturels, mais sans résultat. Il était même allé en France pour rencontrer le grand maître spirituel Jean Saint Mont-Ernier, qui avait bien voulu lui accorder une demi-journée d’entretien. Ce maître, doté, selon lui-même, de pouvoirs extraordinaires, délivrait un enseignement uniquement oral car il prétendait que les livres corrompaient la vérité. Jean Saint Mont-Ernier lui avait beaucoup révélé sur Agartha et sur l’au-delà -il assurait être revenu lui-même de chez les morts- ainsi que sur les façons de communiquer avec les âmes des disparus. Blake était d’ailleurs un fervent adepte du spiritisme. Il avait tenté à de nombreuses reprises de convaincre son frère de le suivre dans sa voie, mais toujours en vain. Julius ne manquait pas une occasion de se moquer de Blake, pensant que tout son charabia était à mourir de rire et il avait plus d’une fois menacé, pour s’amuser, d’en avertir leurs parents, surtout quand ils étaient jeunes car désormais il n’avait quasiment plus aucun contact avec eux et de toute façon il se fichait bien de ce qu’ils pouvaient penser de son frère et de lui. La bonne entente qui existait entre Julius et Blake quand ils étaient jeunes avait perduré mais les deux frères ne se voyaient plus : ce n’était qu’échanges de lettres et de télégrammes et de plus en plus uniquement pour les affaires, il n’y avait quasiment plus rien de personnel, seul Blake donnait très sporadiquement des nouvelles de leurs vieux parents. Victor Brennan, qui s’était installé dans le plus bel hôtel de Wichita, avait été mis au courant par Peter Drabek que Julius avait ses habitudes au Red Orchard et qu’il s’y rendait toujours le dernier jeudi du mois. Ce serait donc le 25 mai. Victor avait huit jours pour se préparer. Il parcourut méthodiquement le quartier où se trouvait la maison close, mais aussi le reste de la ville de Delano pour bien repérer les lieux, tout d’abord de jour, puis la nuit. Il avait pris soin de se changer et de mettre de vieux vêtements pour passer inaperçu. Il examina tout très attentivement, observant les allées et venues, mémorisant chaque détail, déterminant l’endroit où se placer pour abattre sa cible et également comment quitter la ville au plus vite sans se faire remarquer. Lorsqu’à deux heures dix du matin, le vendredi 26 mai, Julius Hole sortait du « Red Orchard », il n’eut pas le temps de faire dix pas qu’une balle de Winchester lui explosait la cervelle. Les deux gardes du corps qui l’accompagnaient n’avaient même pas vu d’où le coup venait. V Victor quitta Delano aussitôt, sans que quiconque l’ait aperçu, s’éloignant de la ville rapidement, en parcourant déjà près quinze miles cette nuit-là, bénéficiant de la faible clarté d’un dernier croissant de lune. Il prit la direction de la ville d’Omaha au Nebraska. Il avait un peu plus de trois cents miles à parcourir mais il avait l’habitude de franchir de grandes distances en peu de temps et il comptait mettre deux semaines environ, en chevauchant six à sept heures par jour, ayant pris soin d’emporter suffisamment de vivres. Il disposait en tout de trois chevaux : deux de selle, Régulus, un hongre bai très vif qu’il avait acheté six ans auparavant et sa belle jument anglo-arabe Terpsichore ainsi que d’un cheval de bât. Il était surtout pressé de quitter le Kansas, ce qui fut fait au bout de sept jours, et par la suite, il n’eut pas envie de s’attarder dans cet espace agricole des plus monotones qu’était le Sud-Est du Nebraska. C’était toujours les mêmes plaines, les mêmes prairies dépourvues d’arbres, les mêmes champs de blé ou de maïs, les mêmes troupeaux de vaches. Il avait l’impression de revivre sans cesse la même journée. Bien qu’il préférât en règle générale dormir à l’hôtel, il choisit de bivouaquer jusqu’à ce qu’il arrivât à la ville de Lincoln au Nebraska, d’abord parce que la prudence étant de mise, il préféra éviter les villes tant qu’il était au Kansas, et ensuite, dans ce coin de campagne perdu du Nebraska où on ne pouvait rencontrer que quelques misérables bourgades, si c’était pour se trouver un lit plein de punaises sous lequel couraient rats ou souris dans une auberge minable, il préférait encore dormir à la belle étoile, d’autant que les nuits n’étaient plus trop fraîches et qu’il eut la chance de ne pas subir de vent trop violent. Il fit une halte de quatre jours à Lincoln, retrouvant avec plaisir les commodités de la ville et profitant d’une confortable chambre au Lancaster Hotel. Victor arriva à Omaha le matin du neuf juin, après quinze jours de voyage. Comme toujours, son premier soin fut de s’occuper de ses chevaux. Il les confia au vieux Tom en lui donnant généreusement trente dollars comme d’habitude et comme d’habitude Tom fit mine de refuser, protestant que c’était trop. Victor lui laissa aussi ses armes (sa Winchester et ses deux Colts 45 que Radomir lui avait offerts trois ans plus tôt), ayant une confiance totale en le vieil homme. Avant même que Victor l’ait demandé, Tom proposa d’envoyer le petit Joe porter ses affaires à l’adresse habituelle, Victor le remercia et confia également au garçon un billet dans lequel il annonçait sa venue pour onze heures. Il profita des deux heures qu’il avait devant lui pour flâner dans Omaha. A chaque fois qu’il revenait, il trouvait la ville plus peuplée et animée, et de plus en plus cosmopolite. La « porte d’entrée de l’Ouest », qui comprenait alors plus de vingt-cinq mille habitants, n’était plus la capitale du Nebraska depuis vingt-deux ans, Lincoln lui ayant ravi la place. Victor s’aperçut que les grands bâtiments de brique rouge de trois ou quatre étages s’étaient multipliés, abritant commerces, hôtels ou usines. Il évita la gare de l’Union Pacific, et son quartier d’entrepôts, d’abattoirs et d’usines de conditionnement de la viande et se rendit jusqu’au bord du Missouri, dont les berges étaient agréablement ombragées par des peupliers, des frênes et des ormes et qui lui rappelaient les bons moments qu’il y avait passés dans son enfance. Là encore c’était l’effervescence, avec les va-et-vient permanents des ferries, qui en traversant le fleuve, faisaient le lien entre l’Est et l’Ouest du pays. Il finit sa déambulation par la place du marché qui regorgeait de produits venus des quatre coins du monde. Il y avait foule. Il se mit en quête d’un présent, hésitant entre de l’eau de Cologne Guerlain et des mouchoirs en dentelle d’Alençon. Il acheta ces derniers, demandant à ce qu’on les lui enveloppe dans un papier de soie agrémenté d’une faveur. Il acheta pour lui un flacon d’eau de Cologne « Extra-Vieille de Roger et Gallet » -on lui assura qu’il s’agissait d’une nouvelle qualité de l’eau de Jean-Marie Farina- et une autre nouveauté de la même maison : un savon rond parfumé1. Soudain, il sentit qu’un gamin tentait de lui faire les poches, il lui saisit aussitôt fermement le poignet et pris un air terrible, sans dire un mot. Le gamin était paniqué, se voyant déjà en prison mais Victor le laissa aller non sans lui assurer, pour lui faire peur, qu’il demanderait à Mr. Walter, le shérif, de l’envoyer aux travaux forcés s’il recommençait. Il faisait déjà chaud en cette matinée du début de mois de juin et il s’arrêta pour boire une bière fraîche. Il était près de onze heures, il se dirigea vers Jefferson Square et frappa à la porte d’une coquette maison. Une belle femme brune aux yeux bleus vêtue d’une élégante robe en taffetas parme lui tomba dans les bras. - Bonjour maman. 1 L’auteur s’est permis un léger anachronisme car si l’ « Extra-vieille » existe bien depuis 1875, les savons ronds parfumés, quant à eux, ne sont apparus qu’en 1879. - Je t’attendais, le petit Joe a apporté tes affaires, je les lui ai fait mettre dans ta chambre. Je suis tellement heureuse de te revoir. Tu m’as manqué depuis tous ces longs mois. Elle regarda son fils avec un large sourire, le fit entrer et reçut son cadeau - avec plaisir. - A moi aussi, tu m’as manqué. Mais rapidement, le beau regard bleu de sa mère se fit scrutateur. - Tu aurais pu nouer ta cravate correctement… » Elle esquissa un geste pour tenter de la rajuster mais se retint, puis, regardant le chapeau que Victor tenait à la main : Eh bien ! Il est encore plus poussiéreux que le plumeau de Lida ! Et tes bottes ! Dans quel état sont-elles ! Victor -qui pensait éviter ce genre de remarques en ayant pris soin de brosser ses vêtements le matin-même - tenta de se défendre : - M’man ! J’ai parcouru plus de trois cents miles en moins de … - Oh ! Ne me dis rien ! Je ne veux surtout pas savoir d’où tu viens. Mais enfin tu es de plus en plus négligé. Ce n’est pas étonnant aussi, avec la vie que tu mènes. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais… Enfin… Allez, tu vas aller prendre un bain et te vêtir correctement, il y a du linge et des vêtements propres dans ta chambre. Pendant ce temps je préparerai moi-même le déjeuner -j’ai envoyé Lida faire quelques achats- je te ferais un repas digne de ce nom, car tu as dû manger n’importe quoi ces derniers mois. Et là tomba la question que Victor redoutait toujours : « Tu restes combien de temps ? » Et il répondit comme à l’accoutumée de façon évasive, « quelques jours » en pensant que trois, ce serait bien assez. La dernière fois qu’il était venu, c’était à Noël dernier, six mois auparavant ; l’atmosphère s’était alourdie peu à peu et la mère et le fils s’étaient quittés non pas fâchés mais soulagés de se séparer. Précisons tout de suite qu’Eugénie ignorait totalement ce qu’était devenu Victor -celui-ci n’avait heureusement pas eu le mauvais goût de lui signaler son changement de… d’« activité »- elle le croyait toujours simplement un « vulgaire détective » comme elle le disait, profession qu’elle exécrait, la trouvant indigne et avilissante et depuis près de six ans, elle ne cessait d’exhorter son fils à changer de vie. Alors, si elle avait su que désormais il était l’un de ces horribles hors-la-loi qu’il pourchassait autrefois ! Elle en aurait été épouvantée et n’aurait peut-être plus voulu le revoir (quoique, elle l’aimait tellement !) La profession de Victor mise à part, les sujets de discordes ne manquaient pas et Victor savait trop ce qu’il allait devoir entendre: « Et si ton père te voyait ! Et le piano ! Et Laura ! Et quand te marieras-tu ?… » Les reproches de sa mère l’agaçaient et même s’il l’aimait profondément, il ne pouvait pas s’empêcher parfois de répliquer durement. C’est pourquoi il pensait qu’il était préférable de ne pas rester trop longtemps. Eugénie Brennan, la mère de Victor, avait définitivement quitté la France en 1850, après la mort de sa mère car elle ne supportait plus la vie qu’elle menait. Son père, bien que fortuné, devenait de plus en plus avare, et surtout elle voulait oublier sa catastrophique histoire d’amour avec son cousin Hector qui lui avait promis de l’épouser mais qui finalement l’avait abandonnée pour aller faire fortune aux Indes. Elle en avait été très malheureuse, attendant en vain des nouvelles pendant plus de deux ans, puis avait appris qu’il s’était marié avec une Anglaise. Elle avait alors pris sa décision : elle partirait et se bâtirait une nouvelle vie ailleurs. Elle avait quitté sa petite ville natale de Buzançais, emportant ses économies qui étaient substantielles (et dire qu’elle avait failli les donner à son cousin qui voulait se lancer dans le négoce !) et avait pris le bateau au Havre. A peine était-elle arrivée à New-York qu’elle rencontrait un bel Irlandais, Pilib Brennan. Ce fut le coup de foudre, ils se marièrent quelques semaines après et en 1852 naissait Victor. L’accouchement s’était très mal passé et Pilib pensa perdre sa femme. Eugénie survécut mais ne put plus avoir d’autres enfants. Ils s’installèrent à Omaha en 1855, un an après la fondation de la ville. Après la mort de son mari, en 1863, Eugénie refusa de se remarier. Et pourtant ce n’était pas les demandes qui manquaient. Bien qu’approchant de la cinquantaine, elle était restée très belle et beaucoup d’hommes auraient bien voulu l’épouser, mais c’était en vain qu’ils faisaient leur demande. Quand, en juin 1869, elle trouva la lettre de Victor -il n’avait pas même dix-sept ans- lui expliquant qu’il était parti pour l’Ouest (sans plus de précisions) promettant de venger son père et insistant sur le fait qu’il « les retrouverait et les abattrait tous », Eugénie fut horrifiée. Foudroyée par la nouvelle, elle resta hébétée pendant un long moment face aux quelques lignes écrites par son fils. Elle tombait des nues, car elle ne se doutait vraiment de rien, ne voyant encore en Victor qu’un doux enfant calme. Et pourtant… Cela faisait un bout de temps que le doux enfant s’entraînait à manier un Colt avec le cousin de son professeur de piano, Radomir Drabek, un Tchèque fraîchement arrivé à Omaha, excellent violoniste, au passé plus que trouble toutefois. Omaha n’étant qu’une étape pour lui vers l’Ouest où il souhaitait exercer ses talents (sans doute pas seulement ceux de virtuose) il accepta bien volontiers d’accompagner Victor dans ses recherches, ce qui permettrait aussi de parfaire l’apprentissage de son élève. Pendant six mois environ Eugénie n’eut aucune nouvelle de son fils. Plongée dans le désespoir le plus profond, elle le pensait perdu pour toujours. Mais, lorsqu’au début de l’année 1870, dans une deuxième lettre, Victor lui annonçait que finalement il venait de s’engager dans l’agence Pinkerton, passée la stupéfaction, l’indignation la gagna et sa colère enfla démesurément. Elle se mit à tourner en rond dans le salon: « Détective ? Détective chez Pinkerton ? Mais quelle idée, qu’est-ce qu’il lui a pris ? Où est-il allé chercher ça ? Quelle absurdité ! Détective… Chasseur de crapules ! Mais c’est… répugnant ! C’est abject ! Sordide ! Ah, quelle horreur ! Détective, non mais voyez-vous ça ! Ah, le sot ! Ah, petit imbécile ! » Et elle finit par utiliser un vocabulaire de plus en plus grossier, ce dont elle ne se serait jamais cru capable, et cela la fâcha encore plus contre Victor, qui, par son comportement, la forçait à dire des horreurs. Elle avait tellement honte qu’il ait fait ce choix, ce n’était pas là un métier honorable, d’ailleurs un « métier », on ne pouvait pas appeler cela un « métier », mais plutôt une vile tâche qui le ferait sans cesse vivre au contact de la pire canaille. Que cela était dégradant, pour lui comme pour elle ! Et ses amis, ses connaissances, ses voisins qui n’allaient pas tarder à être au courant ! Mais ceux-ci, par respect pour Eugénie, ne lui en parlèrent jamais, sachant à quel point elle avait été blessée et attristée. Heureusement, Victor exerçait sa méprisable besogne loin de là, hors du Nebraska, au Colorado, au Kansas ou le diable savait où ! Alors qu’elle l’avait toujours choyé, qu’il avait reçu une bonne éducation et qu’elle lui avait payé (sur ses économies personnelles toujours) des cours de piano -ayant convaincu ce professeur tchèque, leur voisin à New York, Mr Janecek Drabek, de venir s’installer à Omaha pour lui donner des cours- qu’il avait été un enfant calme, sans histoire, pas bagarreur, que lui était-il soudain arrivé ? Elle n’avait pas compris quelles étaient ses motivations et les explications qu’il avait données pour justifier son choix lui paraissaient étranges, même si, bien sûr, il y avait eu le drame de la mort de son père, tué sous ses propres yeux. Mais pour Eugénie, cela ne pouvait pas expliquer cette décision qu’elle considérait désastreuse et elle n’avait cessé de condamner sa conduite. C’est pourquoi au bonheur que ressentait Eugénie de revoir son fils se mêlaient toujours de la déception, de l’amertume et une certaine colère. Eugénie avait toujours imaginé Victor en grand pianiste (ne sachant pas d’où cela lui venait, personne dans sa famille ni dans celle de son mari n’était musicien et elle n’avait été influencée par aucun exemple autour d’elle.) Son mari avait accepté que Victor apprenne le piano mais il voulait qu’il fasse ensuite quelque chose de plus « sérieux ». S’il n’était pas mort prématurément, Pilib se serait sans doute opposé au rêve de sa femme, car le sien était d’envoyer son fils à l’université, à Chicago, voire à Cambridge ou Harvard. Une voisine irlandaise avait dit à Eugénie que le patronyme « Brennan » venait du mot chagrin et en effet le père et le fils lui avaient causé bien des chagrins, pas de la même nature toutefois. Alors que son mari, qui était la probité incarnée, s’était toujours conduit de façon si digne, si honnête, Victor… Ah, Victor ! Que lui était-il donc passé par la tête ? Même si elle essayait de chasser ses noires pensées, elle était régulièrement tourmentée par la crainte d’apprendre sa mort et quand George Walter, le shérif, passait pour venir la saluer (il avait le béguin pour elle mais n’osait pas faire sa demande, se doutant qu’elle le refuserait comme les autres) l’angoisse l’envahissait toujours car elle imaginait le pire. Elle aurait certes pu sombrer dans la folie après la mort de son mari, se jeter dans le Missouri après le départ de son fils, mais non, elle n’avait rien fait de tout cela. Elle avait prié -elle se rendait chaque semaine à la cathédrale Sainte Philomène- espérant que Dieu accueillerait l’âme de son défunt époux tant aimé au Paradis et guiderait Victor sur un chemin plus sage. Sur le plan matériel, Eugénie vivait dans une aisance certaine, son mari lui avait laissé suffisamment d’argent et surtout, elle avait hérité une véritable fortune de son vieux grigou de père qui était décédé l’année où Victor avait quitté le foyer familial. Si elle avait ouvert une boutique de chapeaux, c’était pour s’occuper et non pour gagner sa vie, boutique qui par ailleurs connaissait un grand succès, toutes les élégantes d’Omaha se précipitaient au « Chapeau de la Parisienne. » Victor retrouvait à chaque fois avec plaisir l’intérieur confortable de la maison de sa mère : tout était impeccable, astiqué, en ordre, même s’il se faisait toujours la même réflexion : « Tout ce rose et ce parme, ç’a un peu un côté bonbonnière, mais enfin, cela convient pour une femme seule… » Après un délicieux déjeuner, Victor se mit au piano avant même que sa mère le lui demande car il savait que cela lui ferait plaisir. Victor se disait avec satisfaction que le premier jour cela commençait toujours bien : après un bon repas, quelques airs au piano. Ça se dégradait après… Eugénie avait acheté avec ses propres économies un piano droit, un Erard, lorsque Victor avait commencé à apprendre à jouer, à cinq ans et demi, et le faisait accorder chaque année, même si Victor ne passait pas plus de deux ou trois fois par an. Elle-même jouait un peu. Il joua d’abord du Mozart car il savait qu’elle aimait beaucoup ce compositeur. A peine eut-il achevé « la Marche turque » que sa mère ne put s’empêcher de s’exclamer: « Tu gâches vraiment ton talent, tu aurais pu être un grand pianiste ! D’ailleurs il n’est pas trop tard… » « Ça commence toujours bien, hum… » pensa Victor, qui préféra ne rien répondre, faisant mine d’être absorbé par l’interprétation de la sonate n° 8 de Mozart. - Tu devrais nous jouer la sonate de Beethoven que Mr Drabek t’avait apprise la dernière année, tu sais celle qu’on appelle l’Appassionata, et puis aussi la Rhapsodie hongroise de Liszt. Ce n’était pas par hasard si Eugénie lui réclamait de tels morceaux (elle demandait conseil pour cela auprès de Mr Drabek), c’était des partitions particulièrement ardues, son seul but étant de vérifier la virtuosité de son fils. Victor le savait bien, déjà à Noël dernier, elle lui avait demandé de jouer la fantaisie impromptue de Chopin et le grand galop romantique de Liszt, là encore des pièces qui nécessitaient une habileté de musicien accompli. Il ne put s’empêcher de répliquer : - Tu as vraiment envie d’entendre ça ou si c’est pour… et là Victor hésita sur les mots - comme il n’utilisait plus le français très souvent, il avait tendance à oublier certaines expressions- … pour me mettre à l’épreuve ? - Mais en plus, tu perds ton français ! Ah ! Il ne manquerait plus que ça que tu perdes ton français ! Il faut que tu l’entretiennes ! Il faudra que tu emportes quelques livres et que tu les lises à voix haute. Vaincu, Victor se contenta finalement de dire, très calmement, que dans ce cas, il devrait y travailler plusieurs heures. Il passa donc toute une partie de l’après-midi et de la soirée à revoir la sonate de Beethoven. Sa mère était aux anges, d’entendre ainsi le piano résonner dans toute la maison, comme « avant ». Victor soudain cessa un moment de jouer. Il se prit à penser qu’il ferait peut-être mieux de faire des fausses notes, de massacrer la partition pour qu’ainsi sa mère ne l’importune plus avec ça. Mais… Non… Il ne pouvait quand même pas faire ça à Beethoven, lui assassiner son Appassionata… Et il reposa les mains sur le clavier. Quand sa mère voyait ainsi son fils, si beau, si élégant, jouant du piano, elle ne pouvait pas l’imaginer en train de… enfin, en train de… Elle ne savait comment dire. D’ailleurs elle ne l’avait jamais vu tenir une arme et ne savait pas vraiment en quoi consistait son métier (enfin, son premier métier, celui de détective.) Mais malgré elle, elle l’imaginait parfois, le voyant vêtu en cowboy, avec des vêtements sales, le visage maculé, rampant par terre, dans un brulant désert, des coups de feu éclatant au loin. Elle ne savait pas pourquoi, mais à chaque fois que lui venait ce genre d’images elle l’imaginait dans le désert. Une réminiscence de Manon Lescaut de l’abbé Prevost peut-être, dont la lecture l’avait fortement impressionnée quand elle était jeune ? Néanmoins, elle ne pouvait se représenter son Vic chéri une arme à la main. Et quelquefois, aussi, surgissait une terrible vision : Victor, allongé sur le dos, immobile -toujours dans un désert- une grosse tâche de sang sur la poitrine ; quand cela lui arrivait, de jour comme de nuit, Eugénie se précipitait sur ses rubans, voiles et autres accessoires et elle se mettait à confectionner un chapeau. Elle se plongeait dans sa création, s’y absorbait et finissait par oublier. En fin d’après-midi, alors que Victor faisait une pause et s’était allongé sur un des canapés tendu d’un beau velours rose pêche, sa mère vint s’assoir auprès de lui. Alors qu’elle lui passait la main dans les cheveux, elle lui dit tendrement, comme à son habitude : « Tu as les cheveux de ton père. » Puis, après un court silence : « Au fait, tu sais que Laura est revenue de New York et qu’elle va se marier à la fin du mois ? » « Ah, elle attaque déjà sur le mariage ! » pensa Victor, qui toutefois ne put s’empêcher de ressentir un pincement au cœur. Il aimait Laura. Néanmoins comme celle-ci n’avait jamais fait montre d’un quelconque sentiment amoureux envers lui, il était résolu à l’oublier –ou du moins à essayer. Ils ne s’étaient même pas revus au dernier Noël. - Oui, tu me l’as déjà dit à plusieurs reprises à Noël dernier, que le mariage était prévu pour ce mois-ci. Et toi maman, pourquoi tu ne te remarierais pas, Mr Frog a encore fait sa demande, c’est le vieux Tom qui me l’a dit ce matin… Mais à peine avait-t-il prononcé ces quelques mots qu’il le regretta, il savait bien pourtant ce que cela allait déclencher… Et en effet l’habituelle litanie de réprobations se mit à cascader, et ce furent à n’en plus finir des : « Oh enfin, quelle idée ! », « Tu n’y penses pas », « Comment ! Tu voudrais que j’oublie ton père », « Moi, me remarier, jamais »… Pour échapper un peu à ce déluge, Victor se leva et se remit au piano, reprenant l’Allegro ma non troppo de l’Appassionata. Le flot finit par cesser et Eugénie revint à son idée première. - Quand je pense que vous vous entendiez si bien, Laura et toi, tu te rappelles ? Vous étiez inséparables, depuis que vous étiez tout petits. Eugénie avait toujours espéré qu’ils se marieraient ensemble. Laura était la fille du juge Wright, la famille était originaire de Richmond et était venue s’installer à Omaha la même année que les Brennan. - Et dire qu’elle va épouser cette grosse larve de Charles Pencil, c’est sûrement par dépit, car je suis sûre qu’elle aurait préféré… - Maman ! Tu me l’as déjà dit ! - Et toi, quand vas-tu te marier, Tu vas avoir vingt-quatre ans en août prochain. - Et bien justement, il n’y a pas d’urgence. - Et d’ailleurs, est-ce que tu reviendras pour ton anniversaire, pour le seize août ? - Je ne sais pas, ça dépendra… - Tu n’aimerais pas avoir ton foyer, une épouse, vivre une vie normale, plutôt que de… de vagabonder ainsi ! - Maman, tu exagères ! - Un jour, on va te mettre en prison ou même on va t’envoyer aux travaux forcés pour vagabondage, et tu travailleras comme un esclave sur une route ! - Maman ! Eugénie était tellement prise par ses pensées qu’elle n’accordait plus aucune attention à la musique. Victor était en train de reprendre depuis le début, depuis l’Allegro assai, il secouait la tête, sentant monter l’agacement. Ah, cette éternelle rengaine, sa mère qui voulait le voir marié... Eugénie s’était tu. Cependant, une question lui brûlait les lèvres, à chaque fois la même, mais jamais elle n’oserait aborder un tel sujet avec son fils. Elle se demandait s’il, ne, … ne fréquentait pas,… quand même, ces … ces lieux -elle n’arrivait pas à formuler même en pensée le mot « maisons closes. » Enfin, les trois jours se passèrent plutôt bien, chacun y mettant du sien. Eugénie se résigna, tentant de réfréner ses reproches, tandis que Victor resta attentionné, se gardant de montrer de l’impatience. VI - Avec un salaud pareil, ça va nous en faire des suspects, hein ? Parce que, le Julius, y avait un tas de gars qui lui en voulaient et qui auraient rêvé de lui faire la peau. Depuis tous les cocus aux dizaines de pauvres types qui ont été plumés en faisant affaire avec lui. C’est qu’il en a berné du monde. Ça risque d’être compliqué, vous croyez pas ? Paul Honor, le shérif de Delano, garda le silence et ne réagit pas mais il avait un air concentré et son adjoint qui le connaissait bien - ils travaillaient ensemble depuis quatre ans - savait qu’il avait été écouté. - Ouais, je vois que vous avez déjà une idée, c’est ça ? - Oh, y a pas à aller chercher bien loin, tu vois ce que je veux dire. Cette histoire de wagon frigorifique… - Vous pensez quand même pas à Albert Cooler ? Alors là, franchement,… Il se mit à ricaner. Y a mieux comme tueur sanguinaire ! Ce pauvre Albert, à part pleurnicher et se saouler la gueule depuis deux ans… - Je ne te dis pas que c’est lui qui a tué Julius Hole, mais… Il sait peut-être quelque chose. J’irai lui rendre une petite visite dès que possible. Paul Honor avait tout de suite été mis au courant du meurtre de Julius Hole. Et il en avait été plus que contrarié. Et pas seulement d’avoir été réveillé à trois heures du matin. Il s’était aussitôt rendu sur les lieux -même si sa femme Nellie lui avait dit que ça pouvait attendre : « Maintenant qu’il est mort, y va plus aller bien loin, tu verras ça demain »- mais le problème, c’était que personne n’avait rien vu apparemment. Bon, le shérif ne désespérait pas car il y a toujours des témoins qui mettent un peu de temps à parler. Et puis, il y avait un autre souci et ce n’était pas le moindre, le frère de Julius Hole, le richissime et puissant Blake Hole, déjà averti du drame, avait envoyé en fin de matinée un télégramme annonçant sa venue et sa ferme intention de retrouver le meurtrier de son frère au plus vite. Paul Honor redoutait la rencontre car Blake devait sans doute être tout aussi arrogant que son frère et il allait sûrement vouloir lui dicter ses exigences. Il allait l’avoir dans les pattes et il avait horreur de ça même s’il était bien décidé à ne pas se laisser faire. Mettant ces préoccupations-là de côté, Paul Honor se concentra sur son enquête. Avec son adjoint, il se rendit à nouveau sur les lieux pour les inspecter avec soin au grand jour et interroger encore les éventuels témoins mais il ne fut pas bien plus avancé. Puis, laissant à son adjoint le soin d’essayer de dresser la liste de tous les potentiels suspects, le shérif se rendit chez Albert Cooler, au 16, Douglas Avenue à Wichita. Paul Honor avait bien connu le père d’Albert et avait conçu pour lui une grande estime. Quand il avait appris la nouvelle de sa mort, il en avait été très affecté. Il le trouvait tellement courageux, avec cette affaire qu’il avait réussi à monter contre vents et marées. Il savait parfaitement que le fils de John était incapable de tuer qui que ce soit mais il voulait savoir s’il n’était tout de même pas mêlé à cette histoire. Entre deux verres de whisky, il avait peut-être trouvé le courage d’engager un tueur. Car si c’était le cas, quitte à prendre quelques libertés avec la loi (cela lui arrivait de temps à autre, oh, mais attention, jamais pour protéger de grands criminels mais plutôt pour tirer du pétrin de pauvres gars qui s’y étaient mis suite à un mauvais concours de circonstances) il chercherait comment l’aider, compte tenu de l’amitié qu’il portait à son père. Cependant si Blake Hole venait à apprendre qu’Albert était à l’origine du meurtre de son frère… Il ne donnait pas cher de la peau du jeune homme. Allez, on verra bien ! se dit Paul Honor, arrêtant là ses réflexions puisqu’il arrivait devant la maison des Cooler. Il connaissait les habitudes d’Albert et ne frappa pas à la porte principale, il contourna la maison. Cependant, elle avait l’air encore plus inhabité que d’habitude et elle l’était en effet. Le shérif interrogea alors une des voisines d’Albert, la vieille Carrie, qui jour et nuit était à sa fenêtre, épiant les faits et gestes de tous ceux qui passaient dans son champ de vision. Elle était tellement efficace dans ce domaine que Paul disait souvent à son collègue de Wichita qu’il devrait la prendre comme adjointe. Et quand elle lui dit que oui, ce matin très tôt, le petit Albert était parti sur sa vieille carne décharnée avec des fontes bien remplies, et qu’une semaine plus tôt, tard le soir, il avait reçu deux hommes, Paul se dit qu’il avait donc peut-être vu juste. Il alla aussitôt chez Frank End, le meilleur ami d’Albert, mais celui-ci lui affirma qu’Albert et lui étaient fâchés et qu’ils ne s’étaient pas vus depuis une semaine à peu près. Paul passa ensuite chez son collègue de Wichita, qui était déjà au courant de la mort de Julius Hole, et lui dit de faire rechercher Albert, mais discrètement, et de l’avertir si on le trouvait. Quand il revint à son bureau de Delano, son adjoint avait déjà noirci neuf pages de noms et entamait la dixième. - Alors, qu’est-ce que ça a donné ? - Je peux encore rien dire mais… - Ah, mais, quand même, quand vous dites ça c’est que vous avez appris quelque chose… - Eh bien, la vieille Carrie m’a dit qu’il s’était barré tout juste ce matin et qu’il a reçu deux types il y a une semaine environ, au milieu de la nuit. - Nom de Dieu ! Vous aviez sacrément bien vu ! Il faut le faire rechercher et l’arrêter ! - Ne nous emballons pas. Y’a l’autre Hole qui va se pointer et je suppose que ça va pas être un marrant. On va l’avoir sur le dos, ça va pas tarder. Albert, je le connais bien, je veux pas faire n’importe quoi et je veux l’interroger moi-même. - Ouais, mais il faut le retrouver. - Hum, pas d’inquiétude, je suis sûr qu’il n’est pas loin. - Et s’il s’était barré chez sa mère ? En Californie, je crois ? - On verra dans ce cas, mais… je ne pense pas. J’ai déjà prévenu Jack, on va le chercher. Dans les environs. Mais aussi bien, il reviendra tout seul. L’adjoint de Paul Honor se fia au flair de son chef, il avait une grande confiance dans le shérif qui depuis des années montrait perspicacité et courage - faisant le coup de feu quand il le fallait- et qui avait déjà mis derrière les barreaux nombre de coupables. En fait Albert n’avait pas du tout prévu de partir. Victor Brennan lui avait demandé de le croiser « par hasard » à dix heures du matin, à la sortie du barbier de Topeka Street, le lendemain de leur première rencontre, pour lui remettre les 545 dollars -Victor avait dû insister la veille pour qu’Albert ne l’encombre pas de ses 50 cents- et tout s’était bien passé. Mais le matin suivant l’assassinat, Albert avait été pris d’une irrépressible trouille et sans réfléchir, ayant jeté quelques affaires dans des sacs de selle, avait sauté sur le vieux cheval de son père pour partir au hasard. Il avait laissé le cheval aller où il voulait et celui-ci l’avait mené à El Dorado, à trente miles de là, où Albert avait demandé l’hospitalité à de pauvres fermiers. Quatre jours après la mort de Julius -dont le corps avait été placé dans un des wagons réfrigérés de la Hole Refrigerator Line pour éviter sa décomposition- Blake Hole et son épouse arrivèrent à la gare de Wichita. Blake était long, sec, vêtu de noir -comme il l’était toujours -d’un abord sinistre, sa triste mine n’étant pas due à son deuil, elle lui était habituelle. La petite femme à l’air maussade, vêtue d’une stricte robe noire, tellement effacée qu’on en percevait à peine la présence, était Hélène Hole, son épouse. Le couple austère s’installa dans la clinquante demeure de Julius. Etonnamment, Blake Hole organisa des funérailles très sobres pour son frère : pas de grande cérémonie, de tombe surmontée de statues, de couronnes en quantité, de cortège interminable, d’éloges funèbres grandiloquents. Blake Hole avait une allure si terne que cela fit dire à l’adjoint de Paul Honor (qui avait assisté à l’enterrement avec son chef et le shérif de Wichita) : « Il paye vraiment pas de mine, ce type, si j’avais pas su qui il était je lui aurais donné un billet d’un dollar pour qu’il puisse aller manger à sa faim… Quant à son épouse… elle était où ? Je ne l’ai même pas vue.» Les vieux parents Hole avaient demandé à leur fils de rapatrier le corps à Boston, pour qu’il soit déposé dans le caveau familial mais Blake s’y était fermement opposé. Ses parents n’avaient pas compris pourquoi il s’obstinait ainsi, mais il avait insisté et affirmé qu’il fallait respecter les dernières volontés de Julius. Ils cédèrent sans trop de difficulté : Julius avait toujours mené la vie qu’il voulait alors qu’il en aille de même pour sa mort… Ce que Blake n’avait par contre révélé à personne, c’était que, juste après la mort de son frère, il s’était très longuement entretenu avec lui -enfin… avec son esprit- lors d’une séance de spiritisme particulièrement exaltante, Julius lui ayant fait d’extraordinaires révélations. - Il « exige », rien que ça, monsieur « exige » ! - Allez, dites-moi tout, ça vous soulagera et ça soulagera aussi Nellie, ça lui évitera de vous entendre maugréer pendant des heures ce soir. - Blake Hole, cette espèce d’oiseau de mauvais augure, « exige » que je lui donne régulièrement des nouvelles de l’enquête et il a ajouté :« Si vous trouvez le tueur rapidement, je vous récompenserai. » Comme si nous étions ses larbins. Il « exige », non mais, à quel titre ! Ah, il est peut-être habillé comme un quaker mais il agit en tout cas comme s’il était Dieu tout puissant. Il faut que tout et tous lui obéissent au doigt et à l’œil ! - Bah ! Vous en avez vu d’autres… - Il dit également qu’il va faire venir des détectives privés de Chicago, de cette agence connue, là, tu sais, de chez Pinkerton. Après un silence, l’adjoint de Paul Honor, qui avait compris à quoi pensait le shérif, reprit : - Vous vous faites du mouron pour Albert, c’est ça ? - Les gars de chez Pinkerton, ils font pas dans la dentelle, et s’ils le retrouvent avant nous… Je comprends pas qu’on ait pas encore mis la main dessus, où il s’est fourré, ce con-là ! - Et sa mère ? - J’ai télégraphié, non, rien de ce côté-là. - S’il faut ratisser tout le Kansas… Cela ne fut pas nécessaire. Albert Cooler revint à Wichita, comme l’avait prévu le shérif, au bout d’une quinzaine de jours. Quant aux quatre enquêteurs de chez Pinkerton que Blake avait fait venir, ils avaient jusque-là fait chou blanc eux aussi. Ils avaient eu beau interroger, fureter, tout retourner voire menacer, ils n’avaient rien trouvé et le shérif savait que nul ne leur avait parlé d’Albert Cooler. Paul Honor se rendit aussitôt au 16, Douglas Avenue, prévenant son adjoint de n’en rien dire à personne. Quand il vit le shérif à sa porte, Albert recula, effrayé, comme si la poignée l’avait brûlé. Il avait une mine épouvantable, les cheveux ébouriffés, les yeux injectés de sang. Il resta interdit et ce fut Paul Honor qui insista pour entrer. - Bonjour Albert, alors on a fait un petit voyage ? - Euh… Oui, enfin, non… - Si tu veux bien, on va un peu papoter tous les deux. Le shérif entra et s’assit à la table de la cuisine sans attendre l’invitation. Albert ressortit machinalement sa vieille bouteille de rhum. - Je ne sais pas si tu es au courant, mais Julius Hole est mort. - Ah… - Tu n’en as vraiment pas entendu parler ? - Non, pas du tout. - C’est étrange, tout le monde ne parle que de ça en ce moment à Wichita et à Delano. - Et il est mort comment ? - Eh bien, pas en avalant un noyau de cerise de travers, mais bien plutôt d’une balle de Winchester en plein dans la tête. Albert sursauta comme s’il venait d’entendre le coup de feu. - C’est pas moi, répliqua bêtement Albert sans réfléchir. - Oui, ça je m’en doutais un peu. Il y eut un assez long silence, Albert avait les yeux baissés, il n’osait pas regarder le shérif. - Moi, je le sais, que ça peut pas être toi, mais,…ça fait quand même un bon bout de temps que tu claironnes un peu partout que tu voulais sa mort, à Julius. Tu étais où la nuit du 25 au 26 mai ? - Je sais pas, ici sûrement. Il avait parlé avec une voix si faible que Paul dut se pencher pour entendre. - Tu comprends, quand je dis que je pense que c’est pas toi, c’est juste ma conviction personnelle, mais tu avoueras qu’un type qui crie sur tous les toits pendant deux ans qu’il veut en crever un autre, ça fait un sacré beau suspect. Tu te rappelles vraiment pas ce que tu faisais cette nuit-là ? Tout se mélangeait dans la tête d’Albert, ça bourdonnait, bourdonnait, il était incapable de réfléchir. Et encore plus incapable de se rappeler qu’il avait passé cette nuit-là seul, à faire ses maigres comptes, se demandant bien comment il allait payer les trois ouvriers qui lui restaient puisqu’il avait donné à Victor Brennan tout l’argent qui était encore en sa possession. - C’est que je vais quand même être obligé de t’emmener, comme suspect, pour t’interroger. Et là Paul s’arrêta, il savait que cela suffisait, Albert était suffisamment terrorisé, il dirait tout ce qu’il savait, il n’y avait pas besoin d’en faire plus. - Mais vous avez dit que vous saviez que ce n’était pas moi, dit Albert, toujours d’une voix blanche. - Oui, mais je te le répète, c’est ma conviction personnelle, je n’ai aucune preuve, tu es le principal suspect. Et puis, si c’est pas toi, t’as bien pu engager quelqu’un pour le faire… Albert répondit trop vite : « C’est que ça coûte cher ce genre de type, et moi j’ai pas d’argent. » - Tiens, tiens. Albert se mordit les lèvres. Il finit par lâcher : - De toute façon, je connais pas son nom. Le shérif sentait que ça allait venir, il n’y avait plus qu’à laisser aller… - Ah oui, mais tu sais peut-être des choses, à quoi il ressemble, par exemple? Comme Albert hésitait et que le silence durait trop, Paul Honor décida d’en rajouter un peu. - Bon, allez, hop, puisque tu ne veux rien dire ici, suis-moi. - Si je vous dis ce que je sais vous me laisserez tranquille ? - Ah, bien, voilà qui est plus raisonnable. Bien sûr, on en restera là. Ce que je veux, c’est arrêter l’assassin. Même si tu n’es pas blanc-bleu dans l’affaire, mais bon, je veux bien passer l’éponge, en souvenir de ton père. On dira que tu as eu un moment d’égarement. Albert tergiversa encore. - Oui, mais… Lui… S’il apprend que j’ai parlé, il pourrait bien… - Se retourner contre toi et venir un soir avec sa Winchester pour te régler ton compte ? Le shérif le rassura tout de suite. - Ne t’inquiètes pas, je prends tout sur moi, je dirai que quelqu’un l’a vu à la sortie du Red Orchard. Après une nouvelle pause, Albert chuchota : - Je sais quasiment rien, je sais pas son nom. - Ça tu l’as déjà dit. Mais à quoi il ressemble ? - Un grand gars, habillé en noir. - Tu peux pas en dire plus, couleur des cheveux, des yeux ? - Les cheveux, bruns ou noirs, les yeux, je sais pas, noirs je dirais, foncés en tout cas. - Gros, maigre ? Jeune ou vieux ? - Mince et jeune, dans les vingt, vingt-cinq ans. - Des cicatrices ? - Je crois pas, j’ai pas vu, non, pas de cicatrices. - Habillé en noir, mais comment ? - Oh, des vêtements luxueux, très élégant, on l’aurait cru sorti du Capitole… Il y eut encore un long silence, puis Albert se lança, avec une voix tremblante. - Un type, euh… Il s’arrêta juste à temps, il allait donner le nom de Peter Drabek… Enfin, on l’a appelé Vic devant moi et on m’a dit qu’il était originaire du Nebraska. - Oh, dis-donc, voilà que la mémoire te revient ! - Et aussi… - Quoi ? - Oh, non… c’est une bêtise… un détail. - Dis toujours. - Qu’il jouait du piano. Là, le shérif s’esclaffa. Il se voyait envoyer des télégrammes à tous ses collègues du Nebraska leur demandant s’ils connaissaient un tueur qui jouait du Colt et du Beethoven ! - Bon et c’est tout ? - Oui, je vous assure. - Je vais te laisser. Reste tranquille pour l’instant, je te dirai quoi faire. Ne parle à personne d’autre. Le shérif se leva et était déjà en train d’ouvrir la porte, quand Albert s’écria : - Ah ! et aussi … - Quoi ? Il joue du violon également ? C’est ça ? - Non, il est gaucher. Paul Honor regagna Delano, se demandant si ces maigres informations l’amèneraient quelque part. S’il avait réussi à tranquilliser cette tête de linotte d’Albert en lui faisant croire qu’il suffisait de retrouver le tueur pour ne plus rien avoir à craindre, il n’en allait pas ainsi en vérité. Car si Hole venait à apprendre -ou quiconque- qu’Albert était le commanditaire du meurtre, il serait forcément arrêté. Mais Paul avait sa petite idée. Il lui suffirait de débusquer l’assassin, de le mettre hors d’état de nuire en lui collant quelques balles dans la peau (et par là même dans l’impossibilité de révéler qui l’avait engagé !), il invoquerait bien sûr la légitime défense, puis inventerait le motif qui avait poussé ce pauvre type à se venger, par exemple, qu’il avait été mis sur la paille par Julius ou tiens, que sa femme…. ou sa fille, oui, ça c’était pas mal, sa toute jeune fille, une petite de quinze ans, avait été déflorée par Julius. Paul Honor était content de lui, content de sa trouvaille et c’est plein d’espoir qu’il rentra chez lui. Il ne lui restait plus qu’à découvrir qui était le tueur, à le retrouver et à le supprimer. A cette pensée, sa bonne humeur se flétrit un peu.
68
« Dernier message par Apogon le jeu. 07/07/2022 à 16:05 »
Un jour sur Terre : La fleur et l'automate de Angie BEGUE Pour l'acheter : Lulu Amazon Nouhr regarda ses mains tremblantes, couvertes de sang. Qu'est-ce qui lui arrivait ? Ce n'était pourtant pas la première fois qu'il voyait cet épais liquide rouge... Encore moins sur ses propres mains. Il baissa la tête. Il était à genoux dans l'herbe. De petits cailloux lui entaillaient les genoux. C'en était douloureux. L'air avait une forte odeur métallique. Rien de surprenant. Car un corps était juste là. Contre ses jambes. Un corps cybili. La jeune femme se tenait la poitrine, vaine tentative d’endiguer son hémorragie. Mais ce n'était pas sa seule blessure. Quelqu'un avait voulu s'assurer de son trépas. Des cheveux roux, doucement bouclés, s'échappaient de son chignon défait et tombaient délicatement sur la peau hâlée de son cou. Ses yeux étaient remplis de larmes de douleur... Ou peut-être de tristesse. Elle caressa la joue de Nouhr de sa main libre, y laissant une trace sanglante du bout des doigts. — Ça ne fait rien... Ce n'est pas grave... chuchota-t-elle. Nouhr pleurait. Pourquoi pleurait-il ? Il ne pleurait pourtant jamais. Et puis... Qui était cette fille ? Il avait son nom sur le bout de la langue... Il était sûr qu'il le retrouverait, si cet horrible sifflement qui résonnait dans sa tête voulait bien se taire une minute. C'était… Chapitre 1 — Monsieur ! Nouhr se réveilla en sursaut. Une personne venait de l'appeler pour la troisième fois et le tirait enfin de son cauchemar. Ses yeux se fixèrent un court instant sur un plafond qu’il ne reconnaissait pas. Il détestait ça. — Monsieur... ! Le garçon se redressa vivement pour plaquer ses doigts sur les lèvres de la petite personne dont la voix aigüe lui vrillait les tympans. Son crâne lui fit payer sa précipitation d'un vertige et il en grogna de douleur. La petite humaine qu'il venait d'agresser, ne devait pas avoir plus de huit ans. Elle le fixait de ses yeux sombres et angoissés. Le geste brusque et le grondement du garçon avaient, sans doute, joué un rôle crucial dans la panique qu'il lisait sur son jeune visage. Bien joué, Nouhr. Tu n'as rien de mieux à faire que d'effrayer les enfants ? se reprocha-t-il à lui-même. Il grimaça et retira sa main de la bouche de la petite fille. Il remarqua par la même occasion qu'il ne portait pas ses gants. Il ne portait aucune de ses affaires, en fait. Seulement ce qu’il avait généralement au-dessous de sa cuirasse. Il détestait vraiment ça. — T'm'as surpris... bougonna-t-il en guise d'excuses. La fillette, à genoux près de lui, eut un mouvement de recul, préférant sans doute mettre un peu de distance entre elle et le cybili brutal. — Je savais pas si vous étiez vivant... expliqua l'enfant qui n'osait visiblement pas faire de gestes trop brusques en présence du garçon. Elle sentait la pomme, l'herbe tendre, la sueur et la terre. Elle venait probablement du verger qui se trouvait tout proche de la route. Sa mélodie portait les accents de l'insouciance que Nouhr enviait systématiquement à tous les enfants qu'il croisait... Toutefois, à l’heure actuelle, les notes qui la caractérisaient étaient ternies par l'inquiétude que le garçon avait instillé dans le cœur de la petite humaine. Le jeune cybili se força à détourner son attention de la fillette et de sa musique inaudible pleine d’innocence avant que la pointe d'amertume qui venait de se former dans sa poitrine ne lui fasse trop mal. Il se trouvait sous un vieux débarras à outils. Ça sentait l'odeur familière et rassurante du bois, mais aussi de la terre et du métal. Il percevait les craquements et les fourmillements de la nature ainsi que le chant harmonieux du vent qui dansait entre les arbres. Il trouva avec soulagement son armure et son épée posées contre un des piliers de l'habitacle à deux pas de sa position. Il ne se souvenait toutefois pas s'être désarmé, ce qui le rendit assez nerveux. Il n'aurait jamais enlevé son armure dans un endroit pareil. Il se leva pour aller la chercher et réalisa qu'il avait dormi tout ce temps sur un sac de couchage. Ce n'était pourtant pas à lui. Il glissa son regard sur la fillette qui s'était également relevée et ne le quittait pas des yeux. Impossible. Elle n'aurait pas pu le traîner jusque sous cet abri. Elle était si petite... Et c’était une humaine. Elle n’aurait jamais eu assez de force. — V-vous êtes pas là pour prendre mon p'tit frère, hein ? demanda la petite avec un air accusateur et aussi beaucoup de courage. Nouhr cligna des yeux avec surprise, sans comprendre. — Hein ?! demanda-t-il en la gardant dans son champ de vision tandis qu'il ajustait sa côte de maille sur sa tunique. — Ma maman dit que les cybilis de la GAMME, ben ils prennent les petits enfants comme mon frère. Nouhr secoua la tête avant de s'accroupir pour attacher l'une de ses genouillères. — J'suis pas avec la GAMME, moi. Vraiment pas. À vrai dire, il fuyait les Gardiens Absolus de la Morale et du Mérite comme la pire des calamités. Du moins, leur police et toutes les personnes venues de la capitale. Malgré cette affirmation, la jeune enfant ne semblait toujours pas rassurée. — Alors vous êtes là pour casser notr'maison ? Nouhr grimaça. Certes, il était rare de voir des cybilis hors des grandes villes qui ne soient apparentés ni à la GAMME, ni au MAGEs, mais il n’aurait pas cru qu’on puisse le confondre avec l’un ou l’autre de ces deux groupes. La Milice Armée Générale des États était un groupe de hors-la-loi qui sévissait en dehors des cités, se permettant de voler ce qu'ils voulaient aux agriculteurs ou de mettre à sac leurs villages par simple plaisir. La petite avait dû en entendre parler par des adultes, à coup sûr. — Bah nan... Moi j'suis juste un voyageur, hein. T'vois b'en qu'j'suis tout seul. Nouhr était loin d'être un grand orateur ou très extraverti. Il ne faisait pas la conversation à grand-monde. Mais il estimait devoir répondre aux questions de la fillette pour espérer qu'elle réponde aux siennes. C'était un tacite donnant-donnant et, avec les enfants, c'était beaucoup plus simple qu'avec les adultes. Eux, au moins, n’essayaient que rarement d’obtenir plus que ce qu’ils recevaient. Pas quand leur interlocuteur n’était pas un autre enfant, ou un membre de leur famille. Nouhr n’avait certes pas encore atteint vingt ans, mais il était assez âgé pour éviter d’être embêté par des prépubères. — R'garde, lui dit-il après avoir attaché sa ceinture à sa taille. J'cueillais des pleurotes dans l'bois qu'est là-bas. Il ouvrit une de ses sacoches d'une main pour lui prouver ses dires, lui montrant ses champignons tout frais, puis indiqua du doigt un bosquet un peu plus à l'est. — C'pour les vendre à Nyol. T'en veux ? Tes v’eux s'ront contents qu't'en ramène, nan ? La fillette se pencha pour observer les trouvailles du garçon avec méfiance, puis leva finalement le regard vers lui avant de lui tendre deux petites mains sales et calleuses. Elle semblait avoir enfin laissé sa réserve derrière elle, ce qui rendit sa mélodie inaudible plus adorable encore. Nouhr lui plaça une poignée de pleurotes dans les paumes avant de reprendre. — Y'avait quelqu'un ici, avant qu'tu m'trouves ? demanda-t-il alors que l'enfant examinait un des trésors qu'il venait de lui confier. Elle secoua la tête. — C'pas toi qu'a viré mon armure, hein ? chercha-t-il à s'assurer avant de fixer le fourreau de son épée à sa ceinture. — Non... répondit la fillette en fourrant négligemment les champignons dans les poches de sa tunique rapiécée. J'ai juste voulu toucher vos cornes, mais j'ai pas osé, en fait... Je peux, dites ? Nouhr grogna. — Nan. C'pas un truc qui s'demande, en plus, réprimanda-t-il La petite fille lui adressa une moue déçue puis baissa le nez, mais n'ajouta rien. Toujours en train de décevoir quelqu'un, à ce que je vois, se blâma-t-il encore, intérieurement. Nouhr soupira. Bon. Il reconstituait la scène. Il avait dû s'évanouir près de la route. Un passant l'y avait trouvé et avait généreusement pris le temps de le déplacer à un endroit plus confortable, à l'abri du vent et de la pluie qui menaçait. Ce devait être un voyageur, puisqu’il avait eu la bonté de lui laisser son sac de couchage. Il n'y avait pas à chercher plus loin. Rien de dangereux ne lui était arrivé. On ne lui avait rien volé du tout et son mystérieux bienfaiteur était probablement déjà loin. Tout allait bien, même s'il détestait l'idée d'avoir été sans défense des heures durant et qu'une personne inconnue se soit permise de le toucher. Il avait eu de la chance. — J'vais rentrer, hein. T'f'rais m'eux d'faire pareil, parce qu'va pleuvoir. Le jeune cybili était doué pour prévoir le temps qu'il ferait dans la journée. Il se fiait à ses sens. L'air s'était rafraîchi et il y percevait une très légère odeur d'ozone. Les petits animaux aux alentours revenaient lentement vers leurs abris respectifs et même le chant du lieu qu'il entendait sans vraiment l'écouter se faisait plus mélancolique à chaque seconde. — Tiens ! lança la petite fille en lui tendant une pomme pour le remercier de ses champignons. T'as pas bonne mine. Il faut manger ! Il voulait bien croire qu’il devait sembler épuisé malgré la sieste forcée qu’il venait de faire. Il manquait de sommeil. C'était ce qui l'avait fait s'évanouir en premier lieu. Parfois, il regrettait vraiment que le repos lui soit aussi difficile d’accès. Pas qu'il préférait tourner de l’œil sur la route, mais... Disons qu'il avait du mal à l'idée de vulnérabilité. Son besoin de contrôle sur son environnement était tel que se détendre lui était presque inaccessible. Il prit le fruit qu'elle lui présentait, la remercia d'un signe de tête, puis alla rouler le sac de couchage avant de l'embarquer sous son bras. — “Que le Chant des Déités te garde” ! récita l’enfant en portant ses mains à ses oreilles alors que son interlocuteur se préparait à la quitter. — À un d'ces jours, p'tiote, répondit-il, bien moins pieusement, à la fillette. Celle-ci le salua de la main avant de filer vers son verger. Nouhr, lui, prit la direction de Nyol. Après quelques minutes, il examina la pomme qu’on lui avait offerte avec un brin de suspicion. Ce n’était qu’une enfant... Elle n'allait quand-même pas l'empoisonner, si ? Il faudrait déjà qu'elle sache ce qui était susceptible de tuer un cybili et qu'elle puisse se le procurer. Assez peu probable. Il croqua dans le fruit en observant le ciel d'un mauvais œil tout en marchant. Il avait intérêt à se dépêcher ou il serait trempé avant d'être arrivé en ville. Et les Déités savaient à quel point il détestait être mouillé. Malgré l'urgence, il contourna prudemment un champ de ruines que la nature dévorait progressivement, puis arriva à une plaine où la terre était si meuble que l’eau d’une précédente averse y avait creusé de grandes flaques, stagnant paresseusement depuis lors. En passant, Nouhr jeta un œil à son reflet dans l'eau boueuse. Petit et finement musclé, les cheveux roux en bataille, son visage renfrogné au teint brun faisait ressortir un regard franc aux yeux d’une couleur proche du ciel. Sa tête était surmontée de deux cornes assorties à son regard qui luisaient fièrement et flottaient au-dessus de son crâne. Il passa machinalement son index sur la cicatrice qui lui grimpait sur le menton et lui barrait les lèvres en diagonale ce qui le rappela immédiatement son père. Il ne put s'empêcher de songer à quel point il était sacrément mieux loin, très loin de lui. Il se perdait dans ses souvenirs les plus glaçants et les plus douloureux quand un doux parfum de violettes adoucit l’air et apaisa son âme tourmentée. Il interrompit sa marche, puis leva le nez en fermant les yeux. Le vent venait de l'est et charriait avec lui l'odeur d'ozone et de gros cumulonimbus furieux. Mais aussi cette très délicate fragrance fleurie. Y avait-il un champ de violettes, dans le coin ? Étonnant… Il se tourna doucement contre le vent. Il aurait aimé aller vérifier, mais il craignait de se faire surprendre par la pluie qui menaçait d'éclater à tout instant. Il pourrait toujours revenir le lendemain. Il jeta un œil derrière lui. Nyol se profilait à l'horizon. À portée... Et pourtant, il restait encore de longues minutes de marche. Il nota donc mentalement l'emplacement de l'endroit où il se trouvait et reprit sa route à grandes enjambées. Sur la fin, il dû courir un peu car les intempéries n’avaient certainement pas attendu qu’il s’abrite. Il avait déroulé le sac de couchage et s'en était servi comme d'une protection de fortune, mais une partie de son équipement s'en était malgré tout retrouvée trempée et boueuse. Bon sang... Il allait falloir qu'il essuie soigneusement sa côte de maille et ses protections ou elles se mettraient à rouiller. Quelle corvée ! Une fois entré dans la ville, il s'abrita du mieux possible le long des gigantesques bâtiments de Nyol. Ces habitations étaient déjà impressionnantes... Mais elles faisaient pâle figure en comparaison de Piras. Il les voyait encore, ces tours immenses, faites de verre et de pierre, que les architectes de la GAMME s'échinaient à faire tenir malgré le passage du temps. Après avoir traversé une grande place rectangulaire, le jeune cybili finit par s'engouffrer dans un superbe bâtiment qui comportait d'impressionnantes arcades ainsi qu’un clocher qui datait du temps qui précédait l’avènement des Déités. Il s'ébroua, puis secoua le sac de couchage complètement imbibé d’eau. Près des cuisines bruyantes, il passa devant un humain trentenaire qui portait un tablier. Celui-ci lui donna familièrement une petite claque dans le dos. Paul. Nouhr n'aimait pas beaucoup être touché. Mais Paul était un inoffensif grand gaillard, alors il ne voyait pas vraiment l'intérêt d'esquiver ce qu'il interprétait comme des gestes d'amitié maladroits. Toutefois, il grogna pour communiquer son déplaisir, même si ça n'avait jamais rien changé à la façon dont le cuisinier le traitait. — Ça s'est fini en douche, ta balade ! le taquina le bonhomme. Paul était toujours comme ça avec les plus jeunes que lui. Particulièrement avec les enfants. Et, le cuisinier en était certain, Nouhr n'était pas adulte. Pas encore. Ce n'était jamais évident à définir sur le physique, avec les cybilis... Mais il en avait la conviction. Si ses employeurs l’avaient ainsi pris sous leur protection, c’était qu’il s’agissait encore d’un adolescent. — Mouais. ronchonna le petit rouquin, qui se serait bien passé de devoir éponger tout son équipement. — T'as trouvé ce que tu voulais, au moins ? Nouhr hocha la tête en guise de réponse. — Bon, ben reste pas là. Va t'sécher où tu vas prendre froid. Nouhr roula des yeux. Les cybilis ne pouvaient pas “prendre froid”. C’était bien une expression d’humains, ça ! Les maladies dont leur corps étaient parfois les victimes étaient très différentes de celles des êtres de chair. Leur nature magique les préservait des rhumes et autres broutilles. Toutefois, les afflictions qui leur étaient propres étaient - bien que rares - souvent mortelles. Puisqu’on le congédiait, le rouquin se rendit sans demander son reste à la chambre qu'il occupait depuis trois semaines, maintenant. Ça faisait un sacré bout de temps pour quelqu'un recherché par la GAMME. Surtout qu'il se planquait littéralement sous leur nez. Erod, le patriarche de la famille qui l'accueillait, était le Gouverneur de Nyol et faisait donc partie intégrante de l’État. Le garçon songeait à mettre les voiles. C'était la raison pour laquelle il faisait quelques menus travaux là où on voulait bien de lui et vendait également ses trouvailles en ville. Avec un peu plus d'argent, il pourrait acheter de quoi reprendre la route. Il avait déjà bien de la chance qu’une des familles les plus influentes de Nyol l'ait accueilli sans autre contrepartie que de dîner avec elle. Pour une raison qui lui échappait, le fait d'avoir un vagabond à leur table semblait remplir ses hôtes de joie et assouvir leur besoin d'exotisme. Nouhr, lui, était surtout inquiet à l'idée d'être découvert. Ou pire, qu'on accuse tous les occupants de la bâtisse d'être ses complices pour avoir sympathisé avec lui. Une fois dans sa chambre, le garçon entreprit de se dévêtir et de changer ses vêtements humides. Il sécha ensuite avec attention les pièces de sa cuirasse. Pour ses gants et ses chaussures, il faudrait attendre un peu. Heureusement, aucune des deux paires n'était trop mouillée. Il étendit également le sac de couchage au-dessus d’un meuble du mieux qu'il pouvait. Une fois qu'il fut assuré que ses affaires ne rouilleraient pas, le jeune homme s'autorisa à profiter de quelques instants de repos. Étendu sur son lit, il frotta machinalement entre ses doigts le tissus des draps propres. La fille de chambre les changeait chaque jour, ce que Nouhr trouvait être beaucoup trop. Ce devait être une autre vie que d'être né dans le luxe. Il n'était pas sûr que ça lui aurait convenu... Pourtant, son père avait un rôle plutôt important au sein de la GAMME et vivait plus que confortablement. Mais pour son fils, il avait fait d'autres choix. Alors que l’esprit de Nouhr vagabondait à nouveau dans ses plus mauvais souvenirs, le garçon flaira un parfum qu'il connaissait bien. Ihnee, la plus jeune fille de la famille. Elle devait avoir à peu près son âge, bien qu’il n’eut jamais demandé. Il écouta sa mélodie aiguë et sautillante comme une comptine d’été longer le couloir qui menait à la chambre du rouquin. Il se leva et ouvrit la porte avant même qu'elle n’ait frappé. Elle n'en fut pas surprise le moins du monde. Elle venait le chercher tous les jours depuis trois semaines et elle n'avait jamais eu à frapper. — Tu es rentré ! Le dîner sera servi dans dix minutes, le prévint-elle. Le garçon regarda les deux petites pointes jaune canari que formaient les cornes de la jeune femme glisser vers l'arrière de sa tête à l’instar des oreilles d’un petit chat. Comme à chaque fois qu’elle lui parlait, la peau pâle de son interlocutrice prit une délicate teinte rosée, juste sur les joues, et elle se mit à jouer nerveusement avec une mèche de ses cheveux brun aux reflets magenta. Nouhr se doutait qu'il y avait là un langage corporel qu'il était censé interpréter et comprendre... Mais l'ennui, c'était qu'il n'avait aucune idée de ce qu'elle essayait de lui dire. Personne d'autre n'avait jamais agi comme ça avec lui et, par ailleurs, il était le seul à bénéficier de ces drôles d’attentions de la part d’Ihnee... Ce qui le plongeait dans une certaine perplexité. — On peut patienter ensemble, si tu veux, proposa-t-elle en glissant son regard sur le torse de Nouhr qui, pour une fois, ne portait qu'une tunique et pas son habituelle côte-de-maille. — ... S'tu veux. J'arrive, répondit-il en lui claquant la porte au nez. Il revêtit sa maille protectrice car il ne se sentait un minimum en sécurité que lorsqu'il la portait. Après une courte hésitation, il passa aussi ses genouillères et ses coudières. On n'était jamais trop prudent. Il rouvrit ensuite la porte sur une Ihnee un brin contrariée... Elle le fut encore un peu plus lorsqu'elle posa à nouveau son regard sur lui. — Oh. Tu as remis ta... ferraille, constata la jeune cybilie avec déception. Nouhr ne vit pas l'intérêt de répondre à ce qu'il considérait comme une simple observation. — On y va tranquille ? proposa-t-il en commençant à arpenter le couloir. Ihnee lui emboîta le pas. — Qu'est-ce que tu as fait, aujourd'hui, alors ? demanda-t-elle, son enthousiasme déjà retrouvé. — J'suis allé chercher des champignons, répondit simplement Nouhr, sans entrer dans les détails, comme à son habitude. — Et qu'est-ce que c'était, comme champignon ? demanda Ihnee en lui saisissant la main dès qu'elle remarqua qu'il ne portait pas de gants. Nouhr grimaça. Il n'aimait vraiment pas être touché. Encore moins si c’était par surprise. Heureusement, Ihnee, malgré le pouvoir magique dont elle disposait avec certitude, ne devait pas être bien plus dangereuse que Paul. Sinon, elle serait dans un Camp de Formation de la police de la GAMME et ne serait sûrement pas à Nyol à attendre d’être en âge de se marier. Toutefois, le problème que Nouhr avait avec le contact physique, était indépendant de la dangerosité des gens. — Des pleurotes, répondit-il en prenant sur lui. — C'est bon, ça ? Les pleurotes ? Je ne sais pas si j'en ai déjà mangé. Il faudrait que je demande à Paul. Paul était chef cuisinier pour la famille d’Ihnee. Du moins, pour son père. Pour ce qui était de la jeune cybilie, elle se comportait toujours ainsi avec Nouhr. Elle posait beaucoup de questions et essayait de le faire parler le plus possible, au grand dam du garçon. — C'pas mauvais. Mais j'aime m’eux les Girolles. — C'est un champignon aussi ? — Ouais. C'est un champignon. — Tu m'en rapporteras, la prochaine fois ? — C'plus tell'ment la saison... Il fait d'jà trop froid. — C'est quand, la saison, alors ? — Quand il fait beau et chaud. — Génial ! Dans ce cas, il faut que tu restes jusqu'à cet été pour me rapporter des Girolles ! décida-t-elle. Nouhr grimaça encore. Ça allait être compliqué, ça. Il ne pouvait clairement pas rester aussi longtemps ou la Gamme finirait par lui mettre le grappin dessus. — On verra. P't'être que j'repass'rai. — Quoi ? Tu parles encore de t'en aller ? Mais puisqu'on te dit que tu es ici chez toi ! reprocha Ihnee avec une moue qui exprimait à merveille son insatisfaction. Mais Ihnee n'était pas au courant qu'il était recherché par les Gardiens Absolus de la Morale et du Mérite Égalitaire. Leur gouvernement. Ou du moins, par leur police. Pour avoir un peu trop mis à sac la capitale. Piras et Nyol n'étaient qu'à deux semaines de marche et les communications entre les villes étaient plutôt bonnes et rapides grâce à d’anciens sorts qui dataient d'avant la Malédiction... C'était pourquoi Nouhr commençait à trouver étrange d'avoir autant la paix. Certes, l'incident s'était déroulé plus d'un an auparavant, mais tout de même... Il devait rester prudent. Il n'avait que moyennement envie de finir ses jours en prison ou de faire un aller simple chez son père. Si les choses avaient été différentes... Il aurait peut-être envisagé la proposition de la famille de Ihnee. Tu ne peux t’en prendre qu’à toi-même. — Faut qu'j'reparte. J'peux pas rester. — Quoi ?! Mais pourquoi ? demanda sa jeune interlocutrice, visiblement mécontente de la tournure de la conversation. Même sa mélodie se faisait plus agitée. — J'peux pas, c'tout, répliqua-t-il avant de lui lâcher la main et d'entrer sans attendre dans la vaste salle à manger du domaine. Chapitre 2 Les deux demi-frères d’Ihnee étaient déjà attablés et lancés dans une de leurs – trop nombreuses - conversations à propos de politique. — Honnêtement, cet Arveil à la tête du Conseil, je le sens pas trop, exprima le dénommé Jehd. Son frère haussa les épaules en roulant des yeux. — Tu dis ça pour chaque nouveau conseiller... Pour moi, ils sont vraiment tous les mêmes. Tout juste adultes, les deux cybilis ne devaient avoir que quelques mois d'écart. Leur rythme dégageait encore l'énergie de l'enfance. Bess était le plus jeune, pourtant sa maturité était plus audible à la sensibilité de Nouhr. Toutefois, il croyait parfois percevoir une dissonance dans la mélodie simple et claire de celui qui l'avait pris sous son aile. Mais, à l’instant où il entendait la musique inaudible de son protecteur se déformer, il n’y avait déjà plus rien, tant et si bien que le garçon se demandait s’il ne l’avait pas imaginée. Et puis… Comment un cybili aussi bienveillant que Bess aurait-il pu produire des notes aussi torturées ? Il avait trouvé Nouhr le jour où le rouquin était arrivé à Nyol alors que personne ne faisait spécialement attention à lui. Il avait rapidement déduit qu’il n’était encore qu’un enfant, qu’il était seul et que quelque chose de difficile avait dû lui arriver. Le jeune Noble avait alors pris à cœur d'introduire le vagabond auprès de son père et de plaider en sa faveur pour qu'Erod lui accorde sa protection. — Tu plaisantes ?! reprit Jehd. Depuis qu'il est là, les taxes ont augmenté. Il multiplie les patrouilles aux alentours des villes et les plans de reproduction ont doublé ! Ihnee et Nouhr s'installèrent à la table sans trop se faire remarquer, mais Bess posa son regard sur son jeune protégé et esquissa un drôle de sourire. — Tu en penses quoi, Nouhr ? — ... Eh ? fit le rouquin en dévisageant les deux frères, pris au dépourvu. — On est assez en sécurité, à Nyol, selon toi ? précisa Bess Nouhr baissa la tête, prenant la question au sérieux, même s'il n'y connaissait pas grand-chose en politique. — Ben y'a pas tell'ment d'soucis... Alors j'dirais qu'ouais… — Tu vois ! C'est bien ce que je dis ! On n'a pas besoin de renforcer la police, renchérit Jehd. Bess conserva son regard sur Nouhr, ce qui ne manqua pas de mettre celui-ci mal à l'aise. — Vous avez peut-être raison. C'est vrai qu'il ne se passe rien et que tout est... exactement comme ça devrait être, admit finalement Bess en reportant son regard sur son frère aîné en souriant amicalement. — C'est ça ! Et en attendant, le Conseiller Arveil nous pompe tout ce qu'on a d'argent pour nous protéger d'on ne sait quoi ! — Assez de politique à table ! Et encore moins de blasphème envers les membres du Conseil ! gronda la voix grave d'Erod, alors qu'il entrait dans la pièce. Nouhr l'avait senti arriver. Le son profond et solennel que le patriarche dégageait résonnait dans la poitrine du garçon et lui dressait les cheveux sur la nuque. Son odeur froide, presque métallique, lui inspirait irrémédiablement le danger. Erod lui rappelait bien trop son propre père. Ils étaient à la fois semblables et différents... Mais leurs similitudes étaient bien assez vives pour que Nouhr ne s’adresse à lui que par “Monsieur” en articulant du mieux qu'il le pouvait. D'après Ihnee, Erod devait son important rôle de Gouverneur à son paternel. Ce dernier avait été le détenteur d'une puissante capacité magique que son fils n'avait malheureusement pas reçue. Toutefois, il semblait qu'Erod puisse malgré tout transmettre ce don à sa descendance. La GAMME lui avait donc offert un poste et une vie confortable en échange de sa coopération pour le plan de reproduction. Ihnee, Jehd et Bess, tous trois d'une mère différente, n'avaient pas hérité du pouvoir de leur grand-père. Ils attendaient donc d’être insérés ailleurs dans la société. Le patriarche s'installa en bout de table et observa ses fils d'un regard sévère qui ne sembla pourtant pas intimider Jehd. — Comme tu préfères, Père ! lança le garçon, d'un air presque taquin. Dans ce cas, nous n’avons qu'à discuter de cette fameuse histoire qui nous est parvenue aujourd'hui ! — Quelle histoire ? demanda Erod, méfiant, tandis qu'une domestique posait les plats devant les convives. — Tu n'en as pas entendu parler ? demanda Bess, d’un ton beaucoup plus grave que son frère. Il y a une rumeur... Tous les cybilis de Loutseou se seraient volatilisés. Les humains seraient incapables d'utiliser leur magie. En cherchant les disparus, ils auraient trouvé l'accès à un ancien sous-sol remplis de squelettes de cybilis... Finalement, ils n'étaient peut-être pas aussi en sécurité que ce Jehd avait affirmé un peu plus tôt. — Ça ressemble à une histoire pour faire peur, constata Erod Nouhr ne prêtait qu'une oreille distraite à ce qui se disait à table, en général. Il écoutait seulement au cas où il y aurait des rumeurs à son sujet ou à propos de son père. Il essayait de ne pas participer aux conversations, mais ses hôtes œuvraient justement à le faire parler de lui dès qu'ils le pouvaient. Pour le moment, grâce à l'histoire de Jehd, il avait la paix. — Probablement une invention pour effrayer les plus impressionnables. C'est de saison, ajouta le patriarche en plaçant sa serviette de table sur ses genoux. Il faisait référence à l'automne. La tradition était de se faire peur juste avant l'arrivée de l'hiver et de célébrer les morts et leur souvenir. C’étaient des coutumes qui dataient de bien avant l'avènement des Déités. — C'est ce que j'ai pensé, au départ, répondit Bess. Mais on est allés demander à Meric, figure-toi. Tu sais, c'est mon contact dans la police. Eh bien, il nous a dit que les communications avec Loutseou sont coupées depuis plusieurs jours. Personne ne répond. Rien. Pas un signe de vie. — C'est inquiétant, admit finalement Erod. Je verrai si j'ai plus d'informations sur cette histoire, demain. Nouhr avait commencé à manger et se faisait tout petit. Il n'aimait pas vraiment être assis là avec Ihnee et sa famille. Il avait l'impression d'être un intrus. Et tout était tellement trop luxueux... Trop confortable… Trop brillant. Il ne savait même pas quel couvert utiliser. Il y en avait tellement. Le premier jour, il avait mangé avec les doigts, ce qui lui avait valu une remarque de la part d'Erod. Il n'aimait pas ça non plus. — Il paraît que le Chef Fohrr va lui-même descendre de Piras pour voir de quoi il en retourne, reprit Jehd sur le ton ironique de celui qui ne croit pas du tout aux bruits de couloirs. Mais Nouhr en lâcha sa cuillère. Celle-ci tomba bruyamment dans son bol de porcelaine, faisant tourner tous les regards vers lui. — Ça va, Nouhr ? s'inquiéta Ihnee. Tu n'as pas l'air bien... C'était un euphémisme. Il avait pâli et ses mains s'étaient mises à trembler sans qu'il parvienne à les contrôler. Il les cacha sous la table, puis hocha la tête en s'appliquant à ne croiser le regard de personne. — Mh. J'suis juste un peu crevé. C'est r'en. Il fallait qu'il se calme. Il n'aimait pas mentir, mais il ne pouvait pas non plus clairement dire ce qui n'allait pas au risque de se retrouver en cellule dans l'heure qui suivait. Il serra les poings en espérant que ce geste dérisoire l’aiderait à trembler moins, puis il reprit sa cuillère pour poursuivre son repas. — Tu m'étonnes ! Tu es allé loin, aujourd'hui ? demanda Jehd, intéressé. C'était le plus âgé, mais il n'avait jamais quitté Nyol de sa vie. Pourtant il avait l'air d'en mourir d'envie. Les histoires de Nouhr l'intéressaient toujours beaucoup. Il avait bien essayé de l'accompagner lors de ses balades, mais son père avait refusé à chaque fois. Son fils n'irait pas s'aventurer au-delà des murs de la ville tant que le Grand Conseil ne lui aurait pas attribué une place dans la société. Et il lui importait peu qu'il soit déjà adulte. — À une d'mie heure du verger qu'est au sud-ouest, répondit le rouquin. — C'est ça. Un jour tu iras te promener et tu ne reviendras jamais en nous laissant en plan ! Tu en serais capable, hein ? accusa Ihnee en surjouant la contrariété. Nouhr lui adressa une moue contrite en posant sa cuillère dans son bol pour que la domestique puisse la lui enlever. — Qu'est-ce qu'il se passe, Ihnee ? demanda son père en fronçant les sourcils. — Nouhr parle encore de nous quitter ! se plaignit-elle à son père. Le garçon se tendit imperceptiblement. Il n'aimait pas du tout le regard plein de reproches qu'Erod posait sur lui. Mais tu as l'habitude des reproches. — Je t'ai dit que tu es ici chez toi, mon garçon. Tu es bien trop jeune pour voyager seul, qui plus est. Tu pourrais très bien te faire détrousser ou tuer par les MAGEs au détour d'un chemin. Nouhr grimaça en prenant une des fourchettes à sa disposition pour entamer le plat principal. Il savait qu'il avait eu de la chance qu’aucune personne malveillante ne l'ait approché pendant qu’il était assoupi, aujourd’hui. Il n'y avait pas que des dévots et des Bardes qui arpentaient les chemins des villes. Il garda toutefois ce qu’il s’était passé pour lui en songeant qu’il fallait vraiment qu'il trouve une solution à son problème de sommeil avant de quitter Nyol. Même si ça lui coûtait cher, il ne pouvait pas partir sans. Est-ce que les plantes qu'utilisaient les humains avaient une chance de faire effet sur lui ? Il n'avait jamais essayé. — Et Bess est déjà en train de faire le nécessaire pour que tu aies une place à Nyol, ajouta Erod en posant son regard sur son fils. Bess avait beau être plus jeune que Jehd, son père lui accordait plus de responsabilités. Aux yeux du patriarche, son cadet avait bien plus la tête sur les épaules que son frère aîné. Et puisque c'était Bess qui avait insisté pour prendre Nouhr sous leur protection, il lui avait délégué toutes les responsabilités qui y étaient liées. Soit, trouver d'où venait cet enfant, s'il n'était pas un déserteur de la GAMME et chercher ce qui lui était arrivé. Bess avait pour le moment assuré que les Centres de Formation n'avaient à déplorer aucun disparu. Nouhr écoutait chaque fois attentivement les compte-rendus de Bess, car selon ce que le cybili faisait, il pouvait le trahir et dépêcher en un rien de temps la police de la GAMME pour lui mettre le grappin dessus. Le jeune Noble avait également essayé à plusieurs reprises de discuter avec lui et de chercher à savoir d'où venait son petit aventurier, mais Nouhr s'était appliqué à ne rien révéler du tout. De toute façon, il sentait dans la mélodie de Bess que ce dernier n'y mettait pas vraiment de cœur. Il n'avait jamais vraiment insisté pour briser le mutisme du jeune cybili. — C'est exact, répondit Bess en souriant posément. On devrait même pouvoir te trouver une épouse. Nouhr aurait préféré disparaître que d'entendre ça. Ihnee lança un regard noir à son frère, mais reprit, légèrement enjouée. — Tu vois ! Personne n'a envie que tu t'en ailles ! — C'est vrai que je commence à te considérer comme de la famille, moi ! ajouta Jehd sur un ton rieur, mais sincère. Ils font semblant. Ils mentent. Tu n'es rien du tout, pour eux. Nouhr ignorait si c'était la voix chaleureuse de Jehd ou le contenu de ses propos qui lui faisait cet effet, mais il se referma immédiatement. Il n'offrit aucune réponse et se concentra avec un peu trop d'énergie sur le contenu de son assiette. Ses hôtes s’étaient habitués à cette façon qu'il avait de se déconnecter subitement de ce qui l’entourait et à quitter la pièce, parfois. Ils en étaient toutefois toujours un peu surpris et, quelque part, assez attristés. Ils l'avaient compris dès le premier jour : Ce gamin-là avait vécu des choses qu'il n'aurait jamais dû vivre. — Laissons un peu d'air à Nouhr, décréta Erod de sa voix forte qui ne souffrait aucune réplique. Le repas se poursuivit sur des choses plus légères, badines. Le travail de chacun, la rénovation d'un bâtiment d'avant l'avènement des Déités, si on avait déjà mangé des pleurotes dans cette maison... Seul Bess jetait de temps à autres des coups d'œil inquiets à Nouhr. Ayant définitivement décidé de ne plus prendre part à une discussion de la soirée, le garçon avait déjà achevé le contenu de son assiette et fixait celle-ci sans bouger, en attendant qu'on le congédie. Quand chacun eut terminé de manger et de boire, que les grâce aux Déités furent rendues, le repas prit fin et chaque membre de la famille fut autorisé à prendre congé. Il n'en fallait pas plus à Nouhr pour se lever de table et filer jusqu'à sa chambre. Il entendit seulement Erod demander à sa fille de rester auprès de lui encore un moment. Nouhr regagna sa chambre et retira ses chaussures humides en soupirant. Il commençait à se dire que Bess et Erod ne le laisseraient pas leur fausser compagnie aussi facilement que s'il avait été un voyageur adulte. Peut-être que l'idée d'Ihnee, de s'en aller en faisant croire qu'il allait seulement faire un tour, était la bonne. C'était un peu cruel, mais il ne pouvait pas non plus s'éterniser à Nyol pour leur faire plaisir. Pas dans ces circonstances. Il se posa un moment près de la fenêtre pour écouter la nuit ravir le rythme de la ville et la couvrir lentement d'un voile de mystère. Il aimait être attentif à tous ces petits changements... Et il se sentait définitivement plus à sa place dans la pénombre qu'au grand jour. Ça n'avait pas toujours été le cas... Mais c'était ainsi qu'il se sentait depuis... Il interrompit le fil de sa pensée en percevant le parfum et la musique d'Ihnee se rapprocher de lui. Que voulait-elle, encore ? Le garçon alla lui ouvrir, avant qu'elle ne frappe, comme toujours, et attendit qu'elle s'exprime. — Nouhr... Je... Tu ne voudrais pas qu'on passe la soirée ensemble avant d'aller se coucher ? C'est que... Tu n'as pas l'air en forme et... Je me disais que ça pouvait te changer les idées. Il la dévisagea un court instant et, alors qu'il allait lui répondre, elle le prit de vitesse. — Tu sais... Je dois épouser un type de Larmesile...Je le connais à peine... Je vais devoir quitter Nyol dans trois ou quatre ans tout au plus, pour aller vivre avec mon mari. Elle soupira et s'approcha de Nouhr, beaucoup plus près que ce qu'il aurait préféré. — Mon père n'est pas vraiment d'accord, mais... j'aimerais mieux t'épouser toi ! Si on s'y met à deux, on le convaincra sûrement ! On pourrait vivre à Nyol ensemble. Ou dans la ville que tu voudras ! On serait heureux, expliqua-t-elle en tendant ses doigts vers la joue du garçon qu'elle tentait désespérément de séduire. Nouhr tressaillit et la repoussa d'une main, sans ménagement. Il secoua la tête, troublé par cette déclaration qu'il n'avait absolument pas vu venir et dont il ne comprenait que confusément la teneur. — Nan... Simple, direct, mais probablement le râteau le plus douloureux que Ihnee ne s'était jamais pris. Il ferma la porte sur elle sans attendre, répondant à son besoin urgent de mettre de la distance entre elle et lui. Cependant, à peine le battant fut-il clos que la jeune cybilie frappa furieusement contre le bois. — Si tu entres dans la vie des gens sans jamais les laisser entrer dans la tienne, tu n'iras jamais mieux ! s'écria-t-elle, à la fois furieuse et désemparée. Encore quelqu'un que tu déçois. Mais Nouhr ne saisissait pas ce qu'il avait fait pour qu'elle exprime de pareils sentiments. À vrai dire, il ne la comprenait pas. Et il ne comprenait personne. Il l'entendit repartir, ses pieds martelant le sol avec humeur et sa mélodie rageuse exprimant avec excès la frustration induite par son cuisant échec. Nouhr soupira et s'allongea sur son lit. Pour la énième fois, il pensa que celui-ci était bien trop confortable puisqu'il conservait son armure sur lui et qu’il ne dormirait probablement pas. Il passerait juste une autre très longue nuit à fixer le plafond, à écouter les sons du soir et à ressasser ses souvenirs d'enfance. Ses souvenirs d'Abir. Sa sœur lui manquait. Un sifflement se mettait à résonner dans sa poitrine, dans son crâne, dans son corps entier, chaque fois qu’il pensait à elle. Comme un symptôme du manque. Oui, elle lui manquait à en mourir. Mais comment envisager d'en finir quand elle avait donné sa propre vie pour qu'il soit libre ? Il n'avait pas le droit. Il ne pouvait pas gâcher son sacrifice. Pourtant, chaque fois que son souvenir revenait le hanter, il souffrait le martyr de son absence. Son affection, ses encouragements, ses rires et ses sourires... Même ses réprimandes lui manquaient. Sans parler de sa mélodie enchanteresse. Il était si en colère contre lui-même… Comment se pardonner ? Il n’avait pas pu la sauver. Il l’avait perdue. Il était si en colère contre ceux qui l'avaient assassinée. Contre le monde entier, de n’avoir rien fait. Elle n'aurait pas dû mourir. Ils auraient dû s'enfuir ensemble. Elle devait le sortir de son calvaire. Alors pourquoi se retrouvait-il seul ? Il avait beau vivre avec Ihnee et sa famille depuis trois longues semaines... Il se sentait seul. Personne ne le comprenait comme Abir. Personne ne l'aimait comme Abir. Il était seul. C'est de ta faute. Tu aurais dû la protéger. Il se passa les mains sur le visage. Ses yeux lui brûlaient, comme chaque fois que sa mémoire tournait toute seule, lui rappelant les dizaines de souvenirs qu'il avait d’elle. Il s'en voulait de ne pas avoir été heureux. Maintenant, elle n'était plus là et il n'aurait plus jamais l'occasion de l'être. Il se leva et quitta sa chambre, longeant les couloirs jusqu'à atteindre l'une des quatre salles de bain de la riche habitation. Quatre salles de bains. Sérieusement. Tant d'agriculteurs n'en avaient pas même une seule ! Il actionna le Courant dans le lavabo et se passa de l'eau sur le visage. Ça faisait déjà un an. Plus d'un an. Et il ne s'en remettait toujours pas. Comment les autres faisaient-ils ? Il ne pouvait tout de même pas être le seul dans ce monde à vivre les affres du deuil ! C'était ce à quoi il songeait en retournant à sa chambre... Lorsqu’une odeur, un parfum, l'intrigua. Le parfum de violettes. Il était revenu. Beaucoup plus proche. Nouhr fronça les sourcils et, plutôt que de retourner s'allonger, il suivit sa curiosité. Est-ce qu'il y avait un bouquet quelque part, pas loin ? Est-ce que Paul prévoyait de faire une préparation à base de violettes ? Il suivit la fragrance au travers de la bâtisse endormie sans rien trouver. Pourtant, il crut plusieurs fois l’avoir à portée, mais c'était comme si son origine s'éloignait et se mouvait par elle-même. Étrange car il ne captait aucun autre parfum qui empruntait le même chemin que celui-là et ne percevait pas la moindre mélodie. Ce n'était, à priori, pas vivant. Frustré, il grogna et se résolut d’abandonner sa recherche. Il reprit la direction de sa chambre et, comme il s'y attendait, le parfum prit sa suite. Ça n'avait aucun sens. Il hésitait sur ce qu'il convenait de faire quand il s’immobilisa au milieu du couloir. Ça n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. La violette n'était qu'une distraction. Une distraction pour qu'il ne soit pas au bon endroit. Il venait de passer devant la chambre de Bess et il n'avait entendu aucun son. Pas une respiration. Pas une seule note de musique inaudible. Il y avait un courant d'air dans le couloir et ça sentait la pluie. Quelqu'un avait ouvert une fenêtre, quelque part. Ou bien une porte. Pire, n'était-ce pas l'odeur de la poudre qu'il flairait à l'instant ? Merde. Nouhr s’élança, martelant le sol dans sa course effrénée. Il devait réveiller tout le monde et les faire sortir d'ici. Vite. Mais à peine eut-il percuté qu'une puissante déflagration fit trembler toute la construction. Ces salauds étaient dans les sous-sols. Le jeune cybili allait reprendre sa course quand il aperçut une silhouette au bout du couloir. Fine et encapuchonnée, deux cornes cybilies bleutées flottaient au-dessus de sa tête. Nouhr ne voyait pas son visage, néanmoins deux yeux luisaient sous l'ombre de sa capuche et le fixaient. — Hey ! la héla-t-il, prêt à en découdre. Mais alors qu’il s’approchait, une mélodie familière attira soudainement son attention dans le couloir adjacent. Une voix terrifiée appelait à l'aide. Nouhr n'hésita pas et d’un bond, s'élança vers la voix, abandonnant la silhouette au capuchon. Il trouva Ihnee qui se débattait contre un immense humain d'une vingtaine d'années à la peau noire. Ses cheveux, groupés en une multitude de tresses aussi sombres que la nuit, étaient noués en un chignon sur le haut du crâne de l’assaillant nocturne. Une lumière se reflétait mystérieusement sur certaines d'entre elles et les teintaient d'or. Sa mélodie était aussi calme et légère qu'une nuit de printemps et ce, malgré la situation. Vêtu de cuir foncé, il conservait à sa ceinture une dague que Nouhr repéra immédiatement. Toutefois, ce n'était pas de cette arme que l'homme menaçait Ihnee. Il tenait à la main un étrange objet cylindrique, presque aussi plat qu'un disque et gros comme le chapeau d'un agaric des forêts. Un cercle concentrique était dessiné sur le dessus et brasillait d'une faible lueur rouge dans la pénombre qui les enveloppait. De l'autre côté, une tige métallique dépassait de l'objet. L'humain plaquait Ihnee au sol et, vu son poids, elle aurait toutes les peines du monde à s'échapper. Il tentait de lui enfoncer dans une des oreilles la tige de son outil. Nouhr n'était pas le genre d'adversaire bienveillant et courtois qui fait des sommations et s'incline respectueusement avant d'attaquer. Surtout pas lorsqu'une personne s’avérait ouvertement offensive. C'est pourquoi il laissa instantanément déferler son pouvoir, fit naître une boule de feu cyan entre ses doigts et la projeta sans plus attendre sur leur agresseur. L'humain reçu cette attaque de plein fouet au niveau de l'omoplate, ce qui le força à s'écarter de Ihnee. Il se donna de grandes tapes sur le torse pour être sûr que le projectile de Nouhr n'allait pas l’enflammer, puis posa son regard sévère sur le jeune cybili. — Ce n'était pas prévu comme ça, lança-t-il au rouquin, sur un ton de reproche. Nouhr s'était avancé devant Ihnee qui n'avait pas bougé, tétanisée par la peur. La mélodie claire de la jeune fille s'était beaucoup assombrie et menaçait d'affecter son jeune protecteur. Il était en garde. Genoux fléchis, le centre de gravité plus bas. Pied droit en avant et main droite en avant, levée et ouverte. Son poing gauche était, lui, fermé près de sa hanche gauche, prêt à frapper. Les flammes bleues parcouraient le haut de son corps. Concentré. Il devait rester concentré. Il n'était plus assuré que son adversaire ne bougerait pas et hésitait donc à utiliser à nouveau sa magie. La maison n’était peut-être pas à l'épreuve des forces qu’il employait et il ne voulait pas prendre le risque de provoquer un incendie tant qu’il ignorait ce que ces gens comptaient encore faire exploser. Tant que tout le monde ne serait pas à l’abri. Sa tunique, elle, n'était plus, dévorée par ses propres flammes. Sans regret. Il ne lui restait que sa côte-de-maille et ses protections aux coudes et aux genoux. Malgré tout, il s’élança dans le combat, frappant l’inconnu du poing. Il était rapide, vif et avait été entraîné à ça toute son enfance. Honnêtement, même sans magie, peu de combattants faisaient le poids face à lui. Mais la magie était toutefois le facteur qui allait lui poser problème. Car s’il craignait d’utiliser la sienne, son adversaire, lui, n’avait pas l’intention de s’en priver. Trop hésitant. Un mur transparent s’érigea brusquement entre les deux adversaires. S'il avait l'aspect du verre, il n'en avait pas la constitution car le poing de Nouhr s'y heurta durement. Le garçon jaugea rapidement la situation. Le mur était en réalité un disque. Un disque si grand qu'il touchait presque les parois du couloir. Il pouvait encore passer par-dessus, cela dit. Avec suffisamment d'élan... C'était ce qu'il comptait faire, quand l'humain repoussa son disque transparent contre lui et le fit reculer de plusieurs mètres, jusqu'à ce qu'il se heurte aux jambes d'Ihnee. La jeune fille était toujours au sol, en état de choc. — Elle va s'éteindre de toute façon, déclara l'inconnu avec un calme surprenant, au regard de la situation. — C'est toi qui vas crever ! cracha Nouhr en s'écartant du disque de son adversaire, tout en cherchant comment manœuvrer pour atteindre ce dernier. — Nouhr ! supplia Ihnee, tremblante, les larmes aux yeux en saisissant la cheville du garçon. Il fallait qu'il se concentre. Qu'il écoute le rythme de son adversaire. Ihnee était une gêne. Il allait se dégager quand une seconde déflagration retentit en faisant trembler les murs. — Bordel, mais vous foutez quoi ?! s'écria le rouquin en décidant finalement d'abaisser ses flammes et d'aider Ihnee à se redresser pour s'écarter du disque magique. Ce truc ne lui disait rien qui vaille et il craignait que la bâtisse entière ne finisse par s’effondrer sur eux. Il n’avait pas le temps de se battre. Il fallait qu’il fasse sortir Ihnee d’ici. Qu’il la mette en sécurité. — Si tu veux des réponses... Retrouve-nous à Léteric. — J'vais pas vous retrouver à Léteric, bande de tarés ! gronda-t-il sans comprendre pourquoi on lui demandait ça, si soudainement. Il soutenait une Ihnee tremblante qu'il fit reculer avec lui car l'homme venait d'avancer vers eux en même temps que son disque magique. Encore un peu et il pourrait bifurquer et fuir avec elle pour la mettre en sûreté. — Nous sommes la Partition. Nous répondons au Sifflement. L'appel à un monde meilleur. Tu ne veux pas savoir pourquoi ta sœur a été tuée, Nouhr ? Le jeune cybili en eut le souffle coupé. Les flammes qu’il avait gardées vivantes sur un de ses bras en guise de mise-en-garde vacillèrent et il eut l'impression que tout tournait autour de lui. Tout à coup, il n'était plus sûr d’être celui qui soutenait Ihnee. Peut-être était-ce l'inverse. Ces enfoirés le connaissaient. Ils savaient ce qui était arrivé à Abir. La raison de son assassinat. Qu'est-ce que c'était que ces conneries ?! Comment c’était possible ? Est-ce qu'ils travaillaient avec la GAMME ? Mille questions fusaient sous son crâne en ébullition et il sentait qu'une fois le choc passé, il exploserait. De rage. Incapable de rester concentré sur sa mission de sauvetage plus longtemps, il repoussa Ihnee brutalement, agrandissant son espace afin de contre-attaquer quand une sensation douloureuse lui vrilla brusquement l’oreille. Il avait été si bouleversé que quelqu'un s'était approché de lui à son insu. Son père aurait été furieux, s'il avait été là pour voir ça. Hébété, il porta la main à son oreille endolorie et se tourna vers l’agresseur qui l’avait sournoisement pris en traître. C’était Bess. Il était dans le coup. Nouhr se sentait mal. Horriblement mal. Et ça ne faisait que commencer... car sous ses yeux médusés, Bess se mua brutalement en un squelette et s’écrasa sur le sol dans un fracas métallique insoutenable. Un autre vacarme identique retentit tout près du garçon. Il était terrifié à l'idée de regarder ce qui en était à l’origine, mais il s'y força. Il était arrivé la même chose à Ihnee. Le garçon se baissa lentement, s'agenouillant auprès du corps inerte de la petite cybilie. Son cerveau refusait de percuter. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait, ni ce qui se passait. Rien n'avait de sens. Comment Ihnee et Bess pouvaient-ils s'éteindre si subitement et ne laisser que leur carcasse ?! C'était censé prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours pour qu'un cybili mort ressemble à... ce tas de restes sans visage, sans douceur, sans chaleur... Sans musique, ni parfum. Nouhr passa sa main sur le globe oculaire vide de vie de la petite cybilie, complètement abasourdi. — Bonne nuit, petit soldat. Lui chantonna la voix, beaucoup trop proche, de l'humain à la peau sombre. Et ce fut le noir complet. Chapitre 3 Nouhr cligna des yeux à plusieurs reprises, retrouvant progressivement l’usage de ses sens et de son corps. Où est-ce qu'il avait encore atterri ? Il était assis sur le lit d'une petite chambre assez modeste qui sentait le bois ancien et la lavande. Les petits meubles qui l’habillaient avaient un adorable côté champêtre et rustique. Un panier d’osier était posé sur une commode et contenait un pot-pourri odorant composé avec goût de fleurs séchées et d’épices. Une fenêtre était ouverte tout près de Nouhr et le vent lui emmenait les odeurs de la ville. Pas les plus agréables. C'était le soir et les mélodies d’ordinaires calmes, après le coucher du soleil étaient présentement loin de l’être. C’était bruyant et agité. Il entendait des clameurs, des éclats lointains. Il percevait, au loin, comme des tambours grondants, un rythme furieux. Les Nyolais étaient en colère et désemparés. La quiétude de la pièce où il était abrité, ne reflétait pas du tout l'état réel de la cité. Le garçon jeta un œil au-dehors. Vu où se situait l'horizon, sa chambre n’était clairement pas au rez-de-chaussée. Dans un accès de paranoïa, il s'empressa de fermer la fenêtre, angoissé à l'idée qu'on puisse s’en prendre à lui, malgré la hauteur. Un repas entamé était posé près de lui sur une table de chevet. Nouhr émietta entre ses doigts les restes de ce qu’il identifia comme un gâteau au chocolat, en roulant des yeux. Évidemment, on lui avait enlevé son équipement. Il ne portait qu'une tunique et elle ne lui appartenait même pas, ce qui le fit grogner. Il souleva les draps. Apparemment, on avait quand-même eu la décence de ne pas toucher à son sous-vêtement. Il prit le verre d'eau intouché posé près du plat et en renifla le contenu avec méfiance. Une fois à peu près rassuré, il en bu quelques gorgées. Il allait se lever et trouver un moyen de filer d’ici, mais il se figea. Une odeur venait vers lui. Une odeur humaine. Nouhr écouta attentivement les tonalités du rythme de ce nouveau venu, puis se calma. Ce n'était que Paul. — Nouhr ? Tu as terminé ? demanda le cuisinier en frappant doucement à la porte. J'entre. Nouhr quitta le lit au moment où un Paul soucieux faisait irruption dans la pièce. — Tu as mangé ? C'est bien. N'aies pas peur, je vais juste récupérer le plateau. Le garçon grimaça. Il aurait pu lui arriver bien pire, certes, mais cette situation lui était malgré tout très inconfortable. Il n’avait pas envie d’expliquer. Il n’avait pas envie d’en parler. Il n’avait même pas envie qu’on l’évoque ou même d’y penser. Pourtant… Combien de temps avait-il été dans cet “état” ? Il craignait de ne comprendre que trop bien ce que Paul voulait dire par “n'aies pas peur” et il sentait la honte lui dévorer sournoisement les entrailles. — C'bon, ça va, répliqua-t-il sèchement. Le cuisinier se passa une main sur la nuque, surpris. — Oh. Bon retour parmi nous... Tu étais... différent, ces derniers temps, remarqua le trentenaire. — On est où, là ? demanda Nouhr en glissant à nouveau un regard vers la fenêtre qu'il mourait d'envie de barricader. — ... Tu ne te souviens pas ? Je t'ai récupéré, il y a deux nuits chez Erod. Tu étais complètement paniqué et tu pleur- — On est où, là ?! coupa Nouhr en perdant un peu patience. Paul se tut et observa le garçon sans dire un mot durant un court instant. Comment pouvait-on changer du tout au tout en seulement quelques minutes ? C'était à n'y rien comprendre. Ce garçon renfrogné, agacé, presque en colère et plein d'assurance n'avait rien à voir avec la petite chose terrifiée et larmoyante qu'il avait prise chez lui deux nuits auparavant. Était-il arrivé quelque chose pendant son absence ? — On est chez moi, Nouhr. C'est ma chambre d'ami, ici. Le garçon fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'il faisait là ? Maintenant qu'il se posait la question, tout lui revenait douloureusement avec une précision dont il se serait bien passé. Le parfum de violettes, la maison attaquée, les explosions, l'homme aux tresses dorées, Ihnee, Bess... La mort. Un vertige l’ébranla et il gémit faiblement en tenant un instant l'arête de son nez, le temps que son mal de crâne daigne passer. — Ihnee et Bess ?! questionna finalement le cybili en relevant la tête, les traits tirés par l'angoisse. — Il n'y avait personne d'autre. Tu étais tout seul, lui répondit prudemment Paul qui semblait chercher ses mots. Le jeune cybili dû faire un gros effort pour ne pas céder à la panique. Il porta sa main à son oreille. Celle où Bess lui avait enfoncé la tige de métal de l'étrange objet cylindrique duquel il s’était armé cette nuit-là. L’engin s’y trouvait toujours. C'était vraiment arrivé. — J'ai remarqué ce truc, mais... tu ne voulais pas me laisser approcher, expliqua Paul. C'est quoi ? Nouhr n'en savait rien, mais il avait besoin de l'enlever. Tout de suite. Il s'approcha précipitamment du petit miroir circulaire accroché au mur opposé au lit pour examiner le corps étranger qu’il portait malgré lui. Les oreilles des cybilis étaient assez différentes de celles des humains. Elles faisaient partie intégrante de leur squelette. Il s'agissait d'une proéminence osseuse et pointue où reposait un petit plateau circulaire gravés de cercles concentriques. Certains luisaient parfois de la même couleur que leurs cornes et leurs yeux. Ces os couleur d’ivoire n'étaient pas recouverts de chair et la zone plate était percée d'un trou en son centre. L'appareil que Bess avait posé sur Nouhr y était parfaitement adapté. Impossible de visser ça sur le lobe d'un être humain. Le garçon essaya de l’agripper avec ses ongles, de l'arracher, rien à faire, ça ne voulait pas bouger et lui, commençait sérieusement à angoisser. — Ils sont où, les autres ? demanda-t-il, la voix beaucoup moins assurée. — C'est ça l'ennui... commença Paul. Il pinça les lèvres avec hésitation en observant Nouhr avec un drôle d’air. Un mélange de pitié et de méfiance, reconnut le garçon. Il pouvait entendre la mélodie du cuisinier se troubler et les battements de son cœur s’accélérer. Tout ça ne lui disait rien qui vaille. — Ils ont tous disparu. Tous. Tous les cybilis de la ville. C'est le chaos. Il n'y a plus de gouverneur, les administrations sont bloquées et une bonne partie de la police est hors-service. Tu es le seul qui est toujours là. Nouhr se retourna vers Paul en délaissant son reflet paniqué. La nouvelle était... mauvaise. Très mauvaise. Est-ce qu'ils étaient tous morts ? Comme Bess et Ihnee ? Mais... Pourquoi ? Pourquoi est-ce que quelqu'un ferait une chose pareille ? Tu les as laissés mourir. Comme Abir. Le jeune cybili s'appuya contre la commode qui se trouvait juste derrière lui, mais le parfum du pot-pourri était loin de suffire à l’apaiser. Il se prit la tête entre les mains. Il fallait qu'il rassemble ses idées. — Est-ce que ça va... ? s'inquiéta Paul. Mais il ne lui prêta aucune attention, entièrement concentré à relier les éléments. À trouver un sens à cette folie. D'abord, il était arrivé la même chose à Loutseou, selon la rumeur que Bess avait rapportée. Il y avait également eu cette histoire de sous-sols et de squelettes de cybilis, là-bas. S'il s'agissait également de l’œuvre de la dénommée “Partition”, alors il y avait fort à parier que, quelque part dans l'ancien bâtiment qui avait été la maison d'Erod, il y ait un accès à des sous-sols... Et qu'ils soient tous là. Qu'ils soient vraiment tous morts... Il n'arrivait pas à croire qu'une opération pareille se soit faite en une seule nuit. Ça avait dû prendre des mois de préparation et il y avait fort à parier que certains cybilis, comme Bess, soient dans le coup. Peut-être même des membres de la GAMME. Qu'est-ce qu'on pouvait bien leur promettre pour qu'ils se suicident ainsi sans y penser à deux fois ? Étaient-ils seulement au courant ? Qu'est-ce que c'était que cette “Partition” ? Quel était leur but ? Et surtout... quel rôle, lui, avait-il à y jouer ? Comment se faisait-il qu'ils le connaissent ? Qu'ils connaissent Abir ? Sa sœur avait-elle été une de ces terroristes, de son vivant ? Il n'imaginait pas du tout cette douce et patiente jeune femme participer à des crimes aussi atroces. Mais il ne l'aurait pas imaginé de la part de Bess non plus. — Nouhr, reprit Paul avec plus de fermeté. Qu’est-ce qu’il s’est passé? — J'suis pas sûr... répondit le petit cybili, le regard rivé sur le parquet. — Tu n'es pas sûr ou tu ne veux pas me le dire ? — On... On a été attaqué, bredouilla le garçon en se remémorant les faits. Il y a eu des explosions et un type, un humain hyper grand, essayait de foutre un truc comme ça sur Ihnee... Il indiqua l'objet vissé à son oreille qui semblait fait d'une matière plastique, un matériau que les civilisations actuelles ne savaient plus utiliser depuis longtemps. — Et Bess... Le garçon n'acheva pas sa phrase. Il n'avait pas le cœur à accuser le frère d'Ihnee à voix haute. — Je les ai vus mourir... d'un coup. J'capte pas c'qui s'est passé... Et j'me rappelle de r'en ensuite. Paul observa le garçon d'un air grave et inquiet. Il savait que Nouhr était quelqu'un de franc et il ne repéra aucun mensonge en observant son jeune visage. Même si ça aurait aidé qu'il sache quelque chose, il décida de ne pas insister. — Nouhr, reprit l'humain avec un peu plus de force et d'assurance. Personne ne sait que tu es ici. Mais tu es un coupable tout désigné. Maintenant que tu as l'air d'être redevenu toi-même... Je suggère que tu quittes la ville dès que tu te sentiras d'attaque. Paul était un homme sympathique et altruiste. Plutôt que de jeter les restes des repas de ses employeurs, il en faisait don aux plus démunis de Nyol. Il était bénévole à la soupe populaire et détestait de voir des enfants dans la misère. C'était quelqu'un qui aimait aider. Il était pieux et se sentait donc déchiré entre son affection pour le jeune garçon et son devoir envers le Grand Conseil de livrer le seul suspect en lien avec la catastrophe. Mais au fond de lui, il avait la conviction que Nouhr n'était qu'un gamin perdu à qui il était arrivé de mauvaises choses... Il avait vu les cicatrices sur son corps. Dans son dos. Il voulait croire que cet enfant avait été au mauvais endroit, au mauvais moment. Toutefois, en l'aidant, il se mettait lui et sa famille en danger. Sans compter qu'il serait de plus en plus difficile de le cacher, avec le temps. Cette décision le navrait. Il aimait beaucoup ce petit cybili, mais son départ de Nyol était la meilleure solution pour tout le monde. Nouhr retira ses mains de ses tempes et posa son regard sur Paul avant de hocher la tête, la mine tout aussi grave que celle du cuisinier. Il hésita un instant à lui dire, pour le sous-sol, puis se ravisa. Ça ne changerait pas grand-chose. Paul resterait sans emploi. La ville, sans autorité. Qu'ils trouvent les cadavres des disparus ou non, Nyol, comme on la connaissait, était perdue. L'heure était à la réorganisation. Ils n'avaient pas le temps de pleurer leurs pertes pour le moment. Nouhr choisit donc de garder pour lui cette précieuse, mais néanmoins inutile, information. — L'plus tôt, c'est l'm’eux. Si t'as mes affaires, j'peux bouger maint'nant. Paul fronça légèrement les sourcils. — Non, non. Pas en pleine nuit. C'est intenable, dehors. Si tu veux vraiment partir au plus tôt, pars demain matin. Tout le monde dormira et personne ne fera attention à toi. Le garçon haussa les épaules. Ça lui importait peu. Plus grand-chose ne lui importait, actuellement. Il ferait ce qui arrangerait le plus son ami. — Ok. — J'ai récupéré ce que tu avais dans ta chambre, là-bas. C'est dans l'armoire. Dis-moi si tu as tout. Je vais aller te préparer de quoi tenir quelques jours... — Merci, répondit le jeune cybili en ouvrant un des battants du meuble que son ami lui avait indiqué. Le cuisinier quitta la pièce, laissant le rouquin s'assurer que tous ses effets étaient bien là. Sa tunique avait brûlé, mais il en avait une autre. C'était un peu embêtant, mais ça aurait pu être pire. Il avait toujours une bourse pleine de pleurotes et une autre qui contenait l’argent qu'il avait amassé depuis son arrivée à Nyol. Pas des fortunes, mais c'était déjà ça. Toutefois, il n'avait plus le loisir d'aller acheter ce qui lui était nécessaire pour le voyage maintenant que la ville était en crise et qu'il était le suspect numéro un. Il faudrait qu'il se passe de somnifères, mais il pourrait toujours essayer des infusions à base de camomille ou de valériane s'il en trouvait sur le chemin. Il craignait toutefois leur inefficacité. Nouhr soupira, puis passa son pantalon avant d'aller voir si Paul avait besoin d'aide. Il n'eut aucun mal à trouver la cuisine dans le petit appartement de son ami. Le cuisinier malaxait avec vigueur sur son plan de travail une pâte caoutchouteuse. Nouhr en identifia les ingrédients à leur parfum agréable. Farine de blé, noisettes concassées, eau et levain. Du pain. — J'peux aider... ? proposa le garçon. — Pas pour l'instant. Mais assieds-toi, si tu veux. Le jeune cybili, tira donc une des chaises qui se trouvaient autour de la table à manger et retira une peluche sur l'assise. Il ignorait jusque-là que Paul avait des enfants. Il posa le petit ours en tissu sur la table en pinçant les lèvres et prit place. — Écoute... reprit Paul. J'ai entendu des rumeurs à propos de Nerves... Les gens là-bas accueillent les jeunes un peu perdus et les déserteurs de la GAMME. Tu pourrais aller t’y réfugier ? Je suis sûr qu'ils te protégeront. Le cuisinier soupira en roulant des yeux. — Ces gens-là vivent dans le péché et le Grand Conseil finira par les punir pour leur blasphème, mais je pense que tu devrais y être à l'abri un moment... Surtout vu ce qu'il se passe ici. Ces parias ne devraient pas être une priorité. — Mh. Mouais. P't'être... répondit le garçon, sans grande conviction. Un endroit qui échappait au contrôle de la GAMME ? Il n’y croyait qu’à moitié. À son avis, c'était pareil que partout. Il n’aurait la paix qu’après s’être fait oublier. — Pour y aller, il suffit de longer l'Eriol vers le nord. Ça devrait te faire quelque chose comme cinq ou six jours de marche, poursuivit Paul. L'Eriol était le fleuve qui coulait à l'ouest de Nyol. Le plus long fleuve de leur contrée. L'Ensao qui passait à Nyol n'était qu'une petite rivière, en comparaison. Les villes et villages qui étaient bâtis autour de son lit vivaient généralement de la pêche. — Ok, répondit le garçon. Honnêtement, il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire une fois qu'il aurait quitté la ville. Aller se cacher à Nerves ? Rejoindre Léteric pour avoir le fin mot de l'histoire ? Ce n'était pas la porte d'à côté, ça ferait un sacré voyage. Et Léteric était bien trop proche de Piras à son goût. Cela dit, si ce qu'avait raconté l'ami de Bess était vrai, alors son père était, de toute façon, en route pour Loutseou... Et pour Nyol. Sincèrement, le jeune cybili avait envie de savoir comment Abir était liée à toute cette histoire... Et il ne voulait pas que la Partition s'en tire à si bon compte après avoir tué tous ces gens. Mais à lui tout seul contre une rébellion si bien ordonnée... ? Il avait beau être un combattant exceptionnel, il serait complètement submergé par leur nombre. Car ces gens, il en était sûr, ne pouvaient être que nombreux. Nombreux, organisés et compétents. Il ignorait qui avait fabriqué la chose qui était toujours vissée à son crâne, ni à quoi elle servait, mais ça ne lui inspirait rien de bon. Son instinct lui intimait d'oublier toute cette histoire et de faire profil bas. Mais le sifflement qui venait du fond de sa poitrine lui hurlait le contraire. Il resta très réservé le reste de la soirée. Il essayait de démêler ce qu'il ressentait, de choisir la marche à suivre tout en aidant Paul à emballer quelques provisions pour son voyage. Il empaqueta ses affaires pour le lendemain et, une fois que tout fut prêt pour son départ, le cuisinier lui souhaita une bonne nuit. — Si on ne se revoit pas... Je chanterai pour toi, môme. Prends garde aux Silences. Nouhr hocha la tête et remercia le cuisinier, sans trop saisir ces formules qu'il avait pourtant maintes fois entendues au cours de l'année passée. Il retourna à sa chambre et, dans un accès d’angoisse, vérifia qu'il y était vraiment seul. Une fois rassuré, il se laissa tomber sur le petit lit, qui grinça doucement sous son poids. C'était déjà un peu plus proche de ce à quoi il était habitué... Mais il avait plus souvent passé la nuit sur de la paille ou à même le sol que sur un lit inconfortable. Comme chaque nuit où le sommeil le fuyait, il observa le plafond. Toutefois, il ne laissa pas ses souvenirs d’enfance avec Abir l’atteindre, non. Il cherchait, encore et toujours, à faire le lien entre tous les évènements. Le lien avec lui. Il bouillait de rage, furieux de s’être laissé avoir comme un bleu. Il était certain que la Partition le connaissait bien. Même très bien. Mais la seule personne qui savait des choses aussi intimes sur lui, c'était... Sa sœur. Et ça n'avait aucun sens car Abir était morte dans ses bras plus d'un an auparavant. Pourtant... Elle seule aurait pu savoir qu'il serait intrigué par le parfum des violettes. C'était sa fleur préférée, de son vivant. Et puis... L'assaillant vêtu de cuir sombre avait prononcé les mots “petit soldat”, qui étaient ses déclencheurs. Ça ne pouvait pas être une coïncidence, mais… Personne ne savait ça, à part son père. C’était l’un de ses pires cauchemars que quelqu’un apprenne ce que ces deux petits mots avaient comme emprise sur lui… Alors, comment savaient-ils ? L'explication la plus plausible était qu'il s'agissait d'un piège de Fohrr pour le récupérer, mais... À l'heure qu'il était, ce dernier était probablement en route vers le sud. Sauf si... Sauf si son père faisait lui aussi secrètement partie de la Partition. Ce n'était pas complètement dénué de sens. Le chef des polices Fohrr était un homme plein de charisme aux apparences parfaites. Calme, prévenant et juste. C'était ainsi que n'importe qui l'aurait décrit. Mais ce n'était que son masque. Nouhr le savait mieux que personne, Fohrr avait pour dessein de s'élever au-dessus de son rang social. Il voulait faire partie du Conseil. Il voulait être le Conseil à lui seul. Être adulé comme un Dieu. Avoir tous les pouvoirs. C'était ce qui l'avait poussé à concevoir Nouhr, dans le plus grand secret, et à en faire une arme docile et dangereuse. Il aurait probablement réussi si Abir n'avait pas découvert l'existence de son demi-frère et œuvré à l'exact inverse. Mais comment Fohrr aurait-il su, pour les violettes ? Il n'avait pas vraiment connu Abir. Elle n'était que l'insignifiante fille de la cybilie qu'il avait choisie pour enfanter son arme. Rien de plus que ça. Nouhr avait beau tourner et retourner la situation dans tous les sens, il lui manquait clairement des éléments. Les premières lueurs du jour pointaient déjà... Il était l'heure pour lui de s'en aller avant que les plus lève-tôt ne quittent leurs habitations. Il s'habilla, passa les pièces de son armure sur lui, puis cala le fourreau de son épée dans une glissière du grand sac que lui avait fourni Paul pour qu'elle soit accessible, puis, il hissa son bagage sur son dos. Il quitta l'habitation de son ami en faisant le moins de bruit possible. Et sans dire au revoir. Nyol était encore calme et vide. La mélodie de la ville endormie était apaisante et douce, surtout en comparaison de la veille. Le garçon progressa rapidement et la quitta avec un pincement au cœur. Elle l'avait abrité pendant trois longues semaines. Il lui en était reconnaissant. Ça lui avait permis de se reposer un peu. De se sentir en sécurité quelques temps. C'était révolu, à présent. On le rendait à sa vie d'incertitudes. Il prit la direction de l'ouest pour rejoindre l'Eriol. Ça ne coûtait rien d'aller à Nerves pour voir de quoi il en retournait. Il pourrait peut-être chercher des indices depuis là-bas ? Pas question, en tout cas, qu'il se jette dans la gueule du loup en fonçant à Léteric. Et puis, rejoindre le fleuve n'était pas une mauvaise idée car il pourrait y pêcher. Les poissons étaient moins difficiles à attraper que les lièvres, les faisans ou les canards. Une fois qu'il se fut assez éloigné de l'agglomération, il commença à se sentir un peu mieux. Plus apaisé. Il aimait marcher. Il aimait la nature qui l'entourait. Il aimait entendre les insectes ramper, sautiller, grincer. Il aimait le bruit des petits animaux qui s'écartaient sur son passage ou l'observaient avec curiosité, la mélopée champêtre d'un début de matinée d'automne. Il aimait l'odeur de l'herbe, des fleurs, la fragrance de la terre, le parfum corsé des arbres et des arbustes. Il aimait le vent qui chantait dans les arbres et qui lui caressait le visage en charriant l'humidité et le froid. Il se sentait bien plus dans son élément que dans une chambre à Nyol. Ici, il connaissait les règles. Il savait quelle plante éviter, quel fruit manger. Il savait quel animal suivre pour trouver un abri. Chaque odeur avait un sens. Chaque son, une valeur. Tout ce qu'il voyait définissait quelque chose. Il se sentait libre, mais clairement pas effrayé de l'être. Le monde rural, c'était son truc. Le ciel était maussade, mais l'odeur d'ozone ne lui arriva jamais. Pas de pluie de prévue. Il avança donc à bonne allure et décida d’une courte pause déjeuner dans des ruines envahies de végétation qu’il avait assez repérées par le passé pour les estimer sans danger. Elles étaient partout, ces vieilles bâtisses qui précédaient la Malédiction. Nouhr se posa sur un tas de gravats, près d'une maison dont le toit s'était effondré depuis des lustres. Il avala un morceau de pain et un bout de saucisson. Ça lui suffirait pour l'instant. Il reprit ensuite sa route en prenant le soin de quitter les ruines puisqu’il les connaissait moins bien, passé un certain point. On ne savait jamais avec elles. Elles pouvaient se montrer instables et cacher de mauvaises surprises. Il valait mieux les contourner, en général. L'après-midi, il progressa plutôt bien. Si bien qu'il atteignit le fleuve plusieurs heures avant la tombée de la nuit. Il se mit à le longer en allant vers le nord, puisque c'était ainsi qu'il était supposé rejoindre Nerves. Le voile de la nuit recouvrit le chemin du jeune cybili, tout doucement et Nouhr hésita à continuer. Les cybilis étaient nyctalopes. Le problème de la visibilité ne se posait pas. S’il savait déjà qu’il ne dormirait pas de la nuit... il se sentait toutefois déjà éreinté. Même s'il ne s’assoupissait pas, il trouva important d’accorder à son corps un peu de repos. Dommage qu'il n'ait trouvé sur son parcours aucune plante susceptible de lui apporter le sommeil. Il faisait peut-être déjà trop froid... Mais il gardait l’espoir de trouver de la Valériane près des collines, en chemin. D’ici là, il faudrait qu’il tienne le coup et se surmener ne ferait que le rapprocher du moment où il n’aurait plus la force de continuer sans dormir. Il choisit de s'établir à une certaine distance du fleuve. Les étendues d'eau, ce n'était vraiment pas sa tasse de thé. Il ne savait pas nager. Non, plutôt... Il n'arrivait pas à nager. Dès qu'il était submergé, son corps comme son cerveau refusaient de lui obéir. Il préférait, par conséquent, garder le fleuve à au moins deux dizaines de mètres de lui. Il sortit son sac de couchage et l'étala au sol avant de s'y allonger. Le ciel s'était dégagé et les étoiles étaient magnifiques. Il devait admettre que dormir à ciel ouvert lui avait manqué. Bon, c'était moins amusant quand il pleuvait... Mais ça valait le coup de subir quelques rincées, si c'était pour avoir la chance de voir la voûte céleste scintiller rien que pour lui. Il pouvait les observer des heures durant, ces points lumineux, loin au-dessus de sa tête. C'était presque sa récompense de la journée. Tout en contemplant les astres, il grignota quelques morceaux de pain et de saucisson. Une fois à peu près repu, il ferma les yeux pour se les reposer, essayant du mieux qu'il pouvait de ne pas repenser aux squelettes sans vie de Bess et Ihnee. C'est à ce moment qu'il refit surface. Le parfum des violettes.
69
Résumé : Serons-nous l'esclave de notre assistante de vie connectée ?
Nos traces sur le Net constitueront-elles des preuves à charge ?
La parole et la pensée deviendront-elles pathologiques à l'heure de la communication concise et fonctionnelle ?
Qu'arrivera-t-il si les algorithmes des moteurs de recherche effaçaient des pans entiers de notre mémoire collective ?
Autant de questions parmi d'autres, qu'Estelle Tharreau soulève dans Digital Way of Life, ce nouvel « art » de vivre numérique qui place l'homme face au progrès et à ses dérives. Mon avis :Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce recueil au résumé alléchant. Je connaissais l'auteure à travers ses thrillers. Pour les plus curieux, mes chroniques : La peine du bourreau / Les eaux noires Je suis donc ravie de découvrir ce nouvel exercice d’écriture au travers de ce recueil de nouvelles d'anticipation à la plume incisive, ciselée et parfaitement maîtrisée. dans un univers glaçants et terrifiant, ces textes profonds et travaillés nous plongent, nous enserrent et nous engloutissent dans un futur probable, où on assiste impuissants aux dérives d’une humanité régie par les nouvelles technologies et le virtuel. Pathologique : un enfant qui a trop de vocabulaire, qui dérange, et que l’on veut rééduquer à tout prix. Virtualité réelle : une réalité en trompe l’œil ayant pour dessein d'endormir et de canaliser les désirs, les besoins, les déviances humaines sous couvert d’un monde parfait. Mais quand tout le monde dort, quelle réalité est réellement programmée ? Aveuglement amoureux : quand la justice numérique, pour ne pas se surcharger, fait aveuglément confiance aux algorithmes, ce, sans réflexion, sans remise en question, sans discernement aucun. Peut-on remplacer l'humain par la machine, ce, sans dégâts ? N’a t’on pas besoin de la conscience humaine, aussi imparfaite soit-elle ? Inhumains : le problème des humains réparés par des technologies futuristes sans prendre en compte la dimension de l'âme. Des humains qui à partir de cet instant perdent ce statut car ils engendrent la peur et la méfiance. Automatique : un robot connecté qui gère à votre place la totalité de votre quotidien… c’est tentant, n'est-ce pas ? Toutefois, attention, ils sont loin d’être infaillibles ! Eternité : vous voulez rester éternel ? C'est ce que vous propose la technologie ; sauvegarder votre moi, vos souvenirs pour toujours. Tentés par ce paradis artificiel ? Ce sera à vos risques et périls. Profil : Un professeur compétant et talentueux se voit rattraper par le profil FaceBook créé pendant son adolescence. Une nouvelle qui fait réfléchir sur les dégâts de la diffusion de votre vie privée à toute personne étrangère à votre cercle privé. Bouton rouge : Une nouvelle très courte ; que restera-t-il de notre mémoire collective dans les siècles futurs si les seuls récits sont numériques et que le livre papier a disparu? Dialogue entre deux hommes qui n’ont pas eu le même vécu le premier se souvient de ce que son père lui racontait, l'autre n'a pas accès à ce savoir, puisque les livres n'existent plus… Harceleuse : montre ici aussi le problème de la différence ; Julien, un père attentif, refuse que sa fille, beaucoup trop jeune, rentre dans le moule, plonge dans ce monde virtuel d’apparence si parfait dans lequel évoluent déjà ses camarades de classe, où plus besoin de mot pour s'exprimer ; seules des émoticônes suffisent. Mais est-ce possible ? Ne va-t-elle pas être confrontée au jugement, à la désocialisation, à l'oubli ? Une nouvelle criante de vérité sur les dangers du numérique et de l’uniformisation. La trappe : avec tout ce qu'il a fait subir à la terre, comment l'homme peut-il survivre, surtout s’il agit dans son coin ? Le juste retour de bâton pour ces Hommes qui ont agi sans foi, ni loi est sans concession. Alors même si ces dix nouvelles sont des fictions sur la distorsion de notre usage numérique, elles ont le mérite de questionner, de tirer la sonnette d'alarme sur des abus en tout genre, repoussant une réalité qui pourrait survenir à tout moment si nous n’y prenons pas garde. Ici, les sentiments, les contacts humains, la vie privée et même la mort sont piétinés, étouffés, déchiquetés. Ici, ces mondes sont tous vides de chaleur humaine et d'empathie envers autrui. Ici, l’affectif semble être mis au placard… Seule la connectique règne en Seigneur implacable, dictant ses règles, planifiant votre journée, muselant votre individualité. Des futurs possibles qui n'ont rien de réjouissant pour notre humanité, bien au contraire. Vouloir tout lisser, tout uniformiser, tout régenter, tout réguler, est-ce ce que nous voulons pour nos enfants, nos petits-enfants ? Une telle domination est-elle bénéfique pour l’avenir de l’Homme ? Au final, après cette lecture qui secoue, qui aide à prendre conscience d’un possible trou noir absorbant ce qui fait de nous des humains, n’êtes vous pas nostalgiques de la vie d'avant sans les portables, la téléréalité et l'époque où les gens se parlaient en face-à-face et non cachés derrière des écrans ? : Ma note :       Pour vous le procurer : Éditions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : Twitter Facebook Pour vous le procurer : Éditions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : Twitter Facebook
70
« Dernier message par Apogon le jeu. 23/06/2022 à 17:05 »
Il n'est jamais trop tard pour libérer les licornes de Mélodie Miller Pour l'acheter : AmazonIl n’est jamais trop tard pour libérer les licornes * Amour et fantaisie vont de pair.
Marc Chagall
Je voudrais écrire comme je fais mes peintures, c’est-à-dire, comme la fantaisie me prend, comme la lune me dicte.
Paul Gauguin
Il est doux à tout âge de se laisser guider par la fantaisie.
Marcel Proust1
Chère Manon, dans 20 ans
J’espère que tu vas bien et que tu es heureuse dans ta vie. J’ai 10 ans et je pense souvent à toi. As-tu toujours les cheveux longs et bouclés ? De quelle couleur est ta robe préférée ? La mienne est rose malabar. J’adore aussi les bonbons crocodile et les chamallows. Est-ce que tu dors encore avec Charlotte, la licorne ? Elle est trop gentille, elle comprend tout. Comment va ton chien ? Je suis sûre que tu as un chien parce que, moi, je ne pourrais pas vivre sans. Est-ce que tu habites en ville ou au bord de la mer ? Je rêve de pouvoir me baigner tous les jours, quand je serai grande. J’adore quand on part en vacances avec maman et Théo, faire du camping en Bretagne. Papa ne veut jamais venir, il dit qu’il n’aime pas camper. Et toi ? Où vas-tu en vacances ? Tu préfères le chaud ou le froid ? Le bleu ou le rose ? Est-ce que tu as appris à cuisiner ? Excuse-moi, c’est pas mon fort pour l’instant, mais je te promets de m’y mettre. Claire a dit qu’elle allait m’apprendre. Oh, je croise les doigts pour que tu sois toujours amie avec Claire ! Est-ce que tu es mariée ? Tu as des enfants ? Moi, je veux avoir un mari trop drôle, pas comme papa, mais autant que Pierre. Et aussi gentil et beau que lui. Je t’ai parlé de ses yeux couleur d’éléphant bleu et de son vélo tout rouillé qui nous emmène sur la lune ? Ah ! Peut-être que tu es mariée avec Pierre ? Je te le souhaite. Enfin, je nous le souhaite à toutes les deux. Ah ! Ah ! C’est trop drôle de parler avec toi ! J’aimerais qu’on ait des jumeaux. On les appellerait pareil, genre Jean et Jeanne ou Louis et Louise ou Gabriel et Gabrielle. Et on aurait un chien et puis deux lézards et deux poneys. Est-ce que tu as tout ça ? Des enfants et des animaux ? J’espère que tu as un travail qui te plait. Ça a l’air d’être trop difficile de trouver le bon. Maman n’est pas heureuse dans le sien. Elle travaille à la caisse, au Carrefour. Moi, j’aime bien jouer à la caissière avec Théo. Mais, en vrai, j’aimerais trop être exploratrice de l’espace ou marchande de bonbons dans un manège ou bien coiffeuse pour chien. Et toi, tu fais quoi ? C’est maman qui m’a proposé de t’écrire cette lettre. Elle dit qu’il faut toujours se rappeler d’être enfant. Ça a l’air d’être important pour elle.
Bon, je te laisse, Théo veut aller jouer dans le jardin. C’est notre journée des pirates. On part chercher le trésor enfoui.
Je t’embrasse.
Manon des étoiles (c’est comme ça que maman m’appelle).
P-S : si tu cherches le trésor, il est à côté de la balançoire. Mais c’est pas un vrai trésor, hein, juste une barrette dorée et des pièces en chocolat. Je te préviens pour que tu cherches pas pour rien. 2 PARIS, CHEZ MANON 4 AVRIL Manon se frotte les yeux. Elle éteint le réveil et s’étire dans son lit. Il est 6 heures du matin, Paris s’éveille. Les klaxons des premiers livreurs troublent le silence de la nuit. Elle se lève en se massant les épaules, jette un bref coup d’œil par la fenêtre. Sous la lune dorée, la façade de l’Opéra Garnier brille de mille feux. Elle la regarde à peine. Le ciel est dégagé, ils pourront courir longtemps, c’est bien. Elle enfile sa tenue de sport préparée la veille, pantalon et veste de running noirs, soigneusement pliés sur le dossier de sa chaise. Comme chaque matin, elle rejoint Julien, son coach, au jardin des Tuileries. Elle s’entraîne pour le marathon de Paris, en octobre. Elle n’a jamais manqué un seul entraînement. Elle se félicite mentalement. Elle se dit que son père sera fier d’elle. Il aime qu’elle soit sérieuse. De retour à la maison, sous la douche, elle planifie sa journée : finaliser le rapport financier, appeler l’expert-comptable, répondre aux mails et attraper le train de 20 heures pour la Normandie. Manon s’installe quinze jours chez sa grand-mère, pour les vacances. Elle pourra se reposer et continuer de travailler au calme, avec efficacité. Mamita lui préparera ses petits plats favoris. Et, le soir, elles jardineront ensemble. Tout est prévu et organisé depuis des semaines. Tout… sauf ce texto de Susana, sa boss. — Manon, c’est une urgence ! Retrouve-moi à 13 heures, au Café de la Paix. Manon se fige sur place. Elle déteste l’imprévu. Susana vient d’accoucher. Pourquoi l’invite-t-elle dans un lieu si chic ? Surtout en ce moment ? Avec la pandémie, les résultats de Stella sont catastrophiques. Une partie de l’équipe vient d’être licenciée. Manon se laisse tomber sur son beau canapé en lin beige. Impossible de se voiler la face. C’est elle qui prépare les bilans mensuels. « Mon tour est venu », réalise-t-elle avec angoisse. Créée par Jorge et Stella Perez, à Ibiza, dans les années 80, l’agence d’événementiel Franco-Espagnole a longtemps détrôné toutes les autres. Lancements de marques de luxe, organisation de réceptions privées, inaugurations d’hôtels d’exception, Stella conseillait tous les VIP. Mais le virus est passé par là, les clients ont coupé leurs budgets et l’agence, ses effectifs ! À 28 ans, après de brillantes études dans la meilleure école de commerce, l’avenir de Manon est tout tracé. Elle a effectué son premier stage chez Stella. Puis, rapidement, Susana lui a délégué des responsabilités stratégiques et financières. — Tu es la seule à manier les tableaux croisés Excel aussi vite ! Tu rassures les clients. Ils savent qu’avec toi, le budget sera respecté. — Merci Susana, on croit souvent que l’événementiel est un métier de créatif. Loin de là ! C’est surtout un gros travail d’organisation, de planification et de logistique. — Et pour ça, tu es la meilleure, ma chérie ! Manon a l’habitude. Pendant des années, après le départ de sa mère, elle a géré la maison, pour épauler son père. « Que va-t-il se passer si Susana m’annonce aujourd’hui mon licenciement ? Et mon prêt étudiant que je n’ai pas fini de rembourser ? Et papa, sans emploi, la tête plongée dans ses collections de timbres ? » Manon est pétrifiée. Cet appartement, en plein cœur de Paris, c’est tout ce qu’elle possède, et encore il ne lui appartient pas. Elle balaie du regard le salon aux larges fenêtres, la table basse en bois wengé chinée l’année dernière lorsque Susana l’a promue directrice financière, la collection de tableaux d’art contemporain acquise avec son premier bonus. « Comment vais-je payer le loyer ? » La table du petit déjeuner, dressée hier soir avant de se coucher, est prête, nappe repassée, céréales complètes, lait d’amande, jus de fruit et thé vert sencha bio. « Je me contenterai d’un expresso, ça m’a coupé l’appétit ! » Encore sous le choc, Manon va se brosser les dents en retournant le sablier recommandé par son dentiste. Trois minutes réglementaires matin, midi et soir. Claire, sa meilleure amie, se moque souvent d’elle. — Sérieux, Manon ? Qui d’autre que toi utilise un sablier pour se brosser les dents ? — Tout le monde devrait ! C’est important la discipline. — On croirait entendre Mike Horn. Sauf que lui, il est drôle ! Manon, où est partie ta folie ? — Tu m’ennuies, ma Clarinette. J’ai grandi, c’est tout ! Pendant que le sable s’écoule, ses pensées défilent. Jusqu’à ce dernier dîner tous ensemble : papa, maman, Théo et elle. Manon se souvient à peine de sa vie d’avant. Avant que sa mère ne foute tout en l’air ! Elle refuse d’y songer, repose le sablier et se dirige vers le dressing. Ses vêtements y sont impeccablement rangés par fonction : tailleurs de travail, affaires de sport, le tout dans des tons beige, brun et noir. Elle pose un masque sans rinçage sur ses cheveux bouclés, dix minutes, tous les quinze jours. La seule solution pour les garder en bonne santé. Puis elle les relève en chignon serré, les yeux perdus dans le vide. « J’espérais tellement ce moment au calme avec Mamita. Que vais-je devenir ? » En refermant la porte derrière elle, Manon contemple son nid douillet, les cadres disposés selon leur taille, les plantes vertes nourries d’un engrais biologique une fois par semaine, la moquette d’un blanc immaculé, les bocaux bien ordonnées dans la cuisine fonctionnelle. Sur le tableau noir dans l’entrée, le jour de son emménagement, elle a écrit en lettres blanches « Ici tout n’est qu’ordre, calme et sérénité ». La tête encore dans ses pensées, Manon s’engouffre dans l’ascenseur et se retrouve, nez à nez, avec Martha, la gardienne. — Vous êtes drôlement jolie, ce matin, mam’zelle Manon. Quelle élégance, ce long manteau ! Manon s’observe dans le miroir et répond, les lèvres pincées. — C’est gentil, Martha. En vrai, j’ai l’air d’un fantôme. Regardez comme je suis pâle. Martha hausse les épaules et secoue la tête. — C’est forcément pâle les fantômes ! Vous êtes trop dure avec vous. J’aurais rêvé d’avoir ces longs cheveux soyeux. Et des yeux verts aussi magnifiques. Vous êtes fine, toujours bien habillée, comme cette actrice américaine. Allez, souriez, illuminez-moi ce doux visage. « Ma gardienne, je l’adore ! Mais je vais lui racheter des lunettes ! » se dit Manon, en poussant la porte de son immeuble. 3 PARIS, CAFÉ DE LA PAIX 4 AVRIL Manon est venue à pied depuis chez elle. Elle a ruminé tout le long du trajet, en stressant par avance. Elle sait que Susana n’a pas le choix, elle ne lui en voudra même pas. C’est la vie, c’est comme ça. Elle entend son père lui rabâcher « Si tu crois que tout est facile, ma fille. Quand j’avais ton âge, je travaillais aux champs, arrête de te plaindre ». Avec appréhension, elle pousse la porte du Café de la Paix et passe le lourd rideau de velours rouge. Elle pénètre instantanément dans un univers feutré et luxueux, couleurs chatoyantes, fauteuils profonds et lustres de cristal. « Pourquoi Susana m’a-t-elle invitée ici ? » — Holà ! Manon, s’exclame Susana, depuis le fond de la salle. Franco-espagnole, Susana dirige la filiale France de Stella depuis plus de vingt ans. C’est une grande brune aux cheveux courts, très expansive, souriante et volubile, vêtue de blanc, été comme hiver. « Rappelle-toi, Chiquita, j’ai commencé à Saint-Tropez avec les soirées blanches d’Eddy Barclay, il m’a appris la nuit ! Ah ! C’était une autre époque ! ». Juchée sur des talons vertigineux, Susana s’est levée pour accueillir Manon. Pandémie ou pas, masque ou pas, elle l’enlace et dépose un baiser vigoureux sur ses joues. — Cómo estás querida , ce matin ? Manon recule d’un pas. — Hum, joker, que se passe-t-il ? Pourquoi m’as-tu invitée ici ? Et pourquoi cette urgence ? Susana l’attrape par la main et lui fait signe de s’assoir face à elle. La table est décorée d’un bouquet de roses, les couverts en argent sont disposés le long des assiettes en porcelaine. Susana a commandé ses apéritifs préférés, des gougères au fromage. — Parce que tu le mérites, Manon. Sans toi, l’agence ne se serait jamais autant développée et structurée. Je voulais te dire à quel point j’ai été heureuse de travailler avec toi. « Voilà, c’est bien ce que je pensais, c’est fini ! Comment vais-je l’annoncer à papa et mamita, tous deux si fiers de ma réussite ? » — Tiens, ma chérie, regarde la carte, ajoute Susana, et choisis ce qui te fait plaisir. J’ai envie que nous passions un super déjeuner ! Manon soupire et lève les yeux au ciel. — Je n’ai pas du tout le cœur à ça ! Susana, si tu as quelque chose à m’annoncer, vas-y ! Je sais que les chiffres sont terribles. J’ai compris que tu voulais te séparer de moi, j’aimerais autant qu’on en parle maintenant, plutôt que de continuer à me tordre les boyaux. Susana repose le menu et fixe Manon, l’air surpris. — C’est ce que tu penses ? — Bien sûr, sinon pourquoi m’inviterais-tu dans un tel endroit alors que j’étais censée partir en congés et télétravailler en Normandie. C’est moi qui prépare les rapports financiers, je sais très bien ce qu’il en est. — Tu veux vraiment qu’on discute avant de déjeuner ? insiste Susana. Manon ne répond pas tout de suite, saisit ses couverts et les arrange parfaitement symétriquement autour de son assiette. — Oui, je préfère, finit-elle par acquiescer. Susana l’observe du coin de l’œil en souriant : — C’est bon ? Tu as terminé de tout réorganiser ? Et arrête de nettoyer ce verre avec ta serviette ! Ma chérie, tu fais ça tout le temps. On est au Café de la Paix, tu vois ? C’est propre ici ! Manon bougonne, le visage fermé. — Voilà, maintenant tu te moques ! — Non, ne change pas, je t’aime comme ça. Bon, tu t’en doutes, j’ai quelque chose à t’annoncer, mais je ne sais pas comment tu vas le prendre. Manon inspire, fait le vide dans sa tête. « Ne penser à rien. Ni à l’appartement ni à mon emprunt… à rien ! » — Dis toujours, je suis prête et je comprendrai ! Susana saisit sa besace, une énorme chose en toile orange délavée, qu’elle trimballe depuis des temps préhistoriques. Elle en sort son ordinateur portable, un rouge à lèvres, une boite de tampons, deux tétines, un gros trousseau de clés, des cachets de Doliprane et trois masques usagés avant d’attraper enfin une grande enveloppe. — Ah voilà ! Tiens, c’est pour toi. — Susana, je sais ce que je vais trouver dans cette enveloppe et j’ai eu le temps d’y penser, dit Manon, en répétant le discours préparé sur le chemin. Susana se frotte le menton, d’un air grave. — Ah ? — Je voulais te remercier de ta confiance. Tu as cru en moi, tu m’as donné du travail et des responsabilités. Tu as toujours agi comme une mère. Et quoi qu’il y ait dans cette enveloppe, je me doute que tu ne le fais pas de gaieté de cœur, continue-t-elle, les yeux embués. Susana secoue la tête. — Mais qu’est-ce que tu t’imagines ? Regarde, chiquita ! Manon a les mains moites, ouvre l’enveloppe et en sort… Un billet d’avion Paris-Ibiza, pour dans trois jours ! Ainsi qu’une adresse notée au stylo plume baveux, à l’encre mauve, de l’écriture toute en boucles de Susana. Finca Stella, Calle Isodoro 8, San Rafael, Ibiza. Manon reste bouche bée. — Alors là ? Je ne comprends rien ! Susana verse de l’eau dans leurs verres. Elle la regarde avec tendresse. — Manon, je te revois à tes débuts à l’agence : une petite stagiaire réservée, mais déterminée et efficace. Un curieux mélange de Blanche Neige aux longs cheveux bruns, souriante, organisée et de Mike Horn ! Enjouée et disciplinée ! Rapide et concentrée ! — Oh ! Claire dit aussi que je lui ressemble. Susana la taquine, en tapotant sa main sur la table. — Ton côté suisse, peut-être ? Bref, tu t’es vite intégrée dans l’équipe. Tu as compris le fonctionnement de Stella. Tu as réussi à décrypter nos chiffres et, en l’espace de quelques mois, à améliorer nos performances. C’est vrai, tu as raison, je ne vais rien te cacher, la situation actuelle de l’agence est épouvantable. Nous sommes au bord de la faillite. Jorge a fixé un dernier ultimatum ce matin. Nous avons trois semaines pour redresser la barre ou… Manon lève les sourcils. — Ou quoi ? — Ou l’agence fermera définitivement. Il dit qu’il est vieux et qu’il n’a plus l’âge de s’ennuyer avec tout ça. S’il n’y avait pas Arturo, il aurait déjà mis la clé sous la porte. — Arturo, ce gros macho colérique ? Susana s’esclaffe. Les autres clients se retournent. Elle s’en fiche et continue, sans les regarder, droit dans les yeux de Manon. — Oui, celui-là, qui est aussi son fils unique, rappelle-toi… Bref, Jorge exige une stratégie de relance, la dernière chance de Stella. Il aurait voulu que je me rende à Ibiza, au siège, pour travailler avec les équipes. Mais tu sais très bien qu’avec Luc et les jumeaux de trois semaines, c’est impossible. « Oui, je m’en doute. » Susana est mariée depuis des années à Luc. Il peint, il dessine, il écrivaille, il exerce sa créativité, dit-il. Au final, c’est elle qui fait bouillir la marmite. Et, depuis l’arrivée des enfants, après des années de FIV ratées, Susana est à fond tout le temps. Luc est adorable, super sexy, mais c’est un grand enfant. À 43 ans, Susana est l’homme, la femme, la maman, la super organisatrice, la directrice générale de Stella… d’où peut-être l’imposante besace orange ! — Manon, cariña guapa , tu es la seule à pouvoir redresser l’agence à mes côtés. Je suis désolée de t’en informer au dernier moment, je sais que tu avais prévu tes vacances auprès de ta grand-mère. Je lui enverrai des fleurs pour m’excuser de t’enlever. Ma chérie, j’espère que tu accepteras cette proposition. Bien sûr, tu seras rémunérée en conséquence et tous tes frais seront pris en charge. Tu auras besoin de quelques jours pour comprendre la situation et mettre en place la nouvelle orientation. Je t’aiderai à distance. J’ai prévu que tu t’installes à Ibiza au plus vite. D’où ce départ, dans trois jours. Et, au vu des finances de Stella, Jorge te logera à la Finca Stella plutôt qu’à l’hôtel pour éviter les dépenses. — La Finca Stella ? Tu veux dire la villa où vit son fils ? Susana acquiesce, l’air gêné. — Oui et… Manon s’impatiente. — Et quoi ? Il y a encore une surprise ? — Hum… Arturo ne vit pas seul. Jorge a mis la finca en colocation. Je crois qu’il y a aussi une ou deux autres personnes. Manon bondit sur sa chaise. — Tu plaisantes ? — Non, mais ça va aller. — Moi, Arturo et deux inconnus dans la villa de Jorge ? Et tout le travail qui m’attend ? Susana hoche la tête. — Sí, Manon ! — Je vais devoir habiter avec Arturo, le gars le plus imbu de sa personne ? — Oui, ma chérie, et travailler avec lui ! C’est aussi le responsable marketing de la filiale espagnole et, malgré son caractère de cochon, il a quand même réussi à garder quelques clients. — Mais il est lourd et prétentieux ! En plus, il me déteste ! Il prend toutes les femmes pour des connes ! Bonjour le cadeau ! Susana lui adresse un sourire rassurant. — Ma chérie, l’ordre émane de Jorge. Il nous fait confiance. Je compte sur toi pour travailler en bonne intelligence avec Arturo. Je sais que tu y parviendras et tu sauras le faire évoluer. — Tu sais ou tu espères ? Susana lui répond dans un murmure. — Los dos, cariña. Manon repose sa cuillère qu’elle triturait nerveusement depuis le début. — Susana, j’ai besoin de prendre l’air ! Je vais sortir deux minutes ! — Bien sûr, cariña, va ! Manon file sur le trottoir, envoie un texto à Claire. Manon Tu ne devineras jamais, Clarinette ! Ce matin, je pensais que Susana allait me virer et, en fait, elle m’envoie à Ibiza pour remettre l’agence sur pied. Je vais devoir habiter chez l’abominable Arturo parce que l’agence n’a plus les moyens de payer un hôtel. Claire répond de suite. Elle est en télétravail depuis des mois et n’en peut plus. Toute distraction est la bienvenue. Claire Mais c’est ouf, Manon ! Comment j’aimerais trop être à ta place ! T’imagines Ibiza à cette période ? Quel pied ! Tu vas t’éclater ! Manon Tu rigoles ou quoi ? Je dois pondre la stratégie de la boîte et trouver l’idée brillante qui va permettre de sauver les emplois. Tu t’imagines la pression que j’ai sur les épaules ? Claire T’inquiète ! Je sais que tu vas y arriver ! T’as toujours été la meilleure ! Tu pars quand ? Manon Dans trois jours ! Claire Viens dîner ce soir, si tu veux. On en parlera. Surtout, accepte l’offre de Susana. Manon De toute façon, j’ai pas le choix ! Claire 19 h à la maison, je te prépare ta tarte au chocolat préférée ! Manon respire un grand coup. Et rejoint Susana à l’intérieur. Celle-ci la dévisage avec attention, inquiète de sa réponse. — Alors, ma chérie, tu te sens mieux ? C’est bon ? Manon tapote sur la table. Elle hésite encore, même si, dans le fond, elle sait déjà que sa décision est prise. C’est une mission importante pour l’entreprise et sa boss lui fait confiance. Mamita comprendra. Elle ira la voir au retour. Elle répond, agacée. — Franchement, Susana, je me demande si j’aurais pas préféré que tu me renvoies ! Mais je vais le faire, je vais aller à Ibiza et je vais essayer de remettre Stella sur pied, compte sur moi ! — Hay, maravilloso, cariña ! Sur ce, Susana se lève avec fracas et improvise une petite danse de la joie autour de Manon, consternée. « Dans quelle galère me suis-je embarquée ? » 4 PARIS, CHEZ CLAIRE 4 AVRIL, 19 H Ce soir, il pleut des cordes. Heureusement, Claire a tout prévu pour remonter le moral de sa meilleure amie ! Lorsque celle-ci sort du métro à Bastille, elle l’y attend déjà, abritée sous un grand parapluie jaune et rose à motifs licornes. — Tadam ! Devine qui est là ? dit-elle en surgissant sous ses yeux, les doigts levés en V. Pour l’occasion, Claire a enfilé sur son imperméable, un t-shirt I Love Ibiza, souvenir XXL d’un week-end torride avec l’un de ses date Tinder, basketteur. Ses cheveux roux ondulent dans son cou et retombent en boucles le long de son visage poupin. Claire a le sourire expansif et généreux. Même de loin, il se devine. Et son rire de gorge enveloppant entraîne tout sur son passage. Personne ne résiste à son enthousiasme pétillant, Manon, la première ! Claire, c’est un petit bonbon d’à peine 1,55 mètre, une perle d’amie, une douceur ronde et sensuelle qui collectionne les histoires d’amour. Si l’on devait attribuer la palme du cœur d’artichaut, c’est elle qui gagnerait haut la main. Claire aime aussi vite qu’elle désaime. Sa passion n’a d’égale que sa lassitude. Il n’est pas venu le prince charmant qui saura l’enlever. Elle s’en fiche. Claire a l’amour joyeux et léger ! Elle attrape Manon par la main, la fait virevolter autour d’elle en chantant dans la rue « Trop cool, ma copine part bosser à Ibiza » et l’embrasse sous son parapluie. — Arrête, Clarinette, on a l’air de quoi ? Claire rit sous le grand parapluie. — De deux filles heureuses ! Manon bougonne et fait la moue. — Parle pour toi ! Parce que moi, la perspective de travailler trois semaines avec un dingo et vivre en groupe m’enchante moyen ! — Chuuuut ! Tout se passera bien. On va à la maison, t’es d’accord ? Les autres sont sortis. On sera toutes les deux. Claire vit dans une coloc bruyante, sur une péniche, à Bastille. Elle aurait rêvé que Manon s’installe avec elle, mais son amie préfère sa tranquillité. En plus, les colocs sont tous artistes, musiciens, comédiens et c’est toujours la foire ! Claire adore, elle dit que ça fait pétiller la vie ! Claire est illustratrice de livres jeunesse. Manon et elle se sont rencontrées à l’école primaire, lors d’un exposé à préparer sur le Japon. Pour l’occasion, Claire avait appris dix mots japonais, pour démarrer l’exposé dans la langue du pays, sous l’œil médusé de l’institutrice et des autres élèves. Elle avait tout de suite fait rire Manon. D’autant plus quand elle lui avait donné leur signification ! Que des gros mots ! À huit ans, ça impressionne ! À l’époque, la mère de Manon et son frère, Théo, vivaient encore à la maison et c’était un joyeux capharnaüm. Claire, ça lui avait vite plu ! Chez elle, c’était plutôt strict. Elle a toujours adoré la maman de Manon, même après… Claire la presse, sautant, guillerette, dans les flaques avec ses bottes en caoutchouc jaunes. — Bon, Manon, qu’est-ce que tu fiches ? Tu marches à deux à l’heure. T’inquiète, c’est juste un peu de pluie, tes jolies chaussures ne vont pas se salir pour si peu ! Et, bientôt, tu seras sous le soleil ! La chance ! — Hummm, on verra, râle Manon. Elles traversent la place de la Bastille, continuent sur le boulevard Bourdon et pénètrent par une grille en fer sécurisée, sur le port de l’Arsenal, qui accueille toute l’année plus de 200 bateaux. Viva Bella, la péniche sur laquelle vit Claire, fait plus de 25 mètres de long. C’est la plus imposante du bassin, à l’extrémité gauche, côté Bastille. C’est vrai, le cadre est agréable. « Rends-toi compte, habiter sur l’eau, dans un lieu entouré de jardins, c’est comme avoir l’impression d’être en vacances toute l’année », a dit Claire lorsqu’elle a emménagé, il y a deux ans. Peut-être, mais quel souk à l’intérieur du bateau ! Pourtant, la péniche est spacieuse et dispose de quatre chambres individuelles, bien agencées. Mais chacun y vit à la cool, laissant traîner ses affaires n’importe où. Sur le grand canapé, les coussins bleus alternent avec des plaids usés, en laine jaune effilochée et du linge qui attend probablement d’être rangé. Partout, des mugs, des cendriers pleins. Ici, une guitare, là un livre ouvert et corné. Sans y prêter attention, Claire s’empare des affaires de Manon, les jette sur le bar, lui propose un verre d’eau du robinet, se sèche les cheveux avec le torchon de la cuisine, saisit un paquet entamé de chips et s’installe sur le sol, dans l’un des poufs ronds en tissu bariolé. — Alors, raconte en détail ! commence-t-elle tout en proposant quelques apéritifs. Je veux tout savoir. Manon lui relate le déjeuner avec Susana, l’enjeu et le timing de la mission, les objectifs fixés par Jorge et son futur cadre de vie. — T’as des photos de la villa ? demande Claire. Elle est folle, paraît-il. Le proprio y organisait des fêtes sublimes, non ? Manon hoche la tête. — Oui, je crois. Je ne connais pas. J’ai toujours séjourné en ville pour assister aux réunions commerciales, au bureau. Susana dit qu’elle a été redécorée pendant le premier confinement, lorsqu’Arturo y a emménagé. Claire la dévisage, curieuse. — Et le Arturo ? Un bon coup ? — T’es folle ou quoi ? Ce type est détestable. — Oui, mais… Manon se lève et attrape son verre. — Mais, il n’y a pas de, mais. J’y vais pour bosser, trouver l’idée de génie pour redresser la boite et je rentre. Encore va-t-il falloir la trouver, l’idée ! En ce moment, je suis à sec niveau inspiration. À force de télétravailler, je tourne en rond dans ma tête et mon inspiration aussi. — C’est normal ! Tu te mets trop la pression. — C’est parce que j’en ai ! — Oui, mais t’es pas toujours obligée d’être parfaite. Tu peux laisser aller parfois… te donner du temps libre, rêvasser… Manon lève les yeux au ciel. — Mais j’ai pas le temps de rêvasser ! — T’en as pas ou tu le prends pas ? — Clarinette, on ne va pas repartir sur ce sujet, là maintenant, alors que j’ai juste besoin de réconfort ! Claire lui tapote la main. — Désolée, ma choute, je dis n’importe quoi. Allez, viens, je t’ai préparé la quiche à la courgette que tu aimes. Et la tarte au chocolat croustillant, comme ta mère faisait pour les anniversaires. Manon se redresse brusquement sur le pouf. Claire a touché un point sensible. Et il n’est pas question de se laisser embarquer sur ce sujet. Elles en ont déjà parlé mille fois. — Stop ! — Attends Nounette, j’ai quand même le droit de dire que la tarte de ta mère était incroyable ! Peut-être que c’est grâce à elle qu’on est devenues copines et que je passais mon temps chez toi ! Manon secoue la tête. — Oui, mais… — Oui, mais rien ! Ton père était d’un ennui mortel. Ta mère flétrissait avec lui. — Clarinette, arrête, je connais ton discours. Claire se rapproche d’elle et lui tend le plat, les assiettes et des couverts. Elle sait que cela n’avance à rien de continuer la discussion. Manon est si rigide, parfois. Elle ne souhaite pas la brusquer plus avant son départ. — OK, ma puce. Tiens, sers-toi. Je peux mettre un peu de musique ? Manon répond, boudeuse. — Un peu plus tard, si tu veux. Ça t’ennuie si on reste au calme pour l’instant ? — Mais non. Allez, mange et viens me faire un gros câlin. Sur ce, Manon dévore le dîner préparé par Claire. Trop perturbée par l’annonce de Susana, elle a à peine touché à ses plats à midi. Elle lui raconte. — Franchement, c’était bizarre cette discussion. J’étais persuadée qu’elle me tendait ma lettre de licenciement et, à l’intérieur, je découvre ce billet d’avion. Claire bat des mains. — Canon ! Manon continue d’une toute petite voix, inquiète. — Clarinette, j’ai peur de ne pas y arriver. Et si ça se passe mal ? Et si je ne trouve pas de solution ? Et si la boite s’écroule à cause de moi ? Claire se lève et tourne autour d’elle en riant. La péniche résonne de son enthousiasme. Elle encourage Manon. — Oh ! Oh ! La boite s’écroule déjà ! Elle t’a pas attendu pour chuter ! Donc, toi tu mets juste ta cape de wonderwoman et tu y vas sans crainte ! Et surtout, surtout, tu laisses libre cours à tes idées. « Liberté licorne », tu te souviens ? « Liberté licorne »… Oh, ça remonte à des siècles ! C’est une expression qu’elles utilisaient avant, quand elles étaient petites. Ça voulait dire « Lâche-toi, fais tout ce qui te passe par la tête, chante, danse, colorie, cours, saute, mets-toi au piano, ris, pleure… ». « Liberté licorne », c’était un signal, lorsque l’une d’entre elles devenait trop sérieuse. Comme un mot de passe, un talisman magique, la clé d’une serrure rouillée de conte de fées. « Liberté licorne », ça voulait dire « Tu peux tout faire ». Manon était très forte à ce jeu. Elle pouvait inventer une histoire en un claquement de doigts, se déguiser en n’importe quoi sans réfléchir, mimer la plus difficile des cartes au Time’s Up ! Sa maman aussi était très forte… Mais cela fait bien longtemps que Manon n’a pas libéré de licorne ! Depuis le jour où sa mère est partie avec Théo… Le dimanche d’après, elle a repeint sa chambre en beige, remisé ses jouets dans un coffre à la cave, relevé ses cheveux en chignon et jeté ses robes à fleurs. Alors les licornes ! Elle n’y croit plus ! Elle ne sait même plus où elles sont ! Et, en vrai, de toute façon, les licornes, ça n’existe pas ! Pendant qu’elle était perdue dans ses pensées, Claire n’a pas arrêté de parler. — Manon, tu m’écoutes ? Je suis sérieuse maintenant. Pour y arriver, tu vas devoir cesser de tout contrôler et utiliser tes deux cerveaux. Le droit et le gauche ! Tu te rappelles, je t’ai déjà expliqué. Pour l’instant, tu es à fond sur le gauche, la raison, la logique, les chiffres. Et tu t’en sors bien. Mais là, tu vas devoir libérer le cerveau droit, la créativité, l’intuition, l’imagination. Tu vas devoir ouvrir tes chakras, ma copine… Manon s’est renfrognée. Si Claire se figure que c’est une partie de plaisir, cette mission ! Elle l’interrompt. — OK ! Ça, c’est ton truc. Moi, tout ce que je vois, c’est que je vais me retrouver enfermée avec ce gros macho d’Arturo et deux autres colocataires, en Espagne, avec des gens qui passent leur temps à faire la fiesta alors que j’avais prévu de travailler au calme chez mamita. Claire hausse le ton et la secoue, comme elle seule peut le faire, depuis qu’elles sont petites, comme elle a continué toutes ces années après. — Eh ! Oh ! Manon ! Tu crois pas que t’exagères ? Tu réalises combien de personnes rêveraient de s’envoler pour Ibiza ? Alors maintenant, tu rentres chez toi et tu prépares ta valise, tu sais les petites pochettes pour les culottes, les grandes pour les Tee-shirts ! Tu rajoutes quelques touches de couleurs dans tes vêtements et tu pars sans flipper ! Manon ouvre la bouche pour parler. Mais, avant même d’avoir pu dire un mot… — Je sais, t’as pas de couleur ! la coupe son amie. — C’était gratuit, ça ! Claire lève la main, pour continuer. — Ah oui, et trois derniers trucs parce que je peux me permettre de te les dire, comme on ne se reverra pas tout de suite. — Pas sûre d’avoir envie de t’écouter encore ! — Alors, un, je t’aime ! À vie ! — Moi aussi, Clarinette ! — Deux, ton père est un emmerdeur fini, toujours de mauvaise humeur, toujours à râler, pas fun du tout ! Tu lui passes beaucoup trop de choses, je te l’ai déjà dit. Manon se renfrogne, et ne trouve rien d’autre à ajouter, un peu bredouille que : — Oui, mais ! — Y’a pas de, mais ! Trois, tu pars à Ibiza, Nounette, trois semaines au soleil dans une villa avec piscine. Est-ce que tu réalises bien la chance que tu as ? s’exclame Claire, tout en tourbillonnant autour de son amie. En s’endormant, Manon a repensé à leur conversation… Elle était anxieuse, mais excitée aussi quand même. Trois semaines à Ibiza… 5 FONTAINEBLEAU 5 AVRIL Ils sont assis tous les deux, sous le pommier, dans le jardin de la maison de Fontainebleau, celle de l’enfance de Manon. Le printemps est installé et, avec lui, les premiers bourgeons. Les jonquilles se sont rendormies, les feuilles des framboisiers sont de retour, les roses se préparent à éclore. Mais ni Manon ni son père n’y prêtent attention. C’est sa mère qui avait la main verte, c’est elle qui s’émerveillait, au sortir de l’hiver, de la force de la nature. À l’époque, Manon la suivait partout. Maman lui avait acheté un arrosoir et un petit sécateur. Et elles passaient leurs week-ends dehors à tailler, bêcher, semer et arroser. Théo trottait derrière, en riant, tapant du pied dans son ballon, dérangeant leurs plantations. Elles le houspillaient, le poussant de la main. « Que reste-t-il de tout ça ? » se demande Manon, pensive, observant son père du coin de l’œil. Le jardin est en friche, à l’abandon. Et lui ? Maussade, de mauvaise humeur ! Aussi gris que le ciel aujourd’hui. Manon est arrivée par le train de 11 h 57. Il l’attendait à la gare d’Avon dans sa vieille Peugeot qu’il refuse de remplacer. « Du moment qu’elle fonctionne encore, pourquoi veux-tu que j’en change ? Qu’est-ce que tu crois ? Heureusement que j’ai la tête sur les épaules, moi ! C’est pas comme… Enfin, bon, tu vois ce que je veux dire ! ». Elle avait acquiescé, juste pour le faire taire. Ils ont fini de déjeuner. Un plat à emporter qu’il a acheté au supermarché avant de la récupérer. Manon vient de lui annoncer son départ à Ibiza. Il a reposé sa tasse de café, la beige tout ébréchée. Elle remarque que sa main tremble un peu. Ça ne date pas d’aujourd’hui, mais il refuse d’admettre qu’il boit trop. Elle lit la surprise dans ses yeux. Il tape sur la table. Il n’a jamais su parler calmement. — … Trois semaines à Ibiza ? C’est du grand n’importe quoi ! Et ton travail, Manon, tu y as songé ? — Papa, je viens de t’expliquer que j’y vais pour le travail ! Il lève les yeux au ciel, agacé comme lorsqu’elle était enfant et qu’elle lui racontait où les pirates avaient caché le trésor dans le jardin. — Manon, enfin, personne ne va travailler trois semaines à Ibiza ! — Si, papa, quand la boite a son siège à Ibiza, c’est normal d’y aller. Il avale une gorgée de café, reprend un verre de vin et réfléchit. — Déjà, ça, c’est louche. Il doit y avoir une combine là-dessous. Pourquoi t’as pas choisi une société plus sérieuse ? Manon, avec tes compétences, tu aurais pu faire fortune dans la banque, avoir une carrière, une vraie, en tant qu’avocate. Ou, je ne sais pas, moi, travailler dans l’économie. Quelque chose de sérieux ! Au lieu de ça, tu as choisi une boite avec un nom de poule de luxe. Stella ! Non, mais qui travaille chez Stella ? Elle a un soupir silencieux et renverse sa tête en arrière. — Ta fille, papa, ta fille ! Et, au fait, merci pour tes encouragements ! Ça fait toujours plaisir. — Le plaisir, le plaisir, vous n’avez que ce mot à la bouche ! — Papa, merci, je suis seule en face de toi. Alors, tu arrêtes avec le vous pluriel. Il s’est levé, il balaie de la main une mouche sur la table. Il la regarde avec colère. — Non, mais, c’est vrai quoi ! À la télé, c’est « Faites-vous plaisir, offrez-vous… », dans les journaux, pareil, « La dernière folie pour se faire plaisir ». Et ta mère, évidemment, le plaisir avant tout ! Le plaisir, ça n’existe pas ! Ce qui compte, c’est le travail bien fait. Et c’est tout ! — Oui, oui. — Tu m’entends, Manon ? insiste-t-il. Elle plonge le nez dans le gâteau encore congelé. Il n’a même pas pris le temps de le sortir du frigo avant son arrivée. Claire a raison, il est pénible. Elle s’y est habituée, à force. Elle ne le craint plus. Elle le supporte. Elle fait avec. Elle attrape son assiette et commence à débarrasser la table. — Oui, je t’entends. Je connais ta rengaine par cœur ! Mais tu crois que je fais quoi au bureau, papa ? Je travaille ! Et tu sais quoi ? Ma boss est fière de moi et elle me complimente et elle pense que je suis la seule à pouvoir sauver la boite. Il la suit dans la cuisine, ouverte sur le salon encombré. — Attends, ma fille, je sais que tu es travailleuse, je ne dis pas le contraire. Mais, enfin, partir à Ibiza ! C’est comme… — C’est comme quoi ? demande-t-elle, faussement innocente. — Tu sais très bien ce que je veux dire ! lâche-t-il. Ses yeux tempêtent ! Le gris des Flandres en hiver, la fureur de l’Écosse dans la bourrasque. Son père a le regard de ses origines. Manon se retourne et lui tient tête, du haut de son 1,70 mètre. Elle a posé ses mains sur ses hanches. En vieillissant, il s’est rabougri, presque ratatiné. « Ratatiné », c’est un mot que Théo adorait ! Son père ne lui fait plus peur. Elle le défie. — Non, vas-y, dit Manon en balayant la pièce d’un coup d’œil. Son père ne travaille plus depuis des années. De quoi vit-il ? Un petit héritage, quelques économies, il ne dépense rien de toute façon. Il collectionne les timbres et, une fois de temps en temps, il fait un bon coup en revendant celui qui a pris de la valeur. Voilà son travail ! La maison dans laquelle il vit est celle où Manon a grandi, près de la forêt. Rien n’y a changé depuis son déménagement à Paris. Tout est resté figé, mais en plus sale et poussiéreux. « La vérité, c’est que papa est bordélique ! » Les journaux s’entassent au pied de la cheminée, les toiles d’araignée s’effilochent le long des plinthes et les assiettes s’empilent dans l’évier, à côté des cadavres de bouteilles. « Il a beau jeu de me faire la morale ! » Même le cadre sur le rebord de son bureau n’a pas changé. La photo est toujours là. Celle où ils étaient quatre, avant et qu’il a rageusement coupé en deux, au départ de sa mère. Ne restent plus que lui et Manon, sur ce cliché jauni. « Les licornes ? Où sont passées les licornes chez lui ? » — Alors, je t’écoute, papa, vas-y, qu’est-ce que tu allais dire ? Partir à Ibiza, c’est comme quoi ? — … Elle laisse planer un court silence. — … Tu veux que je le dise à ta place ? Comme partir avec un trapéziste de cirque, c’est ça ? — Tu sais très bien ce que je voulais dire, on ne quitte pas sa famille sur un coup de tête ! s’emporte-t-il avec rage. À l’époque, en plus des collections de timbres, son père s’était lancé dans la lépidoptérologie, mot barbare qui signifie attraper de jolis papillons dans la forêt, les faire sécher sous des feuilles de papier puis les embrocher sous verre ! Les cadres de papillons sont toujours là, il en a même rajouté. Ses parents avaient de violentes disputes à ce sujet. Sa mère ne supportait pas de vivre au milieu d’animaux morts. Elle l’interrogeait sur ses journées, elle qui trimait huit heures par jour à la caisse du Carrefour de Villiers-en-Bière. En rentrant, elle enchaînait sur le ménage, son père laissait déjà tout trainer. Et lui ne se levait jamais pour l’aider, concentré sur ses cadavres. « Comment peut-on vivre comme ça ? » — Faites ce que je dis, pas ce que je fais ! déclare Manon, en ramassant ses affaires. — Comment ? interroge-t-il. Elle attrape son sac à main, vérifie qu’elle n’a rien oublié, lui lance un baiser de loin. — Rien, je me comprends ! Bon, je vais te laisser, je dois rentrer préparer mes maillots de bain, ma crème solaire et ma bouée licorne rose ! Ne bouge pas, je prendrai le bus jusqu’à la gare. Dans le train qui la raccompagne à Paris, elle ferme les yeux et reprend son souffle. C’est à chaque fois la même rancœur, la même aigreur. Elle se fatigue de le voir, mais c’est son père, c’est comme ça ! Elle colle la tête contre la fenêtre, regarde les arbres défiler. À Bois-le-Roi, un couple monte et s’installe en face d’elle. Ils n’arrêtent pas de s’embrasser, c’est gênant. Elle attrape son portable, bien rangé dans la poche intérieure de son sac. Elle consulte ses messages. Elle ouvre le dernier. C’est un WhatsApp de sa mère. Maman Manon, merci pour le mot que tu as envoyé à Théo. Je suis sûre que ça va bien se passer. Donne des nouvelles. N’oublie jamais que je t’aime. Ta maman pour toujours. Manon se retourne vers la vitre. Elle a la gorge serrée. Elle ferme les yeux. Dans le roulis du train qui s’éloigne, seuls les arbres devinent son chagrin, « Si tu m’avais vraiment aimée… »
Pages: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
 Sujets récents
Sujets récents
|



 Messages récents
Messages récents