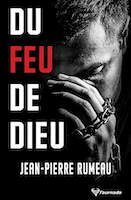1
Résumé : Vitry-sur-Seine. Un bébé est retrouvé mort dans la cuvette des toilettes d’un bar sordide.
Lucien, un flic psychorigide et proche de la retraite, et Anaïs, dernière recrue au look provocateur et au comportement borderline, sont appelés sur cette scène de crime pour le moins singulière, le genre d’affaire que personne ne convoite.
Découvrant que le fœtus a été génétiquement modifié, les deux enquêteurs devront mettre de côté leurs différends et plonger dans les abysses de la folie humaine.
En parallèle, un individu sème la terreur dans la ville avec son chien-loup en laissant derrière lui des cadavres.
Et si les deux affaires étaient liées ?
Et si la vérité était au-delà du supportable ?
Une enquête qui, très vite, va se transformer en compte à rebours.Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième fort inquiétante. Nouvel auteur pour moi ; ce dernier a déjà écrit plusieurs ouvrages apparemment intéressants. Ici, nouvel opus, et je dois dire que je n’ai pas été déçue du voyage ^^ Vitry-sur-Seine : tout débute avec un prologue effrayant et oppressant, où l’on fait la rencontre d’un mystérieux jeune accompagné de son chien-loup qui sème la terreur et les cadavres. Puis, c’est le tour d’un curé retrouvé pendu, qui va révéler bien des mystères. Pour finir, la découverte d’un fœtus abandonné dans la cuvette des toilettes d’un bar miteux, qui va nous apprendre que cet enfant mort-né a en fait été génétiquement modifié. Ces énigmes posées, le ton est donné ; notre curiosité est piquée au vif ; les questions taraudent notre esprit en ébullition. Qui est cet ado accompagné de son animal ? Pourquoi s’en prend-t-il à ces personnes ? Hasard, préméditation ; vengeance, règlement de compte ? Qui est ce prêtre ? Pourquoi disparait-il de l'IML ? Pourquoi gît-il ainsi, au bout d’une corde ? Quels secrets importants possédait-il pour qu’il en vienne à cette extrémité ? Quant à ce fœtus sans vie, pourquoi a-t-il été déposé à cet endroit ? À qui appartient-il ? Pourquoi a-t-il fait l’objet d’une telle pratique ? Et surtout, qui se cache derrière un acte aussi atroce, et joue ainsi les apprentis-sorciers ? Aussi perdus et perplexes que nos protagonistes, une fois la stupéfaction passée, nous voici entraînés, submergés, absorbés au cœur d’un récit glaçant, glauque et étouffant, à la croisée de la science, de la génétique et de ses dérives. Personne ne sortira indemne de cette histoire, même pas les lecteurs ; âmes sensibles s'abstenir ^^ Les investigations démarrent, mais les enquêtes sont laborieuses. Accompagné de sa fidèle équipe, le commandant de la PJ, Tanguy, se retrouve face à un puzzle désarticulé dont les pièces macabres échappent à sa compréhension, refusent de s’emboîter malgré son implication. Afin de faire toute la lumière sur ces tortueux dossiers, il charge Chaumont, Guérin et Salma de traquer l'assassin masqué au chien-loup, tandis que Anaïs et Lucien, les parias de l’équipe avec lesquels personne n’a envie de travailler, vont s’échiner à résoudre l’énigme du fœtus abandonné. Jour après jour, pas après pas, dans une course haletante et un compte à rebours des plus angoissants, nous allons alors suivre au plus près la résolution de ces épineuses affaires. Pour autant, nos enquêteurs ont-ils vraiment pris conscience du dangereux bourbier dans lequel ils ont mis les pieds ? Et s’ils faisaient fausse route ? Et si cette histoire n’était pas celle que l’on pensait de prime abord ? Et si contre toute attente, à bien y regarder, ces deux enquêtes comportaient des points communs, et même pouvaient être liées ? Et si la vérité était ailleurs, au-delà de l’impensable ? Nos équipes de policiers, forts différents mais parfaitement complémentaires, devront faire preuve de ruse, de rigueur, de témérité, et surtout, savoir démêler le vrai du faux s’ils veulent toucher au but afin de résoudre ce casse-tète des plus obscurs. Leurs recherches les mèneront au cœur d’un monde opaque et crépusculaire où complots et trahisons s'enchainent ; à un individu encapuchonné en soif de réponses se transformant en « justicier aux dés » ; jusqu’aux dérives d’un savant fou peu scrupuleux, prêt à toutes les vilénies pour parvenir à ses fins dans la manipulation du génome humain. Je tiens d’ailleurs à féliciter l’auteur pour son travail de recherche considérable, et sa capacité à vulgariser des thèmes complexes pour le tout venant. En effet, le récit demeure parsemé d’explications scientifiques compréhensibles et accessibles, sans oublier l’intrigue qui s'appuie sur des événements réels, comme par exemple l'affaire des jumelles génétiquement modifiées en Chine. Un vrai plus pour accrocher le lecteur, renforcer l’immersion et maintenir l’attention intacte tout du long. Quant aux personnages, qu’ils soient détestables ou attachants, ils sont bien campés, fouillés avec soin ; se complètent au mieux et servent les besoins de ce récit addictif parfaitement construit. Mention spéciale pour le duo Anaïs Lucien qui forment une équipe originale, peu commune et haute en couleurs. Pour dire, Lucien, vieux briscard de 60 ans, est sérieusement mis au placard avec la retraite qui approche. Il vit avec son fils et est resté coincé dans les années 80. Il est méticuleux, maniaque, psychorigide au point de tout cadrer, que ce soit sa nourriture et ses rendez-vous. À la complète opposée, sa consœur Anaïs est jeune, a 25 ans à peine et aime les looks provocateurs. Elle possède une personnalité plutôt borderline, un tempérament de feu, une langue bien pendue, et un goût bien prononcé pour le sucre. Conséquence directe : des anicroches, des disputes en cascades… bref des débuts en tant que coéquipier poussif, problématique, et on ne peu plus explosif. J’ajoute aussi que l’incursion dans leur vie privée respectives en dehors de l’enquête donne une profondeur supplémentaire à ce récit déjà dense et tentaculaire. Grâce a une plume fluide et percutante, dynamique et visuelle, des chapitres courts et addictifs, les pages se tournent à toute allure ; on veut savoir, connaître le fin mot de cet histoire irrespirable et combien perturbante. De rebondissements en rebondissements, de retournements de situations en révélations, nous nous laissons alors balader par l’auteur au gré des méandres de son histoire, jusqu’au dénouement final, qui nous surprendra ou laissera sans voix. Alors, nos protagonistes arriveront-ils à dénouer tous les fils de cette sordide affaire ? Et nos duos de policiers, comment évolueront-ils ? Arriveront-ils à s’apprivoiser, à s’apprécier ? S’apercevront-ils qu’unir leurs forces, utiliser leurs différences comme source de richesse, pourrait être le secret afin de résoudre cette enquête tortueuse ? À vous de le découvrir  Vous l’aurez compris, j’ai énormément aimé ce thriller intense et bien rythmé, la plongée au cœur d’un univers méconnu et bien abordé, sans oublier la qualité de l’intrigue et la manière dont elle a été menée. Alors, si vous aimez les romans qui sortent des sentiers battus, les récits palpitants, à l’intrigue subtile mais retorse, les histoires qui parlent de science et de dérive médicale qui ébranlent les idées, foncez, ce thriller est fait pour vous ! Vous passerez un excellent moment de lecture  Ma note : Ma note :       Pour vous le procurer : Éditions Taurnada Amazon Réseaux sociaux : Facebook Instagram Pour vous le procurer : Éditions Taurnada Amazon Réseaux sociaux : Facebook Instagram
2
Résumé : Mais où se trouve la frontière entre hallucination et réalité ? Comment démêler le vrai du faux sans perdre la raison ?…
Tiffany Malcom, photographe, travaille occasionnellement pour la mairie d’Opatoma. Alors qu’elle couvre la fête annuelle en l’honneur du père fondateur de la ville, Lily, sa fille de 7 ans, disparaît.
Depuis ce jour, inconsolable, c’est une lente agonie pour la jeune femme, entre drogues en tout genre et scarifications…
Lorsque son dealer lui propose une nouvelle substance, Tiffany n’hésite pas longtemps. Durant son trip, elle se retrouve propulsée dans les années 1800, où sévit un redoutable et mystérieux kidnappeur d’enfants… Aussi improbable que cela puisse paraître, la photographe est peu à peu persuadée qu’il s’agit de l’homme qui a enlevé sa fille !Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième fort inquiétante. Ayant déjà lu et apprécié le dernier roman de l’auteur : « Mon ami Charly», avec son ambiances unique et si particulière, j’étais curieuse et impatiente de voir ce que ce dernier allait nous réserver pour son dernier opus ^^ De nos jours, Tiffany, jeune femme fortement extravertie, fille du richissime couple John et Elizabeth Malcom, travaille comme photographe pour la ville d’Opatoma, une ville d’apparence sans histoires. Le jour de la fête du fondateur, alors qu'elle couvre l'événement, sa fille Lily, âgée de 7 ans, disparaît sous ses yeux épouvantés. Ces quelques lignes posées, le ton est donné, cette histoire sombre, angoissante, impliquant la disparition de cette petite fille nous glace le sang ; les questions taraudent notre esprit en ébullition : Que s’est-il passé ? Où se trouve Lily ? La petite s’est-elle perdue dans la foule ? S’est-elle fait kidnapper ? Qui a pu commettre une telle folie, mais surtout pourquoi ? Coïncidence ou préméditation ? À l’image de nos protagonistes, une fois la sidération passée, nous voici entraînés, submergés, absorbés au cœur d’un récit dramatique, glaçant et oppressant à la croisée de la mémoire et du fantastique. Personne ne sortira indemne de cette histoire, même pas les lecteurs ; âmes sensibles s'abstenir ! ^^ Les jours passent, et l’enfant reste malheureusement introuvable. Pour la maman, c’est l’effondrement. La douleur est à son paroxysme. Déjà qu’avant la naissance de son soleil, la vie de cette mère demeurait compliquée… En effet, cette dernière est le fruit inavouable d’une nuit maudite… là les choses vont aller de mal en pis puisque cet évènement va raviver toute l’horreur de ce traumatisme ancien. Les scarifications ne suffisent plus, les drogues consommées n’endorment plus assez sa souffrance. Ce qu’elle voudrait, c’est fuir à jamais cette réalité insupportable. C’est alors qu’en pleine perdition, elle accepte la proposition d’un dealer inconnu et consomme une drogue qu'elle ne connaît pas. Dès la première prise, Tiffany va se retrouver propulsée dans les années 1800 où un homme étrange à 6 doigts et au chapeau tricorne va croiser sa route. Qui est-il ? Pourquoi se sent-elle de suite mal à l’aise en sa compagnie ? Ça y est, elle a compris : elle en est certaine, c'est lui le ravisseur de sa fille et des autres enfants, que ce soit à cette époque ou bien dans le futur. Elle prend donc la décision de le traquer, d’essayer de l'arrêter coûte que coûte. Entre réalité et paradis artificiels, Tiffany ne lâchera rien et cherchera éperdument sa fille, quitte à y laisser sa vie. Mais justement, dans la plongée au fin fond des abysses, au cœur de la psyché de cette mère éplorée, où se situe la vérité ? Mauvais trip ou réalité ? Hallucinations due à la trop grande consommation de psychotropes, ou véritables visions du passé ? À moins que ce soit une distorsion temporelle du mental créé par le traumatisme vécu jadis ? Dans quel but ? Faire face à ses erreurs passées pour les réparer, puis les dépasser, à moins que ce ne soit pour les expier ? C’est dans une savante alternance que nous allons tenter de faire jour, nous efforcer de démêler le vrai du faux, de dénouer ce casse-tête des plus obscurs. Il sera cependant bien difficile de défaire les nœuds de cette histoire sans y laisser quelques plumes. Justement, à ce propos, malgré une intrigue savamment construite, je dois avouer que ma lecture a été quelque peu chaotique. En effet, suite à d’incessants allers-retours à des périodes différentes, des lieux et des personnages multiples, je me suis complètement perdue dans les méandres de cette toile d’araignée aux nombreuses ramifications, m’obligeant ainsi à revenir constamment en amont pour comprendre et pouvoir me raccrocher à un fil d’Ariane bien glissant. Chose d’autant plus dommageable que la plume de l’auteur, tantôt fluide et percutante, tantôt acérée et entraînante, apporte une vraie bouffée d’oxygène dans ce marasme ambiant et cette noirceur psychologique. Une fois avoir raccroché les wagons, les pages se tournent alors sans difficulté ; on veut savoir, découvrir ce que va nous révéler cette quête vitale à corps et à cœur perdu. Après avoir été tiraillée dans un sens puis dans un autre par l’imagination sans limite de l’auteur, après avoir nagé à contrecourant, après avoir bu la tasse, remonté à la surface, c’est l’illumination, on se rend compte que tout était lié et que chaque passage avait son importance ; toutes les pièces mainte fois remaniées s’emboîtent parfaitement pour déboucher sur un final qui nous surprendra ou laissera sans voix. Les personnages, eux aussi, ne sont pas en reste : bien campés, attachants pour certains, détestables pour d'autres, ils servent parfaitement ce récit atypique et en trompe-l’œil. En conclusion, malgré ces petits bémols, ce roman fut un bon moment de lecture, une découverte divertissante, même si ce fut un peu compliqué. Je dois également saluer la prise de risque et l’originalité du sujet. En plus, ce roman a le mérite de questionner : comment appréhender les choses lorsqu’on a perdu pied face à la réalité ? À quoi peut-on se fier ou se raccrocher quand l’esprit demeure perturbé par le poison de la souffrance, de la culpabilité et de la haine mêlées ? Tiffany sombrera-t-elle dans une folie sans retour possible ? Et surtout, aura-t-on des chances de revoir sa fille vivante ? À vous de le découvrir  Alors, si vous aimez les thrillers originaux, les récits en eaux troubles au cœur du psychisme humain lorsqu’on est confronté au deuil et à la perte d’un enfant, si vous n’avez pas peur d’être perdu autant par la double temporalité que par une multiplicité de personnages, ce roman est fait pour vous ; vous passerez un excellent moment de lecture  Ma note : Ma note :       Pour vous le procurer : Éditions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : X Facebook Instagram TikTok
3
Résumé : Adrien Destive disparaît après avoir rencontré Apolline, une adolescente tourmentée, fille d’un restaurateur en faillite.
Rapidement, le cadavre d’un autre garçon est découvert tandis que des phénomènes inexpliqués obligent la journaliste, Marion Stravi, à renouer avec des techniques d’investigation paranormales qui pourraient être la clé pour sauver Adrien.
Racisme, omerta, assassinats et vaudou. Entre doutes et certitudes, Marion se lance dans une course effrénée, plongeant au cœur du mal qui couve dans la ville de Salins.Mon avis :Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième fort inquiétante. Ayant déjà lu et apprécié certains des précédents romans "La peine du bourreau", "Les eaux noires", "Digital way of life", "Il était une fois la guerre", "Le dernier festin des vaincus", "Contre l'espèce", "L'alpha et l'oméga" avec leurs ambiances uniques et si particulières, j’étais curieuse et impatiente de voir ce que l’auteure allait nous réserver pour son dernier opus, sorti exclusivement en numérique ^^ cependant, cette fois, j’ai eu beaucoup de mal à trouver les mots pour décrire mes ressentis. Le sujet abordé, même s’il titillait grandement mon intérêt, m’a de suite fortement interpelée par les thèmes abordés. Attention, âmes sensibles s’abstenir ⚠️. Nous sommes à Salins. Après 15 ans de travaux de rénovation urbaine à vocation touristique, un projet d’envergure va voir le jour ; la réhabilitation des thermes qui sont sur le point d’ouvrir. Julien Destive, le gérant de l’établissement, profite donc des vacances d’été pour emmener son fils Adrien afin de passer un peu de temps en sa compagnie, de l’aider à s’acclimater à sa vie future, et par la même occasion pour superviser la fin des travaux. Non loin de ce nouveau complexe à venir se trouve le restaurant de Marc Carrière, un établissement qui pourrait avoir du potentiel et une clientèle fidélisée si seulement ce dernier se donnait les moyens, en rénovant les lieux et surtout en reprenant le chemin de la cuisine. Au lieu de ça, les choses sont presque laissées à l’abandon et Marc en est réduit à vendre des snacks avec sa fille Apolline, à organiser des soirées concerts pour payer les factures qui s’accumulent. De plus, avec la concurrence qui arrive, la situation est en train de se dégrader ; en effet, la mairie ainsi que la banque commencent déjà à lui tourner le dos. C’est alors que le fils de Julien disparait, peu de temps après avoir été vu au niveau de l'ancienne exploitation de sel, avec pour compagnie Apolline, la fille de Marc. Ces quelques lignes posées, le ton est donné, les questions taraudent notre esprit en ébullition : Que s’est-il passé ? Qui a pu commettre une telle folie ? Coïncidence ou préméditation ? Apolline est-elle au courant de quelque chose, ou pire mêlée à tout ça ? Est-elle aussi innocente qu’elle semble le dire ? Que sait-elle au juste de toute cette histoire ? La jeune fille paraît très étrange depuis quelques jours, alors qu’en est-il ? Cache-t-elle quelque chose ? De quel côté penche la vérité ? À l’image de l’imbroglio qui règne dans les têtes de nos protagonistes, nous voici entraînés, submergés, absorbés au cœur d’une intrigue dramatique et éprouvante à la façon d’un casse-tête des plus obscurs. Où se trouve Adrien ? Est-il encore en vie ? Malheureusement, malgré tous les efforts fournis, les jours passent et ce dernier demeure introuvable. Le climat est lourd, les tensions entre les pères Carrière et Destive sont nombreuses ; pour autant, les hommes décident de se serrer les coudes afin de trouver une issue heureuse Parallèlement aux forces de l’ordre, la jeune journaliste Marion Stravi, aidée de sa collègue Katia va non seulement couvrir la disparition du jeune garçon, mais veut aussi investiguer dans le but de résoudre cette affaire épineuse. À force de ténacité, des faits troublants dans la ville vont peu à peu émerger. Et quand un corps est retrouvé dans les marais, c’est l’affolement. puisqu’il ne s’agit pas d’Adrien mais d’un enfant disparu depuis huit ans. Qui est-il ? Y a-t-il un lien avec le dossier d’Adrien ? Le présent et le passé sont-ils reliés ? Et comme si cela n’était pas suffisant, d’autres cadavres vont se succéder. L’affaire se complexifie ; la police est sur les dents. Certains habitants seraient-il mêlés à tout ça ? Que va-t-on trouver sous les façades, sous les masques et les faux-semblants ? Que se cache derrière tout ça, et pourquoi ? Et surtout, quelles sont les raisons de cette sombre histoire ? Marion Stravi devra s'entourer de personnes inattendues pour l'aiguiller, et creuser dans des voies insoupçonnées pour comprendre… Quels sont les racines de ce mal qui gangrène cette ville ? Et si la piste n’était pas celle qu’on avait imaginé ? Grâce à une écriture tantôt fluide et percutante, tantôt acérée et entraînante, les pages se tournent rapidement ; nous voulons savoir, connaître la conclusion concoctée par l’auteure. Pour les non-initiés au vaudou, comme moi, il vous faudra cependant rester bien attentifs afin de ne pas perdre le fil devant la complexité et la densité des informations distillées. Les chapitres courts et rythmés renforcent le suspense, donnant une sensation d’immersion totale. Quant aux personnages, qu’ils soient détestables ou attachants, ils sont bien campés, fouillés avec soin, se complètent au mieux et servent les besoins de ce récit addictif parfaitement construit. De rebondissements en rebondissements, nous nous laissons alors balader par l’auteure au gré des méandres de son histoire, jusqu’au dénouement final, qui nous surprendra ou laissera sans voix. Vous l’aurez compris, j’ai beaucoup aimé le dernier opus de l’auteure. Pourtant assez difficile sur ce type d’ouvrage, là j’ai beaucoup aimé le mélange fantastique et relations humaines. Ce roman n’est pas seulement une simple histoire paranormale, il traite aussi d’esclavage, de religion, en particulier du vaudou, sans oublier le racisme implanté, nourri et perpétué au fil des générations… mais surtout, nous fait réfléchir sur l’humain et la palette de ses comportements. Alors, si vous appréciez les immersions dans la psyché humaine, les récits originaux et captivants, les thrillers traitant de paranormal, plus précisément de vaudou, ce roman est fait pour vous ; vous passerez un excellent moment de lecture  Ma note : Ma note :       Pour vous le procurer : Éditions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : Twitter/X Facebook
4
Résumé : Lors d'une odieuse agression, un jeune prêtre assiste à l'exécution atroce de son maître spirituel, échappant lui-même de justesse à la mort. Grièvement blessé dans sa chair et dans son âme, il va, peu à peu, perdre ses repères, puis sa foi, jusqu'à prendre le chemin de la vengeance.
Un roman dur et poignant, une impitoyable descente aux enfers.Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième énigmatique. Nouvel auteur pour moi, ce dernier apparemment a déjà écrit plusieurs autres romans ; ici nouvel opus, et je dois dire que cela été une vraie surprise ^^ Lors d’un horrible attentat, Patrick, un jeune prêtre croyant et fort engagé dans sa vocation, assiste impuissant à la mutilation puis l’assassinat monstrueux de son maître spirituel. Malgré la joie d’en réchapper, cet événement va le marquer à tout jamais ; son monde va s'effondrer, toutes ses convictions vont voler en éclat. Une véritable descente aux enfers va alors commencer, et nous allons assister au fil des pages à la lente métamorphose de notre protagoniste, au renoncement de ses valeurs, à la remise en question de sa foi, pour l'amener aux portes d’un monde inconnu à lui jusqu’alors… Mais cette dernière sera-t-elle bonne conseillère ? Et qu'en sera-il de son amour pour le divin ? Va-t-il laisser les doutes, la colère, la haine le dévorer ? Et trouvera-t-il la lumière et la guidance de Dieu ? Sa rencontre avec le policier Manuel Bossost va-t-elle l’aider ou le desservir ? Malgré un intérêt certain, une histoire bien ficelée, ma lecture a été quelque peu entravée. En effet, j'ai été profondément déroutée par le choix de l’auteur sur le fait de consacrer une bonne partie de son ouvrage à la transformation intérieure de Patrick et de retarder sciemment l’entrée dans le vif du sujet. Surtout que si l'on se réfère à la quatrième de couverture, il était fait mention de vengeance, donc à une possible enquête ou au alors à la recherche de ses agresseurs ? Que nenni, l’auteur a préféré explorer le coté émotionnel, le glissement et la désintégration morale de cet homme autrefois investi par Dieu. Alors certes, on ne peut nier que cela soit intéressant, mais je m’attendais à autre chose. Par conséquent, une difficultés à se glisser dans le récit et à s’y immerger pleinement. En plus, j’ai trouvé que les chapitres demeuraient assez longs et qu’il manquait cruellement de but ou d’enjeu. Choses d'autant plus préjudiciable que l’emploi du « je » ainsi que les flash-back et l’introspection dans les pensées du personnage était une bonne idée et donnait une vraie profondeur. La plume de l'auteur, fluide et percutante, acérée et entraînante apporte une bouffée d’oxygène dans ce marasme ambiant et cette noirceur psychologique. Une fois l’action retrouvée, les pages se tournent alors toutes seules, nous sommes happés au cœur du texte, et nous voulons savoir ce que nous a réservé l’écrivain. Les personnages, quant à eux, sont bien travaillés, servent au mieux ce récit original et atypique. Avec beaucoup de justesse et de sensibilité, l'auteur parvient à nous plonger au creux des ressentis de chacun. Forts et intéressants, les sujets traités : la croyance et ses dérives, toutes les sortes de religions, la vengeance, les agressions, le terrorisme, la quête de soi… ne sont pas en reste et ont le mérite de questionner et d’appréhender les choses sous un prisme différent. En conclusion, malgré ces petits bémols, ce roman fut un bon moment de lecture, une découverte intéressante, même si ce fut un peu compliqué. Je dois également saluer la prise de risque et l’originalité du sujet. Alors, si vous aimez les thrillers atypiques portés sur la religion au sens large, où la part belle est donné à la psychologie et à l’introspection, foncez, ce roman est pour vous ; vous passerez un excellent moment de lecture  Ma note : Ma note :      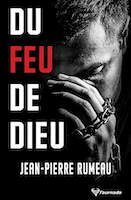 Pour vous le procurer : Éditions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : Facebook Instagram Pour vous le procurer : Éditions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : Facebook Instagram
5
Résumé : Aux Bois radieux, une cité sensible du 93, vivent notamment les Butel, une famille de marginaux, ainsi que Violette Grignon, une retraitée que l'existence a rendue extrêmement méfiante.
La veille de Noël, Johnny Butel, âgé de 25 ans, dérobe les provisions d'un couple de seniors.
La semaine suivante, il récidive avec sa voisine Violette, qui, après avoir hésité, a emporté un revolver pour se rendre au centre commercial.
Les fêtes vont alors virer au cauchemar.
Un roman palpitant, un engrenage implacable. Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième énigmatique et fort intrigante. Nouvel auteur pour moi, ce dernier apparemment a déjà écrit une bonne vingtaine de romans ; ici nouvel opus, et je dois dire que je n’ai pas été déçue du voyage ^^ Bienvenue Au Bois Radieux, une cité sensible du 93 qui porte bien mal son nom. Ici, les bâtiments sont en bien mauvais état, les commerces et les services de proximité ont disparu. Seule une ligne de bus dessert un centre commercial où « ceux de la cité » vont faire leurs courses. C’est dans ces lieux que cohabitent toutes sortes de profils : des familles modestes, des marginaux, des retraités qui peinent à joindre les deux bouts, mais aussi des dealers et des délinquants. Dans un des immeubles peu reluisants, vit la famille Butel. Une famille assez particulière, avec les parents qui ne travaillent pas, le fils de 25 ans qui a connu la prison alors qu’il était innocent, mais piégé par « le Baron » un dealer de drogue reconnu, ainsi qu’une fille ado et une fille ainée qui a pris son envol. En dessous de chez eux, habite Violette, une retraitée de 67 ans, isolée, qui a bien du mal à s’intégrer compte tenu du quartier difficile, où chaque pas au dehors demeure un réel danger au vu des petits caïds qui font la loi. Ses relations sociales sont donc réduites à peu de choses ; elle discute néanmoins de temps à autre avec une voisine ainsi qu’avec Fernand son lien social le plus important. Tout comme elle, ce dernier est retraité et passe son existence en solitaire. Le moment des fêtes est pour eux d’ailleurs un moment privilégié puisqu’ils boivent l’apéritif ensemble. Or, cette année les choses seront différentes : Fernand doit s’absenter pour passer cette fin d’année chez ses enfants qui, contre toute attente, souhaitent l’accueillir. Désireuse de marquer tout de même le coup, notre charmante vieille dame décide donc en ce 31 décembre, d'aller dépenser un peu de ses maigres ressources durement économisées afin de se payer un bon repas. Méfiante, elle amène avec elle le révolver confié par son fidèle ami Fernand, juste au cas où, comme on dit. Ses achats effectués, la sortie du magasin dépassée, Violette ne prend pas garde à Johnny, qui, profitant d’un moment d’inattention, lui dérobe son Caddie, tout comme il avait fait de même avec les provisions d'un couple de seniors le 24 décembre. Mais c’est mal connaitre notre retraitée qui, ne voulant pas se laisser déplumer sans réagir, n’hésite pas à lui tirer dessus en plein centre commercial. Sauf qu’au départ, l’arme était pour se protéger, pas du tout pour tuer. Par chance, aucun témoin, des caméras en panne, et le bus déjà là pour rentrer chez elle. Après cet acte malencontreux engendré par la peur, par un ras-le-bol de devoir sans cesse courber l'échine devant des jeunes agressifs, violents, hargneux, c’est l’escalade, une véritable descente aux enfers où chaque action entraînera une réaction en chaîne incontrôlable… Violette pourra-t-elle arrêter l’engrenage infernal ? Pourra-t-elle assumer les conséquences du désastre qu’elle a elle-même provoquée ? Et si jamais quelqu’un l’avait vue ? Si jamais quelqu’un la dénonçait ? Et si son secret tombait entre de mauvaises mains ? Avec ses yeux et ses oreilles de partout, ces trafics en tout genre, ou le chantage est légion. Ce ne serait pas impossible… Par le truchement de protagonistes passionnants et bien campés, nous allons être happés, enferrés, engloutis au cœur de cette satire sociale haute en couleurs. Entre vies à jamais brisées où aucun retour en arrière ne sera possible, entre règlements de compte, investigations policières et enquêtes de la sœur de la victime, nous allons assister, atterrés et impuissants, à l’embrasement total de la cité, à la dérive dramatique de ces personnages piégés par leurs propres choix. Peut-on réellement échapper à son destin quand tout semble jouer contre soi ? Jusqu'où la peur, la colère et la haine peuvent-elles conduire les individus ? Ballotés par les rebondissements, chahutés par différents ressentis, les pages vont alors se tourner toutes seules ; il nous faudra savoir, connaître le fin mot de cette histoire caustique et remplie d’humour écrite à la manière d’une série télévisée. Alors, que va-t-il advenir de Violette et de toutes les figures de ce quartier ? C’est ce que l’auteur, grâce à une écriture tantôt fluide et percutante, tantôt acérée et entraînante, souhaite vous conter avec ce sujet des plus sensibles. Ce roman sombre, très noir, et ultra réaliste dévoile sans fard ni concession aucune l’univers morose et désespéré des cités ou la pauvreté, l'injustice sociale et les rapports de force prévalent ; où les trafics gangrènent peu à peu les territoires abandonnés, où même les forces de l'ordre semblent impuissantes face à la situation explosive, et où les habitants finissent isolés et délaissés des services publics. Et même si l’on se persuade que cet ouvrage n’est qu’une fiction, qu’il s’agit seulement d’un coup de projecteur temporaire sur certains territoires en souffrance et oubliés, il n’en est rien ! Au contraire, il a le mérite de questionner, de tirer la sonnette d'alarme sur des dangers souterrains en tout genre, mettant en exergue un démantèlement, un pourrissement et un point sans retour qui pourrait survenir à tout moment si nous n’y prenons pas garde. Vous l’aurez compris, j’ai beaucoup aimé ce thriller atypique, qui pour une première découverte, a réussi à me captiver. J’aurais juste aimé encore plus de rythme, plus de tension ; une enquête policière au sein du récit plus présente et approfondie ; et peut-être moins de clichés ? même si cette plongée fut addictive et divertissante. J’irai donc faire un tour dans les précédents romans de l’auteur afin d’approfondir son univers  En conclusion, si vous aimez les chroniques sociales d’une société devenue malade et marginale, les intrigues policières plutôt reléguées au second plan pour laisser la part belle à l’humain, où l’humour noir et la satire transpire au travers des pages… Foncez, ce roman est fait pour vous ! Vous passerez un excellent moment de lecture  Ma note : Ma note :       Pour vous le procurer : Éditions Taurnada Amazon Pour vous le procurer : Éditions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : Facebook
6
« Dernier message par Apogon le jeu. 06/03/2025 à 17:38 »
Radithor de Alexandre Page Pour l'acheter : Amazon BODRéseaux sociaux : Twitter/X Facebook Instagram Résumé :
L'histoire vraie qui a inspiré Lovecraft !
Dans les années 1920-1930, le radium est à la mode. Employé dans des cosmétiques, des peintures luminescentes, des dentifrices, des cigarettes et même des sodas « atomiques », son usage est aussi considéré comme une révolution médicale. Il est vendu dans des comprimés, des pommades et des eaux miraculeuses par des laboratoires qui vont jusqu’à prétendre que la radioactivité a le pouvoir de rajeunissement. Parmi eux, les Bailey Radium Laboratories, créateurs du Radithor, une eau radioactive au succès aussi fulgurant que dévastateur, dont la trajectoire croisera, pour le pire, celle du champion de golf et milliardaire Ebenezer McBurney Byers en 1927.
Avec Radithor, Alexandre Page revient sur l’un des plus grands scandales sanitaires du XXe siècle, à une époque où un concessionnaire automobile, repris de justice et sans diplôme pouvait fonder un laboratoire médical et vendre comme un remède miracle plus de 400 000 doses d’un poison mortel.
-I- Plus que de coutume, il y avait ce jour-là une petite foule qui se pressait aux abords du dix-huitième trou de l’Allegheny Country Club de Pittsburgh. De prime abord, il s’agissait d’une procession de simples spectateurs observant la rencontre attrayante qui se disputait. Les hommes étaient en habits de garden-party, décontractés, arborant costumes clairs, canotiers et panamas, cravates à rayures plutôt que nœuds papillon ; quelques-uns avaient eu la licence de retirer leur veste ou de s’asseoir sur des chaises paillées. Il faisait assez chaud et tous n’étaient pas habitués à marcher et attendre longuement sous le soleil comme le sont les golfeurs émérites. Les femmes portaient des tenues d’un standing similaire et le confort l’emportait généralement sur l’élégance et le raffinement. Les sweaters et les cardigans s’affichaient sans retenue, les mollets se dévoilaient à cause des jupes courtes, tandis que les chapeaux cloches s’enfonçaient presque jusqu’aux yeux pour protéger de la luminosité mauvaise les prunelles délicates de ces dames. En appréciant la qualité du jersey, du tweed, du crêpe et du kasha qui couvraient la peau soyeuse des spectateurs, le cuir de leurs chaussures et le métal de leurs épingles à cravates, il était aisé de conjecturer qu’ils appartenaient à l’upper class américaine. Toutefois, il fallait être davantage introduit dans les arcanes du gotha pittsbourgeois pour caractériser plus précisément cette foule élégante et casual tout à la fois. Ce petit homme seul, un peu gras, à fine moustache et costume crème, continuellement occupé à se tamponner le front avec un mouchoir de soie, était l’avocat Arthur W. Bell. Cet autre homme, au costume blanc, au fédora blanc, aux chaussures blanches et à la cravate blanche rayée de bleu était Frank Faber Brooks, l’heureux concessionnaire Cadillac de Pittsburgh, accompagné de sa femme endimanchée des pieds à la tête par « Jean Patou de Paris ». On trouvait encore les Brown, venus en famille. La fille, la charmante Miss Lillian Brown, portait sa tenue de golfwoman en tant que membre de l’Allegheny Country Club. Les regards qui se posaient sur cette athlétique célibataire de vingt ans ne manquaient pas, car elle joignait à tous les attraits de la femme moderne, l'heureux hasard d’être l’unique héritière du plus grand magnat de l’immobilier de Pennsylvanie. Il y avait encore les Woodwell, les White, les Oliver, les Miller, les Merrick, les Mellon, les McClelland, les Liggett, les Kuhn, les Kay, les Horn, les Howe, autant de noms pittsbourgeois fameux qui disaient l’importance sociale et pécuniaire de la foule rassemblée. Au milieu de tout ce monde, une jeune femme se distinguait et n’en finissait plus de susciter des commérages à bas mots depuis le début de la partie. Ils puisaient leur origine dans le fait qu’elle n’appartenait pas à ce phalanstère de notabilités qui se divertissaient ensemble, se mariaient ensemble, se trahissaient ensemble. Des signes extérieurs de richesse donnaient pourtant l’impression qu’elle en était. Elle portait à merveille sa tenue verte de chez Molyneux et son petit feutre « cendre de brique » ; ils lui allaient presque comme à l’épouse d’un banquier, mais n'étaient qu'un déguisement insuffisant pour lui faire intégrer une communauté à laquelle, par tout le reste, elle était étrangère. Physiquement, on lui trouvait les doigts un peu épais, des mains d’ouvrière ; la poitrine un peu forte, des mamelles de nourrice ; des mollets trop larges, des jambes de commissionnaire. De cela, certains ne s’offusquaient pas, et l’exotisme de son allure plébéienne ne refrénait pas les regards concupiscents. Dans ses manières, on l’estimait vulgaire. On disait que c’était dans ses gestes, et son visage surtout, parce qu’il y avait beaucoup trop de rouge sur ses lèvres et sur ses joues. Puis, elle avait des airs de Louise Brooks, les mêmes cheveux noirs et la même coupe de vamp provocante. Enfin, et c’était le plus grave, elle n’avait pas un sou, venait d’une famille inconnue, et comme naïvement elle répondait aux rares curieux qui l’interrogeaient sur « sa vie d’avant » qu’elle était ouvreuse dans un cinéma, elle laissait imaginer, avec une si modeste extraction, une jeunesse délurée et licencieuse. De tout cela, on causait, on médisait à bas mots, on riait sans lui tenir rigueur de son état, car la bonne société pittsbourgeoise était réputée progressiste. En vérité, si cette femme qui se nommait Mary-Lou Smith indisposait autant les spectateurs autour d’elle, c’était moins à cause de son allure, de son extraction prolétarienne ou de son passé supposé qu’à l’audace avec laquelle elle s'affichait au milieu d’eux. On lui reprochait son arrivisme et sa prétention à se croire d’une classe sociale supérieure en étant seulement l’amante passagère d’un riche héritier. Reproche malvenu, puisque sa présence au milieu de cette foule, Mary-Lou Smith la devait à l’insistance de ce dernier. Il était à l’origine de cette situation inconfortable pour la jeune femme et inconvenante pour une grande partie de la foule qui, sans oser témoigner sa désapprobation à un membre si éminent de l’Allegheny Country Club, n’en pensait pas moins. Cependant, beaucoup étaient déjà disposés à lui pardonner sa conduite, car au même instant, il se trouvait sur le green de golf en belle position pour remporter le duel face à son adversaire de toujours, William C. Fownes Jr. de l’Oakmont Country Club. C’était la prestigieuse affiche du jour, William C. Fownes Jr. opposé à Ebenezer McBurney Byers, un duo qui avait marqué deux décennies du golf amateur, et qui, en cette fin d’été 1927, renouait avec sa gloire passée. Les deux hommes avaient livré une partie remarquable, Fownes dominant les premiers trous jusqu’à avoir six coups d’avance sur Byers qui avait débuté la confrontation en étant l’ombre de lui-même. Puis, les rôles s’étaient inversés ; Byers, soudainement en pleine possession de ses moyens, avait largement dominé le reste de la partie, ramenant l’écart avec son adversaire à un seul coup. Après un putt facile manqué par Fownes à la fin du dix-huitième trou, la victoire de Byers semblait même certaine. Il lui fallait encore bien négocier un coup à peu près semblable pour l’emporter. Dans le public, le silence régnait pour ne pas troubler la concentration du joueur qui s’apprêtait à conclure. Au loin, un pic, peu sensible à l’enjeu sportif, frappait en cadence dans un tronc d’arbre. Fownes, inexpressif, se tenait debout, à proximité de son caddy, la main gauche appuyée sur son putter, le poignet droit sur la hanche. Impassible à première vue, il bouillonnait intérieurement d’avoir commis une erreur de néophyte et d’avoir confié son sort aux mains de son adversaire. Sans même s’en rendre compte, Mary-Lou, nerveuse, avait porté sa main droite à ses lèvres, tachant de rouge son gant blanc. John Frederic Byers, le frère du champion, restait immobile comme une statue de marbre. Contrairement à sa femme, Caroline, qui souriait déjà et semblait pressée d’applaudir le gagnant, il préférait contenir son enthousiasme. En tant que joueur de golf émérite, il savait l’imprévisibilité de son sport, et surtout, d’un coup roulé. Byers s’apprêtait à putter, mais au dernier moment, il se ravisa. Se dirigeant vers son caddy, il tira un autre putter, le soupesa, examina la tête, et se débarrassant de son putter en fer, il privilégia celui en aluminium. Retournant à sa balle, il prit la position singulière d’un joueur de croquet. Ce n’était pas un geste académique, mais c’était toujours ainsi que Byers avait joué ses coups roulés, et il en avait moins manqué que bien des académiciens du geste. De la balle au trou, il n’y avait ni pente ni obstacles, alors Byers se contenta de balancer doucement sa crosse comme un pendule, heurtant sa balle avec la face de son putter en appuyant juste assez pour la faire glisser jusqu’à son point de chute. Au « toc » mat du coup succéda le froissement léger du caoutchouc durci sur le green. Tous les yeux fixèrent la course de la balle qui avançait si mollement que les plus novices crurent qu’elle s’arrêterait avant le trou. Au contraire, elle l’atteignit, et même, le dépassa en glissant d’à peine quelques millimètres trop à droite. Elle s’arrêta à moins de dix centimètres de son but sous les « Oh » unanimes des spectateurs. Ils disaient tout à la fois la déception des membres de l’Allegheny Country Club et le soulagement inespéré de ceux du Oakmont. Byers, mécontent de son coup, grimaça et jeta son club d’agacement. Son geste, contraire à l’étiquette, ne surprit pas, car les colères du joueur avaient fait sa réputation autant que son talent, et c’était même devenu un spectacle iconoclaste attendu. La conclusion de la partie fut une formalité, et la victoire de Fownes se joua à un coup d’avance. Les deux adversaires se serrèrent la main et se congratulèrent, conscients d’avoir disputé une belle rencontre, aussi accrochée et indécise que celles de leur âge d’or. Fownes fut applaudi et rejoint par son épouse, par son frère, Henry, directeur de « l’Oakmont », et par les membres les plus éminents de son club, soucieux de féliciter leur champion. Fair-play, John Denniston Lyon, directeur de l’Allegheny Country Club, vint également lui serrer la main et lui confier avoir rarement vu un combat si acharné et un tel suspense dans une partie de golf : — Je dois dire, répliqua Fownes, que je n’attendais pas cette résistance d’un joueur qui n’est plus en compétition depuis la guerre ! Si Dieu existe, il était peut-être ici avec moi sur ce dix-huitième trou ! Lyon esquissa un sourire de principe tout en invitant le groupe assemblé à l'accompagner au club-house où devait se tenir une garden-party. De son côté, John Frederic Byers rejoignit son frère qu’il savait déçu malgré le faible enjeu sportif de la partie qu’il venait de perdre. Il le trouva en compagnie de sa petite amie qui, obligée de se retenir dans ses démonstrations sentimentales toute la partie durant, s’était jetée à son cou comme une enfant pour le consoler. John Byers tenta de refouler l’expression affligée qui se peignait sur son visage devant ce spectacle risible et attendit patiemment que son frère se fût défait de l’étreinte de sa nymphette pour l’aborder avec des mots réconfortants : — C’était une partie remarquable. Ta meilleure depuis longtemps sur les huit derniers trous. — À l’exclusion du dernier ! répliqua Eben Byers, visiblement frustré. — Ton adversaire m’a confié avoir eu Dieu avec lui ! continua John Byers en souriant. Tu n’y pouvais rien ! Allons, l’essentiel est que nous ayons eu un spectacle de charité digne d’une véritable compétition ; grâce à Fownes et grâce à toi ! Tu restes notre champion ! — Oui, notre champion ! s’exclama Mary-Lou sur un ton candide qui sonna niaisement aux oreilles de John Byers et de son épouse. Elle déposa un baiser sur la joue de son amant qui avait plutôt l’âge d’être son père ; Caroline Byers ne put retenir un soupir d’agacement : — Un champion qui a dû se froisser un muscle ! maugréa Eben Byers en se massant l’épaule. — Plains-toi, je suis ton frère cadet, et même sans compétition, il m’arrive d’avoir des rhumatismes qui me laissent coincé dans mon lit ! Demande à Carrie, elle est obligée de me pousser parfois ! — Idiot ! s’exclama cette dernière en soufflant gentiment son mari sur l’épaule. — Ah, mais c’est vrai ! insista John Byers. Les jours humides, il me faut une séance de rayons violets si je veux me tenir droit sans souffrir. On dit que ce sont les excès de la jeunesse qui se payent ! J’aurais mieux fait d’être joueur d’échecs ! — Acteur ! corrigea Mary-Lou de sa voix perçante. — Croyez-vous que j’en ai la tête ? demanda John Byers, très surpris par cette remarque. — Le cinéma c’est comme le vrai monde, il faut de toutes les têtes ! répliqua la jeune femme sur un ton étrangement sérieux, si sérieux que John Byers, qui n’en attendait pas tant d’elle, resta muet de stupéfaction. Il répondit finalement d’un « Oui, peut-être ». Caroline Byers, voyant l’embarras de son mari et le visage sombre de son beau-frère qui restait piqué par sa défaite, lança, sourire aux lèvres : — Allez, messieurs, le club-house n’est plus qu’à cent mètres. Un rafraîchissement vous fera oublier vos douleurs ! Un petit effort, car nous n’allons pas vous porter ! -II- Le club-house de l’Allegheny Country Club était une élégante bâtisse en bois aux allures de luxueuse résidence de villégiature faisant la part belle aux terrasses et aux grandes fenêtres pour permettre à ses membres de profiter du fairway environnant, du spectacle autant que du cadre bucolique recherché par une clientèle soucieuse de s’écarter un instant de son quotidien ennuyeux ou harassant. Il n’était pas installé au sommet d’une petite colline comme celui du Oakmont Country Club qui, avec des jumelles adéquates, offrait une vue imprenable sur l’ensemble du parcours de golf, mais il n’en restait pas moins un lieu charmant avec toutes les commodités modernes que pouvait exiger une fréquentation huppée. L’intérieur mêlait la chaleur des boiseries d’acajou et d’ébène et la douceur du chintz émaillé qui tapissait les banquettes et les fauteuils et pendait en rideaux aux fenêtres. Toutefois, parce que le club-house aurait eu des airs convenus avec si peu de fantaisie, s’ajoutait à la décoration l’exotisme d’un mobilier hispanique et de tapis et de porcelaines chinoises aux formes et aux couleurs singulières. Ainsi, le club-house était un endroit de détente, mais avec cette touche d’excentricité propice à stimuler la gaieté et la convivialité, alors même qu’il n’était plus possible d’améliorer son humeur avec un verre de vin depuis l’entrée en vigueur de la Prohibition. Bien entendu, comme dans tous les clubs select dignes de ce nom, il y avait une cave pleine de champagne et de cognac, de bourbon et de gin, mais elle ne s’ouvrait qu’aux membres introduits, et elle resta naturellement fermée en cette journée particulière qui réunissait dans une union fraternelle les deux clubs rivaux d’Allegheny et d’Oakmont. S’ils s’étaient livrés à une compétition par l’intermédiaire de leurs champions, sortis exceptionnellement de leur retraite sportive pour s’affronter comme aux temps glorieux de leur jeunesse estudiantine, c’était pour une cause charitable, et si chacun des spectateurs présents ce jour-là avait déboursé, à minima, la coquette somme de cent dollars pour assister à la partie, l’argent était destiné à la souscription en faveur des victimes de l’accident de l’Equitable Gaz Company qui avait ravagé tout un quartier de Pittsburgh moins d’une semaine plus tôt. Un réservoir de 1,5 million de mètres cubes de gaz naturel avait explosé. Autour d’un cratère de vingt-cinq mètres de profondeur s’étendait, sur trois-cents mètres à la ronde, un horrible capharnaüm fumant de monceaux de briques, de structures d’acier tordues, de locomotives renversées et de vitres soufflées que les autorités commençaient à peine à déblayer. Il était déjà acté qu’il faudrait des mois pour effacer les stigmates matériels de l’accident, mais beaucoup plus aux plaies humaines pour cicatriser, et aux vingt-huit morts de l’explosion s’ajoutaient plus de six-cents blessés et d’autres milliers de sans-abris ne pouvant plus demeurer dans les logements les plus fragilisés par le séisme. L’accident était survenu dans le quartier d’Allegheny, dans une zone industrielle et portuaire le long de la rivière Ohio, et un comité de soutien s’était rapidement organisé pour venir en aide aux victimes, principalement des familles d’ouvriers qui vivaient au plus près du lieu de l’explosion et se trouvaient à la rue et sans travail. Dans ce contexte, l’Allegheny Country Club avait décidé la tenue d’un évènement particulier pour lever des fonds et convié à cette fin l’Oakmont Country Club, son historique rival. Plus d’un donateur avait doublé ou triplé la souscription minimale de cent dollars, ce qui restait modique pour eux, mais représentait une petite fortune pour les œuvres charitables de la ville. En tant que directeur de l’Allegheny Country Club, John Denniston Lyon ne cachait pas sa satisfaction, et dans le grand salon du club-house, montant sur une estrade qui supportait un pupitre installé pour l’occasion, devant tous ceux qui quelques instants plus tôt avaient assisté au superbe duel Fownes-Byers, il prit la parole pour une allocution de circonstance : — Mesdames et messieurs, avant que nous nous sustentions au buffet, je tenais d’abord à faire un discours qui paraîtra évidemment trop long et ennuyeux à certains, mais qui s’impose en cette occasion particulière qui nous réunit tous, vous, confrères et consœurs de l’Allegheny Country Club que j’ai l’honneur de présider, et vous, voisins, rivaux et néanmoins amis de l’Oakmont Country Club. Je veux remercier son directeur, Henry Fownes, frère de notre champion du jour, pour sa présence et son investissement dans la bonne tenue de cette journée. Après moi, il vous fera un petit discours de circonstance. Comme vous le savez, notre chère ville de Pittsburgh à la prospérité de laquelle nous œuvrons quotidiennement, a été frappée par une terrible catastrophe, peut-être la plus terrible depuis le grand incendie de 1845. L’enquête, sûrement, en dira l’origine, et nous devons espérer que tous les enseignements nécessaires en seront tirés pour qu’un drame semblable ne se reproduise plus à l’avenir. Cependant, cette plaie ne guérira jamais complètement, car des ouvriers qui travaillaient sur les lieux au moment de l’explosion sont morts, des pompiers parmi les premiers à intervenir ont été victimes d’un effondrement, des centaines de personnes ont été blessées par des vitres éclatées, l’éboulement de leur maison, des jets de briques et de ferrailles, et alors que nous sommes presque à dix jours de l’accident, nos hôpitaux sont toujours saturés de patients dans un état préoccupant. Cette calamité seule nous oblige à nous engager, nous, quelques-unes des plus éminentes familles de Pittsburgh, à aider notre communauté, mais il y a plus encore. Des milliers de personnes, des familles entières, ont perdu leurs logements, vivent dans les rues ou dans des habitats sans fenêtre qui menacent de s’écrouler sur eux-mêmes, et nous entrons dans la mauvaise saison. Chaque jour, vous en êtes témoins, des femmes et des enfants dorment sur nos trottoirs, presque devant nos portes, sans rien d’autre que les vêtements qui les couvrent. C’est là une crise qui exige une réponse rapide, ferme, et que les autorités publiques, débordées par l’ampleur du drame, ne peuvent prendre en charge seules. Face à ce constat, nous nous devions d’agir. Beaucoup d’entre vous déjà ont donné de leur temps et de leur argent aux œuvres de charité et nombre de ces pauvres hères ont pu être hébergés dans des églises et des foyers, nourris et vêtus de vêtements chauds. Je vous remercie d’autant d’avoir donné à nouveau aujourd’hui, et notre trésorier, William Robinson, qui se tient à côté de moi, m’a fait savoir que nous avions recueilli près de quinze mille dollars, une somme considérable qui justifie que nous la conservions au coffre, jusqu’à son transfert sous bonne garde à son destinataire, la mairie de Pittsburgh, qui la distribuera suivant les besoins de chacun. Je ne doutais nullement de votre générosité et je savais pouvoir compter sur vous dans ces moments difficiles. Je savais que la détresse des plus miséreux de notre ville trouverait à travers vous une épée pour la pourfendre. Évidemment, le succès de cette journée doit beaucoup à nos deux champions, ceux qui vous ont offert une partie digne des meilleures compétitions de golf alors même que l’enjeu n’était que caritatif, qu’il n’y avait à attendre ni coupe, ni prestige sportif, et qu’ils n’ont plus les jambes et les bras de leur prime jeunesse, mais ainsi que l’on dit familièrement, « ils ont de beaux restes ». William Fownes, Ebenezer Byers, voilà deux noms qui ont porté dans le monde entier la réputation des golfeurs de Pennsylvanie, il était naturel que pour un évènement d’exception comme celui d’aujourd’hui, nous reformions cette prestigieuse affiche qui aura tant apporté à notre sport, et plus largement, au sport américain. Je vous invite à les applaudir copieusement, tandis que je les somme de me rejoindre sur cette estrade, parce qu’ils le méritent ! Ce fut sous les applaudissements nourris de la foule que les deux golfeurs rejoignirent John Denniston Lyon sur l’estrade, lequel, après une courte conclusion, céda sa place à son homologue du Oakmont Country Club qui n’eut pas à ajouter grand-chose à un discours qui avait dit l’essentiel. Henry Fownes fit un speech rapide sur le devoir de solidarité dans les temps difficiles et sur la philanthropie comme vertu des riches en citant en épilogue de son intervention Andrew Carnegie : « L’argent ne peut être qu’une bête de somme au service de quelque chose qui le dépasse infiniment. » Malgré les airs ennuyants et sermonneurs du discours, il fit bref et fut applaudi pour cette raison, et reprenant la parole, John Denniston Lyon invita ses convives à se désaltérer au buffet prévu à cet effet. Il s’étalait là, en diable tentateur, sous les yeux de l’auditoire qui n’avait écouté que d’une oreille les allocutions qui venaient de lui être faites, alors que son attention se fixait sur les plats d’huîtres, les olives vertes, les tomates en tranches, les crevettes à la poulette, les toasts au bacon braisé Swift, les croquettes de poulet, les crackers salés et sucrés, les pointes d’asperges et les anchois confits au sel. Il y avait de la variété, mais ainsi que le sont les buffets aux États-Unis, les hors-d’œuvre étaient peu apprêtés. Ils auraient paru d’une simplicité déroutante à la notabilité qui se pressait désormais sur la partie droite du grand salon, là où était distribué ce lunch copieux, si elle n'avait été américaine. Des garçons de service en livrée de serveur d’hôtel étaient là pour servir les boissons, du lait glacé, du jus de raisin, du julep à l’orange et de la bière sans alcool qui coulaient dans les verres de cristal comme un vin du vieux monde. Henry Rea, le vice-président de l’Allegheny Country Club, avait tenté de convaincre John Lyon de faire servir du champagne et de la vraie bière à défaut d’alcools plus forts, puisqu’il était de notoriété publique que le Volstead Act avait peu de soutien dans une société pittsbourgeoise qui avait perdu ses distilleries de whisky et ses malteries florissantes. Néanmoins, il s’était vu opposer un refus sans appel de Lyon. C’était la guerre dans les rues de Pittsburgh que certains comparaient à Chicago. Les contrebandiers s’entretuaient, et pour lutter contre ces violences, un peloton d’agents fédéraux avait pris ses quartiers dans la ville. Le premier d’entre eux, John Pennington, était réputé pour sa sévérité et son incorruptibilité qui l’avaient amené à enquêter jusque dans l’entourage du maire de Pittsburgh. Il était l’un des rares à refuser les pots-de-vin, et dans ce contexte qui incitait à la prudence, Lyon avait préféré réserver à un usage privé les bonnes bouteilles de son établissement. Aussi, l’on trinqua avec des jus de fruits et des cocktails sans alcool tout en se lançant des invitations à venir boire moins sobrement à une prochaine party organisée chez untel ou untel. Tandis que Mary-Lou allait quérir un verre de jus de raisin et quelques hors-d’œuvre en faisant les yeux doux à un jeune serveur qui lui avait paru charmant et avec lequel elle entra dans une causerie un peu flirtante, John Byers, qui avait laissé sa femme avec des amis, profita de l’occasion pour allait voir son frère qui finissait juste de recevoir les énièmes compliments d’un couple d’admirateurs. Il lui demanda à nouveau si la défaite n’était pas trop pénible, car il connaissait le caractère compétiteur de son frère qui avait mis fin à sa carrière prématurément dès lors qu’il ne s’était plus trouvé physiquement capable de rester au sommet de son sport. Eben Byers essaya de se montrer serein, mais son frère devinait qu’il n’avait pas complètement digéré sa défaite. Au fond, cela le rassurait ; c’était signe qu’il allait bien. John Byers remarqua qu’il observait sa petite amie occupée à fricoter avec le serveur. Elle riait, alors que lui souriait timidement, elle dodelinait de la tête en minaudant alors qu’il rougissait, ne sachant trop comment réagir tandis qu’il travaillait et se doutait que cette femme avait sans doute son époux dans l’assemblée : — Trois mois, lança John Byers à son frère après avoir avalé une rasade de son lait glacé. — Que dis-tu ? demanda Eben sans détourner les yeux de sa petite amie. — Cela fait trois mois que tu es avec elle. C’est presque un record pour toi. — Tant que ça, déjà ? Me voilà devenu casanier. — Tu ne devrais pas en plaisanter. Allons, elle est charmante, elle a un joli corps, un joli visage, et même, elle n’a pas l’air bête, mais c’est une gamine, elle a à peine vingt ans et tu en auras bientôt cinquante. Elle est avec toi par intérêt. C’est bien normal, son manteau vaut sûrement plus que tout ce qu’elle a gagné dans sa vie, et une fille aussi jolie ne peut pas supporter la pauvreté sinon elle se fane, mais toi ? Tu as l’âge de fonder une famille, d’avoir des enfants, et ce n’est pas avec elle que ça arrivera et tu le sais. Tu n’es plus le « Foxy » fringant de tes jeunes années mon frère, c’est fini le temps de courir la minette. Je ne dis pas, c’était une belle époque, mais il vient un moment où il faut se raisonner, car si on ne le fait pas, on quitte ce monde seul et avec le sentiment d’une vie emplie de futilité. — Il me reste un peu de temps ! Puis, toi tu as eu la chance de tomber sur Caroline, moi je n’ai pas encore trouvé ma moitié. — Ce n’est pas en abordant les femmes suivant l’intérêt de leur croupion que tu la trouveras ! Enfin, tu vois bien, il viendra un moment où elle croisera un jeune avocat ou un jeune médecin bien né avec le physique avantageux de ce serveur, et elle partira avec lui. C’est l’ordre des choses. Tu en trouveras une autre, puis une autre, mais il viendra un temps où même ta belle voiture ne suffira plus à faire asseoir les minettes sur ta banquette, et ce jour-là, il sera trop tard. — Il restera les prostituées ! — Eben ! — Allons, tu ne vas pas me faire la morale. — Et tu la payeras pour te faire un enfant ? Pour rester près de ton lit de mort ? — Je préfère qu’elle le soit de mon vivant ! — Tu prends tout à la plaisanterie. L’amour, les affaires… — Mais j’aime, j’aime Mary-Lou. Je l’aime intensément, puis un jour… J’en aimerai une autre. C’est ainsi. Je suis comme une abeille, je butine à plusieurs fleurs. Quant aux affaires, si Dallas n’avait pas été contraint de fuir la justice en Europe et de disparaître on ne sait où dans le vaste monde… — Ne parlons pas de cela ici, je te prie ! — J’aime les femmes, j’aime la fête, j’aime le sport, j’escompte bien vieillir aussi longtemps que possible avec ces trois plaisirs. — J’espère que tu n’auras pas à regretter de n’avoir que ces plaisirs ! Enfin, n’en parlons plus ! Mais je te tiendrai le même discours à la prochaine que tu ramèneras à ton bras. — J’y compte bien, c’est à cela que sert un frère ! — Si encore j’étais l’aîné… — Si les aînés étaient plus raisonnables, Dallas serait toujours à la tête de l’entreprise, répliqua Eben avec un sourire malicieux. John Byers grimaça, tandis que sa femme s’avançait vers lui en lui demandant ce qui l’ennuyait. Sa grimace s’effaça aussitôt et il lui confia que c’était l’aigreur de son lait : — Je crois qu’il a tourné ! précisa-t-il pour se faire plus convaincant. Elle se proposa d’aller lui en chercher un autre, mais il la retint et ajouta en dévisageant son frère : — Tu devrais aller sauver ce pauvre serveur ! Il va finir par éclater à force de rougir ! Eben Byers inclina la tête en laissant échapper un ricanement sarcastique, et après un temps d’hésitation, il accepta finalement d’aller troubler de sa présence le tête-à-tête qui s'éternisait entre sa petite amie et le malheureux jeune homme qu’elle avait pris dans ses rets.
7
Résumé : Le Comminges. Dans ce coin tranquille, au pied des Pyrénées, la présence incongrue d'un corps mutilé va mobiliser les gendarmes de Salies-du-Salat, associés pour l'occasion à la section de recherche de Toulouse.
Marco Minelli, comptable sans histoires, se retrouve mêlé bien malgré lui à une enquête angoissante qui va le plonger dans les affres du doute, tiraillé entre la raison et la folie.
Ces petites bourgades aux ruelles paisibles abritent-elles la tanière d'un tueur sanguinaire ?
Qui sera la prochaine victime ?
Un roman aussi noir que prenant.Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième énigmatique et intrigante. Nouvelle auteure pour moi, cette dernière apparemment a déjà écrit une trilogie familiale fort intéressante ; ici nouvel opus, et je dois dire que je n’ai pas été déçue du voyage ^^ Près de Toulouse, dans les Pyrénées, Marco Minelli, 45 ans, célibataire, est comptable dans une modeste entreprise. Entouré de sa pétillante voisine de palier Emmanuelle, une institutrice de 46 ans déjà grand-mère, son existence semble routinière. Il n’en est rien, puisque ce dernier possède un don : « enlever le feu ». Un jour, alors qu’il se rendait une nouvelle fois au chevet d’un copain d’ami afin de lui apporter son aide, de le soulager autant que faire se peut, il découvre stupéfait et anéanti le cadavre de son « patient » atrocement mutilé. Ces quelques lignes posées, le ton est donné, les questions taraudent notre esprit en ébullition : Sans rien demander en retour, Marco était venu soigner les brûlures de cet homme bourru et reclus, lui apporter un peu de mieux-être, pourquoi s’en est-on donc pris à cette personne, apparemment sans histoire ? Qui a pu commettre une telle atrocité ? Suite à un bruit de pas à l'étage, Marco s’enfuit, avec la désagréable sensation d’avoir été repéré sur les lieux. Et si le tueur l'avait vu ? Perdu, effrayé à l'idée d'être accusé à tort, il n’ose rien avouer aux autorités. Rongé de remords, il s’épanche auprès de Manu, celle qui demeure d’un soutien inestimable, et suit son conseil de ne rien garder pour lui. Désireux de garder tout de même une certaine sécurité, il décide d’utiliser un biais, un numéro masqué. Dépêchés sur place, les gendarmes viennent enquêter sur ce meurtre, sauf qu’un cas similaire lié à Marco leur a été signalé, remettant fortement en question certaines informations le concernant. Et quand un autre cadavre est retrouvé, le doute n'est plus permis : un tueur en série sévit dans le Comminges. Comment se fait-il que de telles actes odieux puissent être commis dans une terre aussi paisible ? Quels liens peut-il bien exister entre les victimes ? Manu, celle qu’il l'a toujours épaulé, croit fermement à son innocence, et se donne pour mission de rester à ses cotés quoiqu’il se passe. Mais, que dire des agissements étranges de Marco ces derniers jours ? Il semblerait que nombre de visions perturberaient son esprit et que sa routine quotidienne en serait du coup déstabilisée… Marco est-il bien la victime qu’il considère être ? Quel rôle ce dernier joue-t-il donc vraiment dans cette affaire ? Est-il aussi innocent qu’il y paraît ? Où se situe la vérité ? À l’image de l’imbroglio qui règne dans les têtes de nos protagonistes, nous voici entraînés, submergés, absorbés au cœur d’une intrigue éprouvante et dramatique, à la façon d’un casse-tête des plus obscurs. Par une astucieuse construction du récit, nous allons remonter dans le passé, alterner entre les points de vue des nombreux protagonistes, celui de Marco, celui de la police et également celui du tueur anonyme qui raconte son enfance maltraitée. C’est en accédant aux drames et à l'horreur vécue, à toute la palette des ressentis et des motivations, que le voile va peu à peu se déchirer, pour laisser apparaître les imperfections, les fissures des personnalités… Que va-t-on trouver sous les façades, sous les masques et les faux-semblants ? Que se cache derrière tout ça, et pourquoi ? Et surtout, quelles sont les raisons de cette sombre histoire ? Grâce à une écriture tantôt fluide et percutante, tantôt acérée et entraînante, les pages se tournent rapidement ; nous voulons savoir, connaître la conclusion concoctée par l’auteure. Les chapitres courts et rythmés renforcent le suspense, donnant une sensation d’immersion totale. Je tiens à ce propos à féliciter cette dernière pour sa précision et sa justesse. En effet, par son expérience auprès des jeunes enfants, l'intrigue demeure d’une grande profondeur, empreinte d’un réalisme certain puisqu’elle ose aborder et défendre un sujet particulièrement sérieux et délicat, relative aux problèmes dramatiques rencontrés par les enfants placés dans des foyers d'accueil. Rien ne nous sera épargné, ni les souffrances et séquelles psychologiques ressenties, ni les dérives d'un système défaillant où une simple accusation, même infondée, peut détruire des vies à tout jamais. Une réalité parfaitement décrite qui ne peut laisser indifférent ! Quant aux personnages, ils sont bien travaillés, servent parfaitement le récit. On s'émeut de certains et on en déteste d'autres. De péripéties en péripéties, nous laissons l’auteure nous balader au gré des ruelles pittoresques de cette petite bourgade et attendons l’explication du dénouement final, qui pourra surprendre ou être attendu, mais toujours en parfait accord avec l’ensemble. Alors, nos protagonistes arriveront-ils à dénouer tous les fils de cette sordide affaire ? Combien y aura-t-il de victimes avant que les représentant de la loi n'arrêtent le coupable ? À vous de le découvrir  De mon côté, vous l’aurez compris, j’ai beaucoup aimé ce thriller, qui pour une première découverte, a réussi à me captiver d’un bout à l’autre. J’aurais juste aimé encore plus de rythme, encore plus de tension et de rebondissements, même si une pause dans ces si belles montagnes donne envie de s’y perdre pour une petite balade. J’irai aussi faire un tour dans les précédents romans de l’auteure afin d’approfondir son univers  En conclusion, si vous aimez les polars aux meurtres crus, (âmes sensibles s’abstenir ^^) les intrigues tranquilles, qui n’ont pas avalé un TGV, les histoires qui bousculent, remettent en cause vos croyances… Foncez, ce roman est fait pour vous ! Vous passerez un excellent moment de lecture  Ma note : Ma note :       Pour vous le procurer : Editions Taurnada Amazon Pour vous le procurer : Editions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : Facebook Instagram
8
Résumé :
Une vieille dame meurt écrasée sous les roues d'un bus. Un nouveau fait divers dans les rues de Paris.
Cependant, d'autres « accidents » sont rapidement à déplorer, laissant présager que ces tragiques événements ne sont que les prémices d'un sombre dessein.
Le groupe de Lost se retrouve à la tête d'une affaire qui va bousculer toutes ses certitudes.
Frustration. Colère. Incompréhension. Impuissance…
Une course contre la montre au dénouement glaçant et inacceptable.Mon avis : Tout d’abord, je tiens à remercier Joël des éditions Taurnada pour sa confiance et pour m’avoir fait découvrir en avant-première ce nouveau roman à la quatrième fort intrigante. J’avais déjà lu et beaucoup apprécié les précédents romans de l’auteure, ses incontournables polars en compagnie du commandant Rebecca de Lost et son équipe. Si vous tenez à vous faire une petite idée de ce qui précède, pour les plus curieux, mes chroniques ici : Tome 1 : Peine capitaleTome 4 : Blessures invisiblesTome 5 : De l'or et des larmesIci, il s’agit du sixième et apparemment dernier opus de cette série. Je tiens d’ailleurs à préciser qu’il n'est aucunement nécessaire d'avoir lu les ouvrages précédents pour comprendre celui-ci. En revanche, vous n’aurez pas la possibilité de savourer l’évolution des personnages, suivre la vie de chacun au fil des années, au gré de leur vécu, avec leur lot de drames et de bonheurs. Tout commence par la mort énigmatique de Madame Corso, 85 ans, dans les rues de Paris. Accident ? Suicide ? Homicide ? Au fond peu importe, il faut pour l’instant enrayer l’hémorragie de ces meurtres terribles qui s’enchaînent, qui s'accumulent. Il faut dire que l’affaire devient inquiétante : en trois semaines, 6 personnes ont été assassinées, le mercredi, à la même heure, une dans Paris et l'autre dans les Hauts-de-Seine. Chose étrange, ils se produisent toujours par deux, sans mobile apparent, et sans qu’il ne semble exister de liens entre les victimes. Arrivés à la rescousse, l'équipe de Lost experte en affaires complexes se penche sur la question. Les enquêteurs comprennent rapidement qu'ils sont en présence de deux assassins, mais peinent à faire des rapprochements, à comprendre ce qui anime ces tueurs. Très vite, le ton est donné, l’angoisse monte, les questions nous taraudent : Ces personnes semblent n’avoir rien fait de mal, alors pour quelle raison sont-elles prises pour cible ? En quoi ces meurtres en cascade sont-ils reliés ? Quel peut être le mobile de ces atrocités ? Est-ce le fruit du hasard, ou un projet beaucoup plus construit et machiavélique ? Qui se cache derrière ces meurtres affreux ? Et surtout, va-t-on finir par les arrêter ? Rebecca doit trouver des preuves, des liens, des explications au plus vite ; une course contre la montre à débuté… L’enquête est épineuse, met les nerf de chacun à rude épreuve. Malgré les efforts, la commandante se retrouve pour la première fois coincée dans une enquête. Comment trouver de quoi confondre les coupables quand rien ne relie le tueur aux victimes et qu'aucun indice n'est laissé sur les lieux des meurtres ? Les policiers seraient-ils en présence de crimes parfaits ? Comment gérer cette impuissance, cette frustration à ne pouvoir rien résoudre ? Comment vont faire les enquêteurs pour se sortir de cette ornière ? Sous la plume tantôt fluide et entraînante, tantôt acérée et percutante de l’auteure, nous voici plongés, enferrés, happés au cœur d’une intrigue complexe mais fascinante à la manière d’un puzzle macabre dont les pièces n’ont à première vue ni queue ni tête, mais qui au fil d’une enquête rondement menée, vont s’emboiter à la perfection. Quant aux personnages, ils ne sont pas en reste, bien travaillés, servant au mieux la complexité du récit. Si nous ne pouvons ressentir aucune sympathie pour ceux qui sèment la mort, il n’en est rien pour Rebecca qui traverse une période difficile : la perte récente de sa grand-mère maternelle, avec laquelle les liens demeuraient rompus. Ce manque de proximité va la pousser à explorer un passé familial douloureux ; un mystérieux violon retrouvé dans l'appartement de la défunte pourrait d'ailleurs éclairer les motivations de sa mère... Avec courage, force et ténacité, la jeune femme va faire de sacrées découvertes sur son passé, enfin trouver des réponses qu’elle n’aurait jamais imaginées, et vont la pousser à prendre des décisions radicales. Les pages se tournent à toute allure ; on veut savoir. Le rythme est nerveux, enlevé. Le style incisif permet une immersion totale. L'histoire nous captive, nous malmène, nous ballade. Et une fois libérés, nous restons interdits, pantelants, essorés, et on en redemande. À ce propos, un léger bémol a entravé ma lecture : sans spoiler, l’histoire se clôture sans que l’intrigue soit vraiment terminée, et je dois dire que nous restons un peu sur notre faim… Pour moi qui ne suis pas friande des fins aussi ouvertes, j’aurais pensé que tous les arcs se clôtureraient en même temps, surtout que la série touchait à sa fin. Y aurait-il du coup un autre opus dans les cartons afin de revoir Rebecca et de boucler cette enquête ? Vous l’aurez compris, j’ai beaucoup aimé ce roman qui se lit avec délice. J’ai aimé suivre l’intrigue aux multiples rebondissements, autant sur l’affaire, que niveau personnel ; me faire bousculer par l’auteure, me perdre dans les méandres de son histoire pour me retrouver exactement là où elle le souhaitait... Alors, si vous aimez les polars aux nombreuses facettes, les personnages bien campés, les récits addictifs qui traitent de sujets de société, ce dernier opus des aventures de Rebecca de Lost est fait pour vous ; vous passerez un excellent moment de lecture  Ma note : Ma note :       Pour vous le procurer : Éditions Taurnada Amazon Pour vous le procurer : Éditions Taurnada AmazonRéseaux sociaux : Twitter-X Facebook Instagram
9
« Dernier message par Apogon le jeu. 23/01/2025 à 18:05 »
Un nouveau départ T3 : Les racines du passé de Christelle Morize Pour l'acheter : AmazonRéseaux sociaux : Twitter/X Facebook Instagram Site auteure : Christelle MorizeRésumé :
Alors que Jane trouve enfin un semblant de stabilité auprès de Luke, une ombre menaçante plane sur elle. Brett, animé par des intentions machiavéliques, poursuit son plan implacable pour l’anéantir.
Inconsciente de ce qui se trame derrière son dos, Jane, déterminée à construire l’avenir professionnel dont elle rêve, met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs.
Toujours furieuse contre sa mère, Charlie commence à se poser des questions et souffre malgré tout du fossé qui se creuse entre Jane et elle.
Cependant, un allié mystérieux veille dans l’ombre pour contrer les desseins de Brett.Un nouveau départ Tome 3 À toi, ma petite maman, qui as toujours été ma source de lumière, même dans les jours les plus sombres. Je te dédie ce roman en hommage à l’amour incommensurable que tu m’as donné.
C’est si peu…
Tu étais mon roc, ma meilleure amie, ma confidente.
Tu m’as transmis ta passion pour la littérature, partagé tant de souvenirs sur ton passé et ceux de tes ancêtres.
Le 9 décembre 2024, tu es partie dans un monde meilleur, et je ne sais toujours pas comment je vais faire pour continuer sans toi.
Tes magnifiques yeux bleus me manquent, ton sourire solaire et tes petites blagues me manquent.
Malgré mon chagrin, je suis heureuse d’avoir pu prononcer les trois mots les plus importants avant ton grand départ pour les étoiles : Je t’aime, ma petite maman !"Dans chaque famille, il y a des fissures, mais aussi une lumière qui y pénètre."
Leonard Cohen
(Inspiré d’Anthem) Premier Chapitre Jane ne se souvenait pas s’être autant souciée de son apparence. Depuis son retour à Bozeman, elle reprenait goût au maquillage. Un rituel quotidien qui devenait peu à peu naturel. Cela lui procurait énormément de plaisir de se faire belle, d’abord pour elle, parce que la jeune femme s’était trop longtemps négligée, mais aussi pour Luke. Même si ce dernier l’avait dévisagée la veille avec des yeux rougis par les larmes, le mascara coulant sur les joues, elle ne le rebutait pas. Un constat que Jane s’était fait le matin en remarquant son reflet dans le miroir. Malgré la mine épouvantable qu’elle affichait, Luke l’avait désirée et ils avaient fait l’amour comme si c’était leur première fois. Après un déjeuner mouvementé à la boulangerie de Joanna, puisque les clients se ruaient littéralement autour du comptoir et se précipitaient dès qu’une table se libérait, tous les deux s’étaient baladés sur Main Street. A dix jours de Noël, l’effervescence semblait à son comble. Beaucoup moins stressante et agitée qu’à Los Angeles, la course aux cadeaux animait la ville et ses habitants de cette douce euphorie des fêtes de fin d’année. La bonne humeur demeurait présente sur chaque visage et ce, malgré le froid et la neige. L’année passée, Jane s’était rendue dans pas moins de quatre boutiques pour trouver le cadeau idéal censé plaire à Charlie. A déambuler dans les rayons bondés, patienter des heures dans une file d’attente interminable parmi des clients ronchons et quitter le magasin en s’infiltrant tant bien que mal dans une grappe de personnes pressées. En comparaison, Bozeman ressemblait au village du père Noël. Durant leur promenade improvisée, alors que des regards curieux se retournaient sur eux, Jane avait relaté à Luke sa conversation qu’elle avait eue avec monsieur Benson. Si l’énigmatique JHB avait été découvert, la jeune femme craignait que la relation entre sa mère et le galeriste n’ait brisé le couple de ce dernier. Bien qu’elle n’appréciait guère Veronica, Jane se sentait indirectement responsable. Elle se demandait si la jolie blonde avait gardé le contact avec sa mère et se promit de poser la question à Édouard Benson. Tout deux s’étaient séparés devant leur voiture respective, non sans un long et savoureux baiser. Luke devait récupérer sa Jeep au garage et aider Taylor à installer les décorations extérieures de sa maison. De son côté, Jane choisit de rester chez elle le reste de l’après-midi pour faire un peu de rangement dans la chambre de Charlie. Elle décida ensuite de descendre les toiles de sa mère dans son bureau, les enveloppant toutes dans un chiffon propre pour les protéger. Puis elle sortit dans le jardin avec Dixie et son chiot. Dans une ultime tentative pour retrouver son portable, la jeune femme avait fouillé la neige aux pieds de quelques arbres, sans grand succès. Il ne lui restait plus qu’à attendre le printemps pour espérer le retrouver. Non pas qu’elle y tenait tout particulièrement. Jane regrettait cependant de ne pas avoir pris la peine de sauvegarder quelques photos de Charlie et elle, quand toutes deux étaient allées au Disneyland de Los Angeles. Elles étaient rentrées de cette merveilleuse journée des étoiles plein les yeux. Une carte SD pouvait-elle survivre au rude hiver du Montana ? Se demandait la jeune femme. Elle serait fixée à la fonte des neiges. Après une douche bien méritée, Jane chercha longuement une tenue pour aller dîner chez Luke. Elle jeta son dévolu sur une élégante robe pull bleu glacier à col roulé et à la base asymétrique avec deux plis de dentelle. Simple et raffinée. Comme elle se rendait dans la maison voisine, elle ne mit pas les bas noirs ajourés qu’elle avait préparés et opta plutôt pour des bottes hautes. Le résultat lui parut harmonieux. Satisfaite du résultat, la jeune femme pénétra dans son bureau où elle avait posé la maison en pain d’épices, à l’abri des canines gourmandes. Elle se rappela combien Nicole, ainsi que la petite Lily, appréciait les gâteaux. Son chef d’œuvre sucré trouverait sans nul doute de fins gourmets pour la dévorer. Quand bien même elle ne se culpabilisait jamais de dévorer autant de pâtisseries, Jane n’en viendrait pas à bout toute seule. Elle s’octroya quelques minutes pour ouvrir son ordinateur portable, enregistrer l’adresse mail de Meredith Wingreen dans ses contacts privés et lui envoyer des excuses pour avoir oublier leur rendez-vous. Sans trop s’attarder sur les détails et, sachant pertinemment que l’auteure à succès connaissait désormais les raisons de son absence, elle lui expliqua brièvement sa décision de retourner vivre dans sa ville natale. Jane était sur le point de partir quand son téléphone sonna dans la poche de son manteau. Elle espérait vivement que Charlie prenait enfin le temps de l’appeler. Quelque peu déçue en apercevant le nom sur l’écran, même si elle appréciait toujours parler avec sa sœur de cœur, la jeune femme se demandait quand sa fille cesserait de la bouder. – « Je ne te dérange pas ? S’enquit d’emblée Betty, je viens seulement de me rappeler que tu dînais chez Luke ce soir. » – Je m’apprêtais à partir, sourit Jane avant d’adopter un air soucieux. Il y a un problème ? – « Oh non, tout va très bien, ne t’inquiète pas ! D’ailleurs, ce serait plutôt à moi de poser la question. » – Comment ça ? – « Tess Hordan a appelé Susan tout à l’heure. Son mari et elle viennent tous les ans à la réception de Noël qu’on organise à l’auberge. Elle lui a parlé de ton altercation d’hier avec ce salopard de Keith Parker au Montana Grill. » Jane ne doutait pas une seule minute que l’épouse de l’ancien shérif avait raconté la soirée dans les moindres détails, y compris sa sortie en trombe du restaurant. – « D’après Tess, Luke était furieux, reprit Betty, confirmant ainsi les pensées de Jane. Si Cameron Pearce ne s’était pas interposé, il aurait frappé ce gros nul de Keith. Ça lui aurait remis les idées en place. Il a même rembarré Veronica qui essayait de se la jouer avec sa bouche en cœur. » – Vraiment ? – « Absolument ! Luke a menacé Keith de l’escorter personnellement à la sortie du comté s’il t’approchait encore. Nan mais, sérieux ! Pourquoi cet abruti a remis sur le tapis la soirée du bal de promo ? Ce mec n’a rien d’autre à faire que de remuer les plaies du passé. » Voilà donc la raison de son appel. Betty s’inquiétait pour elle. La jeune femme lui en fut intérieurement reconnaissante. – Ça m’a un peu secouée au début, mais je vais bien, la rassura Jane d’une voix sereine. – « C’est ce qu’essayait de m’expliquer Susan puisque vous avez parlé toutes les deux au téléphone ce matin et qu’elle t’avait trouvée particulièrement joyeuse. Je suppose que tu n’as pas abordé le sujet avec elle pour éviter de l’angoisser. » – Honnêtement, j’étais tellement heureuse d’avoir pu mettre un nom sur les initiales du tableau que j’étais pressée de partager cette belle découverte avec elle. – « Je me disais aussi qu’il y avait quelque chose dans ce genre là, comprit Betty, seulement, je voulais juste savoir si ce sale type ne t’avait pas gâché ta soirée d’hier. Te connaissant fort bien, tu n’es pas de nature violente et pourtant, j’ai cru comprendre que cet imbécile s’est ramassé une paire de baffes. Il ne les aura pas volées. En revanche, ça montre à quel point tu devais être furieuse. » – J’ai vu tout rouge quand il a mentionné le fait que je m’étais fait sauter par ses potes dans les buissons, – ce sont ses termes. Je te mentirai en te disant que ses paroles ne m’ont pas chamboulée, confia Jane, en fait, pour être honnête, ça m’a catapultée vingt ans en arrière avec toute la souffrance de cette soirée, raison pour laquelle j’ai fui le restaurant. – « Je le savais, pesta d’emblée Betty, visiblement furibonde. Quand Tess a parlé du bal de promo, j’ai tout de suite su que tu penserais irrémédiablement à Helen. (Elle soupira bruyamment.) Je vais lui arracher les yeux, à cet abruti et peut-être même son cœur, s’il en a un. Quant à cette garce de Veronica, je lui couperai sa langue de vipère. Ah ! Pour colporter des ragots, ça fonctionne bien, mais pour rétablir la vérité, madame perd soudainement la parole. A moins que c’était volontaire de sa part. Je ne serai pas surprise. Peu importe, je vais la déglinguer quand même. » – Ne te donne pas cette peine, déclara Jane, qui pouvait ressentir la colère dans le ton qu’utilisait sa sœur de cœur. Le passé m’a un peu secouée, je ne le nie pas. Cependant, j’ai eu la chance d’avoir une épaule attentive. Luke s’avère être un très bon confident. Je ne crois pas avoir autant parlé de ma vie à un homme comme je l’ai fait avec lui. – « Oh ! Dois-je en déduire que ta soirée ne s’est pas achevée à la sortie du restaurant ? » – Nous avons passé une partie de la nuit à décorer la maison et le sapin. Il voulait me changer les idées après ce fiasco et ça a plutôt bien marché. (Elle marqua une courte pause avant de reprendre d’un ton rêveur.) Je n’ai jamais rencontré un homme tel que lui. Il est vraiment patient, drôle, prévenant. En sa compagnie, je me sens moi-même. J’irai même jusqu’à dire que je me découvre des facettes que je ne me connaissais pas. Jane s’attendait à une réponse surexcitée de Betty comme à son habitude et probablement une tonne de questions, mais un silence étrange s’instaura dans leur conversation. – Tu es toujours là ? S’enquit la jeune femme, étonnée. – « Oui, oui ! Je suis juste en train d’imaginer un somptueux mariage à l’auberge et un bel article dans le Bozeman Daily Chronicle avec un titre super accrocheur du genre : notre séduisant shérif n’est plus un cœur à prendre, il vient… » – Betty ! La coupa Jane d’un ton rieur. Tu es incorrigible. C’est un peu tôt, tu ne crois pas, pour parler mariage. – « Pas dans l’immédiat… pas dans dix ans non plus ! La taquina Betty d’une voix enjouée. » Jane ne savait pas si elle devait éclater de rire ou rêver tout haut avec son interlocutrice. La jeune femme ne pensait plus au mariage depuis des lustres, à juste titre. Son expérience avec Brett l’avait quelque peu échaudée. – En parlant de ça, je croyais que Keith Parker était marié, observa-t-elle, espérant changer de sujet. Je l’ai croisé ce matin avec Veronica devant la galerie de monsieur Benson et ils semblaient très proches. Beaucoup plus que la veille. – « Mouais ! Sa femme vient de demander le divorce. Elle est retournée dans le Wisconsin avec ses enfants. La pauvre aurait appris par l’ex associé de Keith qu’elle était cocufiée depuis des années. » – Oh, quel mufle ! (Jane fronça subitement les sourcils.) Mais, dis-moi ! Comment es-tu au courant ? Keith n’a pas remis les pieds à Bozeman depuis que son père l’a envoyé dans un institut disciplinaire. – « Madame Parker est toujours en contact avec sa cousine qui vit toujours à Bozeman et qui en a parlé à madame Branson, qui à son tour en a parlé à une amie que Tess fréquente régulièrement. C’est une petite ville. » – J’avais oublié à quel point les nouvelles passaient plus vite du bouche à oreilles, lâcha Jane d’un air dépité. A Los Angeles, rares étaient les personnes qui se préoccupaient de ce genre de détails, à moins d’être une personnalité célèbre. Bien entendu, Rob lui avait avoué la vérité quand ils s’étaient croisés par hasard. Peut-être s’était-il senti obligé de lui avouer les infidélités de Brett ? La jeune femme aurait apprécié qu’il le fasse avant que ce dernier ne les abandonne, Charlie et elle, pour sa secrétaire. – « Tu n’as pas idée ! Renchérit Betty, et mon petit doigt me dit que nous n’avons pas fini d’entendre parler du shérif et sa petite amie. Inutile que je te rappelle que Luke ne s’est jamais montré avec une femme depuis qu’il occupe ce poste. » Jane repensa immédiatement à sa conversation matinale avec Luke, sur sa relation quelque peu compliquée qu’il entretenait avec Kate. A cette époque, il était encore agent de sécurité. Peu de gens, excepté les employés de la banque, ne devait se soucier de ses relations personnelles. En devenant une figure d’autorité dans le comté, les habitants semblaient plus sensibles à sa vie privée. – « Mais pour l’heure, reprit aussitôt Betty, alors que des bruits de couverts et d’assiettes se faisaient entendre derrière elle. Je te laisse profiter de ta soirée. Je vais aider Susan et les filles à servir le repas. On se voit avant ton départ pour Yellowstone ? » – Merci ! Oui, je pense venir demain. On part lundi matin à l’aube, déclara Jane, essayant au mieux de dissimuler son excitation à la simple perspective de passer quelques jours en toute intimité avec Luke. Betty semblait visiblement ravie. Peut-être voulait-elle connaître davantage de détails croustillants sur leur soirée ? Quoiqu’il en fût, elles échangèrent des formules de politesse avant de raccrocher. En fermant sa porte, Jane huma profondément le doux parfum de la couronne. Enfin un Noël blanc ! Pensa-t-elle en admirant le duo de rennes et les sphères recouverts de neige. Elle sortit son portable et prit une photo de sa maison entièrement décorée. Comme promis, elle l’envoya à Samantha. La jeune femme parcourut les quelques mètres qui séparaient sa maison à celle de Luke en essayant de ne pas glisser. Elle découvrit les décorations installées l’après-midi même. Luke et Taylor avaient illuminé l’extérieur de part et d’autre. Des luminaires en forme de sapin ponctuaient l’allée en gravier. Des guirlandes lumineuses tombaient en pluie sur la façade. Une autre, ornée de petits flocons de neige, longeait le grand porche. L’encadrement de chaque fenêtre brillait de petites étoiles dorées. Un magnifique panier en osier d’où débordaient des branches lumineuses et posé devant l’encoignure de la porte d’entrée, apportait une douce ambiance festive. Une couronne au reflet doré accueillait les visiteurs.
10
« Dernier message par Apogon le jeu. 09/01/2025 à 15:29 »
Saisir le jour de Marjorie Levasseur Pour l'acheter : AmazonRéseaux sociaux : Twitter/X Facebook Instagram Site auteure : Marjorie LevasseurRésumé : Nathalie vient à peine d’entamer la quarantaine que sa mémoire commence à faillir. Quand le diagnostic d'un Alzheimer précoce tombe, l'urgence de réparer ses relations avec sa mère et d’obtenir des réponses à ses questions l'accapare.
Mais comment renouer avec celle qui a été si longtemps absente ? Comment se créer de nouveaux souvenirs avec elle et tous ceux qu’elle aime, en sachant qu’ils seront les premiers à être oubliés ?
D’Auxerre à Grignan, en passant par Avignon, Nathalie et ses proches devront tenter de resserrer leurs liens pour affronter les répercussions que la maladie de la jeune femme aura sur leurs vies et leur façon d’appréhender ce qui risque d’être perdu et le futur à venir.
Ils tenteront de ne pas perdre de vue le plus important : profiter de chaque moment comme si c’était le dernier.
Saisir le jour, sans penser au lendemain.Saisir le jour Prologue Trente-six ans plus tôt Derrière la vitre de la fenêtre de sa chambre située au premier étage de leur immense maison, Nathalie regarde la berline grise de sa mère s’éloigner dans l’allée jusqu’à ce qu’elle ne devienne plus qu’un minuscule point à l’horizon. Elle n’a pas versé une larme. À six ans, on est une grande fille, on ne pleure pas sur sa mère… sauf quand elle meurt. Et sa maman n’est pas morte, non, elle est plus vivante que jamais. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle part pour les États-Unis. Pour profiter de cette opportunité que lui offre la vie et qui, selon elle, ne se présentera pas deux fois. Un contrat de cinq ans avec le Carnegie Hall, ça ne se refuse pas. La carrière de Danielle Hoffmann, la star montante du chant lyrique, va tutoyer le firmament avec cette série de concerts à guichets fermés, que seuls quelques élus pourront s’offrir. La mère de Nathalie a du talent et elle le sait. Elle a travaillé d’arrache-pied durant de longues années pour atteindre ce niveau vocal, alors renoncer à ce précieux sésame qui lui ouvrira les portes des plus belles scènes mondiales pour son mari et sa fille ? Jamais de la vie ! Heureusement, le papa de la petite Nattie est là. Elle compte plus à ses yeux que n’importe qui. C’est ce qu’il lui dit. Tous les jours. Mais elle n’est pas dupe. Même si elle sait qu’il l’aime, l’adoration qu’il a pour sa mère est au-dessus de tout. Et comme il en est fou et refuse de la perdre, il la laisse partir, de peur qu’elle ne le quitte définitivement. Les yeux brouillés et les bras croisés sur sa poitrine, Nathalie murmure : — Je ne veux pas me marier. Jamais. Il y en a toujours un des deux qui aime plus que l’autre. Je préfère rester seule plutôt que de n’avoir que des miettes… Chapitre 1 À travers le hublot, Danielle regardait, comme hypnotisée, l’avion se rapprocher du gris du tarmac de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C’était la première fois qu’elle revenait en France depuis dix ans. Paris n’était qu’une étape. Dès le lendemain, elle prendrait le train pour Auxerre. Elle avait prévenu Nathalie par courrier – postal, bien entendu, elle restait hermétiquement réfractaire aux mails. Elle n’avait pas eu de réponse à sa lettre et cela l’inquiétait un peu, elle devait bien l’avouer… La dernière fois qu’elle s’était entretenue avec sa fille au téléphone, c’était à peine si celle-ci avait prononcé une phrase complète. Leur relation avait toujours été compliquée. Danielle était certaine que la petite fille qui sommeillait en elle lui en voulait encore de l’avoir laissée en France il y a trente-six ans. Nathalie pensait probablement qu’elle était une mère égoïste. Elle avait sans doute raison… en partie. Mais le fait que Danielle ait temporairement quitté mari et enfant pour faire carrière – même si le temporaire devait initialement durer cinq longues années –, ne signifiait pas, pour elle, qu’elle ne les aimait pas. Bien au contraire. Si elle avait choisi de rester en France en refusant cette opportunité de se produire au Carnegie Hall, elle l’aurait regretté toute sa vie et leur aurait fait payer son amertume, d’une façon ou d’une autre, même involontairement. Elle ne voulait pas que Benoît et Nathalie subissent ses frustrations, alors elle était partie… Ce fut le début d’une longue série d’absences, car ce premier contrat avec cette salle mythique avait ouvert une porte qui l’avait menée à toujours plus de concerts, sur les scènes les plus réputées. Elle rêvait de devenir chanteuse lyrique depuis toute petite. Et plus tard, quand les adolescentes de son âge affichaient fièrement les posters de chanteurs à la mode sur les murs de leur chambre, elle ne possédait que des clichés de Maria Callas. Elle écoutait La Traviata et La Bohème en boucle, les yeux fermés, et des frissons parcouraient son corps. Ses parents avaient vite compris qu’il ne s’agissait pas que d’une tocade et l’avaient inscrite à des cours de chant lorsqu’ils avaient réalisé qu’elle avait déjà des capacités vocales hors normes. Elle travaillait sans relâche et n’avait cure de ne pas profiter à fond de cette période de sa vie, comme toutes les autres filles qui couraient les garçons et faisaient du shopping. Elle avait mieux à faire. Les histoires de cœur n’étaient clairement pas sa priorité. Elle avait laissé quelques adolescents la courtiser, mais pas davantage, car il n’y avait de place que pour le chant dans son existence. Pourtant, quelques jours après son vingt-deuxième anniversaire, elle avait fait une rencontre qui allait bouleverser toutes ses certitudes. Celle de Benoît Garnier, Icaunais de son état. Elle participait à la représentation d’une chorale en tant que soliste. Le groupe vocal faisait une sorte de tournée dans plusieurs villes de France, notamment les préfectures de certains départements, et Auxerre en faisait partie. Pour une jeune Drômoise comme elle, qui n’avait jamais quitté sa région, c’était un sacré dépaysement. À la fin du spectacle, elle avait eu la surprise de voir ce beau jeune homme, à peine plus âgé qu’elle, s’avancer jusqu’à la scène de la salle dans laquelle ils s’étaient produits, lui tendre une seule et unique rose. Sans détour, il lui avait demandé de l’épouser. Elle avait éclaté de rire, plus par nervosité que par moquerie et il lui avait avoué suivre la troupe de choristes à travers toute la France, juste pour l’entendre chanter. Cela l’avait vraiment touchée. Elle n’avait bien entendu pas accepté sa proposition d’épousailles… enfin, pas à ce moment-là du moins. Benoît et Danielle s’étaient communiqué leurs coordonnées, s’étaient écrit des lettres interminables. Après chaque concert, ils se retrouvaient autour d’un verre à deviser sur tout et n’importe quoi et avaient fini par échanger leur premier baiser un soir de pluie, devant l’entrée de l’hôtel où logeaient l’ensemble des chanteurs. Leur relation était restée très chaste pendant de longues semaines et puis, lors des chauds mois d’été, ils s’étaient promis de se voir à Grignan – là où elle vivait avec ses parents – pour quelques jours, et ce fut là, dans une petite chambre d’hôtel sans prétention qu’ils s’étaient donnés l’un à l’autre. Un sourire empreint de nostalgie étira les lèvres de Danielle au souvenir de cette nuit d’amour. La première d’une longue série. Avant Benoît, elle avait connu des flirts sans conséquences, ne désirant pas s’attacher ni accorder trop d’importance à un homme. Mais elle n’avait pas prévu de tomber si vite amoureuse. Si vite, et si fort… Pour autant, l’amour n’avait pas réussi à supplanter le chant dans l’ordre de ses priorités. Danielle voulait toujours devenir une grande cantatrice et l’homme qui l’aimait et allait être son époux devrait accepter de passer au second plan, voire de vivre dans son ombre. Benoît n’avait eu aucun mal à s’accommoder de cette situation et pour cause : c’était de la chanteuse dont il était tombé amoureux en premier lieu et il ne recherchait pas la lumière. Son soleil, c’était Danielle, et cela lui suffisait… C’était le cas jusqu’à ce que le couple voie arriver dans leur existence cette petite fille qui n’était pas prévue. Pas aussi tôt, dès leur première année de mariage. Danielle avait aimé son bébé dès que la sage-femme l’avait mis entre ses bras. Mais elle avait toujours su, au fond de son cœur, que ce petit être ne pourrait, à lui seul, combler le manque créé par un éventuel abandon de ses projets de carrière. Il en était de toute façon hors de question. Le statut de mère au foyer n’était pas pour Danielle, elle avait d’autres ambitions. Aussi, quand six ans plus tard, le Carnegie Hall lui avait proposé ce contrat en or, elle n’avait pas réfléchi longtemps avant de faire ses bagages. À partir de ce moment, la vie des Hoffmann-Garnier s’était partagée pendant cinq années entre la France et les États-Unis, même si Benoît et sa fille, Nathalie, passaient le plus clair de leur temps dans l’Hexagone pour assurer à l’enfant la stabilité nécessaire à son épanouissement aussi bien scolaire qu’amical. Danielle ne s’était pas interrogée plus que cela sur le déséquilibre émotionnel de sa fille induit par l’absence quasi permanente de sa mère à ses côtés. Benoît assumait son rôle de père à merveille. Suffisamment en tout cas pour pallier les carences de sa femme. C’était du moins ce dont Danielle avait fini par se persuader… Avec les années, le fossé entre la mère et la fille s’était creusé jusqu’à devenir un abîme cinq ans auparavant lorsque Benoît avait quitté ce monde, emporté dans un stupide accident de la route. Danielle, prétextant des obligations professionnelles qui l’empêchaient de rester – elle avait exercé en tant que répétitrice et professeure de chant après la fin de sa carrière de cantatrice – était repartie aux États-Unis, son précieux port d’attache, aussitôt la cérémonie religieuse finie, sans un regard ni même un mot pour Nathalie, ce qui avait suscité une incompréhension totale de la part de celle-ci et des reproches s’en étaient suivis. Forcément. Comment expliquer à sa fille qu’il lui était viscéralement intolérable d’entrer dans ce cimetière, de voir le corps de son unique amour disparaître six pieds sous terre. Danielle était encore rongée par le remords et la culpabilité d’avoir préféré fuir plutôt que d’enterrer dignement son mari et d’accompagner son enfant dans la peine qui était aussi la sienne. Elle avait toujours su qu’il lui serait impossible de revenir en arrière. Elle devrait vivre avec ce poids. Éternellement. Chapitre 2 — Écureuil, tasse, soleil, m… Mince, qu’est-ce que c’est déjà ? Nathalie regarda le cahier posé devant elle sur la table et lutta contre la tentation de l’ouvrir. Elle butait toujours sur le dernier mot, quel qu’il fût. Ils étaient pourtant tous d’une simplicité désarmante. Elle les choisissait d’ailleurs dans ce seul but : qu’ils lui reviennent plus facilement en mémoire. D’aucuns auraient souligné que c’était une sorte de tricherie, qu’elle se rendait ainsi la tâche beaucoup plus aisée et qu’il n’y avait plus de challenge. Certes, mais cela la rassurait. Enfin… quand elle se les rappelait tous, ce qui était de plus en plus rarement le cas, elle devait bien l’admettre. Nathalie ferma les yeux et prit une longue inspiration. Un objet rond, de couleur orange, prit forme dans son esprit. — Mandarine ! Elle se retint de sauter de joie. Son enthousiasme bruyant n’aurait pas manqué d’interroger Audrey et elle n’avait pas envie de lui parler de cet exercice quotidien auquel elle s’adonnait depuis plusieurs mois déjà… Depuis ce jour où elle s’était retrouvée sur la place Charles Surugue, face à la statue de Cadet Roussel, sans savoir exactement pourquoi elle s’était rendue au centre-ville d’Auxerre alors qu’elle n’avait rien de spécial à y faire, à première vue. Son rendez-vous chez l’ostéopathe lui était revenu une heure plus tard quand la secrétaire de celui-ci l’avait appelée pour s’enquérir de la raison de son absence. Elle n’avait jamais oublié une consultation médicale ou paramédicale. Jamais. Ses proches louaient sans cesse sa mémoire d’éléphant. Elle se rappelait tout, même le plus infime détail, aussi inutile qu’il fût. Ce qui lui arrivait depuis quelque temps en était d’autant plus frustrant. Elle ne supportait pas ces failles toujours plus nombreuses dans ses capacités intellectuelles. Parce que ses troubles ne se limitaient pas à l’absence de souvenir de ce qu’elle avait fait une demi-heure plus tôt, son vocabulaire lui faisait de plus en plus défaut. Elle utilisait un mot pour un autre ou bien ne trouvait pas la dénomination appropriée d’un objet. Elle l’avait, chaque fois, sur le bout de la langue sans parvenir à le faire émerger de son cerveau. Comme cette… cette… D’un geste rageur, Nathalie ouvrit le cahier pour découvrir le nom dont elle avait réussi à se rappeler quelques secondes auparavant. — Saleté de mandarine ! — Qu’est-ce que ce pauvre fruit a bien pu te faire ? lui lança Audrey, sur le pas de la porte du salon. Elle sursauta, ne l’ayant pas entendue arriver. La panique la submergea. Qu’allait-elle bien pouvoir inventer comme raison à son éclat de voix ? Il fallait qu’elle trouve une explication qui tienne la route, mais son cerveau avait beau tourner à plein régime, rien ne lui venait. C’est alors qu’elle remarqua l’enveloppe que la jeune femme gardait dans sa main. — Le facteur est passé ? s’étonna Nathalie. Audrey fronça les sourcils, tentant sans doute de discerner si la question de sa compagne visait ou non à détourner son attention sur autre chose que cette fichue mandarine. Elle ne pouvait pas savoir que Nathalie avait presque déjà remisé ce fruit dans un recoin de son esprit. — Je… Non, cette enveloppe ne provient pas de la boîte aux lettres, mais du congélateur. Nathalie darda sur Audrey un regard moqueur. — Tu te paies ma tête, c’est ça ? — Non. En fait, je venais justement te demander pourquoi tu avais mis ce courrier de ta mère à cet endroit quand je t’ai entendue pester contre cette mandarine. Je sais bien que les choses sont un peu tendues entre vous, mais de là à planquer sa lettre à côté des glaçons… — Ça vient de Danielle ?! Depuis le départ de sa mère de la maison familiale quand elle avait six ans, Nathalie rechignait à appeler celle-ci autrement que par son prénom. Selon elle, le mot « maman » était un terme beaucoup trop affectueux pour lui être attribué, quant à celui de « mère », elle ne le méritait tout simplement pas… Audrey hocha la tête. Le visage de Nathalie perdit de ses couleurs. Et pas seulement parce que sa mère était en cause, non. Ce qui la perturbait le plus était qu’elle se doutait bien que la présence de cette lettre dans cette cachette absurde était encore une conséquence de ses absences de plus en plus régulières. Elle avait dû la placer là sans réfléchir et l’y oublier… comme nombre de choses ces derniers mois. — Et… que dit-elle ? demanda Nathalie d’un air qu’elle voulait détaché. — Je ne l’ai pas ouverte, Nat, tu le vois bien. Je ne me serais pas permis de le faire sans ton autorisation… Mais pourquoi tu l’as mise là-dedans ? Nathalie haussa les épaules. — Je n’ai pas fait attention. J’ai dû prendre le courrier en rentrant des courses et elle se sera glissée entre deux pizzas surgelées durant le rangement, voilà tout. Elle voyait bien qu’Audrey était moyennement convaincue par sa réponse – d’autant plus qu’elle achetait rarement, voire jamais, ce genre de produits –, mais elle ne s’imaginait pas lui expliquer que chaque jour qui passait, elle perdait un peu plus d’elle-même, de ce qui composait sa vie, ses souvenirs. Dieu seul savait si elle ne finirait pas par l’oublier, elle aussi… Nathalie secoua la tête. Elle refusait d’y penser. Elle espérait au plus profond d’elle-même que ces omissions n’étaient pas dues à cette maladie neurodégénérative qui touchait habituellement les plus de soixante-cinq ans, mais n’épargnait pas pour autant les personnes de son âge, même si c’était dans une moindre mesure. Car si elle-même ne pourrait avoir conscience de ne plus reconnaître ses proches, ceux-ci en revanche en souffriraient fatalement. Audrey, Fanny… Elle ne pouvait en supporter l’idée. — Nat, ça va ? Tu es toute pâle… s’enquit sa compagne en prenant place auprès d’elle sur le canapé. — Je… Tu veux bien me dire de quoi parle Danielle dans sa lettre, s’il te plaît ? — Tu ne souhaites pas la lire toi-même ? s’étonna Audrey. — Non, je préfère que ce soit toi… Et fais-moi un résumé, ça suffira. La jeune femme hésita un instant avant d’opiner du chef et de décacheter l’enveloppe avec précaution. Elle déplia délicatement l’unique feuillet et déchiffra silencieusement le contenu du message. Nathalie observait le visage d’Audrey et s’inquiéta lorsque celle-ci fronça le nez en grimaçant. — Quoi ? — Ça ne va pas te plaire… — Qu’est-ce qu’elle dit ? Audrey lâcha un long soupir avant de déclarer : — Elle t’informe de son retour en France. Et elle doit arriver à Auxerre dans… Elle regarda sa montre. — Exactement trois heures et vingt-six minutes. — C’est une blague ?! s’exclama Nathalie en se levant d’un bond. Elle s’invite comme ça, sans même me demander mon avis et… — Elle n’a pas l’intention de loger ici, Nat. Elle a réservé une chambre d’hôtel. Nathalie sembla prise d’un soudain accès de panique, s’agitant en tous sens. — Mais… mais, elle aurait quand même pu me prévenir plus tôt ! Audrey reprit l’enveloppe entre ses mains et vérifia le cachet de la Poste. — Elle t’a envoyé cette lettre il y a plus d’un mois, mon cœur… Nathalie fixa Audrey sans rien dire. Plus d’un mois… Elle frissonna malgré elle. Tant de choses se délitaient en elle… Chapitre 3 Dire qu’Audrey était inquiète eût été un euphémisme. Elle trouvait l’attitude de Nathalie particulièrement étrange ces derniers temps. Au début, elle avait mis cela sur le compte de la fatigue due à sa charge de travail grandissante au musée dans lequel elle exerçait en tant que conservatrice du patrimoine. Une nouvelle collection allait prendre place dans une des salles récemment rénovées et Nathalie courait à droite et à gauche pour que tout soit prêt en temps voulu. Audrey connaissait elle-même très bien le milieu de l’art, étant galeriste de profession – c’était d’ailleurs lors d’une exposition qu’elle avait organisée dans sa galerie qu’elle avait rencontré Nathalie – mais ça ne pouvait suffire à expliquer l’actuel air désorienté de Nat. Celle-ci semblait totalement perdue, dépassée… Le retour de sa mère la perturbait, c’était certain, mais il y avait autre chose et Audrey ne parvenait pas à comprendre quoi. Et ce courrier trouvé dans le congélateur était, selon elle, un indice de plus de la distraction de Nathalie. Et c’est ce qui l’inquiétait. Sa compagne était plutôt le genre de femme ayant les pieds résolument ancrés sur la terre ferme et la tête sur les épaules. Elle ne se laissait pas facilement distraire. Non, ça c’était davantage la nature profonde d’Audrey : bohème, un peu rêveuse… une âme d’artiste. Mais pas Nathalie, non. Nathalie était un pilier, un roc dont rien ne pouvait venir troubler la sérénité. En temps normal, et quand la mère de celle-ci n’entrait pas dans l’équation. Là, visiblement, ce n’était pas juste un grain de sable qui enrayait le mécanisme, mais quasiment une dune. Elle ne l’avait jamais vue dans cet état. Elles avaient fait connaissance deux ans auparavant et vivaient sous le même toit depuis seulement huit mois. Nathalie avait voulu prendre son temps, être sûre. Pour elle, leur relation n’était pas une mince affaire, et pour cause… elle n’allait pas forcément de soi. En effet, quand Audrey était entrée dans la vie de Nat, celle-ci était en ménage avec… un homme. Lionel. Et leur duo ne connaissait aucune crise majeure, il était même loin de battre de l’aile. Le couple s’entendait bien, une complicité très forte les liait, mais justement… Le lien qui les attachait l’un à l’autre avait davantage les allures d’une belle amitié que celles d’un grand amour. Audrey avait su déceler cette faille quand le regard de Nathalie avait croisé le sien lors de cette fameuse exposition qui avait tout changé dans leurs vies. Au contraire d’Audrey, qui avait compris dès son plus jeune âge qu’elle préférait les femmes, Nathalie n’avait fréquenté que des hommes et n’avait jamais été attirée par quelqu’un du même sexe. C’était d’ailleurs ce qu’elle disait régulièrement à ses proches : « Quand mon cœur s’est emballé pour Audrey, ce n’est pas d’une femme dont je suis tombée amoureuse, mais d’une personne. » Nathalie avait toujours refusé d’être catégorisée, mise dans une case. Elle ne voulait pas mettre un nom sur cet amour-là. C’était une histoire comme les autres et elle s’y épanouissait. Oui, Audrey était certaine que sa compagne ne se posait désormais plus de question sur le bien-fondé de leur relation. Son ex-conjoint avait fini par accepter les choses, Nat avait même gardé de très bons rapports avec lui. Elle était heureuse. Il n’y avait qu’une seule ombre au tableau : Fanny. L’enfant née de l’union de Nathalie et Lionel. Une jeune femme de vingt et un ans pourrie gâtée qui n’appréciait pas du tout que sa mère ait rompu avec son père… et pour une femme qui plus est ! Oh, elle n’était pas homophobe, non, mais voir celle qui l’avait élevée quitter le nid familial parce qu’elle s’était amourachée de quelqu’un d’autre que ce père qu’elle idolâtrait, c’était tout bonnement incompréhensible pour elle. Mais Fanny avait l’intelligence – ou la perfidie, plutôt – de ne jamais attaquer frontalement sa mère sur le sujet. Elle préférait s’en prendre à Audrey, de façon insidieuse cependant, et jamais en présence de Nathalie. Et Audrey, refusant de mettre de l’huile sur le feu de ses relations déjà tendues avec sa « belle-fille », ne parlait jamais en mal de Fanny, passait sous silence ses petites piques bien senties qu’elle disséminait ici et là, sans en avoir l’air. Elle reconnaissait en revanche devant sa compagne que Fanny semblait ne pas l’apprécier. Nathalie lui rétorquait invariablement qu’il était normal que sa fille ait un peu de mal à se faire à la situation, mais qu’elle finirait par accepter les choses. Audrey se gardait bien de répliquer qu’elles étaient en couple depuis déjà un moment et qu’il était peut-être temps d’admettre que sa mère et son père ne se remettraient jamais ensemble. Elle pouvait concevoir qu’une enfant qui avait toujours vécu avec ses deux parents – parents qui, somme toute, s’étaient toujours bien entendus – ait du mal à faire le deuil du duo qu’ils avaient formé. Mais Fanny était une adulte. Une jeune adulte, certes, mais une adulte quand même, et son attitude relevait, selon Audrey, davantage de la contrariété que d’un réel chagrin. Audrey était l’ennemie à abattre, point. Mais celle-ci n’avait aucune envie d’entrer en guerre avec la fille de celle qu’elle aimait. Elle aurait préféré s’en faire une alliée, voire une amie. Avec ses anciennes relations amoureuses, ce conflit ne s’était jamais présenté, car elle n’avait jamais fréquenté que des femmes célibataires, sans enfant. La question d’un potentiel antagonisme filial ne s’était donc jamais posée. Elle avait plus souffert de la jalousie des ex de ses partenaires qui gardaient alors, à son grand dam, une place prépondérante dans l’existence des femmes qu’elle avait aimées… Aux côtés de Nathalie, elle savait qu’elle n’avait rien à craindre sur ce point. Celle-ci n’éprouvait plus d’amour pour son ancien compagnon, juste de la tendresse et un profond respect. Mais cette aversion certaine de Fanny envers elle la contrariait. Car s’il y avait bien une chose dont Audrey avait conscience, c’était que Nathalie aimait sa fille plus que tout et qu’elle ne tirerait rien de bon à tenter de lui montrer le véritable visage de Fanny…
 Sujets récents
Sujets récents
|



















 Messages récents
Messages récents